202187 Saintleger
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
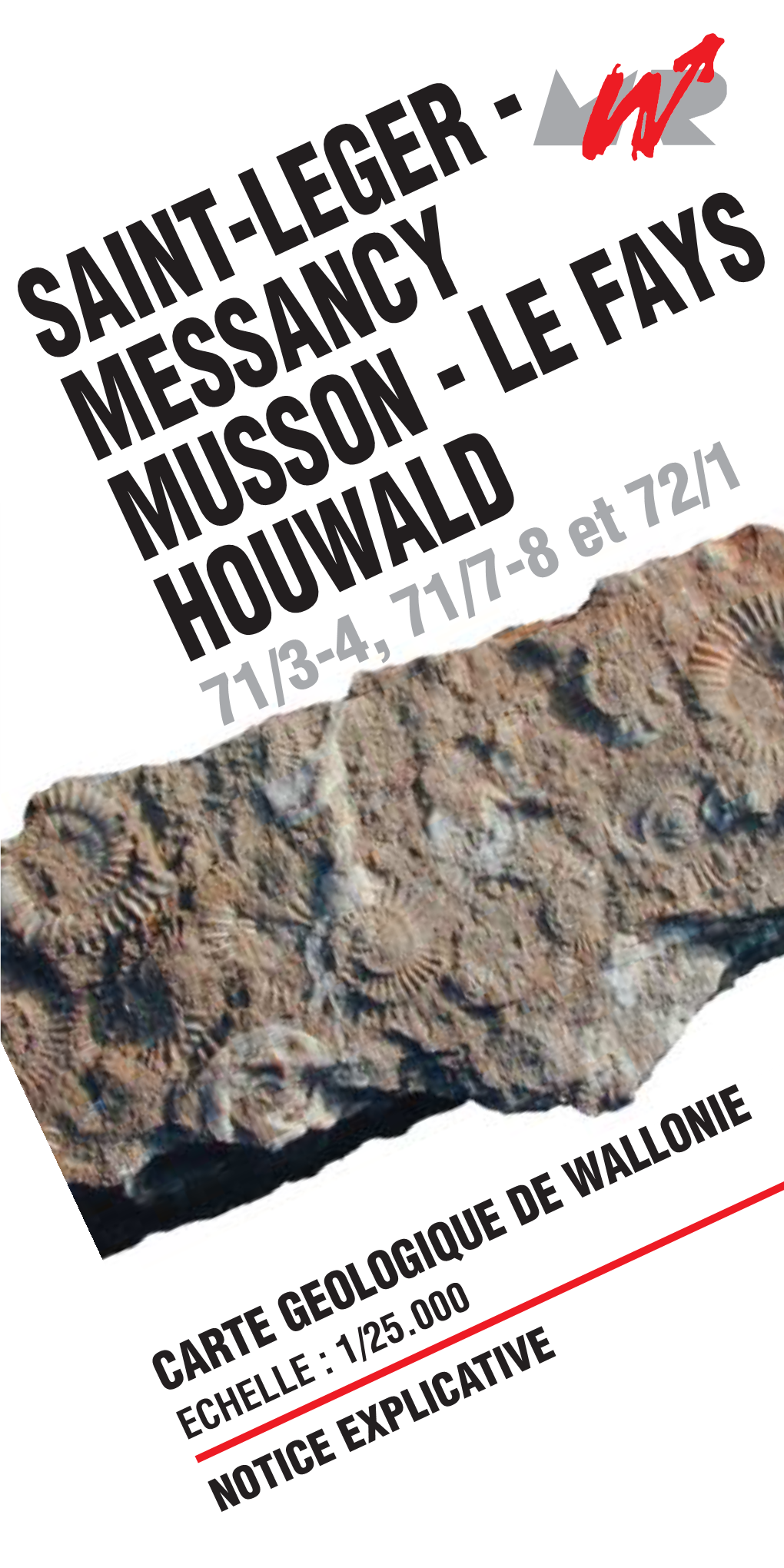
Load more
Recommended publications
-
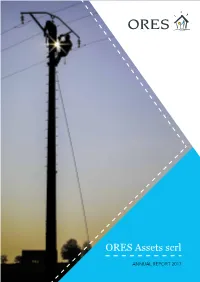
ORES Assets Scrl
ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 1 TABLE OF ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 CONTENTS I. Introductory message from the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer p.4 II. ORES Assets consolidated management report p.6 Activity report and non-financial information p.6 True and fair view of the development of business, profits/losses and financial situation of the Group p.36 III. Annual financial statements p.54 Balance sheet p.54 Balance sheet by sector p.56 Profit and loss statement p.60 Profit and loss statement by sector p.61 Allocations and deductions p.69 Appendices p.70 List of contractors p.87 Valuation rules p.92 IV. Profit distribution p.96 V. Auditor’s report p.100 VI. ORES scrl - ORES Assets consolidated Name and form ORES. cooperative company with limited liability salaries report p.110 VII. Specific report on equity investments p.128 Registered office Avenue Jean Monnet 2, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium. VIII. Appendix 1 point 1 – List of shareholders updated on 31 December 2017 p.129 Incorporation Certificate of incorporation published in the appen- dix of the Moniteur belge [Belgian Official Journal] on 10 January 2014 under number 14012014. Memorandum and articles of association and their modifications The memorandum and articles of association were modified for the last time on 22 June 2017 and published in the appendix of the Moniteur belge on 18 July 2017 under number 2017-07-18/0104150. 2 3 networks. However, it also determining a strategy essen- Supported by a suitable training path, the setting up of a tially hinged around energy transition; several of our major "new world of work" within the company should also pro- business programmes and plans are in effect conducted to mote the creativity, agility and efficiency of all ORES’ active succeed in this challenge with the public authorities, other forces. -

Planning Nmaw 2020 - 2024
PLANNING NMAW 2020 - 2024 BEAUVECHAIN BASSENGE COMINES-WARNETON FLOBECQ GREZ-DOICEAU HELECINE VISE MOUSCRON MONT-DE-L'ENCLUS LA HULPE PLOMBIERES LA CALAMINE JODOIGNE OREYE OUPEYE DALHEM ELLEZELLES RIXENSART LINCENT JUPRELLE LESSINES WAVRE CRISNEE ESTAIMPUIS AUBEL CELLES WATERLOO BERLOZ WAREMME AWANS ORP-JAUCHE PECQ TUBIZE INCOURT REMICOURT HERSTAL LONTZEN FRASNES-LEZ-ANVAING ENGHIEN LASNE BLEGNY BRAINE-LE-CHATEAU CHAUMONT-GISTOUX ANS RAEREN REBECQ GEER THIMISTER-CLERMONT WELKENRAEDT OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE HANNUT FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER RAMILLIES HERVE BRAINE-L'ALLEUD DONCEEL ATH SILLY FAIMES SOUMAGNE ITTRE GRACE-HOLLOGNE MONT-SAINT-GUIBERT PERWEZ SAINT-NICOLAS LIEGE BEYNE-HEUSAY TOURNAI COURT-SAINT-ETIENNE WALHAIN WASSEIGES FLERON DISON LIMBOURG EUPEN BRAINE-LE-COMTE BRAIVES GENAPPE VERLAINE BRUGELETTE SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE OLNE LEUZE-EN-HAINAUT NIVELLES FLEMALLE VILLERS-LE-BOUILLET SERAING VERVIERS BAELEN EGHEZEE BURDINNE CHAUDFONTAINE CHASTRE PEPINSTER CHIEVRES LENS SOIGNIES TROOZ ANTOING ECAUSSINNES VILLERS-LA-VILLE ENGIS AMAY GEMBLOUX FERNELMONT WANZE RUMES SENEFFE NEUPRE HERON ESNEUX JALHAY BRUNEHAUT PERUWELZ BELOEIL JURBISE LES BONS VILLERS LA BRUYERE SPRIMONT HUY SOMBREFFE NANDRIN THEUX PONT-A-CELLES LE ROEULX SAINT-GHISLAIN MANAGE ANDENNE ANTHISNES FLEURUS COMBLAIN-AU-PONT TINLOT SPA BERNISSART MODAVE WAIMES LA LOUVIERE COURCELLES MARCHIN BUTGENBACH AYWAILLE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT JEMEPPE-SUR-SAMBRE NAMUR MONS MORLANWELZ SAMBREVILLE OUFFET MALMEDY QUAREGNON HAMOIR HENSIES FARCIENNES FLOREFFE OHEY BOUSSU GESVES STAVELOT CHARLEROI -

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS Sites Semi-Naturels Et Naturels En Ville D’Aubange
2021 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS Sites semi-naturels et naturels en Ville d’Aubange Au seuil de cette nouvelle année, le Syndicat d’Initiative d’Aubange vous présente ses meilleurs vœux. Ce calendrier est un outil que vous aurez à cœur d’utiliser et de conserver précieusement. Le syndicat d’initiative remercie les annonceurs et les associations qui ont contribué à sa réalisation. Il remercie également G. Schmidt, A. Remacle et C. Waltener pour la mise à disposition des photos, ainsi que le service infographie de la Ville d’Aubange pour la mise en page. Editeur responsable : Christian Binet SYNDICAT D’INITIATIVE D’AUBANGE Rue de Clémarais 28 A, B-6790 AUBANGE [email protected] - www.visitaubange.be Les manifestations présentées peuvent être modifiées, reportées ou annulées en fonction des restrictions gouvernementales en vi- gueur (voir notre site internet). L’orée du bois Le Chenoi et son vallon bocager donnant sur Rachecourt (zone d’intérêt paysager) JANVIER | Les Griechten à Guerlange, colonisés par des saules, ravins étroits où s’écoulent les eaux pluviales 1 vendredi 2 samedi 3 dimanche 4 lundi Prise de commande de 09 à 11h 5 mardi Aubange : Club de marche « La Fourmi » et S.I. AUBANGE : Promenade « Rando-Dé- Ouvert du lundi au samedi de 10h à 15h couverte », Willancourt, 10 km, départ place abbé Michel Gigi, à 13h30. 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi Battincourt : Harmonie Royale « Les Échos de la Batte » : Reprise des répétitions HREB. Aubange : Chorale « Les Choeurs de Lorraine » : Reprise des répétitions à 20h15. 9 samedi 10 dimanche Aix-sur-Cloie : Service Cohésion sociale : « Repair café » à la maison de quartier, rue Reiffenberg de 9h à 12h. -

Bataille Des Frontières
vers Liège Province de Liège Houmart Les villages martyrs : Bende-Jenneret Borlon Ozo Izier Fonds Tijenke Dagnelie Tijenke Fonds [email protected] Bomal Tohogne ©Archives de l’État à Arlon, Arlon, à l’État de ©Archives Palenge Sabine Vandermeulen, Directreur FTLB Directreur Vandermeulen, Sabine Entre le 21 et le 26 août, plus de 867 civils sont exécutés en Neufchâteau, Rendeux Neufchâteau, Villers-Saint-Gertrude Harre Editeur responsable : responsable Editeur Luxembourg belge, près de 1000 si l’on compte les défunts des vers Liège vers ©Communes : Manhay, Manhay, : ©Communes ème ème Septon Libramont DurbuyDurbuy zones frontières. Les massacres sont perpétrés par la 4 et la 5 Barvaux-Sur-Ourthe ème Heyd © Office de tourisme : : tourisme de Office © armées allemandes (la 3 au Nord). Ces cruautés témoigneraient Marche-Nassogne, Gaume Marche-Nassogne, du mythe allemand de l’existence de « francs tireurs » contre lesquels Chêne-al-Pierre www.luxembourg-tourisme.be Vielsalm-Gouvy, Saint-Hubert, Saint-Hubert, Vielsalm-Gouvy, Wéris il fallait sévir immédiatement pour protéger les troupes. Ils voyaient Petit-Han Grand-Talleux Ourthe et Aisne, Aisne, et Ourthe Fax : +32 (0)84/412 439 (0)84/412 +32 : Fax Grandhan Mormont ©Maisons du tourisme : : tourisme du ©Maisons en chaque habitant (femme, vieillard, enfant) un tireur potentiel. Les Biron Oppagne Fanzel Tél.: +32 (0)84/411 011 (0)84/411 +32 Tél.: Province Neufchâteau, Libin Libin Neufchâteau, « atrocités allemandes» désignent aussi les destructions volontaires Petit-Thier ©J.Brisy, ©Cercles historiques : : historiques ©Cercles ©J.Brisy, 6980 La Roche-en-Ardenne La 6980 le Pays d’Ourthe & Aisne des villages, les exécutions de prisonniers, les pillages et les Bruxelles de Namur ©P.Dumont, ©G.Fairon, ©G.Fairon, ©P.Dumont, Quai de l’Ourthe, 9 l’Ourthe, de Quai nombreux otages déportés dans les camps. -

29 Mai 1973 Arrêté Royal Soustrayant Le Territoire De Certaines Communes À L'application De L'article 8 De L'arrêté Royal D
29 mai 1973 Arrêté royal soustrayant le territoire de certaines communes à l'application de l'article 8 de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables Deux arrêtés royaux, respectivement du 29 mai 1973 et du 24 janvier 1974, pris en vertu de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables, article 8, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1972, soustraient le territoire des communes mentionnées ci-dessous à l'application dudit article 8. Province de Liège arrondissement de Huy: Ben-Ahin, Boiset-Borsu, Clavier, Comblain-Fairon, Ernonheid, Ferrières, Hamoir, Harzé, Huccorgne, Landenne, Lavoir, Les Avins, Lorcé, Marchin, Nandrin, Ocquier, Oteppe, Ouffet, Pailhe, Poulseur, Seilles, Seny, Tavier, Terwagne, Vierset-Barse, Vieuxville, Vyle-et-Tharoul, Waret-l'Evêque, Warnant- Dreye, Werbomont et Xhoris; arrondissement de Liège: Ayeneux, Aywaille, Beaufays, Cerexhe-Heuseux, Chaudfontaine, Dalhem, Dolembreux, Fléron, Forêt, Louveigné, Melen, Micheroux, Mortier, Saint-André, Saint-Remy et Saive; arrondissement de Verviers: Amblève, Aubel, Baelen, Basse-Bodeux, Battice, Bellevaux-Ligneuville, Bevercé, Bilstain, Bolland, Bra, Bullange, Butgenbach, Chaineux, Chevron, Clermont, Crombach, Dison, Elsenborn, Eupen, Eynatten, Francorchamps, Gemmenich, Grand-Rechain, Henri-Chapelle, Heppenbach, Hombourg, Jalhay, Julémont, Kettenis, La Gleize, Lierneux, Lommersweiler, Lontzen, Malmédy, Manderfeld, Meyerode, Montzen, Moresnet, Neufchâteau, Olne, Pepinster, Polleur, Raeren, Rahier, Recht, Reuland, Rocherath, Saint-Vith, Sart, Schoenberg, Soiron, Spa, Stavelot, Stembert, Stoumont, Theux, Thimister, Thommen, Trois-Ponts, Waimes, Walhorn, Wegnez, Welkenraedt et Xhendelesse; arrondissement de Waremme: Berloz, Corswarem, Darion, Donceel, Fumal, Haneffe, Lens-Saint-Servais, Limont et Lincent; Province de Limbourg arrondissement de Tongres: Bovelingen et Fouron-le-Comte; En vigueur du 31/05/74 au .. -

Using Geographically Weighted Poisson Regression to Examine the Association Between Socioeconomic Factors and Hysterectomy Incidence in Wallonia, Belgium
Using Geographically Weighted Poisson Regression to Examine the Association Between Socioeconomic Factors and Hysterectomy Incidence in Wallonia, Belgium Aline Clara Poliart ( [email protected] ) ULB École de Santé Publique: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique https://orcid.org/0000-0003-1510-0648 Fati Kirakoya-Samadoulougou ULB École de Santé Publique: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Mady Ouédraogo ULB School of Public Health: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Philippe Collart ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Dominique Dubourg ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Sékou Samadoulougou ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Research article Keywords: geographically weighted Poisson regression, Wallonia, hysterectomy, socioeconomic factors Posted Date: May 11th, 2021 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-505108/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License 1 Using geographically weighted Poisson regression to examine the 2 association between socioeconomic factors and hysterectomy 3 incidence in Wallonia, Belgium 4 Aline Poliart1, Fati Kirakoya-Samadoulougou1, Mady Ouédraogo1, Philippe Collart1,2, Dominique 5 Dubourg2, Sékou Samadoulougou 3,4 6 1 Centre de Recherche en Epidémiologie, Biostatistiques et Recherche Clinique, Ecole de Santé 7 Publique, Université Libre de Bruxelles, 1070 Brussels, Belgium; [email protected] (AP); 8 [email protected] (MO); [email protected] (PC) ; [email protected] (FKS) 9 2 Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), 6061 Charleroi, Belgium ; [email protected] 10 (PC), [email protected] (DD) 11 3 Evaluation Platform on Obesity Prevention, Quebec Heart and Lung Institute, Quebec, QC, G1V 12 4G5, Canada; [email protected] (SS). -

Equipes-Inscrites-Par-Division.Pdf
I II dinez B aye d les castors a Jamoigne A Biermonfoy A libramont b selange a bras a meix a tenneville A chatillon b meix b CENTRE ARDENNE B fays-les-veneurs a melreux b CHENE-AL'PIERRE A gouvy a ourthoise a joubieval a hachy a Rulles B virton b halanzy-musson a schoppach-arlon b schoppach-arlon a halanzy-musson b selange b TILLET A jamoigne b tenneville b Rulles A joubieval b tillet b marloie b lafosse a III athus b hondelange a ourthoise b aye e jamoigne c rulles c aye f joubieval c rulles d basse semois a joubieval d sainlez a beausaint a les castors b schoppach-arlon c Biermonfoy b les castors c selange c bouillon c libramont c tenneville c centre ardenne c lomme a tillet c chene-al'pierre b longchamps a tt saint pierre a dinez c longchamps b ttc famenne a dinez d marloie c villers a dinez e marloie d villers b fays-les-veneurs b melreux c virton c hachy b messancy a virton d hachy c ochamps a wellin a IV attert a chene-al'pierre c lafosse b montleban a selange d aye g devantave a langlire a ochamps b selange e aye h dinez f les castors d ourthoise c sibret a basse semois b dinez g libramont d palette centre a sibret b bastogne a dinez h lomme b petit-thier a tenneville d beausaint b gouvy b longchamps c rulles e tillet d Biermonfoy c hachy d longchamps d rulles f tt saint pierre b bouillon d halanzy-musson c longchamps e sainlez b tt saint pierre c bras b halanzy-musson d marloie e saint hubert a ttc famenne b centre ardenne D hondelange b meix c saint hubert b villers c centre ardenne e jamoigne d meix d schoppach-arlon D villers -

Analyse Des Résultats Des Élections 2019
Analyse des résultats des élections fédérales et régionales du 26 mai 2019 Un travail du CIEP, Centre d’Information et d’Éducation Populaire du MOC Luxembourg Juillet 2019 2 MOC Luxembourg Table des matières 1. Élections à la Chambre : les résultats ..................................................................... 5 1.1 Les résultats en pourcentages ........................................................................................... 5 A. Les partis francophones ................................................................................................. 5 B. Les partis flamands ......................................................................................................... 7 C. Quelle place pour l’extrême droite en Belgique ? .......................................................... 8 1.2 Les résultats en sièges....................................................................................................... 9 1.3 Les résultats dans la Province de Luxembourg .............................................................. 11 A. Quelle place pour l’extrême droite dans la province ? ................................................. 13 1.4 Quels gouvernements possibles ? ................................................................................... 14 2. Élections au Parlement Wallon : les résultats ...................................................... 15 2.1 Les résultats en pourcentages ......................................................................................... 15 A. Quelle place pour l’extrême -

Staatsblad Moniteur
Annexe 1re — Détermination des zones de soins en assuétudes Zone 01 Mouscron-Tournai-Ath Antoing, Ath, Belœil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaim- puis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l’Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai. Zone 02 La Louvière Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Rœulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies. Zone 03 Brabant Beauvechain, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre. Zone 04 Huy-Waremme Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut- Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges. Zone 05 Liège Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé. Zone 06 Verviers Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt. Zone 07 Mons Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain. Zone 08 Charleroi Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l’Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montignies-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin. -

731 Bus Dienstrooster & Lijnroutekaart
731 bus dienstrooster & lijnkaart 731 Athus Ecoles →Saint-Leger Rue du 5 Septembre Bekijken In Websitemodus De 731 buslijn (Athus Ecoles →Saint-Leger Rue du 5 Septembre) heeft 3 routes. Op werkdagen zijn de diensturen: (1) Athus Ecoles →Saint-Leger Rue du 5 Septembre: 16:06 (2) Messancy Ecole Primaire →Saint-Leger Rue du 5 Septembre: 11:40 (3) Saint-Leger Rue du 5 Septembre →Athus Ecoles: 07:00 Gebruik de Moovit-app om de dichtstbijzijnde 731 bushalte te vinden en na te gaan wanneer de volgende 731 bus aankomt. Richting: Athus Ecoles →Saint-Leger Rue du 5 731 bus Dienstrooster Septembre Athus Ecoles →Saint-Leger Rue du 5 Septembre 58 haltes Dienstrooster Route: BEKIJK LIJNDIENSTROOSTER maandag Niet Operationeel dinsdag 16:06 Athus Ecoles Rue Neuve, Athus woensdag 13:00 Athus Rue Houillon donderdag 16:06 38 Rue Houillon, Athus vrijdag 16:06 Athus Centre - Rue Houillon zaterdag Niet Operationeel N 88, Athus zondag Niet Operationeel Athus Grand Rue Athus Gare Athus Clinique 731 bus Info Route: Athus Ecoles →Saint-Leger Rue du 5 Aubange Rue D'Athus Septembre 21 Rue d'Athus, Aubange Haltes: 58 Ritduur: 61 min Aubange Rue du Village Samenvatting Lijn: Athus Ecoles, Athus Rue 35 Rue du Village, Aubange Houillon, Athus Centre - Rue Houillon, Athus Grand Rue, Athus Gare, Athus Clinique, Aubange Rue Aubange Place D'Athus, Aubange Rue du Village, Aubange Place, 3 Rue du Village, Aubange Aubange Rue De Messancy 70, Aubange Rue De Messancy 120, Messancy La Hart, Messancy Avenue Aubange Rue De Messancy 70 De Longwy, Messancy Clinique, Messancy Ecole -

Le Marche Immobilier Dans La Province Du Luxembourg En 2010
LE MARCHE IMMOBILIER DANS LA PROVINCE DU LUXEMBOURG EN 2010 LE MARCHE IMMOBILIER DANS LA PROVINCE DU LUXEMBOURG EN 2010 Les Notaires de la Province de Luxembourg comparent et mettent en commun leurs données statistiques depuis maintenant 7 ans. Jusqu’en 2007, les prix montaient sans arrêt. Il suffisait de chiffrer cette hausse En 2008, nous avions conclu à un « ATTERISSAGE EN DOUCEUR », avec une baisse de 5 à 7% selon le type de biens, cette baisse limitée résultant des bons résultats du 1er semestre 2008 par rapport aux mauvais résultats du 2ème semestre. En 2009, on enregistrait encore un léger recul de 0,4 % par rapport à 2008, selon le baromètre notarial. 2 Les tendances générales du marché immobilier en 2010 Le marché vu par les notaires De l’analyse des réponses des notaires de la Province de Luxembourg, on peut résumer la tendance générale de 2010 de la façon suivante : Après un nouveau tassement des prix en 2009, on constate une hausse générale plus ou moins forte selon les communes en 2010 ; très peu de communes voient leur prix baisser ; même lorsque c’est le cas, il s’agit de baisses légères. Le volume des ventes est également en hausse ; après un premier semestre assez laborieux, on a connu une belle envolée du nombre de ventes au second semestre, si bien que l’on peut parler d’une fin d’année sur les chapeaux de roues ! Les transactions sont assez rapides dès lors que les prix sont raisonnables. Cependant, trop de biens présentés à des prix excessifs encombrent encore le marché, donnant à certains endroits l’image fausse d’un marché en repli. -

Messancy Sera Coloré Cet Été ! Bébange | Buvange | Differt | Guelff Habergy | Hondelange | Longeau | Messancy Pages 16 À 19 Sélange | Turpange | Wolkrange 2 Sommaire
Bulletin communal Juin 2019 Messancy sera coloré cet été ! Bébange | Buvange | Differt | Guelff Habergy | Hondelange | Longeau | Messancy Pages 16 à 19 Sélange | Turpange | Wolkrange 2 Sommaire COMMUNE DE MESSANCY CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE 100, rue Grande - 6780 MESSANCY Route d'Arlon, 48 - 6780 MESSANCY www.messancy.be Service Population : 063/44 01 20 ou 22 Tous les jours ouvrables 063/38 18 90 Service Urbanisme : 063/44 01 23 ou 26 de 8h15 à 12h00 et de 13h15 à 16h30 Service Etat Civil : 063/44 01 24 ou 25 Le samedi de 9h00 à 11h00 Service Finances : 063/44 01 29 Culture et communication : 063/24 52 90 Service urbanisme : 063/38 18 99 Fermé les mardis, mercredis et jeudi matin. Le mecredi après-midi sur RDV uniquement. 063/38 34 15 Tous les jours ouvrables de 9h00 à 11h30 et sur rendez-vous. Imprimé - 3500 exemplaires • Conception et impression - Lorgé Imprimeur Echevin de la communication - Jean-Raymond Lichtfus • Coordination - Vanessa Rossignon Crédit photos : L'Avenir de Luxembourg et La Meuse Luxembourg CITOYENNETÉ 3 NOS JOIES, NOS PEINES... Naissances 15.01 KOHL Kylia, fille de Steve et CAMBRESY Gwenaëlle, Messancy 18.01 KAUTEN Rose, fille de Gaëtan et LUTGEN Mandy, Differt 25.01 ADAM Nejma, fille de Cynthia, Hondelange 01.02 BERNARD Juliette, fille de Alexis et DE CIA Laura, Sélange 19.02 SAINT-AMAND Thibaut, fils de Yannick et DUBRU Magali, Messancy 01.03 JACOB Hanna, fille de Jonathan et PONCET Hélène, Messancy 02.03 SON Nora, fille de Pierre-Etienne et DANHYER Hélène, Differt 03.03 KOANDA Issa, fils de Issaka et