Rapport D'enquête De Base Du Projet PADIN
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Central & Northern Mali Emergency Response
CENTRAL & NORTHERN MALI EMERGENCY RESPONSE SITUATION REPORT | SEPTEMBER, 2019 Mali Response To Remain Category III June 2019 to 168,515, by 8 August, the majority of them National Office Response from Mopti and Segou regions. UN Hosts High-Level Meeting on Mali and • A total of 81,338 people are at risk of flooding, with78,115 the Sahel Highlights A World Vision Declaration Decision Group (DDG), that already affected. Stronger precipitations are expected, while On September 25th 2019, the United Nations hosted a high-lev- discusses the magnitude of each humanitarian emergency, the level of Niger river may rise as waters are released from making decisions on categorization, has reviewed the Cen- el meeting on Mali and the Sahel at the United Nations General dams in Guinea and Mali. Assembly. The meeting was opened by the Secretary-General tral and Northern Mali Emergency Response (CNMER). Its • Reports reveal that 920 schools remained closed at the end resolution, the Central and Northern Mali Emergency of the United Nations, Mr. António Guterres, together with the of the school year. Of these, 598 were in the Mopti region, President of the Republic of Mali, H.E. Mr. Ibrahim Boubacar Response remains a Category Three National Office affecting 276,000 children. Response. Keïta, among other Heads of State and dignitaries. • A total of 650,000 people are expected to be at risk of severe Participants discussed the implementation of the Agreement for This is because of the magnitude of the crisis that has over food insecurity and livelihood compared to 416,000 initially, Peace and Reconciliation in Mali, originating from the Algiers 3.9 million people affected by the emergency. -

Cultural Impacts of Tourism: the Ac Se of the “Dogon Country” in Mali Mamadou Ballo
Rochester Institute of Technology RIT Scholar Works Theses Thesis/Dissertation Collections 2010 Cultural impacts of tourism: The ac se of the “Dogon Country” in Mali Mamadou Ballo Follow this and additional works at: http://scholarworks.rit.edu/theses Recommended Citation Ballo, Mamadou, "Cultural impacts of tourism: The case of the “Dogon Country” in Mali" (2010). Thesis. Rochester Institute of Technology. Accessed from This Thesis is brought to you for free and open access by the Thesis/Dissertation Collections at RIT Scholar Works. It has been accepted for inclusion in Theses by an authorized administrator of RIT Scholar Works. For more information, please contact [email protected]. CULTURAL IMPACTS OF TOURISM: The case of the “Dogon Country” in Mali A Thesis presented to the faculty in the College of Applied Science and Technology School of Hospitality and Service Management at Rochester Institute of Technology By Mamadou Ballo Thesis Supervisor Richard Rick Lagiewski Date approved:______/_______/_______ February 2010 VâÄàâÜtÄ \ÅÑtvàá Éy gÉâÜ|áÅM vtáx Éy WÉzÉÇá |Ç `tÄ| TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1 Abstract…………………………………………………..……….………………………………7 Introduction…………………………………………………………..……………………………9 1.1. Background: overview of tourism in Mali…………………….….…..………………………9 1.2. Purpose of the study…………………………………………………...………….…………13 1.3. Significance of the study………………………..……………………...……………………13 1.4. Definition of key terms…………………………………………………...…………………14 CHAPTER 2 Literature Review…………………………………….……….………….………………………15 CHAPTER 3 Methodology……………………………….……………………………………………………28 3.1. Description of the sample………………………...…………………………………………29 3.2. Language…………….…………………………...………………………….………………30 3.3. Scope and limitations……………………...……………………………...…………………30 3.4. Weakness of the study………………………..…………………………….………………30 3.5. Research questions …………………………………..……………………..………………30 CHAPTER 4 Results analysis…………………………………………………………………………………..31 CHAPTER 5 Conclusions and Recommendations …………….………………………………………………56 5.1. Major findings …………………………...….………………………………………………56 5.2. -

M700kv1905mlia1l-Mliadm22305
! ! ! ! ! RÉGION DE MOPTI - MALI ! Map No: MLIADM22305 ! ! 5°0'W 4°0'W ! ! 3°0'W 2°0'W 1°0'W Kondi ! 7 Kirchamba L a c F a t i Diré ! ! Tienkour M O P T I ! Lac Oro Haib Tonka ! ! Tombouctou Tindirma ! ! Saréyamou ! ! Daka T O M B O U C T O U Adiora Sonima L ! M A U R I T A N I E ! a Salakoira Kidal c Banikane N N ' T ' 0 a Kidal 0 ° g P ° 6 6 a 1 1 d j i ! Tombouctou 7 P Mony Gao Gao Niafunké ! P ! ! Gologo ! Boli ! Soumpi Koulikouro ! Bambara-Maoude Kayes ! Saraferé P Gossi ! ! ! ! Kayes Diou Ségou ! Koumaïra Bouramagan Kel Zangoye P d a Koulikoro Segou Ta n P c ! Dianka-Daga a ! Rouna ^ ! L ! Dianké Douguel ! Bamako ! ougoundo Leré ! Lac A ! Biro Sikasso Kormou ! Goue ! Sikasso P ! N'Gorkou N'Gouma ! ! ! Horewendou Bia !Sah ! Inadiatafane Koundjoum Simassi ! ! Zoumoultane-N'Gouma ! ! Baraou Kel Tadack M'Bentie ! Kora ! Tiel-Baro ! N'Daba ! ! Ambiri-Habe Bouta ! ! Djo!ndo ! Aoure Faou D O U E N T Z A ! ! ! ! Hanguirde ! Gathi-Loumo ! Oualo Kersani ! Tambeni ! Deri Yogoro ! Handane ! Modioko Dari ! Herao ! Korientzé ! Kanfa Beria G A O Fraction Sormon Youwarou ! Ourou! hama ! ! ! ! ! Guidio-Saré Tiecourare ! Tondibango Kadigui ! Bore-Maures ! Tanal ! Diona Boumbanke Y O U W A R O U ! ! ! ! Kiri Bilanto ! ! Nampala ! Banguita ! bo Sendegué Degue -Dé Hombori Seydou Daka ! o Gamni! d ! la Fraction Sanango a Kikara Na! ki ! ! Ga!na W ! ! Kelma c Go!ui a Te!ye Kadi!oure L ! Kerengo Diambara-Mouda ! Gorol-N! okara Bangou ! ! ! Dogo Gnimignama Sare Kouye ! Gafiti ! ! ! Boré Bossosso ! Ouro-Mamou ! Koby Tioguel ! Kobou Kamarama Da!llah Pringa! -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -
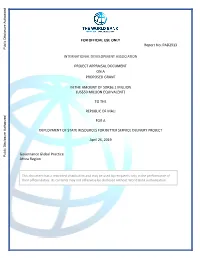
Decentralization in Mali ...54
FOR OFFICIAL USE ONLY Report No: PAD2913 Public Disclosure Authorized INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A PROPOSED GRANT IN THE AMOUNT OF SDR36.1 MILLION (US$50 MILLION EQUIVALENT) TO THE Public Disclosure Authorized REPUBLIC OF MALI FOR A DEPLOYMENT OF STATE RESOURCES FOR BETTER SERVICE DELIVERY PROJECT April 26, 2019 Governance Global Practice Public Disclosure Authorized Africa Region This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. Public Disclosure Authorized CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective March 31, 2019) Currency Unit = FCFA 584.45 FCFA = US$1 1.39 US$ = SDR 1 FISCAL YEAR January 1 - December 31 Regional Vice President: Hafez M. H. Ghanem Country Director: Soukeyna Kane Senior Global Practice Director: Deborah L. Wetzel Practice Manager: Alexandre Arrobbio Task Team Leaders: Fabienne Mroczka, Christian Vang Eghoff, Tahirou Kalam SELECTED ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AFD French Development Agency (Agence Française de Développement) ANICT National Local Government Investment Agency (Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales) ADR Regional Development Agency (Agence Regionale de Developpement) ASA Advisory Services and Analytics ASACO Communal Health Association (Associations de Santé Communautaire) AWPB Annual Work Plans and Budget BVG Office of the Auditor General ((Bureau du Verificateur) CCC Communal Support -

Section 2 : Informations Clés 3
Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) Mission Mali Bamako 22/04/2021 Notre référence : NRC/BKO/04/2021/006 OBJET : APPEL D’OFFRES POUR FOURNITURES DE KITS D’ASSISTANCE D’URGENCE DANS LES REGIONS DE SEGOU, MOPTI, TOMBOUCOU, TAOUDENIT, GAO, MENAKA ET KIDAL. Cher / Chère M. / Mme En réponse à votre demande du cahier de charge pour l’appel d’offres susmentionné, nous vous adressons ci-joint les documents constitutifs du dossier d’appel d’offre. Les éventuelles demandes de précision doivent être adressées par écrit à NRC au moins 4 jours avant la date limite de soumission des offres. NRC répondra à ces demandes au moins 2 jours avant la date limite de soumission des offres. Les frais engagés par le soumissionnaire pour préparer et soumettre ses propositions ne seront pas remboursés. Nous attendons avec intérêt de recevoir votre offre, aux adresses de NRC précisée dans les Informations clés du présent Dossier d’Appel d’Offre en pièce jointe avant le Mardi 18 Mai 2021 à 15h00mn comme indiqué dans l’avis de marché. Si vous décidez de ne pas présenter d’offre, nous vous prions de bien vouloir nous en informer par écrit en précisant les motifs de votre décision. Bien cordialement, Fatouma Hassan NRC Logistics Manager Le présent dossier contient les documents suivants : A compléter par NRC 1. La présente lettre d’accompagnement 2. Section 2 : Informations clés 3. Section 3 : Conditions générales de l’appel d’offres 4. Section 4 : Clauses techniques A compléter par le soumissionnaire 5. Section 5 : Acte d’engagement 6. Section 6 : Compléments d’information sur les produits SECTION 2 Informations clés 1. -

RAPPORT Evaluation Rapide De Protection De Djenné (Village De Sare-Hére Et Dankoussa)
RAPPORT Evaluation Rapide de Protection de Djenné (Village de Sare-Hére et Dankoussa) Dernière mise 30/04/2021 à jour Dates de l’ERP 23 au 25/04/2021 Site de Djenne Région de : Mopti Cercle de : Mopti Commune de : Soye, Village de : Sare-Hére, Néou, Megou, et Laanawoye Localités affectées Site de Sofara/Diaba-Peulh Région de : Mopti Cercle de : Djenné Commune de : Fakala Village de : Dankoussa, Moupan, Saré-Hére. Lors de cette évaluation rapide de protection, l’équipe a pu observer la présence des personnes déplacées de plusieurs villages sur les sites de déplacement à Djenné, Sofara et Diaba-Peulh. Il faut noter que pour des raisons de sécurité et d’accès des équipes à tous les sites cités dans l’alerte, l’évaluation a seulement concerné les déplacés de Sare-Hére à Djenne et ceux Dankoussa à Sofara et Diaba-Peulh. Par contre, les villages de Moupan, Gnirigara, Nantinorén, Manga Peulh, Marebougou, Latitude : N 13°54’17,19432’’ Mégou, Méou, Natino, Koroboro ; Siman-Bambara, Koyena ; Gagnan-Koïna, Siman-Togo et Djombougou n’ont pu être visités. Longitude : O 4°33’48,99312’’ Populations Altitude :280,98m affectées Selon les informations recueillies lors des échanges avec les participants des groupes de discussions et Précision : 96m les informateurs clés du village de Sare-Hére, les PDI de Sare-Hére sur le site d’accueil de Djenné sont estimées à 193 personnes dont 43 hommes, 42 femmes et 108 enfants dont 53 garçons et 55 filles. Sur le site d’accueil de Sofara et Diaba-Peulh, les participants des groupes de discussions et les informateurs clés ont estimé les PDI de Dankoussa à 336 personnes dont 71 hommes et 131 femmes et 134 enfants dont 65 garçons et 69 filles. -

Connaissance Du Fleuve, Évolution Et Indicateurs
Avenir du fleuve Niger Chapitre 3 – L. D IARRA , A. F OFANA , P. G IVONE , et al. © IRD éditions 2007 CHAPITRE 3 Connaissance du fleuve, évolution et indicateurs Lassine DIARRA , Almoustapha FOFANA , PIERRICK GIVONE Housseini MAÏGA , Pierre MORAND , Didier ORANGE , Pierre Sibiri TRAORÉ , Avertissement méthodologique : prévision saisonnière, couplage de modèles et gestion intégrée des bassins versants Introduction La modélisation procure des outils dont l’usage se généralise fortement, en particulier dans le domaine des sciences et techniques pour l’environnement. De nombreux modèles sont désormais sortis du champ historique de la résolution numérique des lois de comportement gouvernant nombre de processus physiques (modèles basés sur la résolution de systèmes d’équations différentielles partielles), en particulier dans les domaines de l’hydrologie, de l’hydraulique, du transport solide…, ceci au sens le plus large. De type encore très différent et plus globale, la modélisation stochastique et statistique, ou « individu-centré », fait également partie du quotidien (ou presque) du chercheur, de l’ingénieur et du technicien, et ceci dans les domaines les plus variés incluant, bien entendu, les sciences de l’univers et les sciences de la vie mais aussi les sciences de l’homme et de la société. Le couplage de modèles, là encore au sens le plus large et tous types confondus, se généralise, ceci pour produire des éléments 193 Avenir du fleuve Niger Chapitre 3 – L. D IARRA , A. F OFANA , P. G IVONE , et al. © IRD éditions 2007 d’analyse et d’aide -

ACTED DRPC Carte Evaluation
Mali - Région de Ségou et Mopti Pour usage humanitaire uniquement Evaluation rapide post inondation - Aout 2013 Date de prodution : 29 08 2013 Diondori Diondori Diabaly Togoro Kotia Sougoulbe Ouro Ardo Sokolo Toridaga Kareri " Guire. Socoura Tenenkou Commune N'Debougou Sasalbe Niamana Ouro Guire "" Sirifila Boundy Koubaye Mariko """ Sio Diaka Togue Mourari Yeredon Sanio Ouro Modi Niono " Monimpebougou Soye Sebete Kala Siguida Bellen Niono Kewa Diafarabe Derrary Siribala Niono Toubacoro Boky Were Ouro Ali Femaye Macina Pogo Macin"a M'Bewani Kokry Centre N'koumandougou Matomo Fakala " Kolongo Souleye Djenne Commune Pondori Madiama Dougabougou Nema Badenyakafo Sansanding Timissa Sibila Sana Dandougou Fakala Saloba Baguindabougou Toukoroba Kamiandougou Ouan Niansanari Markala Dioro Farakou Massa. Folomana Segou Diedougou Tongue Diganibougou Baramandougou Togou Souba Sy Ouolon Fangasso Boussin Sama Foulala Farako SEGOU Siadougou Nyamina Diouna Fatine Fion Sego"u Commune Pelengana Folomakebougou Tene Sebougou Teneni Katiena "" Cinzana Koula Tamani Dougoufie " San Commune Sibougou Somo N'gara Sakoiba " Tominian " Tominian" Niasso "" "" N'goa Somo Boidie Massala Soignebougou Tougouni Fani Djeguena 0 375 750 1 500 Tesserla Koulandougou Konodimini Kilomètres Dinandougou Samine San Benena Kazangasso N'torosso Yasso Touna Dah Village de Sibougou BBoabraooueli Village de N’Débougou Village de Folomakebougou Village de M’Bewani N'gassola Dieli Date du sinistre : 6 Août 2013 Date du sinistre : 10 au 11 août D2ie0n1a3 KDoraodteo udguou sinistre : 20 au 21 août 2013 Date du sinistre: 23 au 24 août 2013 Niamana Bilan du 18 août Bilan du 15 août Bilan du 25 août Bilan du 27 août Sanekuy Yangasso Sourountouna •129 ménages sinistrés soit un nombre estimé de 1290 personnesS,a nando •126 ménages sinistrés soit 1260 personnes, toutes relogées •260 personnes sinistrées •200 ménages sinistrés soit approximativement 1000 personnes. -

Bulletin Sap N°327
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI ------------***------------ ------------***------------ COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi ------------***------------ SYSTEME D’ALERTE PRECOCE (S.A.P) BP. 2660, Bamako-Mali Tel :(223) 20 74 54 39 ; Adresse email : [email protected] Adresse Site Web : www.sapmali.com BULLETIN SAP N°327 Mars 2014 QU’EST-CE QUE LE SAP ? Afin de mieux prévoir les crises alimentaires et pour améliorer la mise en œuvre des aides nécessaires, le Ministère de l’administration Territoriale et des Collectivités Locales a mis en place un groupe Système d’Alerte Précoce du risque alimentaire (S.A.P.) Le groupe S.A.P. a pour mission de répondre aux questions suivantes : Quelles sont les zones et les populations risquant de connaître des problèmes alimentaires ou nutritionnels ? Quelles sont les aides à fournir ? Comment les utiliser ? Il bénéficie pour ce faire de l’appui du projet S.A.P. Le S.A.P. surveille les zones traditionnellement « à risque », c’est à dire les zones ayant déjà connu des crises alimentaires sévères, soit les 349 communes situées essentiellement au nord du 14ème parallèle. Cependant avec l’évolution du risque alimentaire (lié au marché, lié à la pauvreté) le SAP surveille l’ensemble des 703 communes du pays depuis 2004. Le S.A.P. se base sur une collecte permanente de données liées à la situation alimentaire et nutritionnelle des populations. Ces informations couvrent des domaines très divers tels la pluviométrie, l’évolution des cultures, l'élevage, les prix sur les marchés, les migrations de populations, leurs habitudes et réserves alimentaires, ainsi que leur état de santé. -

Pnr 2015 Plan Distribution De
Tableau de Compilation des interventions Semences Vivrières mise à jour du 03 juin 2015 Total semences (t) Total semences (t) No. total de la Total ménages Total Semences (t) Total ménages Total semences (t) COMMUNES population en Save The Save The CERCLE CICR CICR FAO REGIONS 2015 (SAP) FAO Children Children TOMBOUCTOU 67 032 ALAFIA 15 844 BER 23 273 1 164 23,28 BOUREM-INALY 14 239 1 168 23,36 LAFIA 9 514 854 17,08 TOMBOUCTOU SALAM 26 335 TOMBOUCTOU TOTAL 156 237 DIRE 24 954 688 20,3 ARHAM 3 459 277 5,54 BINGA 6 276 450 9 BOUREM SIDI AMAR 10 497 DANGHA 15 835 437 13 GARBAKOIRA 6 934 HAIBONGO 17 494 482 3,1 DIRE KIRCHAMBA 5 055 KONDI 3 744 SAREYAMOU 20 794 1 510 30,2 574 3,3 TIENKOUR 8 009 TINDIRMA 7 948 397 7,94 TINGUEREGUIF 3 560 DIRE TOTAL 134 559 GOUNDAM 15 444 ALZOUNOUB 5 493 BINTAGOUNGOU 10 200 680 6,8 ADARMALANE 1 172 78 0,78 DOUEKIRE 22 203 DOUKOURIA 3 393 ESSAKANE 13 937 929 9,29 GARGANDO 10 457 ISSA BERY 5 063 338 3,38 TOMBOUCTOU KANEYE 2 861 GOUNDAM M'BOUNA 4 701 313 3,13 RAZ-EL-MA 5 397 TELE 7 271 TILEMSI 9 070 TIN AICHA 3 653 244 2,44 TONKA 65 372 190 4,2 GOUNDAM TOTAL 185 687 RHAROUS 32 255 1496 18,7 GOURMA-RHAROUS TOMBOUCTOU BAMBARA MAOUDE 20 228 1 011 10,11 933 4,6 BANIKANE 11 594 GOSSI 29 529 1 476 14,76 HANZAKOMA 11 146 517 6,5 HARIBOMO 9 045 603 7,84 419 12,2 INADIATAFANE 4 365 OUINERDEN 7 486 GOURMA-RHAROUS SERERE 10 594 491 9,6 TOTAL G. -

Rapport Final Du Projet Pilote « Adaptation Au Changement Climatique Au Niveau Du Delta Central Du Fleuve Niger Au Mali »
Centre Régional AGRHYMET Projet Appui aux capacités d’adaptation aux changements climatiques au Sahel RAPPORT FINAL DU PROJET PILOTE « ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU NIVEAU DU DELTA CENTRAL DU FLEUVE NIGER AU MALI » Janvier 2006 SOMMAIRE AVANT PROPOS 6 1. INTRODUCTION 7 2. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE 9 2.1. CADRE INSTITUTIONNEL ............................................................................... 9 2.2. APPROCHES METHODOLOGIQUES................................................................ 9 2.2.1. Caractérisation du bassin du fleuve Niger ............................. 10 2.2.2. Enquêtes sur les systèmes de production ............................... 11 2.2.2.1. Systèmes de riziculture ......................................................... 11 2.2.2.2. Systèmes pastoraux.............................................................. 11 2.2.2.3. Systèmes de pêche.............................................................. 12 3. RESULTATS 14 3.1. CARACTERISTIQUES DU BASSIN DU FLEUVE NIGER ......................................... 14 3.1.1. Caractéristiques physiques....................................................... 14 3.1.1.1. Le Niger .................................................................................. 14 3.1.1.2. Le delta intérieur................................................................... 14 3.1.1.2.1. Secteur où la submersion commence avant la fin de la saison des pluies (fin Septembre)....................................... 15 3.1.1.2.2. La submersion coïncide avec la fin de la saison