Portraits De Médecins 5/02/10 18:26 Page 429
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Historia De La Urolog.A.Qxd
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/237841677 Libro 'Historia de la Urología'. 2006 Data · June 2013 CITATIONS READS 0 2,303 1 author: Julio Potenziani National Society of History of Medicine of Venezuela 77 PUBLICATIONS 26 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Julio Potenziani on 03 June 2014. The user has requested enhancement of the downloaded file. Historia de la Urolog a.qxd 23/03/2006 01:17 p.m. Page 1 Historia de la Urolog a.qxd 23/03/2006 01:17 p.m. Page 2 Portada: Dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci (1452-1510), Dibujo del coito, vías urinarias superiores, vías urinarias pelvianas con sus anexos. "En virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la Resolución Mediante la cual se dictan las Normas para la Promoción y Publicidad de Medicamentos dictadas por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, AstraZeneca informa que solamente ha aportado su patrocinio económico para la publicación final de la presente obra. Todos los aspectos relativos a la compilación y análisis de información, redacción de la obra y afines han sido realizados exclusivamente por el autor de la obra de manera independiente y sin ningún tipo de participación por parte de AstraZeneca en la misma. AstraZeneca no se hace responsable de la veracidad o exactitud de la información contenida en la obra así como de las opiniones contenidas en la misma." No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento o procesamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright Derechos Reservados. -

Marcel Proust: Angled Or “L” Shape) from Notebooks and Recycled Galley Proofs of the “Original” Second Volume Dating Newspaper Clipping, Signed
Exhibition Items The two plates on display, which belong to the opening episode of A l’ombre des jeunes filles en fleurs, illustrate Proust’s writing method. The first one is a galley proof sheet dated 13 June 1914, which Proust Case 1: corrected and to which he pasted significant additions. A missing text block may have been cut and M. Proust. Les plaisirs et les jours. Paris : Calmann-Lévy, 1896. Q. 845P94 OP transposed elsewhere, or discarded. The second plate is a “mosaic” or “patchwork” of multiple printed and M. Proust. Les plaisirs et les jours. “Dîner en ville.” Ms. fragment, 1895. Lefebvre 77. handwritten fragments which were assembled by an employee at the NRF in order to prepare and fix the “Le Banquet.” [Carte de rédacteur.] 1892. Lefebvre 101. correct text sequence for the printer. There is no trace of a later intervention by Proust on this plate. The Case 2: materials come from different sources: handwritten pages and marginal additions (recognizable by their M. Proust. “Un dimanche au Conservatoire.” Le Gaulois, 14 janvier 1895. Marcel Proust: angled or “L” shape) from notebooks and recycled galley proofs of the “original” second volume dating Newspaper clipping, signed. Uncataloged. back to the fall of 1913 and the spring of 1914. M. Proust. “Un dimanche au Conservatoire.” Ms fragment, 1895. Lefebvre 100-3. M. Proust. [Jean Santeuil passage.] “Henri de Réveillon.” Ms. fragment, Du côté de chez Swann received some favorable reviews and publishers who had turned it down offered to [1896-7] Lefebvre 100-5a. Writing Without End publish the remaining parts. -

1 Sommaires Du : - Bulletin De La Société Des Amis De Marcel Proust Et Des Amis De Combray (BSAMP) - Bulletin De La Société Des Amis De Marcel Proust (BMP)
1 Sommaires du : - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray (BSAMP) - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust (BMP) Le Centre de documentation de l’équipe Proust conserve les numéros suivants : En format papier : 4-5, 9, 12, 13-14, 18-22, 24-60 En format pdf : 1, 7-17 Sont donc manquants : 2-3, 6, 23 On peut télécharger les numéros 1, 7-17, ainsi que des sommaires, sur le site Internet de la Société des Amis de Marcel Proust : http://marcelproust.pagesperso-orange.fr/bulletin_marcel_proust.htm BSAMP N° 1 – 1950 Avant-propos, par Henri MONDOR, de l’Académie Française Séparation Lettre à L. P. Fargue Deux inédits de Marcel PROUST Un témoignage sur Proust, par Jacques de LACRETELLE, de l’Académie Française L’Horizon de Combray, par L. GORON Proust, Sainte-Beuve et Balzac, par H. BONNET La vie de la Société, par P. L. LARCHER BSAMP N° 2 – 1952 Des lettres inédites de Marcel Proust, présentées par Henri MONDOR Inédits d’Albertine disparue, présentés par André FERRÉ Remarques sur le texte des Jeunes Filles en Fleurs. Projet d’une édition par Pierre CLARAC « Grain de Peau » (Mallarmé et Proust), par Henri MONDOR Musset et Proust, par Jean POMMIER Technique et Vision, par Georges CATTAUI Du message à la leçon, par André FERRÉ Combray, par P.-L. LARCHER BSAMP N° 3 – 1953 Huit lettres inédites (1919-1922) au capitaine Charles Bugnet, présentées par Gérard BAUER, de l’Académie Goncourt, et Charles BUGNET Huit lettres inédites à Maria de Madrazo, présentées par Marie RIEFSTAHL-NORDLINGER Nouveaux inédits de À la recherche du temps perdu, présentés par André FERRÉ Marcel Proust : le moraliste dans Jean Santeuil, par Edmée de la ROCHEFOUCAULD De Jean Santeuil à la Recherche du temps perdu : la médiation ruskinienne, par Henri LEMAÎTRE À quel moment fut composé Jean Santeuil, par Henri BONNET « Les beaux jours d’Illiers », par P.-L. -
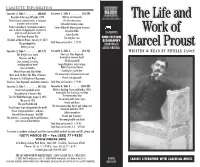
Marcel Proust
C ASSETTE I NFORMATION Cassette 1, Side 1. (40:48) Cassette 1, Side 2 . (38:59) Reynaldo Hahn sings Offrande, 1909 Military service (cont) The Life and Three fictional creative artists: a composer, The first short story a painter and an author Influential drawing rooms Proust’s episodes of ‘involuntary memory’ Comte Robert de Montesquiou-Fezensac were a means of digging into sensation in Reynaldo Hahn Work of order to reach the heart of it 3 CASSETTES Lucien Daudet The Franco-Prussian War The Dreyfus Case NON-FICTION The birth of Marcel Proust, January 10, 1871 Total Time on Cassette 1: 1:19:47 BIOGRAPHY The goodnight kiss UNABRIDGED Marcel Proust Military service AUDIO-ORIGINAL Cassette 2, Side 1. (41:17) Cassette 2, Side 2. (38:15) W RITTEN & READ BY N EVILLE J ASON The Dreyfus Case (cont) Time Lost, Time Regained; Pleasures and Days involuntary memory (cont) Jean Santeuil, the early, Alfred Agostinelli autobiographical novel Sergei Diaghilev, Jean Cocteau, Anna de Noailles Pablo Picasso and friends Marcel Proust and John Ruskin Looking for a publisher More work: Ruskin’s The Bible of Amiens The manuscript is delivered to Grasset The move to 102 Boulevard Haussmann Proust and Agostinelli Time Lost, Time Regained; involuntary memory Total Time on Cassette 2: 1:19:32 Cassette 3, Side 1. (41:28) Cassette 3, Side 2 . ((38:17) Proust and Agostinelli (cont) Within a Budding Grove published in 1919, The publication of Swann’s Way winning the Prix Goncourt, and then The Guermantes Way The First World War begins, August 3, 1914 The meeting with -

MARCEL PROUST and the Medicine of the Belle Epoque
MARCEL PROUST and the medicine of the Belle Epoque 12 November 2018 - 26 January 2019 1 Exhibition Curator Robert Greenwood Editor David Springall With additional material by Robert Greenwood Graphic Designer Henry Trickey Contact us [email protected] 020 7290 2940 Exhibition hours Mon - Thurs 9am - 9pm Friday 9am - 5.30pm Saturday 10am - 4.30pm 2 CONTENTS 4 Introduction Medicine and illness in the writing of 5 Marcel Proust 7 Marcel Proust’s family background 10 Proust’s ilnessess 11 Asthma and neurasthenia 12 Proust’s physicians 18 The death of his parents – the starter’s gun? 19 Illness, sensitivity, perception 20 Use of language 22 Proust’s sexuality 23 October - November 1922 Marcel Proust and the Medicine of the Belle Époque 3 A young Marcel Proust. Image courtesy of Dutch National Archives Introduction Marcel Proust (1871-1922) eventually came to the conclusion that “Medicine is a compilation of all the sequential and contradictory errors made by doctors… to believe in medicine is sheer folly, but not to believe in it a greater folly still, because from this accumulation of errors a few truths have eventually emerged”. His constant references to the world of medicine do much more than provide humorous comment on the idiosyncrasies of society. They are observations of people in quite specific circumstances: in illness, dying and death. As such, they are an expression of Proust’s desire to access and analyse humankind at its deepest level, in its ultimate essence. In the words of Henri Ellenberger: “What Marcel Proust indefatigably analysed were the many manifestations of polypsychism, the multiple shades of personality within us. -
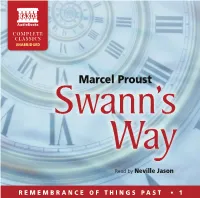
Marcel Proust Swann’S Way
Marcel Proust Swann’s Way Read by Neville Jason REMEMBRANCE OF THINGS PAST • 1 1 Swann's Way – Remembrance Of Things Past 10:39 2 The stiffened side underneath my body would… 9:37 3 Riding at a jerky trot… 10:13 4 My sole consolation… 8:47 5 Our utter ignorance… 9:44 6 In the end… 9:49 7 But we sat silent. 10:14 8 I do not agree with you… 9:58 9 In this particular instance… 10:42 10 Noiselessly I opened the window… 10:06 11 I was not, however. 11:30 12 ‘My dear,’ she had said to Mamma… 10:53 13 And so it was that… 7:25 14 And I begin again to ask myself… 7:31 15 COMBRAY 11:13 16 That rosy candlelight… 9:56 17 ‘Oh dear, dear; the poor little creature!’ 9:34 18 While my aunt gossiped on in this way… 10:54 19 The church! 6:33 20 It was the steeple… 7:54 2 21 On our way home from mass… 9:39 22 And since, besides this… 9:24 23 Every morning I would hasten… 7:39 24 On the table was the same plate… 7:50 25 I had not the least idea… 9:51 26 But in later years… 10:12 27 The novelist's happy discovery… 9:22 28 Sometimes I would be torn from my book… 9:34 29 Before seeing them… 9:48 30 I was by no means Bergotte's sole admirer… 9:23 31 I dared not accept such an offer… 10:06 32 While I was reading in the garden… 9:56 33 ‘Look at Roussainville,’… 9:29 34 Françoise was avaricious… 8:29 35 When I say that… 10:24 36 His one and only passion… 9:18 37 She was genuinely fond of us… 8:37 38 One Sunday, when my aunt… 9:29 39 I crept out of the kitchen… 10:36 40 Just as we reached the house… 10:36 3 41 Of course he would never have admitted… 11:39 42 That -

Samuel Pozzi-J.BATTIN Mise En Page 1 25/08/17 15:50 Page287
Samuel Pozzi-J.BATTIN_Mise en page 1 25/08/17 15:50 Page287 Samuel Pozzi (1846-1918) Créateur de la chirurgie gynécologique à la Belle Époque * Samuel Pozzi (1846-1918), the founder of gynaecological surgery during the Belle Époque par Jacques BATTIN ** La Belle Époque ! Elle ne le fut pas pour tous. Surtout, elle fut un court entracte entre deux guerres, qui s’enchaînèrent, celle de 1870, et la Grande Guerre de 1914-1918. Paris brilla de mille feux durant ce bref intervalle, comme l’a rappelé la récente exposition du musée du Petit-Palais “Paris 1900, la ville spectacle”, où les dernières salles étaient consacrées aux affiches de Mucha annonçant les pièces jouées par Sarah Bernhardt, dont les sculptures de la comédienne montraient les multiples talents. Parmi les étoiles de la Belle Époque, il y eut en effet Sarah Bernhardt (1844-1923), la première superstar, la diva, le monstre sacré pour Cocteau, la voix d’or pour Victor Hugo. Clemenceau la quali - fia même de trésor national, car en 1915, il redoutait qu’elle ne tombât aux mains des Allemands. Elle venait de triompher dans le rôle androgyne de l’Aiglon qui faisait se pâmer les plus républicains. Au soir de sa vie, elle souffrait atrocement de son genou droit atteint d’une tumeur blanche (l’ostéo-arthrite tuberculeuse) et elle suppliait son “docteur Dieu” Samuel Pozzi de l’amputer, seul moyen de ne plus souffrir. Pozzi l’avait déjà opérée, en 1898, d’un volumineux kyste de l’ovaire, mais l’affection ostéo-articu - laire de la diva n’étant pas de sa compétence, il décida de la confier à l’un de ses anciens internes devenu le réputé professeur d’orthopédie à Bordeaux, Maurice Denucé. -

Bulletin L'académie Nationale De Médecine
Tome 201 — Vie de l’Académie 2017 BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE publié par MM. Daniel Couturier, Secrétaire perpétuel et Jean François Allilaire, Secrétaire adjoint Rédacteur en chef : Professeur Jean-Noël Fiessinger Adjointe à la Rédaction : Sibylle du Chaffaut ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 16, RUE BONAPARTE — 75272 PARIS CEDEX 06 http://www.academie-medecine.fr 2017 ¢ Tome 201 ¢ Vie de l’Académie Sommaire BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE publié par MM. Daniel Couturier, Secrétaire perpétuel et Jean François Allilaire, Secrétaire adjoint Rédacteur en chef : Professeur Jean-Noël Fiessinger Adjointe à la Rédaction : Sibylle du Chaffaut sommaire Allocutions 1455 Bilan de l’activité académique 2016 Pierre Bégué 1465 Discours d’intronisation aux fonctions de président de l’Académie nationale de médecine Claude Jaffiol 1479 Notre histoire est d’actualité Claude Jaffiol Présentations d’ouvrages 1491 Bernard Guiraud Chaumeil. Ils ont inventé la médecine, gardons-lui son humanité. Éditions Michel Lafon, 2016. Présentation par Laurent Degos 1493 Jean-Marc Vital. Anatomie de la colonne vertébrale, nouveaux concepts. Sauramps medical édition, 2016. Présentation par Jean Dubousset 1494 Théophile Godfraind, Académie royale de Belgique. Hominisation et trans- humanisme. Collection : l’Académie en poche. Bruxelles 2016. Présentation par Raymond Ardaillou 1451 Académie nationale de Médecine 1497 Jean-Louis Michaux. Ludwig van Beethoven, Le génie et ses maladies. Éditions Fiacre, juin 2015. Présentation par Bernard Lechevalier 1500 Jean-Michel Besnier, Francis Brunelle, Florence Gazeau. Un cerveau très prometteur. Paris : Le Pommier, 2015. Présentation par Géraud Lasfargues 1501 Michel Huguier. Quelle Assurance maladie voulez-vous ? Paris: Éditions L’Harmattan, 2017. 247 pages. Présentation par Antoine Durrleman 1504 Michel A. -
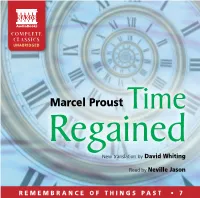
Marcel Proust Time Regained New Translation by David Whiting
COMPLETE CLASSICS UNABRIDGED Marcel Proust Time Regained New translation by David Whiting Read by Neville Jason RemembRance of Things PasT • 7 CD 1 1 Time Regained: Chapter One 4:47 2 Robert came several times to Tansonville while I was there. 5:55 3 Françoise, who had already seen... 5:46 4 One day when Robert was due to come to Tansonville... 5:22 5 As for that love he kept talking to me about... 4:13 6 Once Robert had gone off again... 5:26 7 It occurred to me that it was because Robert had... 6:11 8 ‘The day before yesterday...’ 5:46 9 ‘You Westerners find that impossible to understand…’ 4:58 10 When I spoke to Verdurin of the subtle pleasure... 5:46 11 ‘Yes, I give you my word...’ 4:39 12 Hearing this, Doctor Cottard... 3:39 13 I stopped there... 5:40 14 The result of this was... 4:29 15 Thus it was that the Goncourts’ journal had revealed to me... 4:47 Total Time on CD 1: 77:29 2 CD 2 1 I had realised earlier that it is not the most witty... 5:25 2 Chapter Two 4:26 3 ‘The sadness of the present moment, it is true...’ 5:00 4 Saint-Euverte’s salon had a faded image... 6:16 5 M. Bontemps would not hear of peace... 5:38 6 Now Morel ought not to have been there... 4:53 7 These words, which would have injured... 6:42 8 Before the time when the afternoon teas came to an end.. -

Sodomand Gomorrah
COMPLETE CLASSICS UNABRIDGED Marcel Proust Sodom and Gomorrah Read by Neville Jason RemembRance of Things PasT • 4 1 Sodom and Gomorrah: Part 1 9:35 2 I was about to change my position again... 9:49 3 All that I have just said... 10:07 4 ‘So as not to lose the trail,’ he went on... 9:55 5 Those of my readers who do not care to refer... 6:30 6 Their honour precarious... 11:28 7 It is with these professional organisations... 10:41 8 We need not pause here to consider... 10:08 9 Then the solitary languishes alone. 10:11 10 It is true that inverts... 9:30 11 Sodom and Gomorrah: Part 2 – Chapter 1 9:01 12 The person immediately in front of me... 10:34 13 I was buttonholed at that moment... 10:43 14 But in default of the pleasures sacrificed... 10:35 15 The distance between me and the garden door... 10:19 16 In any case, if there are transitions... 7:00 17 It was not so difficult... 10:49 18 One of these little accidents... 9:26 19 It was not so very long since... 9:34 20 While, before she had even left the entrance hall... 10:27 2 21 In any event, the names of Ibsen and D’Annunzio... 10:50 22 Assuredly, if it had been only Oriane... 9:50 23 M. de Charlus would, no doubt, readily have compromised... 9:59 24 ‘Talking of Dreyfusards,’ I said... 6:59 25 I was longing to know..