Direction Nationale De L'hydraulique Et De L
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mli0006 Ref Region De Kayes A3 15092013
MALI - Région de Kayes: Carte de référence (Septembre 2013) Limite d'Etat Limite de Région MAURITANIE Gogui Sahel Limite de Cercle Diarrah Kremis Nioro Diaye Tougoune Yerere Kirane Coura Ranga Baniere Gory Kaniaga Limite de Commune Troungoumbe Koro GUIDIME Gavinane ! Karakoro Koussane NIORO Toya Guadiaba Diafounou Guedebine Diabigue .! Chef-lieu de Région Kadiel Diongaga ! Guetema Fanga Youri Marekhaffo YELIMANE Korera Kore ! Chef-lieu de Cercle Djelebou Konsiga Bema Diafounou Fassoudebe Soumpou Gory Simby CERCLES Sero Groumera Diamanou Sandare BAFOULABE Guidimakan Tafasirga Bangassi Marintoumania Tringa Dioumara Gory Koussata DIEMA Sony Gopela Lakamane Fegui Diangounte Goumera KAYES Somankidi Marena Camara DIEMA Kouniakary Diombougou ! Khouloum KENIEBA Kemene Dianguirde KOULIKORO Faleme KAYES Diakon Gomitradougou Tambo Same .!! Sansankide Colombine Dieoura Madiga Diomgoma Lambidou KITA Hawa Segala Sacko Dembaya Fatao NIORO Logo Sidibela Tomora Sefeto YELIMANE Diallan Nord Guemoukouraba Djougoun Cette carte a été réalisée selon le découpage Diamou Sadiola Kontela administratif du Mali à partir des données de la Dindenko Sefeto Direction Nationale des Collectivités Territoriales Ouest (DNCT) BAFOULABE Kourounnikoto CERCLE COMMUNE NOM CERCLE COMMUNE NOM ! BAFOULABE KITA BAFOULABE Bafoulabé BADIA Dafela Nom de la carte: Madina BAMAFELE Diokeli BENDOUGOUBA Bendougouba DIAKON Diakon BENKADI FOUNIA Founia Moriba MLI0006 REF REGION DE KAYES A3 15092013 DIALLAN Dialan BOUDOFO Boudofo Namala DIOKELI Diokeli BOUGARIBAYA Bougarybaya Date de création: -

Programme National De Developpement Des Plateformes Multifonctionnelles Pour La Lutte Contre La Pauvrete 2017 - 2021
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME RÉPUBLIQUE DU MALI DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SECRETARIAT GENERAL PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DES PLATEFORMES MULTIFONCTIONNELLES POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 2017 - 2021 Durée : 5 ans (2017 - 2021) Couverture géographique : Territoire National Coût de réalisation: 55 497 925 000 FCFA • Contribution du gouvernement : 8 558 525 000 FCFA • Contribution des bénéficiaires : 2 500 000 000 FCFA • Financements et Partenariats à rechercher : 44 439 400 000 FCFA Novembre 2016 Table des matières Sigles et Abréviations .......................................................................................................................................... 4 RESUME DU PROGRAMME ................................................................................................................... 6 Résumé exécutif .................................................................................................................................................. 7 1.2. Problématiques et enjeux ......................................................................................................................... 13 1.3. Objectifs de développement et cadrage politique .................................................................................... 14 II. STRATEGIES ET POLITIQUES NATIONALES ET SECTORIELLES ........................................................................... 15 2.1. Stratégies et Politiques nationales ............................................................................................................ -

Schéma D'aménagement Et De Développement Durable Du Cercle
République du Mali Un Peuple - Un But - Une foi REGION DE KAYES CERCLE DE YELIMANE Schéma d’aménagement et de développement durable du cercle de Yélimané 2011-2025 Tome 1 : Diagnostic des secteurs de développement Rapport définitif COLLECTIF INGENIEURS DEVELOPPEMENT SAHEL cids SARL Siège social : B.P. 309 - Kayes Tél : 21 52 21 78 [email protected] Août 2010 1 Sommaire Généralités ................................................................................................................................................. 7 I/ Introduction .................................................................................................................. 8 II/ Démarche methodologique .......................................................................................... 9 III/ Les difficultes rencontrees .......................................................................................... 11 IV/ Les points positifs ...................................................................................................... 12 V/ Les limites de l’etude .................................................................................................. 12 Traits caractéristiques du cercle de Yélimané .......................................................................................... 13 I/ Présentation du cercle de Yélimané .............................................................................. 14 1.1 Historique .................................................................................................................. -

SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 15 Au 17 OCTOBRE 2014 SELON LE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE DU MALI DE L’EAU ET DE l’ASSAINISSEMENT UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS(DNEF) SYSTEME D’INFORMATION FORESTIER (SIFOR) SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 15 au 17 OCTOBRE 2014 SELON LE SATTELITE MODIS. LATITUDES LONGITUDES VILLAGES COMMUNES CERCLES REGIONS 12,3150000000 -9,9470000000 SITAOULI KOULOU KITA KAYES 12,5960000000 -9,0010000000 GORO MAKANO KITA KAYES 12,8610000000 -9,0410000000 KOUNSALA SEBEKORO KITA KAYES 13,9030000000 -9,0520000000 BAMBARA MADINA KITA KAYES 14,1980000000 -9,0870000000 BENDOUGOU DIANGUIRDE DIEMA KAYES 14,1600000000 -9,3100000000 SAKORA GUEMOUKOURABA KITA KAYES 14,2880000000 -8,8900000000 SAGABARA-S MADINA KITA KAYES 14,2330000000 -11,014000000 MOUNITACO DIAMOU KAYES KAYES 14,3000000000 -11,082000000 MAMACITA SEGALA KAYES KAYES 14,3550000000 -11,093000000 DRAMECO SEGALA KAYES KAYES 14,3600000000 -11,099000000 DRAMECO DIAMOU KAYES KAYES 14,5710000000 -11,553000000 SOMANKIDI BANGASSI KAYES KAYES 14,4740000000 -10,883000000 KOUBINE MARINTOUMANIA KAYES KAYES 14,5570000000 -11,972000000 TOUBABOUNK FALEME KAYES KAYES 14,0910000000 -8,9470000000 BENDOUGOU GUEMOUKOURABA KITA KAYES 14,5380000000 -12,035000000 SOBOKOU FALEME KAYES KAYES 14,0590000000 -8,9220000000 BENDOUGOU MADINA KITA KAYES 13,8760000000 -8,5030000000 BORO ET SO MADINA KITA KAYES 14,3090000000 -11,717000000 MARENA-GAD SADIOLA KAYES KAYES 14,3000000000 -11,718000000 SOUKOURANI SADIOLA KAYES KAYES 13,7870000000 -8,7100000000 SAMAKOULOU MADINA KITA KAYES 13,6810000000 -8,9260000000 -

Bulletin Sap N°327
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI ------------***------------ ------------***------------ COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi ------------***------------ SYSTEME D’ALERTE PRECOCE (S.A.P) BP. 2660, Bamako-Mali Tel :(223) 20 74 54 39 ; Adresse email : [email protected] Adresse Site Web : www.sapmali.com BULLETIN SAP N°327 Mars 2014 QU’EST-CE QUE LE SAP ? Afin de mieux prévoir les crises alimentaires et pour améliorer la mise en œuvre des aides nécessaires, le Ministère de l’administration Territoriale et des Collectivités Locales a mis en place un groupe Système d’Alerte Précoce du risque alimentaire (S.A.P.) Le groupe S.A.P. a pour mission de répondre aux questions suivantes : Quelles sont les zones et les populations risquant de connaître des problèmes alimentaires ou nutritionnels ? Quelles sont les aides à fournir ? Comment les utiliser ? Il bénéficie pour ce faire de l’appui du projet S.A.P. Le S.A.P. surveille les zones traditionnellement « à risque », c’est à dire les zones ayant déjà connu des crises alimentaires sévères, soit les 349 communes situées essentiellement au nord du 14ème parallèle. Cependant avec l’évolution du risque alimentaire (lié au marché, lié à la pauvreté) le SAP surveille l’ensemble des 703 communes du pays depuis 2004. Le S.A.P. se base sur une collecte permanente de données liées à la situation alimentaire et nutritionnelle des populations. Ces informations couvrent des domaines très divers tels la pluviométrie, l’évolution des cultures, l'élevage, les prix sur les marchés, les migrations de populations, leurs habitudes et réserves alimentaires, ainsi que leur état de santé. -

Le Suivi Technique Et Financier Des Services Les Projets Au Mali
LE SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER DES SERVICES LES PROJETS AU MALI L’association SEVES, créée en 2007, accompagne des collectivités Depuis 2011 et dans le cadre de deux projets, territoriales, des ministères, des associations et des opérateurs SEVES a soutenu 4 communes du Cercle de dans l’organisation de services publics de qualité et à moindre Yélimané, région de Kayes avec la création ou coût pour les usagers en Afrique subsaharienne. En partenariat l’optimisation de 8 services d’adduction d’eau avec des opérateurs de suivi technique et financier locaux potable (AEP), en partenariat avec les (STEFI) au Sahel, SEVES s’inscrit dans une démarche de communes, les associations de la diaspora, les suivi/évaluation permanent de la gestion technique et financière associations des usagers de l’eau villageoises, le des services d’eau qu’elle a appuyée. groupe AGED-2AEP, et le cofinancement du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) : Dans la région de Kayes au Mali, le Groupe AGED-2AEP assure la prestation STEFI pour 109 services d’eau. Pour 20 FCFA (0,03€) ▪ POSEY 1 : Optimisation du Service Public /m3 produit, les gestionnaires sont appuyés et disposent d’un de l’Eau dans la commune de Diafounou rapport d’audit semestriel. En 2017, tous les centres ayant été Gory (2011-2016) accompagnées par SEVES sont suivis par le dispositif, excepté le ▪ POSEY 2 : Optimisation du Service Public village de Guiffi. de l’Eau dans le cercle de Yélimané (2016- 2019) Les services d’eau potable accompagnés Services accompagnés Production Rendement de réseau Variation -
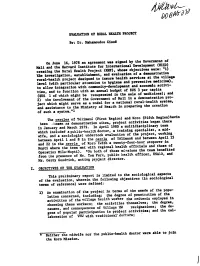
I. OBJECTIVES of the EVALUATION This Preliminary Report Is Limited To
EVALUATION OF RURAL HEALTH PROJECT By: Dr. Mahamoudou Ciss& of On June 16, 1978 an agreement was signed by the Government (HIID) and the Harvard Institute for International Development Mali "l) the Rural Health Project (RHP), whose objectives were: creating a demonstration investigation, establishment, and evaluation of %be village project designed to insure health services at the rural-health medicine), (with particular attention to hygiene and preventive level activi integration with cowmunity-development and economic to allow capita and to function with an annual budget of $US 3 per ties, and might be recuperated in the sale of medicines); ($US. I of which pro of the Government of Mali in a demonstration 2) the involvement system, which might serve as a model for a national rural-health ject the creation and assistance to the Ministry of Health in preparing of such a system."1 (Fifth Region)havin The cercles of Ye'limani (First Region) and Koro began there .Aiosen as demonstration sites, project activities been team and March 1979. In April 1980 a multidisciplinary in January a mid included a public-healtb doctor, a training speciolist, which project, working and a sociologist undertook evaluation of the wife, April 15 April 1 and 8 in the cercle of Yflimang and between between stopover in and 22 in the cerele of Koro (with a twenty-four-hour and those of Mopti where the team met with regional health officials the team benefited Operatioa Mils-Mopti). *On both of these missions officer, USAD, and from the presence of Mr. Tom Park, public health Mr. -

Screening of Feasible Applications of Wind and Solar Energy in Mali: Assessment Using the Wind and Solar Atlas for Mali
Screening of feasible applications of wind and solar energy in Mali: Assessment using the wind and solar atlas for Mali DANIDA contract 1711 Feasibility of renewable energy resources in Mali December 2012 Risø-R-Report Authors December 2012 Ivan Nygaard, Per Nørgård, Luc Dewilde, Jake Badger, Mads Olander Rasmussen, Lars Boye Hansen, Ousmane Ouattara, Famakan Kamissoko, Alhousseini Issa Maiga, Souleymane Diarra, Nanourou Coulibaly Title Screening of feasible applications of wind and solar energy in Mali: Assessment using the wind and solar atlas for Mali ISBN: 978-87-92706-75-1 Contract no.: DANIDA contract 1711 Front Page: Hybrid PV-diesel system in Ouélessébougou, Mali Photo: Felicia Fock Department of Management Engineering Technical University of Denmark Risø Campus Frederiksborgvej 399, P.O. Box 49 Building 142 4000 Roskilde, Denmark Direct + 45 46775115 Fax + 45 46321999 Skype: ivan.nygaard3 [email protected] Contents LIST OF ABBREVIATIONS 3 1 PREFACE 4 2 EXECUTIVE SUMMARY 6 3 THE ELECTRICITY SECTOR IN MALI 10 3.1 Demand forecast for electricity in the integrated system 10 3.1.1 Demand forecast 10 3.1.2 Extension of the integrated system 12 3.1.3 Existing and planned production units for electricity and planned imports 13 3.1.4 Future avoided costs in the integrated system 17 3.1.5 Conclusion 19 3.2 Demand forecast in the isolated grids (Centres isolées) 20 3.2.1 Tombouctou grid 21 3.2.2 Monthly variations 23 3.2.3 Diurnal variations 24 3.2.4 Avoided costs for electricity in isolated grids 25 3.3 Rural electrification (mini-grids) 26 -

GE84/210 BR IFIC Nº 2747 Section Spéciale Special Section Sección
Section spéciale Index BR IFIC Nº 2747 Special Section GE84/210 Sección especial Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Date/Fecha : 25.06.2013 Expiry date for comments / Fecha limite para comentarios / Date limite pour les commentaires : 03.10.2013 Description of Columns / Descripción de columnas / Description des colonnes Intent Purpose of the notification Propósito de la notificación Objet de la notification 1a Assigned frequency Frecuencia asignada Fréquence assignée 4a Name of the location of Tx station Nombre del emplazamiento de estación Tx Nom de l'emplacement de la station Tx B Administration Administración Administration 4b Geographical area Zona geográfica Zone géographique 4c Geographical coordinates Coordenadas geográficas Coordonnées géographiques 6a Class of station Clase de estación Classe de station 1b Vision / sound frequency Frecuencia de portadora imagen/sonido Fréquence image / son 1ea Frequency stability Estabilidad de frecuencia Stabilité de fréquence 1e carrier frequency offset Desplazamiento de la portadora Décalage de la porteuse 7c System and colour system Sistema de transmisión / color Système et système de couleur 9d Polarization Polarización Polarisation 13c Remarks Observaciones Remarques 9 Directivity Directividad -

PROGRAMME ATPC Cartographie Des Interventions
PROGRAMME ATPC Cartographie des interventions Agouni !( Banikane !( TOMBOUCTOU Rharous ! Ber . !( Essakane Tin AÎcha !( Tombouctou !( Minkiri Madiakoye H! !( !( Tou!(cabangou !( Bintagoungou M'bouna Bourem-inaly !( !( Adarmalane Toya !( !( Aglal Raz-el-ma !( !( Hangabera !( Douekire GOUNDAM !( Garbakoira !( Gargando Dangha !( !( G!(ou!(ndam Sonima Doukouria Kaneye Tinguereguif Gari !( .! !( !( !( !( Kirchamba TOMBOUCTOU !( MAURITANIE Dire .! !( HaÏbongo DIRE !( Tonka Tindirma !( !( Sareyamou !( Daka Fifo Salakoira !( GOURMA-RHAROUS Kel Malha Banikane !( !( !( NIAFOUNKE Niafunke .! Soumpi Bambara Maoude !( !( Sarafere !( KoumaÏra !( Dianke I Lere !( Gogui !( !( Kormou-maraka !( N'gorkou !( N'gouma Inadiatafane Sah !( !( !( Ambiri !( Gathi-loumo !( Kirane !( Korientze Bafarara Youwarou !( Teichibe !( # YOUWAROU !( Kremis Guidi-sare !( Balle Koronga .! !( Diarra !( !( Diona !( !( Nioro Tougoune Rang Gueneibe Nampala !( Yerere Troungoumbe !( !( Ourosendegue !( !( !( !( Nioro Allahina !( Kikara .! Baniere !( Diaye Coura !( # !( Nara Dogo Diabigue !( Gavinane Guedebin!(e Korera Kore .! Bore Yelimane !( Kadiaba KadielGuetema!( !( !( !( Go!(ry Youri !( !( Fassoudebe Debere DOUENTZA !( .! !( !( !(Dallah Diongaga YELIMANE Boulal Boni !( !(Tambacara !( !( Takaba Bema # # NIORO !( # Kerena Dogofiry !( Dialloube !( !( Fanga # Dilly !( !( Kersignane !( Goumbou # KoubewelDouentza !( !( Aourou !( ## !( .! !( # K#onna Borko # # #!( !( Simbi Toguere-coumbe !( NARA !( Dogani Bere Koussane # !( !( # Dianwely-maounde # NIONO # Tongo To !( Groumera Dioura -

Performance Evaluation of the High-Impact Health Services (SSGI)This Document and Was Preparedthe Social for the USAID/Mali and Behavior As Part of Contract Change No
MALI Photo credit: Children watch as a woman and child practice hand washing in Mali. / WASHplus Performance Evaluation of the High-Impact Health Services This document was prepared for the USAID/Mali as part of contract No. 720-688-18-F-00002 – Evaluation (SSGI) and the Social and Behavior Change Communication of the High-Impact Health Services (SSGI) and Social and Behavior Change Communication (KJK) (KJK)Programs. Programs Final evaluation report January 16, 2019 This document was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by the Mitchell Group, Inc. (TMG). i Prepared by: Dr. Issakha Diallo, Evaluation Specialist/ Team Leader M. Mamadou F. Camara, Research Coordinator and Quality Assurance Advisor Dr. Arkia Diallo, MNCH/FP Technical Advisor Dr. Mohamed Amadou Traore, Infectious Disease Technical Advisor M. Sankaria Maiga, Behavior Change/Health, Communication Advisor Dr. Elvira Beracochea, Technical Manager Dr. Sarah Castle, Qualitative Data Specialist Dr. John McCauley, Quantitative Data Specialist KoitaConsulting: Local partner Main contact: M. Abou Kone, Program Manager, TMG, Inc., Washington, DC. Email: [email protected] The Mitchell Group, Inc. 1816 11th Street, NW Washington, DC 20001 Tel.: 202-745-1919 DISCLAIMER The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. ii ABSTRACT Background: Since December 2014, USAID has supported the High-Impact Health Services (Services de Santé à Grand Impact - SSGI) and Keneya Jemu Kan ((KJK) Social and Behavior Change Communication (SBCC) programs. This Mid-Term Evaluation explores whether these programs’ activities are making progress toward planned results, and to what extent financial, management, and M&E systems are affecting implementation and achievement of results. -

Resultats Bac 2020
MEN LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU BACCALAUREAT MALIEN PÔLE DE CORRECTION .... CNECE SESSION D'OCTOBRE 2020 DE KAYES TERMINALE ARTS ET LETTRES DATE DE LIEU DE N°PL PRENOMS NOM SEXE ETABLISSEMENT ACADEMIE MENTION NAISSANCE NAISSANCE ELEVE STATUT STATUT 1 Kadiatou BAGAYOKO F 03/07/2000 Kayes LDKK KAYES REG PASSABLE 3 Assétou COULIBALY F 21/09/2002 Kita LKITA KITA REG PASSABLE 9 Nyele Batoma DIAKITE F 03/08/2001 Kita LKITA KITA REG PASSABLE 11 Issa DIALLO M Vers 2003 Kita LKITA KITA REG PASSABLE 16 Daman FOFANA M 19/06/2002 Kita LKITA KITA REG PASSABLE 17 Fatoumata FOFANA F 22/04/2001 Diema LDKK KAYES REG PASSABLE 23 Bassirou KANE M 15/09/2001 Baroueli LKITA KITA REG PASSABLE 27 Diouma Lassana KONATE F 20/09/2004 Kita LKITA KITA REG PASSABLE 29 Mahamadou NIAKATE M 01/01/2001 Krémis LDKK KAYES REG PASSABLE 34 Ramatoulaye SOW F 20/10/2000 Kayes LDKK KAYES REG PASSABLE AE_KITA AE_KAYES 1 AE_NIORO MEN LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU BACCALAUREAT MALIEN PÔLE DE CORRECTION **** CNECE SESSION D'OCTOBRE 2020 DE KAYES TERMINALE LANGUES ET LITTÉRATURE DATE DE LIEU DE ETABLISSEM N°PL PRENOMS NOM SEXE ACADEMIE MENTION NAISSANCE NAISSANCE ENT ELEVE STATUT STATUT 2 Précious ADAZE F 26/06/2002 Diéma LDIEMA NIORO REG ASSEZBIEN 6 Sidi Mohamed AG ISSOUF M 31/12/2001 Bourem LPFN NIORO REG PASSABLE 10 Mariama Walet ASSE WAT F 04/02/2001 Gao LBAK KAYES REG PASSABLE 2312 Almaoudata Walet BABAHMED F 12/07/2005 Bamako CLLPODK KITA CL ASSEZBIEN 26 Boudian BAGAYOKO M 14/07/1995 Bamako LDJIDIANc KITA CL PASSABLE 32 Adama BAH M 09/09/2003 Tambaga LMASASI KITA REG ASSEZ-BIEN