Diagnostic Initial Du Territoire D’Étude
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

American Armies and Battlefields in Europe 533
Chapter xv MISCELLANEOUS HE American Battle Monuments The size or type of the map illustrating Commission was created by Con- any particular operation in no way indi- Tgress in 1923. In carrying out its cates the importance of the operation; task of commeroorating the services of the clearness was the only governing factor. American forces in Europe during the The 1, 200,000 maps at the ends of W or ld W ar the Commission erected a ppro- Chapters II, III, IV and V have been priate memorials abroad, improved the placed there with the idea that while the eight military cemeteries there and in this tourist is reading the text or following the volume records the vital part American tour of a chapter he will keep the map at soldiers and sailors played in bringing the the end unfolded, available for reference. war to an early and successful conclusion. As a general rule, only the locations of Ail dates which appear in this book are headquarters of corps and divisions from inclusive. For instance, when a period which active operations were directed is stated as November 7-9 it includes more than three days are mentioned in ail three days, i. e., November 7, 8 and 9. the text. Those who desire more com- The date giYen for the relief in the plete information on the subject can find front Jine of one division by another is it in the two volumes published officially that when the command of the sector by the Historical Section, Army W ar passed to the division entering the line. -

Authority, Marriage, and Politics in Late-Medieval France
The Pennsylvania State University The Graduate School College of the Liberal Arts PERSUADING THE POLITY: AUTHORITY, MARRIAGE, AND POLITICS IN LATE-MEDIEVAL FRANCE A Dissertation in French and Women’s Studies by Elizabeth L. Kinne © 2013 Elizabeth L. Kinne Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy May 2013 The dissertation of Elizabeth L. Kinne was reviewed and approved* by the following: Norris J. Lacy Edwin Erle Sparks Professor (Emeritus) of French and Medieval Studies Dissertation Advisor Co-Chair of Committee Bénédicte Monicat Professor of French and Women’s Studies Head of the Department of French and Francophone Studies Co-Chair of Committee Christine Clark-Evans Associate Professor of French, Women’s Studies, and African and African-American Studies Jean-Claude Vuillemin Professor of French Robert R. Edwards Edwin Erle Sparks Professor of English and Comparative Literature * Signatures are on file in the Graduate School Kinne ii Abstract Persuading the polity: Authority, marriage, and politics in late-medieval France In the later Middle Ages, texts on marriage proliferated, either works of conduct meant to make women good wives or more general reflections addressed to a wide spectrum of medieval society. These multiple and contradictory discourses regarding matrimony performed a variety of functions beyond attempting to regulate a household or persuade the audience of the worthiness, or lack thereof, of the institution. They are displays of power that seek to impose an idealized vision of society and one’s authority over others. An exploration of this subtext brings to light the difficulties of exerting individual agency in the face of myriad constraints, whether social, economic, or political. -

Foe's Population Drops;
The Great War.1400th Day French made frequent successful counter attacks. Red Cross Ready The furthest point reached by the Foe's Population Cavalry Gets is Drops; enemy Troosnes, which is only Comment To forty milts from the Paris fortifi¬ Military Care for U. S. cations. A French counter attack Entente Holds Its Own Its Chance in threw him out of ibis town, and also By William L, McPherson Wounded Troops from FaverollcsT Corey and Lon¡r-, I^HE effect of Fcch's ently massed on that front. Some «voie German}^, in Another Year of Will Have Lost 1 0 Per waiting; pont, which at one time all in War, Marne Battle is to be¬ of the hardest fighting of the last his strategy beginning Three Thousand Beds Pro¬ possession. Cent of Her of Britain In¬ come apparent. The Allied few days has taken place between This counter attack was Numbers.People probably general-in-chief was not tempted Noyon and Soissons. Here, after vided in Paris a rear-guard action crease Battle Losses District; only covering Despite Slashing, Open Warfare into opposing a serious resistance to the first necessary retirements ta the retirement of the French troops the German drive south to the Vcsle the Crecy-Chavigny line, and then More Available Soon slightly to the north in the Marks Present Struggle operating and thence to the Marne. to the Kpagny-Blerancourt line, the " i June 2.- egion of Vierzy and Chaudun. LONDON, The drain of stress and anxiety of the war, am! Barnum's " power, the fall owinp to sickness and disease, which for Paris French have lost little ground. -

Juin 2013 3 Projet De SAGE Aisne Vesle Suippe Chapitre 1 : Historique Et Fonctionnement
PAGD ET REGLEMENT ; 1 88888 Projet de SAGE Aisne Vesle Suippe Sommaire Chapitre 1 : Historique et fonctionnement du SAGE Aisne Vesle Suippe ...............................4 Chapitre 2 : Le territoire du SAGE et ses enjeux - Synthèse de l’état des lieux ......................8 I- Les caractéristiques du territoire du SAGE..............................................................................8 II- Analyse du milieu aquatique existant.....................................................................................11 III- Recensement des différents usages des ressources en eau.....................................................21 IV- Evaluation du potentiel hydroélectrique ................................................................................27 V- Exposé des principales perspectives de mise en valeur des ressources en eau ......................30 Chapitre 3 : Le SAGE et sa portée juridique ............................................................................32 Chapitre 4 : Le PAGD .................................................................................................................34 I- Organisation du PAGD ..........................................................................................................34 II- Les dispositions......................................................................................................................37 Chapitre 5 : Le Règlement.........................................................................................................134 -

Archiv Für Naturgeschichte
© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at IV. Pisces für 1908. Von Prof. Dr. Karl Eckstein. (Inhaltsverzeichnis siehe am Schlüsse des Berichtes.) I. Verzeichnis der Veröffentlichungen mit Referaten. Aagard, Birger. Fängst af Fisk i smaabundne Kilenoter i e: Kile- neter, hvis Masker er mindre end 58 mm mellem Knuderne i vaad Tilstand. Norsk Fiskeritidende Bergen. 32 p. 115 ff. Salmo salar, Länge u. Gewicht junger Tiere. Aalderink, H. Nieuwe wet, veredeling der visch, verdelging der vischvijanden en stinkend water! Onze Zoetwatervischerij Utrecht. 4. p. 23. Vergiftend wirkende Abwässer machen das Aussetzen von Fischen und die Vertilgung der Fischfeinde nutzlos. Aalscholver. Onze Zoetwatervischerij . 4. p. 84. Ein Kormoran hat einen 1 Pfund schweren Aal gefressen. Abel, 0. (1). Die Anpassungsformen der Wirbeltiere an das Meeres- leben. Vortrag. Verlag des Vereins zur Verbreitung naturwissen- schaftlicher Kenntnisse in Wien. 48. Heft. 14. p. 1 —28. 6 Abb. In der Küstenregion, in der Hochsee und in der Tiefsee werden folgende Anpassungsformen unterschieden und definiert: I. Necton: fusiform, cheloniform, tritoniform, mosasauriform, taenioform. IL Benthos: depressiform, macruriform, compressiform-asymmetrisch, anguilliform, asterolepiform. III. Plankton: aculeiform, compressi- form-symmetrisch, globiform. Viele Beispiele aus der Zahl der Fische. — {%). Angriffswaffen und Verteidigungsmittel fossiler Wirbel- tiere. Verhandlungen k. k. zoolog.-botan. Ges. Wien. 1908. p. 207—217. Die fossilen Fische zeigen den Typus des Angriffsgebisses wie die lebenden Formen. Edestiden (Helicoprion), Rochen. Das Seitenorgan der Asterolepiden ist Fangapparat. Eine Kombination von Angriffs- und Verteidigungswaffen besitzt Pterichthys. Abonyi, Sandow. Über die biologische Bedeutung des silbernen Schimmers der Fische. Termet. Közl. Budapest, 40, p. 530—532. Adams, L. A. Description of the skull and separate cranial bones of the wolf-eel (Anarrhichthys ocellatus), Lawrence, No. -

THE CHATTANOOGA NEWS Vol
THE CHATTANOOGA NEWS Vol. XXXI. No. 28. Deliveieo By Carrier HOME EDITION CHATTANOOGA, TKNN., SATURDAY fcVKNINO, AUGUST 3, 1918 PRICE: THREE CENTS Twelve Cents Wek. Huns Compelled to Retreat Further East Soissons HE'S THERE I in K. C. RETIRING ON ALL RYE CONCEDES 500 ARRESTS FOLLOW Evers, Uniform, EICHORN'S MURDER BOCHES UNABLE TO MAKE to Leave for France Zurich, Aug. S. Five hun- Ready SIDES dred arrcBts have been made OFSALIENT RACE TO SHIELDS following the assassination of Field Marshal Von Fichorn nt ....... -- . ... k STAND SOUTH THE Kiev and martial law has been VESLE proclaimed there, said a dis- Allies Close at Heels on patch from a Herman source Pressing Senior Senator's Majority today, Ten German soldiers were of Retreating Foe Taking Face of Returns Slightly found murdered at Kiev. Destroying Bridges and Burning Villages, Enemy The situation throughout the whole of I'klulnia Is described Many Towns. Over 12,000. as being most critical. Retires, Hotly Pursued by Advancing French Field Marshal Von Mncken- - sen, commander of the German On Aisne - Marne Front Fourteen forces In Rumania, has pro. SOISSONS A SURPRISE ROBERTS STILL AHEAD claimed a state of siege throughout that country as a Great Fires Observed. result of the spread of the workmen's and peasants' Indications That Huns Were However, Late Returns Cut Cav-air- ) Not Expecting Qhase y Down His Lead Majori-tie- s ft. (Associated Press. in it . in.). the Lead. by Counties. London, Aug. (12:20 Hotly pursuing retreating fJoniians on the Aisne-.Mani- e trout, the allies S.- - The German re- LOCAL RETREAT London, Aug. -
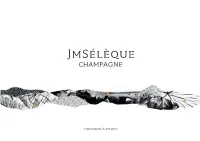
Winery Presentation
VIGNERON À PIERRY THREE GENERATION HENRI SÉLÈQUE Henri SELEQUE, Jean-Marc's grandfather, a native of Poland, arrived with his father in France in 1925. He ran a farm with his wife Francoise Bagnost for many years. His son Richard, wanted to get involved in wine, so he planted the family’s first vines in Pierry and Moussy in 1965. He sold his first bottles in 1969 thanks to the cooperative of Pierry, whose president is none other than his father-in-law Jean Bagnost. RICHARD SÉLÈQUE Richard SELEQUE, Jean-Marc's father began producing his own champagne in the 1970s. He outfitted his operation with a press, tanks, barrels, etc. Wishing to master all the stages of champagne production, he even bought his own bottling and disgorging production line. He is a true technician who still today brings all his expertise to the / THE PHILOSOPHY / THE STYLE / THE MUSIC / FIND US FIND MUSIC / THE THE STYLE/ / PHILOSOPHY THE / vineyard as well as to the cellar. JEAN-MARC SÉLÈQUE THE WINERY Jean-Marc SELEQUE arrived to the property in 2008, and took over vinification. He has since shifted viticultural practices towards a more precise expression of terroir. His approach to wine is constantly evol- ving while maintaining a spirit of authenticity. In 2015, with his wife, Oriane SELEQUE, they build a new winery. N NO NE O E Canal SO SE de l’Aisne S à la Marne la à 0 (km) 20 0 (mi) 40 Vesle Gueux Reims Vrigny Jouy-lès-Reims Sillery Ville-Dommange Sacy Montbré Puisieulx Ecueil Villers- Rilly- Beaumont-sur-Vesle Allerand la-Montagne Chamery Verzenay Chigny-les-Roses -

51St Highland Division History, Part Three
CHAPTER XIV THE GERMAN OFFENSIVE The year 1917 closed in an atmosphere of depression. Most Divisions on the Western Front had been engaged continuously in offensive operations. Some had been hurried off to Italy; all were exhausted, and either numerically weak or had been reinforced by rather indifferent material. The drain on officers had been severe during the last twelve months, and deficiencies in this respect were hard adequately to replace. The signing of the Brest-Litovsk Treaty and the complete defection of the Russians had, at the same time, enabled Germany not only to make up the wastage in her ranks, but even to increase the number of Divisions on the Western Front. There was a universal feeling that, in spite of the sacrifices of Arras and Passehendaele, and the bitter fighting at Messines, Ypres, and Cambrai, the initiative could but pass into the hands of the Germans, and that they were soon to become the aggressors. There had also been the painful incident of the ringing of the joy-bells in London, which had heralded the Germans' successful counter-attack against the shoulders of the Cambrai salient. This counter-attack had fallen on, among other Divisions, the 56th Division. It had necessitated urgent orders being sent on 30th November to the 51st Division, which was resting in the neighbourhood of Baisieux, to move at once to the Lechelle area. These orders arrived most inopportunely, as, in the first place, it was St Andrew's Day, and the numerous dinners which were to be eaten in memory of the patron saint were actually being cooked, and had to be left untouched. -

Champagne Update April 2016
Champagne Update April 2016 An Unique Appellation Champagnes can be identified by the initials that appear before a number on the wine label. • RM (meaning Récoltant-Manipulant) commonly associated with Grower Champagnes. NM (meaning Négociant-Manipulant) appear on the labels of large Champagne houses that source the majority of their grapes rather than growing them. • CM (meaning Coopérative-Manipulant) is a co-operative of growers who blend the product of their collective vineyards to sell under one or more brands. In this situation the individual grower may have some involvement in the winemaking process. Special Thank You To: • RC (meaning Récoltant-Coopérateur) is a wine sourced from a single grower but made entirely for him by a co-operative winemakingElbé & Martie facility. While the wine is sold under the grower's ownChampagne brand, he will often Jacquart have had and very Southern little if any involvementDistributers in the winemaking process. Wine Cellar in Cape Town • SR (meaning Société deGreat Récoltants) Domaines is a registered in Johannesburg firm set up by two or more growers who share the same winery which theyReciprocal use to make Trading wine to sell under their own label. This designation differs from a CM in that the growers almost always have significant involvement in the winemakingTeam process. Graham Beck Champagne – An Unique Appellation • 34 300 Hectares over 5 Departments • 319 Crus (Communes) also know as Villages • Pinot Noir 38%, Pinot Meunier 32% & Chardonnay 30% • Pinot Blanc, Arbanne, Petit Meslier, Pinot de Juillet (Rosé), Pinot Gris (named Fromenteau in Champagne) • 0.4% of Total World Vineyard Plantings • 13% of Total World Bubbly Consumption • 40% of Total World Bubbly Value • 63 % of Total French Bubbly Exported @ 91% Value • Exported to 190 Countries - Roll of the CIVC The Comité Champagne is the trade association that was established in 1941, that represents the interests of independent Champagne producers (vignerons) and Champagne Houses. -

KILLED INACTION Jfismes TAKEN BY
* PAGE 6 THE OSKALOOSA HERALD. THURSDAY. AUGUST S i»IS to get out of the pocket, there is con- siderable speculation as to whether MAJOR GENERAL BIRKBECK The Official they propose to form a new line in BY the drop back the Aisne TAKEN EM UNABLE Vesle or to or COHANAIUB OTHER THREE IOWA BOYS FISMESj whether they are preparing for a new Reports of Big blow and utilize perhaps some of the first troops withdrawn from the sa- Allied Victory TROOPS TO GETFDOTING lient. TOWNS ABE TAKEN KILLED IN ACTION AMERICAN Still On the Run. AFT London, Aug. 3.—6 l>. m.—German CASUALTY LIST J Washington, D. C., 5. ENEMY STRONGHOLD FALLS ~ TODAY’S NAMES Aug. AT troops are reported to be retiring to- BT ALLIES TODAY General Pershing’s official report PEACE FIGHT. ANT ER A BITTER wards the eastern banks of the Ancre 206 AMERICANS says: The full fruits of victory in river Aveluy westward to between the counter offensive begun Albert, dis- so PUSHED BACK TWO TO THREE according to battle front AMERICAN TROOPS WITHIN SIX gloriously by Franco-American patches received here today MILES; MILES OF FISMES troops on July 18. were reaped to- STILL GOING. British Break Hun Lines. AIL READY FOR VESLE BATTLE SIGOURNEY ROY STIIL ALIVE day when the enemy who met his London, Aug. 3/— British troops second great defeat on the Marne rushing forward north of .the Somme was driven in confusion beyond occupied portions of the German front Americans, British French Now Private S. D. Shauafelt Reported the line of the Vesle. -

Multi-Biomarker Approach in Wild European Bullhead, Cottus
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by HAL-INERIS Multi-biomarker approach in wild European bullhead, Cottus sp., exposed to agricultural and urban environmental pressures : practical recommendations for experimental design Sabrina Jolly, Anne Bado-Nilles, Florent Lamand, Cyril Turies, Edith Chadili, Jean-Marc Porcher, St´ephaneBetoulle, Wilfried Sanchez To cite this version: Sabrina Jolly, Anne Bado-Nilles, Florent Lamand, Cyril Turies, Edith Chadili, et al.. Multi- biomarker approach in wild European bullhead, Cottus sp., exposed to agricultural and urban environmental pressures : practical recommendations for experimental design. Chemosphere, Elsevier, 2012, 87 (7), pp.675-683. <10.1016/j.chemosphere.2011.12.055>. <ineris-00961775> HAL Id: ineris-00961775 https://hal-ineris.ccsd.cnrs.fr/ineris-00961775 Submitted on 20 Mar 2014 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. 1 Multi-biomarker approach in wild European bullhead, Cottus sp., exposed to 2 agricultural and urban environmental pressures: practical recommendations for 3 experimental design 4 5 Sabrina Jolly1,2, Anne Bado-Nilles1,2, Florent Lamand3, Cyril Turies1, Edith Chadili1, Jean- 6 Marc Porcher1, Stéphane Betoulle2, Wilfried Sanchez1* 7 8 1. -

Atlas Cartographique Du SAGE
ATLAS CARTOGRAPHIQUE ASSOCIÉ AU PAGD ET AU RÈGLEMENT Sommaire CARTE A - Ensemble du territoire du SAGE CARTE B - Bassins versants du territoire du SAGE Bassin versant de l'Aisne amont (B1) Bassin versant de l'Aisne aval (B2) Bassin versant de la Suippe (B3) Bassin versant de la Miette (B4) Bassin versant de la Vesle amont (B5) Bassin versant de la Vesle moyenne (B6) Bassin versant de la Vesle aval (B7) Bassin versant de l'Ardre (B8) CARTE C - Vallées ou rivières citées dans le PAGD Miette (C1) Ardre (C2) Aisne (C3) L'Aisne et la Vesle axonnaise (C4) CARTE D - Zones de tension quantitave ou d'assecs CARTE E - Captages prioritaires identifiés par le SAGE CARTE F - Sols tertiaires CARTE G - Zones à dominante humide CARTE H - Patrimoine naturel du territoire du SAGE CARTE I - Obstacles aux écoulements et classement des cours d'eau CARTE J - Sensibilité des sols à l'érosion en 2007 SAGE Aisne Vesle Suippe Limites du SAGE Aisne Vesle Suippe B1 : Bassin versant de lRAisne amont Limites du bassin versant Limites du département ASFELD PROVISEUX-ET-PLESNOY AVAUX EVERGNICOURT GuignicourtGuiGuignicourtGuigngnicourticourt VIEUX-LES-ASFELD 08 02 Ardennes Guignicourt Aisne NEUFCHATEL-SUR-AISNE MENNEVILLE VARISCOURT L'AisneL'Aisne 0 7,5 51 Marnes kilom tres Limites du SAGE Aisne Vesle Suippe B2 : Bassin versant de lRAisne aval Limites du bassin versant Limites du département PROUVAIS CORBENY CRAONNE SANCY-LES-CHEMINOTS Guignicourt 08 AIZY-JOUY OSTEL BRAYE-EN-LAONNOIS OULCHES-LA-VALLEE-FOULON VENDRESSE-BEAULNE PAISSY Ardennes CRAONNELLE PONTAVERT Vailly-sur-aisne