(The Last of the Mohicans) De James Fenimore
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Oneworld Readers' Guide
Oneworld Readers’ Guide The Orenda Joseph Boyden 1640s, The New World In the remote winter landscape a brutal massacre and the kidnapping of a young Iroquois girl violently re-ignites a deep rift between two tribes. The girl’s captor, Bird, is one of the Huron Nation’s great warriors and statesmen. Years have passed since the murder of his family, and yet they are never far from his mind. In the girl, Snow Falls, he recognizes the ghost of his lost daughter, but as he fights for her heart and allegiance, small battles erupt into bigger wars as both tribes face a new, more dangerous threat from afar. Travelling with the Huron is Christophe, a charismatic missionary who has found his calling among the tribe and devotes himself to learning and understanding their customs and language. An emissary from distant lands, he brings much more than his faith to this new world, with its natural beauty and riches. As these three souls dance with each other through intricately woven acts of duplicity, their social, political and spiritual worlds collide - and a new nation rises from a world in flux. About the Author Joseph Boyden’s first novel, Three Day Road, was selected for the Today Show Book Club, and it won the Rogers Writers’ Trust Fiction Prize, the Amazon.ca/Books in Canada First Novel Award, as well as numerous others. His second novel, Through Black Spruce, was awarded the Scotiabank Giller Prize and named the Canadian Booksellers Association Book of the Year; it also earned him the CBA’s Author of the Year Award. -

The Heritage Gazette of the Trent Valley Volume 19, Number 1, May 2014
Heritage Gazette of the Trent Valley, volume 19, number 1, May 2014 1 ISSN 1206-4394 The Heritage Gazette of the Trent Valley Volume 19, number 1, May 2014 President’s Corner: Going, Going Gone ….…………………………….…….…………..……………… Susan Kyle 2 The Dummer Murders: Jane Payne and David Doughty, 1872 …………………………………… Elwood H. Jones 3 From Pontypool to Peterborough: continuing the memoirs of Thomas Alvin Morrow: The Light of Other Days Around Me, part 3 …………………….………………….. Thomas A. Morrow 8 Turnbull Disaster ……………………………………………………………….………….………….. F. H. Dobbin 17 Hazelbrae Barnardo Home Memorial 1910-1911 ……………………………….…………… John Sayers, Ivy Sucee 18 Awareness about Samuel de Champlain in 1615 ……………………………………………………………………… 23 Champlain Was Here ……………………………………………………………………………… Elwood H. Jones 23 The Orenda: First Nations and Champlain ………………………………………….. Peter Adams and Alan Brunger 25 Biographical Sketches in Mulvany’s 1884 history of Peterborough County …………………………………………. 26 Big Island in Pigeon Lake ……………………………………………………………………………… Grace Barker 34 Big Island Stock Farm ……………………………………………………………………………George J. Johnson 36 Queries ………………………………………………………………………… Heather Aiton Landry, Pat Marchen 37 Hidden for a Century; Windover; Maher; Fleming Trent Valley Archives …………………………………………………………………………………………. Editor 38 Grosse Isle Trip, 38; Rice Lake Tour, 38; Annual General Meeting of TVA, 38; 2014 June Callwood Award Recipients, 39; June Callwood Outstanding Achievement Award to TVA, 39; Keith Dinsdale Award, 39; Land Records Indexing Project Volunteers Win Cultural Heritage Award, 40; We Need Your Assistance, 41; Books Available from Trent Valley Archives Bookshelf, 41; TVA and SPARK, 42; World Wars Commemoration, 42; John M. Turner Honoured, 42; From a 1936 Scrapbook, 43; Other Recent Additions to Our Holdings, 43; Aerial View of Canada Packers, c. 1947, 44 Look to our webpage for the latest developments around Trent Valley Archives. -

Living in the New World
February 15 – May 6, 2018 A Special Collections Exhibition at Pequot Library LIVING IN THE NEW WORLD Exhibition Guide Living in the New World CONTENTS Thoughts .................................................................................................................................................................................. - 3 - Discussion Topics ..................................................................................................................................................................... - 6 - Vocabulary ............................................................................................................................................................................... - 7 - Suggested Reading .................................................................................................................................................................. - 9 - Reading List for Young People ............................................................................................................................................. - 9 - Reading List for the perpetually Young: ................................................................................................................................ - 9 - Internet Resources ................................................................................................................................................................ - 11 - Timeline ................................................................................................................................................................................ -

Jean De Brébeuf
Jean de Brébeuf “Brebeuf” redirects here. For other uses, see Brebeuf (disambiguation). Saint Jean de Brébeuf (March 25, 1593 – March 16, 1649) was a French Jesuit missionary who traveled to New France (or Canada) in 1625. There he worked pri- marily with the Huron for the rest of his life, except for a short time back in France in 1629-1633. He learned their language and culture. In 1649 Brébeuf and several other missionaries were cap- tured when an Iroquois raid took over a Huron village. Together with Huron captives, the missionaries were rit- ually tortured and eight were killed, martyred on March 16, 1649. Brébeuf was beatified in 1925 and canonized as a saint in the Roman Catholic Church in 1930. 1 Biography 1.1 Early years North American Martyrs Brébeuf was born 25 March 1593 in Condé-sur-Vire, Normandy, France.[1] (He was the uncle of poet Georges de Brébeuf). He joined the Society of Jesus in 1617 at the with Father Anne Nouée. Brébeuf worked mostly with [2] age of 24, spending the next two years under the direc- the Huron, an Iroquoian-language group, as a missionary tion of Lancelot Marin. Between 1619 and 1621, he was in North America. Brébeuf briefly took up residence with a teacher at the college of Rouen. Brébeuf was nearly ex- the Bear Tribe at Toanché. Brébeuf met with no success. pelled from the Society when he contracted tuberculosis He was summoned to Quebec because of the danger to in 1620—an illness which prevented both studying and which the entire colony was then exposed by the English, [3] teaching for the traditional periods. -
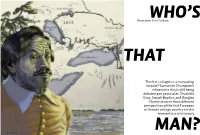
Samuel De Champlain's Influence in 1615 Is Still Being Debated 400
IllustrationWHO’S Ben Clarkson THAT The first cottager or a marauding invader? Samuel de Champlain’s influence in 1615 is still being debated 400 years later. Charlotte Gray, Joseph Boyden, and Douglas Hunter present three different perspectives of the first European in Ontario cottage country on this momentous anniversary 78 cottagelife.com Summer 2015 MAN? By Charlotte Gray 1615: A SPACE ODYSSEY The rocky pink islands of Georgian Bay, aglow in vivid sunsets. The sparkling, shallow waters of the French River and the tree-fringed lakes in the Kawarthas. Stands of majestic pines, their needle- was the toughest leg of the trip: the forty- heavy boughs rippling in the wind. ish explorer, his interpreter, a servant, That’s what we love about Ontario’s and 10 Algonquin guides must have had cottage country, right? This is our “wil- a wretched time paddling and portaging derness.” We overlook the buzz of Jet two large canoes through, in his words, Skis and the invasive species everywhere “an ill-favoured region…barren and unin- so that we can wallow in the idea that habited,” full of “rocks and mountains.” we are communing with nature. We Only the abundance of blueberries raised assume that our summer sojourns on his spirits. At first glance, it seems much this landscape are surface scratches the same today. But a closer look at the on its immutable ecology. map reveals that, thanks to a mining Not so. Southern Ontario was once frenzy 300 years after Champlain strug- covered in first-growth oak, birch, maple, gled across the land, tailings piles and and pine forests. -

The Orenda by Joseph Boyden ______
The Orenda by Joseph Boyden __________________________________________________________________________________________ About the author: Joseph Boyden became widely known in Canada following the publication of his debut novel Three Day Road in 2005, which won numerous awards and was nominated for a Governor General’s Award. His second novel, Through Black Spruce, won the 2008 Scotiabank Giller Prize and was named the Canadian Booksellers Association Book of the Year. Joseph Boyden is of Irish, Scots, and Métis descent and the son of a highly decorated medical officer of World War II (Raymond Wilfrid Boyden). In 2012, Boyden received the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal for his contributions to Canadian art and culture. He divides his time between Louisiana, where he teaches creative writing at the University of New Orleans, and the James Bay area of Ontario, where he is an accomplished hunter, trapper, and bushman. Source: Penguin Random House Canada (http://penguinrandomhouse.ca) & The Canadian Encyclopedia (http://www.thecanadianencyclopedia.ca) About this book: The Orenda was a finalist for the Governor General’s English Language Prize (2013), the Scotiabank Giller Award (2013), won the Libris Book of the Year Award (2014) and the 2014 Canada Reads competition. Ambitious in scope yet deeply intimate in its execution, The Orenda is a riveting saga of the first encounters between the native populations of New France and the Jesuit missionaries who attempt to convert them. This defining moment of human history is rendered in exquisite detail, told through the alternating perspectives of a young Iroquois girl, a Huron warrior, and a French missionary. April 2016 In prose as luminous as it is brutal, their stories illuminate the great moral complexities that arise when these cultures are forced to co-exist. -

November 2015
Heritage Gazette of the Trent Valley, Vol. 20, no. 3 November 2015 ISSN 1206-4394 herITage gazeTTe of The TreNT Valley Volume 20, Number 3, NoVember 2015 President’s Corner: Great Open House and more ………………….…………………….……… Guy Thompson 2 British Bowlers in Peterborough ………………………………………………….……………. Elwood H. Jones 3 Great Find in Upper Canada Sundries: Petition of the inhabitants of Peterborough ………..… George A. Neville 6 Everist Heath, Peterborough’s Tom Thumb ……………………………………………………. Elwood H. Jones 9 Anniversary of Champlain’s time here celebrated …………………………………………………. Dale Clifford 11 Buildings shown on Bird’s Eye View 1895: Peterborough, Ontario ……………………………………………… 12 Samuel Strickland plaque at Nicholls’ Oval ………………………………………………..……… Dale Clifford 16 John Bowes: Greater Peterborough ………………………………………………………………………………… 16 150-year history celebrated at the Pig’s Ear …………………………………….………………….. Paul Rellinger 17 Laurier came to Peterborough in October 1904 …………………………………………………. Elwood H. Jones 18 Trent Valley Archives happenings …………………………………………………………………………………. 20, 26 Peterborough Courthouse and Jail had interesting history ………………………………….……. Elwood H. Jones 21 The saga of Samuel Lowry’s Jacquard Loom ……………………… annie, Craft, Design, Festivals, Trout in Plaid 24 Samuel Strickland farmed at Nicholls Oval in 1820s ……………………………….……………. Elwood H. Jones 27 Plaque for Champlain’s Rest at Bridgenorth rededicated, September 19 …………………………………………… 32 Trent Valley Archives News and Queries ……………………………. Heather Aiton Landry and Elwood H. Jones 33 MAIG Open House, 33; Recent Accruals and New Collections, 33; Patrick Mahoney, 35; John Dunbar, 35; Henry Humphries, 35; Burnham/ Knowles, 35; Major’s Hill Park, Ottawa, 36; Tom Thumb Golf, 39; Betty P. Beeby died, 39; Hazelbrae Barnardo Home Memorial 1914 …………………………………………….. John Sayers and Ivy Sucee 37 A World War II Novel about Fort Ste Marie ………………………………………… Alan Brunger and Peter Adams 40 Looking Ahead to the 2016 SPARK Photo Festival ……………………..………………………. -

72 Native American Warfare, Before European Contact, Is Char- Acterized
CULTURAL ASPECTS OF WARFARE: THE IROQUOIS INSTITUSION OF THE MOURNING WAR CANDICE CAMPBELL This paper was written for Dr. Shirley’s Senior Seminar course. Native American warfare, before European contact, is char- acterized as primitive warfare due to their lack of territorial gain or economic advancement. The Iroquois, specifically, based their warfare on social continuity and spiritual growth. Death in Iroquois society is a direct correlation to the level of tribal spiritu- ality and strength. Sustainability of this strength is maintained through adoption and Mourning War. Mourning War (as these were called due to their emphasis on the deceased) assured the spiritual power of the clan would be preserved. The encounter of Europeans and the Iroquois drastically changed the Iroquois society and their methodology of warfare. Europeans brought disease and commerce, which in turn proved disastrous to these tribes. By the early sixteenth century, the definition of the Mourning War had changed. Warfare began as a cultural answer to death and diminishing power within the Iroquois soci- ety; however, after contact with Europeans, this tradition evolved into a detrimental cycle of destruction. Older histories attribute Iroquois warfare to various different rationales. Scholars of the nineteenth century tended to portray the warfare of the northeastern Native Americans as an innate cultural or racial predisposition. They were seen as possessing an “intractable spirit of independence, and pride which…rein- force…that savage lethargy of mind from which it is so hard to rouse him.”1 Tragically, this aided in the ideas of Indian sav- agery. Twentieth century historians tended to reject these earlier notions and began to concentrate on the economic factors of warfare. -

A Quest for Meaning at the Early 16Th-Century St
A QUEST FOR MEANING AT THE EARLY 16TH-CENTURY ST. LAWRENCE IROQUOIAN MAYNARD-McKEOWN SITE By Joyce M. Wright Department of Anthropology McGill University, Montreal July 2009 A thesis submitted to McGill University in partial fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy. © Joyce M. Wright Library and Archives Bibliothèque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l’édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-61805-9 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-61805-9 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L’auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant à la Bibliothèque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l’Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, à des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, électronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L’auteur conserve la propriété du droit d’auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protège cette thèse. Ni thesis. Neither the thesis nor la thèse ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent être imprimés ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

Rewarding Civility in Canada's Battle of the Books
REWARDING CIVILITY IN CANADA’S BATTLE OF THE BOOKS REWARDING CIVILITY IN CANADA’S BATTLE OF THE BOOKS: CANADA READS AND THE POLITE DISCOURSE OF ELIMINATION By JEREMY D. HAYNES, BAH, MA. A Thesis Submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy McMaster University © Copyright by Jeremy Haynes, 2018 Descriptive Note McMaster University DOCTOR OF PHILOSOPHY (2018) Hamilton, Ontario (English) TITLE: Rewarding Civility in Canada’s Battle of the Books: Canada Reads and the Polite Discourse of Elimination AUTHOR: Jeremy D. Haynes (McMaster University) SUPERVISOR: Dr. Daniel Coleman NUMBER OF PAGES: viii, 194 ii Abstract This thesis looks at three seasons of the Canadian Broadcasting Corporation’s (CBC) radio show Canada Reads – 2014, 2015, and 2016. I examine how each year’s debates over reconciliation (2014), inclusive multiculturalism (2015), and Canada’s role as a global refuge (2016) commonly presume a national mythology that Indigenous peoples have either disappeared or become “Canadian.” I argue that despite the show’s desire to build a better society through encouraging Canadians to read Canadian books, the debates featured on Canada Reads reflect the way assumed Canadian control of Indigenous lands is embedded in the language of Canadian literature and culture to both limit the political disruptiveness of Indigenous presence and reproduce ongoing colonial domination. Central to my argument is the sad truth that, even as the show invites diverse critiques of Canadian society, it nonetheless favours stereotypical narratives of Canadian multiculturalism, benevolence, and civility, and by doing so buttresses Canada’s unchanged status as a settler colonial state. -

Nova Scotia, New Brunswick & Prince Edward Island
GRAND CIRCLE TRAVEL PLANNING GUIDE The Canadian Maritimes: Nova Scotia, New Brunswick & Prince Edward Island 2022 Learn how to personalize your experience on this vacation Grand Circle Travel ® Worldwide Discovery at an Extraordinary Value 1 Grand Circle Travel ® 347 Congress Street, Boston, MA 02210 Dear Traveler, At last, the world is opening up again for curious travel lovers like you and me. Soon, you’ll once again be discovering the places you’ve dreamed of. In the meantime, the enclosed Grand Circle Travel Planning Guide should help you keep those dreams vividly alive. Before you start dreaming, please let me reassure you that your health and safety is our number one priority. As such, we’re requiring that all Grand Circle travelers, Program Directors, and coach drivers must be fully vaccinated against COVID-19 at least 14 days prior to departure. Our new, updated health and safety protocols are described inside. The journey you’ve expressed interest in, The Canadian Maritimes: Nova Scotia, New Brunswick & Prince Edward Island vacation, will be an excellent way to resume your discoveries. It takes you into the true heart of the Canadian Maritimes, thanks to our groups of 42 travelers (with an average of 30). Plus, our Canadian Program Director will reveal their country’s secret treasures as only an insider can. You can also rely on the seasoned team at our regional office in Boston, who are ready to help 24/7 in case any unexpected circumstances arise. Throughout your explorations, you’ll meet local people and gain an intimate understanding of the regional culture. -

Supporting the Boomers As Society Ages, We Need to Look Squarely at the Coming Social Impact
How did Gandhi do it? PAGE 25 Visit reviewcanada.ca for web-exclusive essays and reviews $6.50 Vol. 21, No. 8 October 2013 Sandra Martin Supporting the boomers As society ages, we need to look squarely at the coming social impact ALSO IN THIS ISSUE Terry Glavin David Crane Peter Russell The dogs of Afghanistan Stagnate or innovate? The Getting aboriginal rights right quest for new Canadian jobs PLUS: NON-FICTION Bronwyn Best on Canada and Japan + Reg Whitaker on the “notorious” Cuban Five + Jim Roots on the architecture of deafness + Walter deKeseredy on misreading male aggression + Stephen Henighan on the story of Spanish + Andrew Woolford on the clearing of Publications Mail Agreement #40032362 the midwestern plains Return undeliverable Canadian addresses to LRC, Circulation Dept. FICTION Marian Botsford Fraser reviews The Orenda by Joseph Boyden + Jack Kirchhoff reviews PO Box 8, Station K Toronto, ON M4P 2G1 Emancipation Day by Wayne Grady POETRY Kyeren Regehr + Guy Ewing + W.M. Herring + Barry Butson New from UNIVERSITY OF TORONTO PRESS Memoirs and Reflections Who Is an Indian? Along a River by Roy McMurtry Race, Place, and the Politics of Indigeneity The First French-Canadian Women in the Americas ‘Roy McMurtry took the justice system by by Jan Noel edited by Maximilian C. Forte the hand and led it fearlessly out of its Along a River is a remarkable history of indifference into a commitment to fairness. This collection examines the changing roles the first French-Canadian women including In just one generation. Remarkable!’ of race and place in the politics of defining Governor’s wives, farmers, nuns, and even Rosalie Abella, Justice of the Supreme Court Indigenous identities in the Americas.