Histoire De Vie De Maître Kichenin Sont Innombrables
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The European Social Dialogue the History of a Social Innovation (1985-2003) — Jean Lapeyre Foreword by Jacques Delors Afterword by Luca Visentini
European Trade Union Institute Bd du Roi Albert II, 5 1210 Brussels Belgium +32 (0)2 224 04 70 [email protected] www.etui.org “Compared to other works on the European Social Dialogue, this book stands out because it is an insider’s story, told by someone who was for many years the linchpin, on the trade unions’ side, of this major accomplishment of social Europe.” The European social dialogue — Emilio Gabaglio, ETUC General Secretary (1991-2003) “The author, an ardent supporter of the European Social Dialogue, has put his heart and soul into this The history of a social meticulous work, which is enriched by his commitment as a trade unionist, his capacity for indignation, and his very French spirit. His book will become an essential reference work.” — Wilfried Beirnaert, innovation (1985-2003) Managing Director and Director General at the Federation of Belgian Enterprises (FEB) (1981-1998) — “This exhaustive appraisal, written by a central actor in the process, reminds us that constructing social Europe means constructing Europe itself and aiming for the creation of a European society; Jean Lapeyre something to reflect upon today in the face of extreme tendencies which are threatening the edifice.” — Claude Didry, Sociologist and Director of Research at the National Centre of Scientific Research (CNRS) Foreword by Jacques Delors (Maurice Halbwachs Centre, École Normale Supérieure) Afterword by Luca Visentini This book provides a history of the construction of the European Social Dialogue between 1985 and 2003, based on documents and interviews with trade union figures, employers and dialogue social European The The history of a social innovation (1985-2003) Jean Lapeyre European officials, as well as on the author’s own personal account as a central actor in this story. -
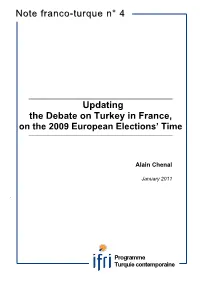
Updating the Debate on Turkey in France, Note Franco-Turque N° 4
NNoottee ffrraannccoo--ttuurrqquuee nn°° 44 ______________________________________________________________________ Updating the Debate on Turkey in France, on the 2009 European Elections’ Time ______________________________________________________________________ Alain Chenal January 2011 . Programme Turquie contemporaine The Institut français des relations internationales (Ifri) is a research center and a forum for debate on major international political and economic issues. Headed by Thierry de Montbrial since its founding in 1979, Ifri is a non- governmental and a non-profit organization. As an independent think tank, Ifri sets its own research agenda, publishing its findings regularly for a global audience. Using an interdisciplinary approach, Ifri brings together political and economic decision-makers, researchers and internationally renowned experts to animate its debate and research activities. With offices in Paris and Brussels, Ifri stands out as one of the rare French think tanks to have positioned itself at the very heart of the European debate. The opinions expressed in this text are the responsibility of the author alone. Contemporary Turkey Program is supporter by : ISBN : 978-2-86592-814-9 © Ifri – 2011 – All rights reserved Ifri Ifri-Bruxelles 27 rue de la Procession Rue Marie-Thérèse, 21 75740 Paris Cedex 15 – FRANCE 1000 – Brussels – BELGIUM Tel : +33 (0)1 40 61 60 00 Tel : +32 (0)2 238 51 10 Fax : +33 (0)1 40 61 60 60 Fax : +32 (0)2 238 51 15 Email : [email protected] Email : [email protected] Website: Ifri.org Notes franco-turques The IFRI program on contemporary Turkey seeks to encourage a regular interest in Franco-Turkish issues of common interest. From this perspective, and in connection with the Turkish Season in France, the IFRI has published a series of specific articles, entitled “Notes franco-turques” (Franco-Turkish Briefings). -

Macroeconomic and Monetary Policy-Making at the European Commission, from the Rome Treaties to the Hague Summit
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Maes, Ivo Working Paper Macroeconomic and monetary policy-making at the European Commission, from the Rome Treaties to the Hague Summit NBB Working Paper, No. 58 Provided in Cooperation with: National Bank of Belgium, Brussels Suggested Citation: Maes, Ivo (2004) : Macroeconomic and monetary policy-making at the European Commission, from the Rome Treaties to the Hague Summit, NBB Working Paper, No. 58, National Bank of Belgium, Brussels This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/144272 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu NATIONAL BANK OF BELGIUM WORKING PAPERS - RESEARCH SERIES MACROECONOMIC AND MONETARY POLICY-MAKING AT THE EUROPEAN COMMISSION, FROM THE ROME TREATIES TO THE HAGUE SUMMIT _______________________________ Ivo Maes (*) The views expressed in this paper are those of the author and do not necessarily reflect the views of the National Bank of Belgium. -

The Coming Chirac-Sarkozy Prize Fight
The Coming Chirac- Sarkozy B Y P HILIPPE R IÈS Prize Fight t the European Council last March, European journal- ists looked stunned as French President Jacques Chirac went into a lengthy rant against “liberal globalization” at his final press conference. One joked afterward that he expected Chirac to stand up, raise a tight fist, and But will France when start singing the old “Internationale” workers anthem. At the summit, Chirac, nominally a conservative, reportedly told his fellow European heads of state and it’s over be left with government that “liberalism (i.e., pro free-market and deregulation in the AEuropean meaning of the word) was the communism of our days,” a kind of fundamentalism that would deliver equally catastrophic results. any hope for the prize Actually, the tirade was not so surprising coming from a man who strongly supports a Tobin tax of a sort on international financial transactions to fund of genuine reform? development aid and regards Brazilian leftist President Lula da Silva as a “com- rade.” And if you get confused, you are not alone. So have been the French peo- ple and Chirac’s own political allies. In a political career spread over more than three decades, Chirac has earned a well-deserved reputation for ideological inconsistency. This one-time advocate of French-styled “Labour” policies (“travaillisme à la française”) has been an ineffective prime minister under President Valery Giscard d’Estaing. Back to the same position under socialist President François Mitterrand, in an arrange- THE MAGAZINE OF INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY ment called “cohabitation” (when the president and the prime minister come 888 16th Street, N.W., Suite 740 Washington, D.C. -

The Ideas of Economists and Political Philosophers, Both When They Are Right and When They Are Wrong, Are More Powerful Than Is Commonly Understood
The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back. J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (chapter 24, §V). The evolution of the international monetary and financial system: Were French views determinant? Alain Alcouffe (University of Toulouse) alain.alcouffe@ut‐capitole.fr Fanny Coulomb (IEP Grenoble) Anthony M. Endres in his 2005 book, has stressed the part player by some economists in the design of the international monetary system during the Bretton Woods era. He proposed a classification of their doctrines and proposals in a table where fifteen economists are mentioned for ten proposals (Hansen, Williams , Graham, Triffin, Simons, Friedman/Johnson, Mises/Rueff/ Heilperin/Hayek/Röpke, Harrod, Mundell). Among them only one French economist, Jacques Rueff, is to be found but he did not stand alone but merged with those of other « paleo‐liberals ». At the opposite, in his 2007 book, Rawi Abdelal pointed the predominant part played by French citizens in the evolution of the international monetary system during the last decades, especially during the building up of the euro area and the liberalization of the capital movements. The article outlines the key stages in the evolution of the international monetary system and the part played by French actors in the forefront of the scene (Jacques Delors – European commission, Pascal Lamy, WTO) or in the wings (Chavranski, OECD). -

Maes Cover.Indd 1 19/06/2004 22:58:47 EUI Working Paper RSCAS No
EUI WORKING PAPERS RSCAS No. 2004/01 Macroeconomic and Monetary Thought at the European Commission in the 1960s Ivo Maes EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE Robert Schuman Centre for Advanced Studies Pierre Werner Chair on European Monetary Union Maes Cover.indd 1 19/06/2004 22:58:47 EUI Working Paper RSCAS No. 2004/01 Ivo Maes, Macroeconomic and Monetary Thought at the European Commission in the 1960s The Robert Schuman Centre for Advanced Studies carries out disciplinary and interdisciplinary research in the areas of European integration and public policy in Europe. It hosts the annual European Forum. Details of this and the other research of the centre can be found on: http://www.iue.it/RSCAS/Research/. Research publications take the form of Working Papers, Policy Papers, Distinguished Lectures and books. Most of these are also available on the RSCAS website: http://www.iue.it/RSCAS/Publications/. The EUI and the RSCAS are not responsible for the opinion expressed by the author(s). EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE, FLORENCE ROBERT SCHUMAN CENTRE FOR ADVANCED STUDIES Macroeconomic and Monetary Thought at the European Commission in the 1960s IVO MAES EUI Working Paper RSCAS No. 2004/01 BADIA FIESOLANA, SAN DOMENICO DI FIESOLE (FI) All rights reserved No part of this publication may be reproduced, distributed or utilised in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without the prior permission in writing from the Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Download and print of the electronic edition for teaching or research non commercial use is permitted on fair use grounds—one readable copy per machine and one printed copy per page. -

A History of the French in London Liberty, Equality, Opportunity
A history of the French in London liberty, equality, opportunity Edited by Debra Kelly and Martyn Cornick A history of the French in London liberty, equality, opportunity A history of the French in London liberty, equality, opportunity Edited by Debra Kelly and Martyn Cornick LONDON INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Published by UNIVERSITY OF LONDON SCHOOL OF ADVANCED STUDY INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU First published in print in 2013. This book is published under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY- NCND 4.0) license. More information regarding CC licenses is available at https://creativecommons.org/licenses/ Available to download free at http://www.humanities-digital-library.org ISBN 978 1 909646 48 3 (PDF edition) ISBN 978 1 905165 86 5 (hardback edition) Contents List of contributors vii List of figures xv List of tables xxi List of maps xxiii Acknowledgements xxv Introduction The French in London: a study in time and space 1 Martyn Cornick 1. A special case? London’s French Protestants 13 Elizabeth Randall 2. Montagu House, Bloomsbury: a French household in London, 1673–1733 43 Paul Boucher and Tessa Murdoch 3. The novelty of the French émigrés in London in the 1790s 69 Kirsty Carpenter Note on French Catholics in London after 1789 91 4. Courts in exile: Bourbons, Bonapartes and Orléans in London, from George III to Edward VII 99 Philip Mansel 5. The French in London during the 1830s: multidimensional occupancy 129 Máire Cross 6. Introductory exposition: French republicans and communists in exile to 1848 155 Fabrice Bensimon 7. -

Intersection// Michel Rocard Perspectives// Antoine Rufenacht
INTERSECTION// Michel Rocard PERSPECTIVES// Antoine Rufenacht, Laurent Fabius, Edouard Philippe, Philippe Duron, Olaf Merck TERRItoIRES//Dominique Dron/ Dominique Lefebvre CITIES// Philip Heylen, Marc Van Peel NFÉvrier 2012 °02 CONTRIBUTIONS Michel rocard, Antoine grumbach, Antoine rufenacht, olivier breuilly, philippe duron, Ancien premier minisTRE, ARCHITECTE & URBANISTE, COMMISSaire générAL DIRECTEur générAL DÉPUTÉ-maire de AMBASSADEur de frANCE PROFESSEur à l'ÉCOLE Au déVELoppement de la de la COMPAGNIE Caen, président de pour les pôles arcTIQUE NAtionale supérieURE Vallée de la SEINE. D’EXPLOITAtion des PORTs, la cOMMUNAUTÉ et antARCTIQUE. D'ARCHITECture de PARIS- VEolia ENVIRONNEMENT. D’AGGLOMÉRAtion CAEN BELLEville (ENSAPB). la mer. laurenT fabius, daniel béhar, olaf merk, Thierry bogaert, édouard philippe, ancien premier minisTRE, GÉOGRAPHE, professeUR ADMINISTRATEur de ARCHITECte indusTRIEL, Maire du haVRE, président président de La CREA à L'IFP et à l'ÉCOLE la DIRECtion de la membre de l’ASSOCIATION de la cODah (COMMUNAUTÉ (COMMUNAuté de NAtionale des PONTs et Gouvernance publique INTERNAtionale des VILLES de l'aGGLOMÉRATION L’AGGLOMÉRAtion Rouen- CHAussées, direCTEur de et du déVELOPPEMENT PORTUaires (AIVP). HAVRaise). ELBEuf-AUSTREBERthe). la cOOPÉRAtive ACADIE. TERRITorial de l’OCDE. philippe deiss, dominique dron, dominique lefebvre, philip heylen, marc van peel, président de haropA, DÉLÉGUÉE maire de CERGY, président ÉCHEvin d’ANVERs, président du PORT GIE reGROUPant les porTS INTERMINIStérielle aU de la COMMUNAUTÉ chargé de la cULTURE D’ANVERs ET éCHEVIN du HAVRE, de ROUEN DÉVELoppement durABLE D'AGGLOMÉRAtion de et du tOURISME. de la ville. et de PARIS. et cOMMISSaire générALE CERGY- PONTOISE, Au déVELOPPEMENT VICE-président de PARIS DURable au minisTÈRE MÉTROPOLE. de l’éCOLOGIE, du DÉVELoppement durABLE, des trANSPORTs et du LOGEMENT. -

City Guide EURO 2016 GB
CITY GUIDE Editorial Welcome to our European Metropole of Lille! It’s the event we all have been waiting for: EURO 2016 is kicking off. For the occasion and since the European Metropole of Lille (MEL) is fulfilling its organizing role alongside UEFA, you will be able to find every useful information in this city guide: match schedule, latest news, and a range of practical advice to help you get around and discover the city… We all are really lucky to be right at the heart of this event, the third biggest in the world! We want the celebration to be a big one, whether at the Pierre-Mauroy Stadium or on the Fan Zone with its entertaining activities. And we want to share it with all of you, our European neighbours: Russians, Germans, Italians, Ukrainians, Irish, Swiss and Slovakians. You are of course more than welcome in our region, and you will enjoy everything we have to offer: gastronomy, history, heritage, museums… And of course the warmest welcome! A first glance will leave you wanting to discover the city further. Also be sure to benefit from most of the opportunities and to discover or rediscover all the advantages offered by MEL in terms of sport: facilities (swimming pool, ice rink, stadium), city clubs and events for all. Together, let’s savour this unique moment and stand united behind our champions. Enjoy your visit, enjoy the Euros CONTENTS WELCOME p.4-5 A EUROPEAN METROPOLE p.6-7 Damien Castelain President of European GETTING TO THE STADIUM p.8-13 Metropole of Lille The FAN ZONE p.14-17 The UEFA EURO 2016 MATCHES p.18-19 DISCOVER -

【Simone Veil Biographical Information】
【Simone Veil Biographical Information】 July 13, 1927 Born in Nice, in the south of France March, 1944 Arrested by the Gestapo in a café in Nice the day after passing the baccalaureate (high school certification exams) April 15, 1945 Liberated by the Allied forces from the Bergen-Belsen concentration camp 1945 After receiving a scholarship in autumn, jointly enrolled in the Faculty of Law at the University of Paris and the Paris Institute of Political Studies 1949 Earns bachelor’s degree from the Faculty of Law at the University of Paris, completes studies at the Paris Institute of Political Studies 1954-1956 Two-years training in the Paris Prosecutor’s Office, qualified as a Justice Department official 1957-1964 Worked at the Ministry of Justice Penal Administration Office 1964-1969 Worked at the Civil Affairs Bureau 1969-1970 Adviser to the Minister of Justice 1970-1974 Secretary General of High Council of the Judiciary (direct advisory organ to President Georges Pompidou) 1974-1976 Minister of Health (Appointed by President Giscard d’Estaing to the Jacques Chirac Cabinet) 1976-1979 Minister of Health, Social Security, and Family (President Giscard d’Estaing, Raymond Barre Cabinet) 1979-1993 European Parliament Member 1979-1982 European Parliament President 1982-1984 European Parliament Head of the Legal Committee 1993-1995 Minister of State, Minister of Social Affairs, Health and City (under coexistence government of Socialist Party President François Mitterrand and Rally for the Republic (RPR) Party Prime Minister Édouard Balladur) 1997-1998 Policy Member of the High Council of Political Policy 1998-2007 Member of the Constitutional Council of France 2000-2007 First President of the Fondation pour la Mémoire de la Shoah (Honorary President) 2003-2009 Board of Director of the International Criminal Court's Trust Fund for Victims 2007 Published the autobiography “Une vie” (Stock Company) 2010 Inducted to the Académie Française (elected in 2008) 2011 Conferred an Honorary Doctorate degree from Meiji University 【Honorary Doctorate Degree】 Mme. -

COHABITATION: the PARLIAMENTARY ASPECT of the FRENCH SEMI PRESIDENTIAL SYSTEM by Małgorzata Madej
POLISH POLITICAL SCIENCE VOL XXXVII 2008 PL ISSN 0208-7375 COHABITATION: THE PARLIAMENTARY ASPECT OF THE FRENCH SEMIPRESIDENTIAL SYSTEM by Małgorzata Madej e political system of the French Fi h Republic is referred to as “semi-presidential- ism”. is is to indicate its mixed nature – of a system presidential and parliamentary at a time. e Constitution grants broad prerogatives – and assigns serious tasks to both the head of state – le Président de la République – and the chief of government – le Premier ministre . When the prime minister represented the pro-presidential political camp, the head of state gained very serious in! uence on governing the state and political strategy (" rst, when the French political scene was dominated by the right – 1958–1981; then by the le – 1981–1986 and 1988–1993; and " nally by the right again 1995–1997 and since 2002). As early as during Charles de Gaulle presidency (1958–1969) the idea called domaine reservée came into existence. According to this political concept, the widely- interpreted external policies – including foreign a# airs and defence were recognised as presidential prerogatives, regardless the of literal construction of legal provisions. Relations within the executive changed radically with the end of political unity. During the so-called cohabitation French political practices were di# erent and they ultimately led to an amendment of the Constitution. QUASICOHABITATION 19741976 GISCARD D’ESTAINGCHIRAC PERIOD For the " rst time posts of the President of the Fi h Republic and his Prime Min- ister were taken by representatives of di# erent parties in 1974. is year the liberal Cohabitation: e Parliamentary Aspect of the French Semi-Presidential System 185 politician Valéry Giscard d’Estaing was elected president and he appointed a rightist Gaullist Jacques Chirac chief of the government. -

Resistance to Neoliberalism in France
RESISTANCE TO NEOLIBERALISM IN FRANCE RAGHU KRISHNAN AND ADRIEN THOMAS ll eyes are once again on France in the wake of hard-Right candidate ANicolas Sarkozy’s victory in the 2007 presidential elections. Main- stream media and academic commentators, especially in the Anglo-Ameri- can sphere, have heralded the Sarkozy victory as a tremendous opportunity to carry out the neoliberal reforms we are told the country requires if it is to emerge from the years of conflict and stagnation that these same commenta- tors decry with alarm and indignation. They fervently hope that president Sarkozy will stay the course of free-market reform, whatever opposition he encounters from ‘over-protected’ and ‘conservative’ sectors of the popula- tion.1 However, while the results of the presidential and legislative elections have further tilted the relationship of forces against those millions of men, women, students and youth who have taken to the streets in recent years against neoliberal reforms, it would be premature to declare the definitive triumph of neoliberalism in France. Sarkozy faces two major difficulties. The first is the breadth of the resistance to neoliberalism in France, and the eroded political legitimacy of the neoliberal project on a global scale. In the first part of our essay we explore the strengths and weaknesses of resistance to neoliberalism in France – focusing on the cycle of anti-liberal struggles and critical thinking that began with the massive strike and protest move- ment of late 1995, and the striking resilience of anti-neoliberal resistance since that time. The second difficulty Sarkozy faces is the particular character of his victory.