Radiographie De L'interactivité Radiophonique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fortin Pdf.Pdf
French Journal For Media Research – n° 5/2016 – ISSN 2264-4733 ------------------------------------------------------------------------------------ CONSTRUCTION DES IDENTITES COMMUNICATIONNELLES DANS LE DEBAT MEDIATIQUE Exemple des interactions conflictuelles dans l’émission On n’est pas couché Gwenolé Fortin Maître de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication à l’Université de Nantes docteur en Sciences du Langage Chercheur au LEMNA (Laboratoire d’Economie et de Management de Nantes- Atlantique) [email protected] Résumé S’appuyant sur un corpus constitué par des séquences issues de l’émission de France 2 On n’est pas couché, il s’agit de décrire les interactions langagières – argumentatives – comme élément constitutif à la fois de l’identité sociale des interlocuteurs et en même temps constituées par les sujets en interaction et de montrer comment elles procèdent d’une dynamique de négociation identitaire et d’un processus de co-construction de sens. Mots-clés Communication, identité, débat médiatique, conflit Abstract This article is based on a corpus of short videos from France 2’s “On n’est pas couché” and the objective is to describe the language interactions – argumentative ones- as a constitutive element of the social identity of the interlocutors. The objective is to demonstrate how those conflictive interactions stem much more from a dynamics of identity negotiation and from a meaning co-construction process. Keywords Communication, identity, media debate, conflict 1 French Journal For Media Research – n° 5/2016 – ISSN 2264-4733 ------------------------------------------------------------------------------------ « Pour être confirmé dans mon identité, je dépends entièrement des autres » Hannah Arendt Introduction Cet article s’inscrit dans un programme de recherche sur la communication et les représentations discursives. -

3268 LAG Doc De Ref 2017 LIVRE GB.Indb
REFERENCE DOCUMENT containing the Annual Financial Report FISCAL YEAR 2017 PROFILE The Lagardère group is a global leader in content publishing, production, broadcasting and distribution, whose powerful brands leverage its virtual and physical networks to attract and enjoy quali= ed audiences. The Group’s business model relies on creating a lasting and exclusive relationship between the content it offers and its customers. It is structured around four business divisions: • Books and e-Books: Lagardère Publishing • Travel Essentials, Duty Free & Fashion, and Foodservice: Lagardère Travel Retail • Press, Audiovisual (Radio, Television, Audiovisual Production), Digital and Advertising Sales Brokerage: Lagardère Active • Sponsorship, Content, Consulting, Events, Athletes, Stadiums, Shows, Venues and Artists: Lagardère Sports and Entertainment 1945: at the end of World 1986: Hachette regains 26 March 2003: War II, Marcel Chassagny founds control of Europe 1. Arnaud Lagardère is Matra (Mécanique Aviation appointed Managing Partner TRAction), a company focused 10 February 1988: of Lagardère SCA. on the defence industry. Matra is privatised. 2004: the Group acquires 1963: Jean-Luc Lagardère 30 December 1992: a portion of Vivendi Universal becomes Chief Executive Publishing’s French and following the failure of French Of= cer of Matra, which Spanish assets. television channel La Cinq, has diversi ed into aerospace Hachette is merged into Matra and automobiles. to form Matra-Hachette, and 2007: the Group reorganises Lagardère Groupe, a French around four major institutional 1974: Sylvain Floirat asks partnership limited by shares, brands: Lagardère Publishing, Jean-Luc Lagardère to head is created as the umbrella Lagardère Services (which the Europe 1 radio network. company for the entire became Lagardère Travel Retail ensemble. -
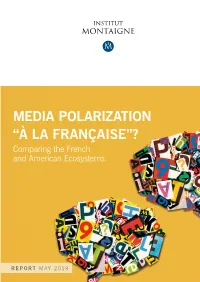
MEDIA POLARIZATION “À LA FRANÇAISE”? Comparing the French and American Ecosystems
institut montaigne MEDIA POLARIZATION “À LA FRANÇAISE”? Comparing the French and American Ecosystems REPORT MAY 2019 MEDIA POLARIZATION “À LA FRANÇAISE” MEDIA POLARIZATION There is no desire more natural than the desire for knowledge MEDIA POLARIZATION “À LA FRANÇAISE”? Comparing the French and American Ecosystems MAY 2019 EXECUTIVE SUMMARY In France, representative democracy is experiencing a growing mistrust that also affects the media. The latter are facing major simultaneous challenges: • a disruption of their business model in the digital age; • a dependence on social networks and search engines to gain visibility; • increased competition due to the convergence of content on digital media (competition between text, video and audio on the Internet); • increased competition due to the emergence of actors exercising their influence independently from the media (politicians, bloggers, comedians, etc.). In the United States, these developments have contributed to the polarization of the public square, characterized by the radicalization of the conservative press, with significant impact on electoral processes. Institut Montaigne investigated whether a similar phenomenon was at work in France. To this end, it led an in-depth study in partnership with the Sciences Po Médialab, the Sciences Po School of Journalism as well as the MIT Center for Civic Media. It also benefited from data collected and analyzed by the Pew Research Center*, in their report “News Media Attitudes in France”. Going beyond “fake news” 1 The changes affecting the media space are often reduced to the study of their most visible symp- toms. For instance, the concept of “fake news”, which has been amply commented on, falls short of encompassing the complexity of the transformations at work. -

« Avec Moi, Ça Passe Ou Ça Casse ! »
N°589 PROGRAMMES DU 30 SEPT. AU 6 OCT. 2017 RÉGIONS Les pouvoirs extraordinaires du corps humain FRANCE 2 | MARDI 20.55 Adriana Karembeu « Je suis folle des animaux ! » L’épopée du cinéma familial FRANCE 4 | MARDI 20.55 Bienvenue dans le cinéma pop-corn ! Le miroir de son époque FRANCE 3 | VENDREDI 20.55 Laurent Gerra CORINNE MASIERO par lui-même Affaires judiciaires NT1/W9 | SAM./MER. 21.00 Nathalie Renoux « Avec moi, Magali Lunel Les dames ça passe ou du crime L’homme dauphin ARTE | SAMEDI 20.50 ça casse ! » Jacques Mayol Un mythe et un CAPITAINE MARLEAU | MARDI 3 OCT. | 21H00 précurseur www.tvregions.com 0178 900 531 - VEDIASHOP.fr APPEL LOCAL ACTUS TÉLÉ Le meilleur de Twitter La Mante Nathalie Renoux et Christophe Beaugrand@Tof_ Magali Lunel Beaugrand Punaise ! En mode replay de #LaMante @TF1 c’est génial Mais fl ippant ! Excel- lents Carole Bouquet & @FredTestot Les dames Morgan Cineman@CineMorgan Rattrapé aujourd’hui les 2 pre- miers épisodes de #LaMante : Intrigue du crime palpitante, ambiance soignée, acteurs à MERCREDI À 21H00 contre-emploi épatants ! @TF1 Clémence@Cleeemmm Carole Bouquet comment elle fait froid dans le dos quand elle dit pour- La concurrence est rude entre les magazines traitant d’affaires quoi et comment elle a tué sa troisième judiciaires. Deux d’entre eux sortent pourtant du lot : Enquêtes victime... #LaMante criminelles, présenté par Nathalie Renoux sur W9, et Chroniques criminelles, présenté par Magali Lunel sur NT1. Les deux journa- lepagesandrine@amie3118 @FredTestot juste sublime dans listes évoquent les faits divers, devenus pour elle une passion. -

Sombres Aspects Du Charlatanisme
SOMBRES ASPECTS DU CHARLATANISME par Eric CHAMS J’avais clairement annoncé en note liminaire de mon article du 12 mars 2009, après une première tentative de censure, que ma charité connaissait des limites. La toute récente nouvelle tentative de faire supprimer ledit article m’oblige, tenant mes promesses, à livrer quelques nouvelles informations sur des personnages auxquels le lecteur choisira d’accoler les épithètes qu’il voudra. Sous réserve de nouveaux compléments si les censures devaient se poursuivre. Avec une touchante naïveté j'ai à la publication de textes et documents longtemps cru que les adeptes du yoga, divers auxquels la possibilité de les pratiquants de la pensée positive et s'opposer est offerte par les mêmes autres prosélytes de la méditation moyens. transcendantale devaient opposer à l'adversité qu'ils pouvaient parfois Tout ceci est d'autant plus surpre- rencontrer l'ataraxie d'un esprit zen nant que le même professeur de yoga propre à décontenancer les plus fortes est aussi le dirigeant d'une radio, Ici et têtes. Aussi tombé-je de haut en Maintenant, surnommée avec simplicité constatant avec quelle hargne tenace LA radio tant elle ne saurait souffrir la M. Didier G. dit de Plaige, lui-même moindre comparaison, et dans laquelle ancien enseignant de yoga et fondateur les auditeurs sont invités à s'exprimer d'un centre de méditation, cherche à en toute liberté. La liberté y est telle, m'empêcher d'agir sous prétexte que je d'ailleurs, qu'on peut y entendre les le fesse en public. Par mes humbles propos les plus démentiels mais aussi, écrits, s'entend. -

Perles Et Poncifs Anti-Maurrassiens
Actualité de l'édition maurrassienne, 10. PERLES ET PONCIFS ANTI-MAURRASSIENS. A) Le dossier. B) Les bibliographies. Il reste à faire... Il reste en effet beaucoup à faire pour ramener à la raison tous les détracteurs de Charles Maurras. Mais il ne suffit pas d’avoir raison, encore faut-il le faire savoir, et se donner les moyens de le faire savoir. Comme témoins de cette ignorance crasse des idées de Maurras, et donc de l'ampleur de la tâche qui nous attend, nous avons retenu ici (seulement) quatre publications, deux revues, et deux livres. [1] 1/ La première de ces publications est la revue trimestrielle ‘Codex‘ (ex 'Histoire du christianisme magazine'), dont le n°4 (été 2017) publie un dossier relatif à ‘L'Action française’ (pages 33-85), sous la direction de Jacques Prévotat. Nous en avons déjà parlé, dans notre précédente page de présentation. Si cette revue bénéficie d’une présentation irréprochable qui lui donne une coloration "officielle" et respectueuse, ce dossier n’est qu’une suite d’agressions envers Maurras et l’Action Française, un dossier militant. Le fil conducteur des textes est le soit disant paganisme de Maurras, et sa volonté d’instrumentaliser la religion catholique. Ces reproches ne sont pas nouveaux, quelques prêtres intégristes les brandissaient déjà au début du vingtième siècle, des royalistes "légitimistes" rajoutèrent une couche et fournirent l’essentiel des arguments hostiles, un avocat belge germanophile lança un ballon d’essai, la fourberie de certains clercs fit le reste, et la démocratie-chrétienne en embuscade (non complexée par sa propre condamnation), profita de l’occasion pour provoquer insidieusement l’épuration des institutions proches du Vatican, pour ensuite les coloniser. -

Lundi 10 Février 2014 - Carnets De Courtoisie — Gazette Non Officielle De Radio Courtoisie 17/02/14 16:48
lundi 10 février 2014 - Carnets de Courtoisie — gazette non officielle de Radio Courtoisie 17/02/14 16:48 Carnets de Courtoisie, gazette indépendante et non officielle de Radio Courtoisie Pour les archives de juillet 2005 à juillet 2012 cliquez ici LES CARNETS ACCUEIL PRÉSENTATION CONTACT FACEBOOK GOOGLE+ RESSOURCES DIVERS PUBS LA RADIO SITE OFFICIEL FACEBOOK OFFICIEL TWITTER OFFICIEL GÉNÉRIQUES (ALT.) TROMBINOSCOPE A L'ÉCOUTE ~ BULLETIN L'ECOUTE MP3-FLASH MP3-WMP MP3-HTML5 .MP3 .M3U LA COMPAGNIE FORUM OFFICIEL FORUM ALTERNATIF #RADIOCOURTOISIE LIBRAIRIES LES ANIMATEURS BRASSIÉ HEU MOURLET TIKHOBRAZOFF TANOÜARN ANTONY SMITS SOURGINS CLUZEL HAMICHE LOURS MAXENCE LES ANIMATEURS KERROS SUREAU ARTUR DU PLESSIS - UNA VOCE INDÉPENDANCE VIEILLE EUROPE BILD LASSALLE CHANSON TRADI. LA RÉACTION B&RB . FHE . JN . IN . NOVO . FDS . CI . AMI . O-ISM . POL . LVP . N360 . TB . RP . NDF . NA . MM . BV . E&D . OJIM . MPI . LSB . R-CATH . R&N . GEN . CA . OS DI . CM lundi 10 février 2014 16 : 48 Charles Zorgbibe ⇓ Lu 17 18:00 Henry de Lesquen Lu 17 21:15 ♫ La discothèque Lu 17 22:15 ♫ Grands interprètes 10:45 Français, mon beau souci Lu 17 23:00 ♫ Merveilles du piano Ma 18 0:00 Charles Zorgbibe R Ma 18 2:00 Henry de Lesquen R Michel Mourlet, assisté de Catherine Distinguin, recevait Gabriel Matzneff, Ma 18 6:00 Philippe Nemo R écrivain, Pierre Londiche, comédien, poète, Alfred Eibel, écrivain, critique Ma 18 7:30 Henry de Lesquen R littéraire, et Marc Favre d'Echallens, administrateur de Défense de la Langue Française, pour évoquer le retour de la littérature épistolaire. Grilles officielles : globale / sem. -

Catalogue Des Ouvrages
SERVICE ARCHIVES ECRITES ET MUSEE DE RADIO FRANCE BIBLIOTHEQUE D’ETUDE GENERALISTE ET TECHNIQUE SUR LA RADIODIFFUSION, LA TELEVISION ET LES MEDIAS CATALOGUE DES OUVRAGES La bibliothèque d’étude généraliste et technique du Service Archives écrites et Musée de Radio France regroupe près de 2000 ouvrages sur la radio, la télévision et les médias publiés du début du XX e siècle à nos jours. Présentés ici par ordre alphabétique, les ouvrages traitent prioritairement de la radiodiffusion, mais aussi de la télévision et des médias en général, selon différents angles : ⋅ Aspects politiques, administratifs et institutionnels ⋅ Histoire générale et chronologies ⋅ Aspects techniques ⋅ Politique éditoriale, contenu et traitement des programmes et des émissions ⋅ Radio France et l’audiovisuel de service public ⋅ Radios périphériques, pirates, associatives, libres, privées… ⋅ Biographies, témoignages et personnalités ⋅ Métiers de l’audiovisuel ⋅ Sociologie des médias, analyse du public, audience ⋅ Musique, programmation musicale, formations musicales de Radio France ⋅ Audiovisuel, presse et communication dans le monde ⋅ Etc. La bibliothèque d’étude comprend également : ⋅ Dossiers d’archives thématiques ⋅ Revues dont les plus anciennes datent des années vingt Documents et fonds d’archives consultables au Service Archives écrites et Musée de Radio France Le Service Archives écrites et Musée de Radio France met à la disposition des lecteurs des archives et des documents de différentes natures et de différentes provenances : ° Fonds d’archives des directions, des chaînes et des formations musicales de Radio France, conservés sur place avant leur versement aux Archives nationales consultables dans les limites des délais de classement et de communicabilité ° Documents liés à la vie institutionnelle de Radio France, reflet condensé de l’activité de l’entreprise : ⋅ Programmes diffusés : grilles, bulletins d’information destinés à la presse, communiqués de presse, etc. -

Qui Est Bernard Lugan ?
Qui est Bernard Lugan ? Bernard Jean René Lugan Né le 10 mai 1946 à Alger. Étudiant en histoire à Paris X Nanterre. Milite à la FNEF (Fédération nationale des étudiants de France) aux côtés de Jean-Pierre Stirbois, Alain Renault, le bras droit de François Duprat, et de Bruno Gollnisch. 1968 : En charge des commissaires de l’Action Française, service d’ordre du mouvement maurrassien. 1976 : Thèse de 3ème cycle. L'Économie d'échange au Rwanda de 1850 à 1914 sous la dir. de Jean-Louis Miège, Université d’Aix-en-Provence. 1972 -1982 : assistant d’histoire et de géographie coopérant. En poste à l’Université Nationale du Rwanda, à Butare puis à Ruhengeri. 1982 : recruté à l’Université Jean Moulin Lyon 3, « dans le cadre d’une procédure spéciale qui permet à d’anciens coopérants ayant des états de service, de rejoindre l’enseignement supérieur et de s’y faire ensuite titulariser » (Rapport Rousso, p. 71). Dans une lettre émanant du recteur de l’Académie de Lyon adressée au Président de l’Université de Saint Etienne, en date du 10 août 1982, il est indiqué « St Étienne n’en veut pas – proposé à Lyon 3 par le ministère ». 1983 : Thèse d’État. Entre les servitudes de la houe et les sortilèges de la vache : le monde rural dans l'ancien Rwanda, sous la dir. de Jean-Louis Miège, Université d’Aix-en-Provence. Dans le rapport de soutenance, son directeur de recherches ne cache pas "ses réticences, ouvrant une discussion approfondie sur les sources, la bibliographie et déniant au travail le caractère d'histoire fiable". -

Le Traitement Audiovisuel De La Politique : Les Recompositions Symbolico-Cognitives De La Politique À La Télévision (1996-2006) Ludovic Renard
Le traitement audiovisuel de la politique : les recompositions symbolico-cognitives de la politique à la télévision (1996-2006) Ludovic Renard To cite this version: Ludovic Renard. Le traitement audiovisuel de la politique : les recompositions symbolico-cognitives de la politique à la télévision (1996-2006). Science politique. Université Montesquieu - Bordeaux IV, 2006. Français. tel-00282245 HAL Id: tel-00282245 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00282245 Submitted on 27 May 2008 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITE MONTESQUIEU-BORDEAUX IV DROIT, SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES, SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION Ecole doctorale de Science Politique de Bordeaux LE TRAITEMENT TELEVISUEL DE LA POLITIQUE Les recompositions symbolico-cognitives de la politique à la télévision (1996-2006) Thèse pour le Doctorat en Science Politique présentée par Ludovic RENARD et soutenue publiquement le 11 Décembre 2006 2 En mémoire de mes grands-parents, Pierre & Renée R. Je voudrais dire ici ma profonde gratitude à Pierre Sadran, et, remercier les personnels de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux. 3 4 « Dans les conditions d'un monde commun, ce n'est pas d'abord la "nature commune" de tous les hommes qui garantit le réel; c'est plutôt le fait que, malgré les différences de localisation et la variété des perspectives qui en résulte, tous s'intéressent au même objet. -

L'émission Qui Fait Du Bien
N°532 PROGRAMMES DU 27 AOÛT AU 2 SEPT. 2016 RÉGIONS Secrets d’Histoire FRANCE 2 | MAR 20.55 Alexandre le Grand Commissariat central M6 | SAM 18.35 Du rifi fi chez les fl ics Esprits criminels : Unité sans frontières M6 | JEU 21.00 Sœur de fi ction Le monde en face FRANCE 5 | MAR 20.50 Maux d’esprit Silence, ça pousse ! FRANCE 5 | VEN 21.50 Jolie nature L’émission qui fait du bien SAMEDI 27 AOÛT 20H55 www.tvregions.com LE KIT PLIO LES PROTÈGE-LIVRES ASTUCIEUX SANS NI DE © 2016 Disney AP Plio 2016 180x275.indd 1 01/07/2016 10:06 ACTUS TÉLÉ Le meilleur de Twitter The Flash Mathi@weirdoklm ça doit être sympa de sortir avec Flash il te ramène un McDo ou une pizza en 2 secondes J@DyIanMan SÉRIE SAMEDI À 18H35 Meilleure série de l’histoire Smallville Meilleure série en cours THE Flash voilà. Commissariat central delena+stydia@damon_stilinski barry allen || the flash - un ange Du rifi fi dans la police tombé du ciel - t’as pas + adorable - veut sauver tt le monde - souffre trop Ce nouveau programme court de M6 met en scène les em- ployés d’un commissariat. Dans la distribution fi gurent une Moony@maryfeltwood impressionnante liste de jeunes humoristes de talent et Guy Tom Felton qui rejoint le casting de The Flash, voilà une bonne raison de Lecluyse, un vétéran des sitcoms. commencer cette série. ampanella est un spécimen. Un un vrai dissimulateur, à la fois américain, vieux briscard de la police, ringard arabe et portugais. -

Quel Rôle Pour La Radio Numérique Terrestre ?
Evolution des modes de diffusion de la radio : quel rôle pour la radio numérique terrestre ? Janvier 2015 www.csa.fr EVOLUTION DES MODES DE DIFFUSION DE LA RADIO : QUEL ROLE POUR LA RADIO NUMERIQUE TERRESTRE ? Plan Introduction .......................................................................................................................................... 4 1 L’état des lieux des modes de diffusion de la radio ........................................................................ 6 1.1 Les ondes moyennes et les ondes longues, modes de diffusion historiques de la radio ............ 6 1.2 La FM, socle du paysage radiophonique français ................................................................... 8 1.2.1 Un nombre de fréquences allouées permettant de délivrer une offre radiophonique riche et diversifiée ................................................................................................................................. 9 1.2.2 Des disparités de l’offre en FM sur le territoire............................................................... 9 1.2.3 L’état du marché publicitaire ........................................................................................ 10 1.3 Une part croissante de l’offre provenant des services sur internet ......................................... 11 1.3.1 L’internet permet aux acteurs diffusés par voie hertzienne de développer leur visibilité, et d’enrichir et diversifier leur offre ................................................................................................