Secteur Ouest Carte Jpg.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
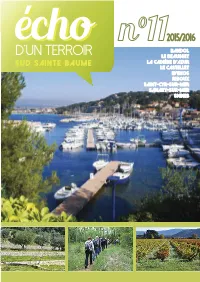
Echo D'un Terroir
n°112015/2016 échod’unécho TERROIR BANDOL LE BEAUSSET SUD SAINTE BAUME LA CADIÈRE D’AZUR LE CASTELLET EVENOS RIBOUX SAINT-CYR-SUR-MER SANARY-SUR-MER SIGNES Bandol 04 94 29 12 30 www.bandol.fr Le Beausset 04 94 98 55 75 www.ville-lebeausset.fr édito ......................................................................... p.3 La Cadière d’Azur 04 94 98 25 25 e naissance et évolution www.lacadieredazur.fr de la communauté .......................................... p.4 r le fonctionnement i de la communauté............................................ p.6 Le Castellet 04 94 98 57 90 le conseil communautaire ........................ p.7 www.ville-lecastellet.fr a les objectifs de la communauté .............. p.8 l’éducation une priorité ............................... p.9 Evenos m améliorer le cadre de vie ............................. p.11 04 94 98 50 86 www.evenos.fr promouvoir le dynamisme du territoire ....................... p.14 m développer une politique de préservation de l’environnement Riboux et du patrimoine .............................................. p.17 o 04 42 73 88 68 proposer s un tourisme culturel ...................................... p.19 Saint-Cyr-sur- Mer 04 94 26 26 22 www.saintcyrsurmer.fr Sanary-sur-Mer 04 94 32 97 00 www.sanarysurmer.com signes 04 94 25 30 80 www.signes.com 2 édito Nécessaire, oui cela l’est de préparer nos enfants à maîtriser au mieux de nouvelles technologies de l’informatique, en leur apprenant surtout à en faire le meilleur et le plus judicieux des usages, moyen de réussite supplémentaire de l’enseigne ment et surtout une valorisation de la relation entre le maître, l’élève et le savoir. Outils de remédiation aussi pour les élèves en difficulté, l’ordinateur, la tablette, le tableau interactif sont des moyens mis à disposition des enseignants et des élèves de toutes les écoles de notre territoire de Sud Sainte Baume. -

Publication of an Application for Registration of a Name Pursuant to Article 50(2)(A) of Regulation (EU) No 1151/2012 of The
C 26/8 EN Offi cial Jour nal of the European Union 27.1.2020 Publication of an application for registration of a name pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2020/C 26/05) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1) within three months of the date of this publication. SINGLE DOCUMENT ‘BROUSSE DU ROVE’ EU No: PDO-FR-02424 – 28.6.2018 PDO (X) PGI () 1. Name(s) ‘Brousse du Rove’ 2. Member State or third country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product [as in Annex XI] Class 1.3: Cheeses 3.2. Description of product to which the name in (1) applies ‘Brousse du Rove’ is a goat’s cheese presented in its original cornet used for moulding. The cornet is a truncated cone mould measuring 32 mm (diameter at the top) x 22 mm (diameter at the bottom) x 85 mm (height), with three holes pierced in the base. The cheese is produced using the milk flocculation method after heating and adding white alcohol vinegar as an acidifier. It contains a maximum of 30 grams of dry matter per 100 grams of cheese, and a minimum of 45 grams of fat per 100 grams of cheese when completely dry. Its weight is 45 to 55 grams at the end of the moulding process. -

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Service De La Communication
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Toulon, le 26 juillet 2021 SÉCHERESSE Alerte Sécheresse sur le bassin de l’Hu eaune ! les "esures de restrictions d’eau #our les co""unes de $lan d’Au#s, Ribou% et Saint&'acharie $ar "esure coordonnée a ec le dé#arte"ent des Bouches&du-Rhône qui a #lacé l’Hu eaune a"ont en situation d’alerte Sécheresse #ar arr+té #ré,ectoral du 12 juillet 2021, le #ré,et du -ar place é.ale"ent en alerte Sécheresse le bassin ersant de l’Hu eaune a"ont corres#ondant / la 0one 11 du plan d’action sécheresse 2$AS34 Les communes de Plan-d’Aups, Riboux et Saint-Zacharie sont concernées. En e,,et, le débit de l’Hu eaune a"ont a atteint des aleurs basses pour la saison4 5es derni6res "esures de l’Hu eaune a"ont / Roque aire enre.istrent des débits en dessous du seuil d’alerte Sécheresse établi à 140 l8s4 Mesures générales hors usage agricole, hors prél!vements par des canaux# Arrosa.e des pelouses 9nterdiction d’arrosa.e entre 9h et 19h et es#aces verts Réduction des prél6 e"ents de 20 ; Arrosa.e des fleurs et massi,s 9nterdiction totale d’arrosa.e entre 9h et 19h ,loraux, arbres et arbustes, jardins pota.ers, jardins d’a.ré"ent Arrosa.e des stades et es#aces 9nterdiction d’arrosa.e entre 9h et 19h s#orti,s de toute nature Réduction des prél6 e"ents de 20 ; Arrosa.e des gol,s (<3 9nterdiction d’arrosa.e entre 9h et 19h Réduction des prél6 e"ents de 20 ; 5a a.e des éhicules, bateau% 5a a.e de éhicules interdit / l’e%ce#tion des stations et en.ins nautiques "otorisés ou #ro,essionnelles écono"es en eau et des éhicules auto"obiles ou non, des -

29 Sud Sainte Baume
Belgentier, Cuges-les-Pins, Évenos, Gémenos, La Cadière-d'Azur, Le Beausset, Le Castellet, FICHE Le Revest-les-Eaux, Méounes-lès-Montrieux, Sud Sainte-Baume Riboux, Roquefort-la-Bédoule, Signes, Solliès-Toucas Bouches-du-Rhône, Var 29 Pinède de Gémenos Caractéristiques Occupation du sol Forêts 2% 1% Milieux à végétation Centre Var arbustive et/ou herbacée Monts Auréliens- Etoile- Nord Sainte-Baume Espaces ouverts, Garlaban sans ou avec peu 14% Photographie : C. Tailleux, Cemagref de végétation Maures et Le Beausset Dépression Territoires 5% Permienne agricoles 14% Territoires artificialisés Surfaces en 65% eaux > Surface boisée de production : 26 450 ha. > Surface totale : 51 950 ha. > Taux de boisement : 51 %. > Taux de boisement régional : 35 %. (> Source 1) (> Source 2) (> Source 3) L'espace forestier à dires d'acteurs > Forêt privée très représentée. > Zone de faible production (principalement bois de chauffage) avec un léger potentiel de développement facilité par une accessibilité et des conditions d'exploitation relativement bonnes. > Forte utilisation de l'espace forestier pour les loisirs de proximité. > Rôle environnemental faible. > Risque d'incendie moyen faisant apparaître des besoins d'équipements supplémentaires (débroussaillements). Traitement nécessaire des zones poudrières situées en piémont de massif (sensibilisation des petits propriétaires forestiers). > Forte pression de l'habitat diffus. > Mauvais état phytosanitaire des (> Sources 2 et 17) Occupation du sol et espaces boisés peuplements forestiers. Types d'espaces -

Mise En Page 1
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE o Adobre Stock - VOUS ATTENDEZ UN ENFANT Préparons ensemble sa venue La Protection Maternelle et Infantile est un service du Conseil départemental du Var Direction de la Communication du Conseil départemental Var : pôle création graphique IC ; imprimerie - 11-2019 Phot PARTOUT, POUR TOUS, LE VAR ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN PARTOUT, POUR TOUS, LE VAR ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN Vous attendez un enfant Pour bénéficier de la présence d’une sage-femme, prenez directement contact avec Nous avons eu connaissance de votre déclaration de grossesse par la Caisse le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) de votre commune de résidence. d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole. Les sages-femmes de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil départemental se tiennent à s LA SEYNE-SUR-MER - SAINT-MANDRIER LA SEYNE-SUR-MER : 04 83 95 49 00 la disposition des futurs parents pour des informations, une écoute, un soutien, un conseil, une consultation… s TOULON TOULON : 04 83 95 23 53 C’est avant la naissance qu’il est important de poser vos questions. s BANDOL - ÉVENOS - LA CADIÈRE - LE BEAUSSET - LE CASTELLET LITTORAL SUD SAINTE-BAUME : Vous pouvez faire appel à elles. OLLIOULES - RIBOUX - SAINT-CYR - SANARY - SIGNES - SIX-FOURS 04 83 95 27 60 s BELGENTIER - BORMES - CARQUEIRANNE - COLLOBRIÈRES - CUERS VAL GAPEAU ILES D’OR : HYÈRES - LA CRAU - LA FARLÈDE - LA GARDE - LA VALETTE - LA LONDE 04 83 95 39 50 LE LAVANDOU - LE PRADET - LE REVEST - PIERREFEU - SOLLIÈS-PONT Où rencontrer une sage-femme ? SOLLIÈS-TOUCAS - SOLLIÈS-VILLE La sage-femme peut vous recevoir lors d’une consultation au service de PMI de votre s BESSE - CABASSE - CARNOULES - FLASSANS - GONFARON - LE CANNET CŒUR DU VAR : 04 83 95 19 35 territoire ou se rendre à votre domicile pour répondre à toutes vos questions. -

Secteurs Des Assistantes Sociales Site Du Var
Secteurs des Assistantes sociales Site du Var Les Le Bourguet Chateauvieux Salles Brenon La Martre Trigance Vinon Aiguines La Bastide Baudinard Bargème Bauduen La Roque St Julien Artignosc Comps Esclapon Mons Ginasservis Régusse Vérignon La Verdière Seillans Montmeyan Moissac Rians Aups Montferrat Bargemon Callian Esparron Varages Tavernes Ampus Fayence Fox Amphoux Artigues Tourtour Chateaudouble Claviers Tourettes Montauroux St Sillans Tanneron Martin Barjols SalernesVillecroze Ponteves Figanières Callas St Paul Brue Pourrières Flayosc Auriac Entrecasteaux DRAGUIGNAN Bagnols Les Adrets Seillons Chateauvert Cotignac Ollières St Antonin La Motte Trans Bras Correns Monfort Lorgues Pourcieux St Maximin Carcès Taradeau Le Muy Puget sur Argens St Raphaël Le Val Les Arcs Vins Cabasse Le Thoronet Fréjus Tourves Roquebrune Mme Mylène GEOFFROY Brignoles St Zacharie Vidauban La Celle Agence de Brignoles Nans les Rougiers Le Luc Le Cannet Pins Camps Flassans Ste Maxime Accueil sur Rendez-Vous Mazaugues Tél : 04 94 69 68 84 Plan d’Aups La Roquebrussanne Forcalqueiret Besse Plan de Ste Gonfaron La Garde Mail : [email protected] Garéoult Anastasie la Tour Riboux Carnoules Freinet Signes Rocbaron Les Mayons Néoules Pignans Puget-Ville Grimaud Méounes Cuers St Tropez Mme Marie TIREAU Le Castellet Belgentier Pierrefeu Collobrières Cogolin Gassin La Cadière Le Ramatuelle Agence de Brignoles Beausset Solliès-Toucas La Môle La Croix Accueil sur Rendez-Vous Solliès Solliès Le Revest Pont Valmer Evenos Ville Cavalaire Tél : 04 94 69 68 88 -

Massif De La Sainte -Baume
FICHES DE CARACTERISATION DES RESERVOIRS ET DES CORRIDORS DE LA TVB PROVENCE ALPES COTE D'AZUR MMAASSSSIIFF DDEE LLAA SSAAIINNTTEE--BBAAUUMMEE CONTINUITES ECOLOGIQUES Massif de la Sainte-Baume GENERALITES Grand ensemble écologique : Arrière-pays méditerranéen Hydro-écorégions : Collines calcaires de Basse Provence NOMBRE DE RESERVOIRS DE BIODIVERSITE : - Forêt : 1 - Milieux semi-ouverts : 8 - Milieux ouverts : 0 - Eaux courantes : non dénombrés - Zones humides : non dénombrés NOMBRE DE CORRIDORS : - Forêt : 8 - Milieux semi-ouverts : 4 - Milieux ouverts : 0 CONTINUITES / SURFACE TOTALE DE LA PETITE REGION NATURELLE : 70,6 % Dont 0 % sont des espaces protégés et 15,2 % sont des zonages spécifiques PACA. COMPOSANTE VERTE COMPOSANTE BLEUE Petite région à dominante naturelle. Principaux réservoirs concernant les eaux courantes : Très majoritairement constitués de la partie amont (sources) d'un ensemble de fleuves côtiers comme l'Huveaune, le Caramy, l'Arc, l'Issole et le Gapeau ainsi que d'un affluent amont de l'Argens, le Cauron. État de la fonctionnalité très dégradé pour l'Huveaune, l'Arc, le Gapeau et l'Issole, Principales continuités écologiques : milieux forestiers et secondairement milieux semi- état dégradé pour le Caramy. Seul le Cauron est jugé comme non dégradé pour le Las. L'état de dégradation des cours d'eau est surtout lié au nombre d'obstacles présents ouverts (Mont Aurélien). ainsi qu'à une dégradation de l'état chimique (Arc et Caramy). Principales pressions : Milieux rivulaires et zones humides très peu développés à l'exception de quelques milieux rivulaires ou zones humides présents en bordure des cours d'eau. Nombreux projets d’aménagement surfaciques (Zones d’Aménagement Concerté, zones La surface totale des zones humides et milieux rivulaires est d'environ 2,5 km² (dont la quasi-totalité issue de notre travail de traitement sur Ocsol) soit 0,5 % de la surface d’extraction de granulats, projets d’énergies renouvelables, notamment sur le plateau de totale de cette région naturelle. -

N° 12 Printemps-Été 2017 Sud Sainte Baume, L’Excellence Pour L’Éducation De Notre Jeunesse! Echoprintemps2017-MANUGRAPH.Qxp Echo2017 20/06/2017 12:05 Page2
EchoPrintemps2017-MANUGRAPH.qxp_Echo2017 20/06/2017 12:05 Page1 N° 12 Printemps-été 2017 Sud Sainte Baume, l’excellence pour l’éducation de notre jeunesse! EchoPrintemps2017-MANUGRAPH.qxp_Echo2017 20/06/2017 12:05 Page2 Sommaire ÉDITO . .P.3 BUREAU COMMUNAUTAIRE . .P.4 ÉDUCATION : les Petits Reporters de Sud Sainte Baume . P.5 L’ÉCOLE DU DEVELOPPEMENT DURABLE . .P.6/7 ENVIRONNEMENT : PIDAF-La Fête des Parcs à Riboux . .P.8/9 L’AGGLO A VOTRE SERVICE : des déchèteries à votre dispositon - Mémo Tri . .P.10 TOURISME : label Vignobles et Découvertes . .P.11 TRAVAUX . .P.12/13 FINANCES . .P.14 WEB . .P.15 ÉCONOMIE : des mesures innovantes sur le Parc d’Activités de Signes . .P.16 GROS PLANS : des communes dynamiques et attractives . .P.17/20 EN SUD SAINTE BAUME : les maires évoquent les temps forts de cet été . .P.21/22 VIE DU TERRITOIRE : transport scolaire, SCoT, Très haut débit, Spanc . .P.23/24 TRIBUNES LIBRES . .P.25 JEUNESSE : des lieux culturels pour les familles, zoom sur la Maison Bleue, sites des communes . .P26/27 BANDOL LE BEAUSSET LA CADIÈRE D’AZUR LE CASTELLET ÉVENOS RIBOUX SAINT-CYR-SUR-MER SANARY-SUR-MER SIGNES COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SUD SAINTE BAUME STATUT : E.P.C.I (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) CRÉATION : en 1994 COMMUNES MEMBRES : Bandol, Le Beausset, La Cadière d’Azur, Le Castellet, Evenos, Riboux, Saint-Cyr-sur-Mer, Sanary-sur-Mer, Signes. SUPERFICIE : 35 564 hectares POPULATION : 59 978 habitants Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume 155 avenue Jansoulin 83740 La Cadière d’Azur - www.cc.sudsaintebaume.fr - Tél. -

83 Patrimoine Et Intercommunalités 5802 Logements (01/01/2015)
Alpes-de-Hautes-Provence Implantation du patrimoine de Logis Familial Varois - 83 04 Patrimoine et Intercommunalités CHATEAUVIEUX 5802 logements (01/01/2015) LE BOURGUET LES SALLES LA MARTRE -SUR-VERDON BRENON Alpes-Maritimes 14 LA BASTIDE TRIGANCE 06 Vaucluse BARGEME LA ROQUE-ESCLAPON 84 AIGUINES BAUDINARD COMPS-SUR-ARTUBY MONS 17 -SUR-VERDONBAUDUEN 18 VINON-SUR SAINT-JULIEN ARTIGNOSC -VERDON -SUR-VERDON 13 SEILLANS TOURRETTES VERIGNON 36 REGUSSE MONTFERRAT GINASSERVIS 23 MOISSAC BARGEMON 11 LA VERDIERE -BELLEVUE MONTAUROUX MONTMEYAN Var AMPUS AUPS FAYENCE 83 CALLIAN CHATEAUDOUBLE CLAVIERS 12 TAVERNES TANNERON TOURTOUR RIANS ESPARRON VARAGES FOX-AMPHOUX 19 2 SAINT-PAUL-EN-FORET VILLECROZE CALLAS SAINT 1 LES ADRETS Bouches-du-Rhône ARTIGUES SILLANS-LA -MARTIN FIGANIERES BARJOLS -CASCADE SALERNES DRAGUIGNAN -DE-L'ESTEREL 13 PONTEVES FLAYOSC 631 BAGNOLS-EN-FORET 10 56 LA MOTTE COTIGNAC SAINT-ANTONIN SEILLONS -DU-VAR TRANS-EN-PROVENCE -SOURCE BRUE-AURIAC MONTFORT ENTRECASTEAUX 15 -D'ARGENS FREJUS OLLIERES CHATEAUVERT LORGUES 15 -SUR-ARGENS PUGET-SUR 422 Patrimoine de la filiale 230 LE MUY SAINT-RAPHAEL POURRIERES CORRENS 31 CARCES TARADEAU -ARGENS Logis Familial Varois : 654 POURCIEUX BRAS LE THORONET LES ARCS 25 67 24 3 ROQUEBRUNE Nombre de logements 4 29 18 SAINT-MAXIMIN LE VAL VINS-SUR-CARAMY -SUR-ARGENS -LA-SAINTE-BAUME Implantation dans la commune 82 12 CABASSE 23 12 VIDAUBAN Intercommunalité : BRIGNOLES TOURVES 144 321 FLASSANS LE LUC 1 Nom de l'EPCI LE CANNET SAINTE-MAXIME -SUR-ISSOLE LA CELLE CAMPS 103 Périmètre de l'EPCI ROUGIERS -

Ultimate Fight Night : Une Sacrée Soirée !
Le Beausset Magazine d’informations municipales ÉTÉ 2017 N°10 Ultimate Fight Night : une sacrée soirée ! n n n n n n n n n n n n n n Edito n Chères beaussétanes, Chers beaussétans, L’école est finie alors vive le temps des vacances pour ceux qui en bénéficient ! e mag’10 vous donne bien entendu l’agenda des manifestations estivales – mais je l’avoue un peu tronqué – puisque nous étions en attente d’une décision primor- C diale concernant la rentrée scolaire : allions-nous pouvoir revenir sur la réforme des rythmes scolaires et enfin rétablir la semaine scolaire sur 4 jours ? La question était très importante pour nos familles en quête d’organisation pour septembre. Vendredi 7 juillet, la réponse de l’Académie nous est parvenue et fait droit à notre demande : retour aux 4 jours d’école selon les horaires souhaités. Alors, agenda complet des manifesta- tions de juillet / août ou info sur la rentrée du 4 septembre, j’ai choisi. De votre côté, la page facebook de la commune, les différents points d’accueil vous communiqueront tout ce qu’il y a à savoir pour un été riche d’une programmation festive et culturelle. Je suis particulièrement satisfait qu’il soit dérogé à cette réforme du gouvernement précédent, même si cette mesure intervient tardivement, à une époque où les agents du Pôle scolaire sont tout naturellement en congé. Ce premier semestre 2017 a été chargé en tensions de toutes sortes. Aujourd’hui, Le Beausset et la France ont choisi un Président de la République et lui ont donné les députés qui confortent sa ligne politique. -

Livret D'accueil Des Déchèteries Intercommunales De La
déchèteries intercommunales livret d’accueil BANDOL LE BEAUSSET SAINT-CYR-SUR-MER SANARY-SUR-MER SIGNES 3 le mot du Président 4 la communauté Sud Sainte Baume et le tri 5 carte d’accès modalités d’obtention 6 déchets acceptés 7 déchets refusés 8-9 limitation de dépôt 10 extraits du réglement 11 quelques liens utiles sommaire 12 infos pratiques 2 le mot du Président Les déchèteries intercommunales, au nombre de cinq, sont au cœur du dispositif environnemental du territoire communautaire. Je les souhaite performantes et accueillantes. Pour cela nous avons la possibilité d’agir sur les dispositifs humains et matériels avec nos partenaires. Au niveau des moyens humains, nous nous inscrivons par l’intermédiaire de l’association Kroc’Can dans le choix de l’économie solidaire et sociale en favorisant l’insertion des citoyens du territoire. Concernant les moyens matériels, un nouveau dispositif en partenariat avec le Sittomat (Syndicat mixte Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise), le « Roll-packer » a été mis en place dans chaque déchèterie, il permet de réduire le bilan carbone. En effet, compactés, les déchets prennent moins de place et les camions font donc moins de rotations pour les évacuer. Assurer un service de proximité et de qualité est notre manière d’encourager les gestes citoyens auprès des particuliers comme des professionnels. Mais, maintenir le territoire propre est également l’affaire de tous. Conteneurs, points d’apport volontaire et déchèteries ne sont que des moyens mis à la disposition de tous et il convient de prendre l’habitude d’en faire bon usage. -

TERRITOIRES Et CENTRES DE SOLIDARITE
TERRITOIRES D’ACTION SOCIALE et CENTRES DE SOLIDARITÉ Liste des centres de solidarité du conseil départemental Il est tout à fait conseillé aux chefs d’établissement de se mettre en lien avec les travailleurs sociaux de leur secteur dans le cadre de la prévention des situations d'enfants en risque de danger. En effet, les Assistantes sociales de secteur sont à même de coopérer dans la mesure où elles suivent un grand nombre de familles. TERRITOIRES D’ACTION CENTRES DE SOLIDARITE COMMUNES CONCERNEES SOCIALE LA SEYNE Centre Hermès 04 83 95 37 90 LA SEYNE SUR MER LA SEYNE – ST MANDRIER ST MANDRIER Mairie 04 94 11 51 60 ST MANDRIER les lundis et vendredis Cantons 1, 2, 3 Lazare Carnot 04 83 95 00 00 Canton 4, 5, 6 et 7 04 83 05 23 67 TOULON TOULON Canton 8 04 83 95 61 00 Canton 9 Ste Musse 04 83 16 67 15 HYERES 04 83 95 55 80 HYERES BORMES LES MIMOSAS 04 83 95 41 90 BORMES, LE LAVANDOU, LA LONDE CUERS 04 83 95 53 90 CUERS, COLLOBRIERES, PIERREFEU LA CRAU 04 83 95 56 20 LA CRAU, CARQUEIRANNE, LE PRADET VAL GAPEAU ILES D’OR LA GARDE 04 83 95 56 50 LA GARDE LA VALETTE 04 83 95 56 90 LA VALETTE, LE REVEST LES EAUX LA FARLEDE, BELGENTIER, SOLLIES-PONT SOLLIES-SOLLIES-PONT 04 83 95 46 00 SOLLIES-TOUCAS, SOLLIES-VILLE SIX-FOURS 04 83 95 41 00 SIX-FOURS Matin 04 94 10 25 75 SANARY SANARY Après-Midi 04 83 95 27 50 LITTORAL SUD STE BAUME OLLIOULES 04 83 95 58 50 OLLIOULES EVENOS, LA CADIERE, SIGNES, LE BEAUSSET, LE BEAUSSET 04 83 95 57 30 LE CASTELLET, RIBOUX BANDOL 04.83.95.52.70 BANDOL, ST CYR SUR MER BESSE, CABASSE, CARNOULES, FLASSANS, CŒUR DU