Télécharger Article
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cultura E Scienza Del Colore - Color Culture and Science Journal, 10, Pp
7 1Meriem Benkhedda [email protected] Color on Ceramics in the Medieval 2Kheira Tabet Aoul [email protected] Architecture of Tlemcen, Algeria: [corresponding author] 1Département d’Architecture, Light, Ambiance and Symbolism Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf, USTO-MB, Oran, Algeria ABSTRACT 2 Department of Architectural Engineering, College of Engineering, United Arab The architectural heritage of the Marinid and Ziyanid dynasties in the region of Emirates University, POBox Tlemcen (Algeria) is characterized by geometric and floral shapes of the ornamental 15551, Al Ain, United Arab ceramic of particularly rich polychromic expressions. This ornamentation defines Emirates the minarets, porches, interior courtyards and patios. The ceramic colors in different tones and arrangements provide spaces with an exceptional quality that highly characterizes this medieval Arab architecture. The polychromic compositions of the ceramic with their intrinsic spatial and aesthetical value remain largely unexplored. This research attempts to explore first, an untapped ancestral know-how or “savoir- faire” and second, to demonstrate that this architectural heritage has a colorful atmosphere, whose evolution is linked to the relationship between shapes, lights, materials and colors as well as its socio-cultural context. The investigation method consists of a survey of colors on ceramics and an analysis of arrangement patterns between colors and geometry (relationship and mixtures of colors) to determine the rhythms, harmonies of figures and background, optical compositions, and finally determine the color language and agreements that result. Color properties, the subtle combination of colors and materials interacting with an exquisite geometry display a decisive influence on the appearance and the ambiance that emerge, providing brightness and light, creating rhythm, motley and fusion in a web of optical effects, filled with symbolism, suitable for the cultural and religious circumstances of the place. -

Casablanca ENG.Indd
2 3 Casablanca SPAIN MEDITERRANEAN SEA Saïdia Rabat ATLANTIC OCEAN 5 Editorial Zagora 6 A city with the ocean on its doorstep 8 A city of the future ALGERIA CANARY ISLANDS 10 The Hassan II Mosque 12 Casablanca, a happening city 16 Experiencing the city 18 Activities in the city 20 Casablanca, seaside resort 22 The Casablanca region 26 Information and useful addresses MAURITANIA 4 5 Editorial Casablanca, an exhilarating megalopolis The sun is scarcely above the horizon and Casablanca is already waking up. Little red taxis play dodgems at the feet of the white city’s ultra-modern buildings. There is no escaping the allure of its grandeur, its pure energy, and all of a sudden we ourselves are imbued with the same heady dynamism. Casablanca, economic heart of the Kingdom, lives at a frenetic pace. Business and art go side by side here, often intermingling. It is here, above all, that tones and trends are set. Why is it that so many artists have found their inspiration in Casablanca? Perhaps the contrasting curves of its Art Deco buildings are enough to cast a spell over them. The richness of the city’s architectural heritage is sufficient in itself to call forth the image of a city where time has no hold. Charged with In Casablanca, modern history yet resolutely turned towards the future, this most cosmopolitan of cities, buildings stand side where every nationality is represented, parades its modernity for all to see. by side with Arab-An- dalusian architecture and Art Deco creations Morocco’s economic nerve centre and keeper of a unique historical heritage, from the 1920s Casablanca reveals all of its many faces to us. -

Medersa Sehrij
• Medersa Sehrij (D9) • Sidi Ahmed Tijani Mausoleum (C8) • Complexe Nejjarine (C7) • Nejjarine Fontain (C7) • Seffarine Square (C8) the centre of the palace and the courtyard Founded by the Merinid Situated close to the Qaraouiyne It is about one of the The Fountain extends the This is one the most interesting decorated with zellij cover 60% of the total Sultan Abou-l-Hassan Mosque, this mausoleum was most beautiful urban and funduq towards the center sites in the medina because it built in memory of the famous surface of the monument. The Museum between 1321 and 1323 saint, Sidi Ahmed Tidjani (died architectural complexes in of Nejjarine Square and is contains one of the oldest crafts is opened every day from 9:00 am until A.D, this medersa was named in 1815), founder of the most Fez. This complex, organized an important component of in Fez: copper work. Craftsmen 17:00 pm (except Tuesday). after the basin (Sehrij) at the important Islamic brotherhood around a place (Saha) consists the urban architecture of the still work copper and brass to in West Africa. The numerous Admission is charged. centre of its courtyard. Its of a foundouk (today museum Square. Built in the mid- make utensils such as teapots, African disciples of the Tijaniya • Borj Nord (B5) layout, architecture and rich Sufi order never fail to visit of the wood), of a fountain 19h century, this charming trays, goblets and pots. decoration of the interior the mausoleum to renew their and a souk. The name of fountain is the most complete This fortress now holds the facades illustrate the beauty of Arabo- commitment often coming to Fez after their complex derives from its specialization in example of a typical Fassi public fountain. -

The Magic of Morocco
10028 T HE M ETROPOLITAN M USEUM OF A RT T HE M AGIC OF M OROCCO From her dazzling royal palaces and ancient m Palaces, Deserts & Kasbahs She has t We begin in Morocco’s capital, Rabat, encircled by 8th-century pink stone r Following two nights at the elegant Sofitel Jardin des Roses, w Experiencing life as lived by the pashas, w Among the splendid sights is the a Discover the 1,200-year- o Also experience the peace and beauty o As p April 1 to 12, 2011 1 10028 T HE M ETROPOLITAN M USEUM OF A RT Dear Members and Friends of The Metropolitan Museum of Art, Morocco, a country which is a mélange of European, Arab and Berber cultures, has long fascinated travelers. From her dazzling royal palaces and ancient medinas to the awe-inspiring Sahara and rugged Atlas Mountains, this is a land that delights the senses. Accompanying us is Josephine Berger-Nadler, known for her lively and popular talks on the Metropolitan’s collections of Islamic, Southeast Asian and ancient Near Eastern art. She has traveled extensively in North Africa and is very pleased to be returning with us to Morocco to share her enthusiasm for the country’s rich culture. The imperial cities of Rabat and Fes, as well as enchanting Marrakesh, are the focus of this program. We begin in Morocco’s capital, Rabat, encircled by 8th-century pink stone ramparts that survive to this day. Following two nights at the elegant Sofitel Jardin des Roses, we travel on to Fes, stopping en route to visit the ancient Roman city of Volubilis, whose forum and Arch of Caracalla still tower over the plain. -
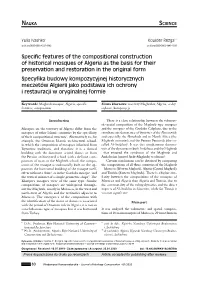
Specific Features of the Compositional Construction Of
NAUKA SCIENCE Yulia Ivashko* Kouider Rezga** orcid.org/0000-0003-4525-9182 orcid.org/0000-0002-1843-1605 Specific features of the compositional construction of historical mosques of Algeria as the basis for their preservation and restoration in the original form Specyfika budowy kompozycyjnej historycznych meczetów Algierii jako podstawa ich ochrony i restauracji w oryginalnej formie Key words: Maghreb mosque, Algeria, specific Słowa kluczowe: meczety Maghrebu, Algeria, cechy features, composition stylowe, kompozycja Introduction There is a close relationship between the volumet- ric-spatial composition of the Maghreb type mosques Mosques on the territory of Algeria differ from the and the mosques of the Cordoba Caliphate, due to the mosques of other Islamic countries by the specificity simultaneous dominance of dynasties of the Almoravids of their compositional structure1. Alternatively to, for and especially the Almohads and in North Africa (the example, the Ottoman Islamic architectural school, Maghreb countries) and the Perinea Peninsula (the so- in which the composition of mosques inherited from called Al-Andalus)3. It was this simultaneous domina- Byzantine traditions, and therefore it is a domed tion of the dynasties in both Andalusia and the Maghreb building with the dominant central dome; or from that ensured the symbiosis of the Maghreb and the Persian architectural school with a definite com- Andalusian (united Arab-Maghreb) traditions4. position of iwan; in the Maghreb school, the compo- Certain conclusions can be obtained by comparing sition of the mosque is traditionally built on the op- the compositions of all three countries of the Maghreb position the horizontal building of the mosque itself, – Morocco (Western Maghreb), Algeria (Central Maghreb) often without a dome, as in the Cordoba mosque, and and Tunisia (Eastern Maghreb). -

Uhm Phd 4580 R.Pdf
4550 UNIVERSiTY OF Hj~W/\n LIBRARY DIALECT LEVELING, MAINTENANCE AND URBAN IDENTITY IN MOROCCO FESSI IMMIGRANTS IN CASABLANCA A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAI'I IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN LINGUISTICS MAY 2005 By Atiqa Hachimi Dissertation Committee: Michael L. Fonnan, Co-Chairperson Miriam Meyerhoff, Co-Chairperson Patricia J. Donegan Ibrahim G. Aoude Robert J. Littman ACKNOWLEDGMENTS I would like to extend my deepest and sincere thanks to both my supervisors: Professors Michael L. Forman and Miriam Meyerhoff. Professor Michael L. Forman has been there from the very beginning and has supported me in all my endeavors. His guidance and intellectual stimulation have been instrumental in developing my understanding of sociolinguistics. I am grateful to him for introducing me to linguistic anthropology and to advising me to explore the richness of language. His kindness and sense of humor have kept me going for all these years. I am particularly indebted to my advisor and chair, Professor Miriam Meyerhoff, who has constantly been pushing me to go beyond my limits. She has always had faith in me when I believed I had already given my best. I am grateful to her for introducing me to variationist linguistics and for her brilliant insights. She gave me invaluable advice, guidance and critiqued my work, and materially improved my understanding of my own work. I am deeply humbled by her generosity and big heart. She invited me to Edinburgh to help me with my work and she was a gracious host. -

LUIS ALFONSO DE LA FUENTE SUAREZ Topic: Architecture Author
GA2010 – XIII Generative Art Conference – Politecnico di Milano University, Italy LUIS ALFONSO DE LA Paper: Architectural Complexity: Hiding the Underlying Order FUENTE SUAREZ Abstract: We see buildings but, do we understand their geometry? This paper is a perceptual approach to the comprehension of architectural composition. As we know, Gestalt Psychology is concerned with the principle of simplicity in our perception, understanding by this the way simple patterns are “easier to see” because we are inherently predisposed to find them. Gestalt principles tell us the characteristics that a figure or group of figures should have to be considered simple: continuity, closure, similarity, proximity, etc. We compose our visual world of the simple elements we find in it. Every shape would in theory be reduced to simple collections of interconnected shapes. But, while simple things are easily visible, and therefore easily comprehensible, there are some kinds of patterns, the complex ones, which are difficult to see and to comprehend. We will focus on those designs that evade to be simplified and that does not allow us to use Topic: Architecture the Gestalt laws that help us in perceiving normal objects, therefore making us difficult the creation of a mental idea of their composition. Author: This paper is about complexity of conception and difficulty of Luis Alfonso de la perception. We will focus on the ways we can “hide” or take out of Fuente Suárez view the ordering principles of architectural shapes. All ordered Polytechnic University of structures are susceptible of complication, and in architectural Catalonia, Architectural compositions ornament has an important role. -

CASABLANCA, MOROCCO Arrive: 0800 Friday, 28 September Onboard: 1800 Monday, 1 October
CASABLANCA, MOROCCO Arrive: 0800 Friday, 28 September Onboard: 1800 Monday, 1 October Brief Overview: Exotic Morocco is an intoxicating blend of sights, smells, and sounds. In Casablanca, the Hassan II Mosque (inaugurated in 1993) is the largest in the world after Mecca. The bazaars and kasbahs are fascinating to experience, and Moroccan cuisine is considered by many to be some of the best in the world. Spend an evening or a couple of days with a family to really understand the culture and the people of this intriguing country. Nearby: Rabat, an elegant, modern capital city, offers visitors a view of the historic grandeur and cultural diversity of Morocco with a smaller, more relaxed kasbah and medina. Participate in half day or full day trips such as CAS25 or CAS35. Fes: The old-town Medina of Fes will transport the visitor to another century. Citizens still gather at the local well for water, apothecary carts on the streets offer medicinal treatments, and vast open leather-dying pits are a sight to behold. Visit Meknes and explore the best-preserved Roman ruins in Morocco at Volubilis. Marrakech: The city of Marrakech is a hub of activity with an intriguing Medina and bazaar itself. It also serves as the inland base for adventures ranging from Camel Riding in Palm Groves; visiting a Nomad Camp in the mountains; a treasure hunt/zipline adventure; or the beautiful Ourika Valley. Other Destinations: Adventurers from the 2011 voyage described their trip to the Berber Villages of the High Atlas Mountains as a “transformative experience.” New by request for 2012 is a camel trek in the Sahara (CAS04) via Ouarzazate and the magical Draa Valley. -

Casablanca, Rabat, Fez, Erfoud, Merzouga, Ouarzazate, Ait Benhaddou & Marrakech
Casablanca, Rabat, Fez, Erfoud, Merzouga, Ouarzazate, Ait Benhaddou & Marrakech Your Company Name Street Address LOGO City, Province, Postal Code Phone Number: 1-800-???-???? ITINERARY AT A GLANCE DATE DAY DESCRIPTION ACCOMMODATION MEALS* Day 1 Arrive in Casablanca Le Doge Casablanca _,_,_ Day 2 Casablanca – Rabat Villa Mandarine Rabat B,_,_ Day 3 Rabat - Fez Riad Fes B,_,_ Day 4 Fez Riad Fes B,_,_ Day 5 Fez - Erfoud - Merzouga Deluxe encampment in Merzouga B,_,D Day 6 Merzouga-Ouarzazate-Ait Benhaddou Ksar Ighnda B,_,_ Day 7 Ait Benhaddou - Marrakech La Maison Arabe B,_,_ Day 8 Marrakech La Maison Arabe B,L,_ Day 9 Marrakech La Maison Arabe B,_,_ Day 10 Marrakech – Casablanca Le Doge Casablanca B,_,_ Day 11 Depart Casablanca B,_,_ *B = Breakfast, L = Lunch, D = Dinner Tourcan Vacations – 1 Your Company Name Street Address LOGO City, Province, Postal Code Phone Number: 1-800-???-???? Day 1: ARRIVAL IN CASABLANCA Flight: xx xxxx x:xxam-xx:xxpm Welcome to Casablanca. Welcome and assistance by your private English-speaking driver from our local representative who will be at your service for the duration of your stay in Morocco. Transfer to your hotel. Overnight: Le Doge Casablanca Day 2: CASABLANCA - RABAT Enjoy Breakfast at the hotel. After breakfast at the hotel transfer to Rabat, the capital of Morocco and an Imperial city located along the Atlantic Ocean. Overnight: Villa Mandarine Rabat Meals: Breakfast Day 3: RABAT - FEZ Enjoy Breakfast at the hotel. Check out of the hotel after breakfast and tour the administrative capital of Morocco visiting The Mohammed V Mausoleum; this architectural and historical masterpiece is the final resting place of three significant members of Morocco royal family, including King Mohamed V. -

Muslim Descendants of Jews in Morocco: Identity and Practice1
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Apollo Muslim descendants of Jews in Morocco: identity and practice1 Vanessa Paloma Elbaz Institut national des langues et civilisations orientales Sorbonne Paris Cité One day a young Jewish girl from Fez had a fight with her family and ran out of the mellah and banged on the doors of the mechouar (surrounding the royal palace). They opened the doors, she ran in and was never seen again. They raised her in the palace, she converted to Islam and was married to a Muslim. In 2014, she told her adult granddaughter of her story, that she was a Jewish girl from the mellah of Fez. Her granddaughter is Muslim but is puzzlingly attracted to us [older Jewish ladies], she looks just like a Jewish woman from Fez, blond with large green eyes.2 Since 2010 a small group of Moroccan Muslims with Jewish ancestry have been reintegrating parts of their Jewish identity and practice into their life. As is with any group that recaptures lost identities, identity reconstruction occurs on a continuum of practice and engagement. In Morocco, publicly identifying with Jewish ancestry seems to be emerging from being completely taboo as recently as ten years ago to some who are maintaining a firm connection to Muslim practice while acknowledging Jewish ancestry. At the furthest extreme of this continuum, a small number of young Moroccans (five cases that are known to me) are engaging with Jewish ritual practice. This article will address the negotiations around and development of this continuum of identity and practice in contemporary Morocco. -

2000 Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor February 23, 2001
Morocco Page 1 of 41 Morocco Country Reports on Human Rights Practices - 2000 Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor February 23, 2001 The Constitution provides for a monarchy with a Parliament and an independent judiciary; however, ultimate authority rests with the King, who presides over the Council of Ministers, appoints all members of the Government, and may, at his discretion, terminate the tenure of any minister, dissolve the Parliament, call for new elections, and rule by decree. The late King Hassan II, who ruled for 38 years, was succeeded by his son, King Mohammed VI, in July 1999. Since the constitutional reform of 1996, the bicameral legislature consists of a lower house, the Chamber of Representatives, which is elected through universal suffrage, and an upper house, the Chamber of Counselors, whose members are elected by various regional, local, and professional councils. The councils' members themselves are elected directly. The lower house of Parliament also may dissolve the Government through a vote of no confidence. In March 1998, King Hassan named a coalition government headed by opposition socialist leader Abderrahmane Youssoufi and composed largely of ministers drawn from opposition parties. Prime Minister Youssoufi's Government is the first government drawn primarily from opposition parties in decades, and also represents the first opportunity for a coalition of socialist, left-of-center, and nationalist parties to be included in the Government. The November 1997 parliamentary elections were held amid widespread, credible reports of vote buying by political parties and the Government, and excessive government interference. The fraud and government pressure tactics led most independent observers to conclude that the results of the election were heavily influenced, if not predetermined, by the Government. -

Minarets Des Mosquees De Tlemcen
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ Faculté de Technologie ﻗﺳم اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ Département d’Architecture Mémoire Pour l’obtention d’un Diplôme de Magister en Architecture Option : La ville, Patrimoine et Urbanisme Thème : MINARETS DES MOSQUEES DE TLEMCEN Étude architecturale et artistique Préparé par : Mr MERZOUG Noureddine Abdellatif Soutenu en 2012 Devant le jury composé de : Mr BOUMECHERA Nadir Maitre de conférences A UABB Tlemcen Président de jury Mme KASSAB Tsouria Maitre de conférences A EPAU Alger Encadreur Mr OUISSI Nabil Maitre de conférences A UABB Tlemcen Examinateur Mr BABA HAMED Hadj Ahmed Maitre assistant A UABB Tlemcen Examinateur Année Universitaire : 2011 - 2012 ﻣﻠﺨﺺ: ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺌﺬﻧﺔ ﺑﺸﻤﻮﺧﮭﺎ و ﺟﻤﺎﻟﮭﺎ رﻣﺰا ﻟﻺﺳﻼم واﻧﺘﺼﺎراﺗﮫ و ﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ , و ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮروث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺎدي و اﻟﻼﻣﺎدي اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻠﮫ ھﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ وﻛﺬا ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﺪدا ﻣﻦ أروع ﻣﺂذن اﻟﻤﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ ذو اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮﺑﺎﻋﯿﺔ.ﯾﺴﻌﻰ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺂذن ﺗﻠﻤﺴﺎن و دراﺳﺘﮭﺎ دراﺳﺔ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ و ﻓﻨﯿﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻻﺳﺘﺨﻼص أﺳﺮار ﺟﻤﺎﻟﮭﺎ و ﺗﻨﺎﺳﻘﮭﺎ . ﯾﺘﻄﺮق ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺌﺬﻧﺔ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﻤﯿﺎﺗﮭﺎ, ظﮭﻮرھﺎ , ﺗﻄﻮرھﺎ و ﺗﻨﻮع أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ و ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﯾﺘﻠﻤﺴﺎن , و ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺂذن اﻟﺰﯾﺎﻧﯿﺔ و اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻓﮭﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﮭﺎ وھﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻤﺂذن اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و ﻛﺬا اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺼﻤﯿﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺪﯾﺪة. Résumé : Le minaret, - par son élancement et sa beauté - , est considéré comme un symbole de l’Islam et ses victoires, et une expression pratique des sens de l’unicité « El tawhid ».