Jules Bourdais (1835-1915) Un Ingenieur Chez Les Architectes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport D'activité 2019 Musées D'orsay Et De L'orangerie
Rapport d’activité 2019 Musées d’Orsay et de l’Orangerie Rapport d’activité 2019 Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie Sommaire Partie 1 Partie 3 Les musées d’Orsay Le public, au cœur de la politique et de l’Orangerie : des collections de l’EPMO 57 exceptionnelles 7 Un musée ouvert à tous 59 La vie des collections 9 L’offre adulte et grand public 59 Les acquisitions 9 L’offre de médiation famille et jeune Le réaccrochage des collections permanentes 9 public individuel 60 Les inventaires 10 L’offre pour les publics spécifiques 63 Le récolement 22 L’éducation artistique et culturelle 64 Les prêts et dépôts 22 Les outils numériques 65 La conservation préventive et la restauration 23 Les sites Internet 65 Le cabinet d’arts graphiques et de photographies 25 Les réseaux sociaux 65 Les accrochages d’arts graphiques Les productions audiovisuelles et numériques 66 et de photographies 25 Le public en 2019 : des visiteurs venus L’activité scientifique 30 en nombre et à fidéliser 69 Bibliothèques et documentations 30 Des records de fréquentation en 2019 69 Le pôle de données patrimoniales digitales 31 Le profil des visiteurs 69 Le projet de Centre de ressources La politique de fidélisation 70 et de recherche 32 Les activités de recherche et la formation des stagiaires 32 Partie 4 Les colloques et journées d’étude 32 L’EPMO, Un établissement tête de réseau : l’EPMO en région 33 un rayonnement croissant 71 Les expositions en région 33 Les partenariats privilégiés 34 Un rayonnement mondial 73 Orsay Grand Département 34 Les expositions -
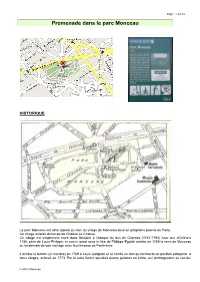
Promenade Dans Le Parc Monceau
Page : 1 sur 16 Promenade dans le parc Monceau HISTORIQUE Le parc Monceau est ainsi appelé du nom du village de Monceau situé en périphérie proche de Paris. Ce village existait du temps de Charles Le Chauve. Ce village est simplement entré dans l’histoire à l’époque du duc de Chartres (1747-1793) futur duc d’Orléans 1785, père de Louis-Philippe, et connu aussi sous le titre de Philippe Egalité achète en 1769 la terre de Monceau au lendemain de son mariage avec la princesse de Penthièvre. Il achète le terrain (un hectare) en 1769 à Louis Colignon et lui confie en tant qu’architecte un pavillon octogonal, à deux étages, achevé en 1773. Par la suite furent ajoutées quatre galeries en étoile, qui prolongeaient au rez-de- Le Parc Monceau Page : 2 sur 16 chaussée quatre des pans, mais l'ensemble garda son unité. Colignon dessine aussi un jardin à la française c’est à dire arrangé de façon régulière et géométrique. Puis, entre 1773 et 1779, le prince décida d’en faire construire un autre plus vaste, dans le goût du jour, celui des jardins «anglo-chinois» qui se multipliaient à la fin du XVIIIe siècle dans la région parisienne notamment à Bagatelle, Ermenonville, au Désert de Retz, à Tivoli, et à Versailles. Le duc confie les plans à Louis Carrogis dit Carmontelle (1717-1806). Ce dernier ingénieur, topographe, écrivain, célèbre peintre et surtout portraitiste et organisateur de fêtes, décide d'aménager un jardin d'un genre nouveau, "réunissant en un seul Jardin tous les temps et tous les lieux ", un jardin pittoresque selon sa propre formule. -

Le Paris D'haussmann
56 57 DÉMOLITIONS ET EXPROPRIATIONS le pAris La démolition des quartiers anciens entraîne l’expropriation* d’une partie de la population, qui doit quitter Paris pour s’installer en périphérie. Démolition des habitations Une grande partie de la cité médiévale disparaît du quartier de l’Opéra sous les coups de pioche, tandis que des immeubles afin de réaliser une avenue. aux façades uniformes s’alignent le long d’HAussmAnn des nouveaux boulevards. Poursuivant l’œuvre de ses prédécesseurs, le baron Haussmann, préfet de Paris de 1853 à 1870, modifie radicalement le paysage de la capitale. LES OBJECTIFS Le nouvel empereur, Napoléon III, demande Vue depuis le toit de l’Opéra de Paris Vue depuis le toit de l’Opéra de Paris montrant l’avenue au nouveau préfet, Haussmann, de poursuivre la avant le percement de l’avenue. de l’Opéra et le nouveau quartier aux immeubles bien alignés. modernisation de la ville commencée par Rambuteau. Il faut relier les gares entre elles, créer de larges avenues offrant de belles perspectives sur les monuments et faciliter les déplacements de l’armée en cas d’émeutes. Façade d’un immeuble haussmannien. « Du boulevard du Temple à la barrière du Trône, une entaille ; puis, de ce côté, une autre entaille, de la Madeleine à la plaine Monceau ; et une troisième entaille dans ce sens, une autre dans Caricature du baron Haussmann celui-ci, une entaille là, une entaille plus loin, Sur ce plan le tracé en noir du prolongement en bâtisseur- de la rue de Rivoli vers l’hôtel de ville. des entailles partout. -

Jean-Charles-Adolphe Alphand Et Le Rayonnement Des Parcs Publics De L’École Française E Du XIX Siècle
Jean-Charles-Adolphe Alphand et le rayonnement des parcs publics de l’école française e du XIX siècle Journée d’étude organisée dans le cadre du bi-centenaire de la naissance de Jean-Charles-Adolphe Alphand par la Direction générale des patrimoines et l’École Du Breuil 22 mars 2017 ISSN : 1967-368X SOMMAIRE Introduction et présentation p. 4 Carine Bernède, directice des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris « De la science et de l’Art du paysage urbain » dans Les Promenades de Paris (1867-1873), traité de l’art des jardins publics p. 5 Chiara Santini, docteur en histoire (EHESS-Université de Bologne), ingénieur de recherche à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille Jean-Pierre Barillet-Deschamps, père fondateur d’une nouvelle « école paysagère » p. 13 Luisa Limido, architecte et journaliste, docteur en géographie Édouard André et la diffusion du modèle parisien p. 19 Stéphanie de Courtois, historienne des jardins, enseignante à l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles Les Buttes-Chaumont : un parc d’ingénieurs inspirés p. 27 Isabelle Levêque, historienne des jardins et paysagiste Les plantes exotiques des parcs publics du XIXe siècle : enjeux et production aujourd’hui p. 36 Yves-Marie Allain, ingénieur horticole et paysagiste DPLG Le parc de la Tête d’Or à Lyon : 150 ans d’histoire et une gestion adaptée aux attentes des publics actuels p. 43 Daniel Boulens, directeur des Espaces Verts, Ville de Lyon ANNEXES Bibliographie p. 51 -2- Programme de la journée d’étude p. 57 Présentation des intervenants p. -
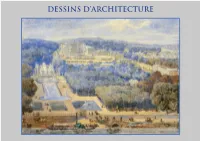
Dessins D'architecture
DESSINS D’ARCHITECTURE I. René Deminuid. Page 1 II. Auguste Roy et les frères Piat. Page 9 III. Philippe Chaperon. Page 12 IV. Françoise de La Perrière. Page 14 V. De Versailles aux Tuileries. Page 15 VI. Châteaux. Page 17 VII. Jardins. Page 22 Hommage à Monsieur Roland Pierry qui fut VIII. Paris et sa région. Page 25 l’initiateur de ces catalogues. IX. Bretagne historique. Page 28 X. Édifces religieux. Page 32 XI. Plans, terriers, travaux d’ingénieurs. Page 35 Les photographies de ce catalogue sont de XII. Divers. Page 40 Suzanne Nagy-Kirchhofer. En haut, à gauche, n° 5-a : René Deminuid, ancienne maison Danthan dans le Bois de Boulogne. En bas, à gauche, n° 6-a : René Deminuid, projet pour l’église Saint-Justin de Levallois-Perret. En haut, à droite, n° 3 : René Deminuid, Projet de brasserie dans le parc des Buttes Chaumont, « Pavillon Rosa Bonheur ». En première de couverture, n° 31 : « Vue du Palais de Saint-Cloud, de la grande cascade et du bas jardin, 1839 ». I. René Deminuid René Demimuid voit le jour à Commercy (Meuse) le 21 décembre 1835. Ingénieur diplômé en 1858 de l’École Centrale des Arts et Manufactures, il est l’élève de Gabriel Davioud et de Léon Vaudoyer à l’École des Beaux-arts où il est admis en 1859. Il est ensuite nommé inspecteur des travaux de la ville de Paris et travaille sous la direction de Davioud au service des promenades et plantations. C’est Haussmann qui a créé cet organisme pour son adjoint Alphand ; ce dernier constitue alors une équipe d’architectes sous la direction de Davioud et de paysagistes sous celle de Barrillet-Deschamps. -

I. Aquarium Du Trocadero Ii
Lucien Gratté - Survivance de l'Art pariétal –– 2ème édition PARIS - SEINE PARIS I. AQUARIUM DU TROCADERO II. Paris. IV. C'est encore une histoire de carrières, comme de nombreux sites parisiens. Il est en effet constitué d'anciennes carrières qui auraient hébergé une partie de la cavalerie de l'empereur Napoléon III. Le mélange de la paille et du crottin produit par les locataires dans un milieu humide s'avéra un terrain très favorable pour... la culture du champignon de Paris. C'est ainsi que débuta la production du champignon de Paris en ces lieux. L'aquarium de Paris fut imaginé en 1867 et aménagé dans des carrières désaffectées selon le projet de l'architecte Combaz, à proximité des sites des fréquentes expositions universelles, sous la colline de Chaillot, en face de la Tour Eiffel. L'aquarium original fut pour partie construit à ciel ouvert, pour partie construit en souterrain en imitant une grotte. Ce fut le premier aquarium au monde. On peut imaginer l'émerveillement du public du XIXème siècle, de tous ces enfants qui n'avaient même jamais vu la mer et qui se retrouvaient soudain plongés ainsi au milieu des poissons. Il fut ensuite transformé, agrémenté d'une rotonde et modernisé pour l'exposition de 1937. Il présentait alors les poissons des rivières de France. Ce fut longtemps le plus grand aquarium d'Europe avant d'être détrôné par celui de Monaco. VIII. http://www.troglonautes.com/Un-aquarium-souterrain-a-Paris_a1367.html Actuellement. 1170 Lucien Gratté - Survivance de l'Art pariétal –– 2ème édition PARIS - SEINE I. -

Le Cheval De Course En Île-De-France, Une Présence Architecturale Et Paysagère
In Situ Revue des patrimoines 18 | 2012 Le cheval et ses patrimoines (1ère partie) Le cheval de course en Île-de-France, une présence architecturale et paysagère Sophie Cueille Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/insitu/9685 DOI : 10.4000/insitu.9685 ISSN : 1630-7305 Éditeur Ministère de la culture Référence électronique Sophie Cueille, « Le cheval de course en Île-de-France, une présence architecturale et paysagère », In Situ [En ligne], 18 | 2012, mis en ligne le 31 juillet 2012, consulté le 19 avril 2019. URL : http:// journals.openedition.org/insitu/9685 ; DOI : 10.4000/insitu.9685 Ce document a été généré automatiquement le 19 avril 2019. In Situ Revues des patrimoines est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Le cheval de course en Île-de-France, une présence architecturale et paysagère 1 Le cheval de course en Île-de- France, une présence architecturale et paysagère Sophie Cueille Le monde des courses est un vaste monde qui se suffit, les soucis et les joies du turf remplissent une existence et les sept jours de la semaine sont ainsi répartis : le lundi à Saint-Cloud, le mardi à Enghien, le mercredi au Tremblay, le jeudi à Auteuil, le vendredi à Maisons-Laffitte, le samedi à Vincennes, le dimanche à Longchamp1. 1 À ce jour, en confrontant les différentes listes des hippodromes en France, plus de 250 sites sont répertoriés. Si l’ensemble des régions possèdent ce type d’équipement, la répartition reste très inégale. -

"Art and Industry" at the Pare Des Buttes Chaumont Ann E. Komara
"Art and Industry" at the Pare des Buttes Chaumont AnnE. Komara B.A., The Pennsylvania State University, 1980 M.L.A., The University of Virginia, 1984 A Thesis Presented to the Faculty Of the Department of Architectural History Of the School of Architecture School of Architecture University of Virginia May, 2002 Table of Contents List of Illustrations i Acknowledgements V Chapter I Introduction, including a history and description of the 1 Pare des Buttes Chaumont site Chapter Il The Exposition Universelle, Paris (1867): "Art and Industry" 13 Chapter ill Art: Picturesque Revelations at the Paredes Buttes Chaumont 30 Chapter IV Industry: Technology and Design Innovations at the Pare 55 des Buttes Chaumont Chapter V Conclusion 90 Bibliography 96 Appendices Appendix A: A chronological list of Alphand's works 104 Appendix B: List of the categories forthe Exposition Universelle 105 Appendix C: A list of Davioud's major works 106 Appendix D: Partial plant list forthe Pare des Buttes Chaumont 108 Illustrations 109 List of Illustrations Chapter I - Introduction 1. Vue des falaises, engraving, delineator E. Grandsire (1867) Alphand, Plate 2. Promenades de Paris, engraved plan. Alphand, Plate 3. Le site de Paris (contour plan) Demangeon, p. 11 4. City topography "Croquis orographique de Paris (1/25 000)" Rouleau, p. 132 5. Vue generale des moulins a vent de la butte de Chaumont Garric, p. 132 6. Plan de Paris et ses environs par Bullet et Blonde!, revise 1670 Garric, p. 129 7. Le Plan de Roussel ( 1731) Garric, n. p. 8. Horse yards near Montfaucon and the Buttes Chaumont Garric , p. -
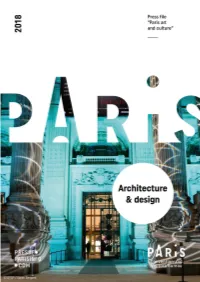
Architecture and Design 2018
In 2018, an exhibition at the Archives Nationales will shine a spotlight on the architecture of the Grand Siècle (the 17th century, when France enjoyed cultural and political pre- eminence), which produced such marvels as the dome of the Invalides and the Colonnade, the easternmost façade of the Louvre – two iconic symbols of Paris. Built on the orders of a number of kings, from Henri IV to Louis XIV, these extraordinary monuments forged the reputations of François Mansart, Louis Le Vau and Jacques Lemercier, three architects whose work transformed both the physical space and the perception of Paris. Comprising rare historical documents, the exhibition at the Archives Nationales (Hôtel de Soubise) shows how the emerging cityscape was carefully documented in architectural drawings. Four centuries on, the greatest contemporary architects (Koolhaas, Nouvel, Ando, Gautrand, Saana, Wilmotte, Gehry) have added their stamp, in the form of bold, strikingly modern buildings. Current-day designs focus on making Paris a pleasant city to live in and get around – an approach that is increasingly leading the French capital along the path of pedestrianization and non-motorized transport. After turning the Seine quaysides over to pedestrians – thereby placing the heart of Paris and its two islands firmly back on the map of the aesthetic mind – the city council has carved out a cycle path along Rue de Rivoli, docking the space available for motorized transport (and cutting noise into the bargain). The redesign of the city’s squares, too, is proceeding apace. Following the renovation of Place de la République, Place du Panthéon will become a breathable space dotted with wooden benches and chairs by the autumn of 2018, while Place de la Nation will subsequently be covered by a smooth expanse of lawn, with traffic restricted to three lanes instead of the current seven. -

Fondation Louis Vuitton 5
Eng Press Kit Opening: October 27th, 2014 October 17,2014 PRESS KIT Contents “A Dream Come True”, by Bernard Arnault 1 I — Birth of the project 3 « The triumph of Utopia », by Jean-Paul Claverie 3 A new ambition for LVMH’s corporate patronage 4 A building between the woods and the garden 5 The major stages in the progress of the Fondation Louis Vuitton 5 II — An exceptional building 7 A new monument for Paris 7 A new landmark in 21st-century architecture 7 Frank Gehry, Architect 8 Using aerospace technology to support creativity 8 Talents, skills and innovations 9 The environmentally-friendly approach at the heart of the project 9 III — The art program 11 “Openings” by Suzanne Pagé 11 Commissions 14 Collection 15 Temporary exhibitions 17 Events 18 Musical Program 19 Diary 20 IV — Cultural Program 25 “A Fondation for all of us” by Sophie Durrleman 25 Publics and interpretation 25 The Documentation centre 27 The publications of the Fondation 28 V — Dedicated services 29 An Easy access 29 Bookshop of the Fondation 29 Derivative products inspired by the architecture 30 Restaurant “Le Frank” 30 VI — A favourite partner: the Jardin d’Acclimatation 31 France’s oldest amusement park 31 The Jardin in 2014 31 A redesigned park for the opening of the Fondation Louis Vuitton 32 VII — Practical information 33 PRESS KIT « A Dream Come True » by Bernard Arnault The Fondation Louis Vuitton opens an exciting new cultural chapter for Paris. It brings the city a new space devoted to art — especially contemporary art — and above all a place for meaningful exchanges between artists and visitors from Paris, from France, and from the entire world. -

Le Parc Montsouris, Un Parc Haussmannien
Gabrielle Heywang VARIA Le parc Montsouris, un parc haussmannien « Oui, je sais, d’autres avaient le Panthéon et ses grands hommes […], le Louvre, les Tuileries, la place de la Concorde […] ! La tour Eiffel, cette géante ! D’autres avaient le Génie de la Bastille ! Mais nous nous avions le parc Montsouris1 ! » Ainsi parlait Louise Hervieu, écrivain qui avait habité toute son enfance en face du parc Montsouris, à la fin du xixe siècle. Aujourd’hui, ce parc apparaît pourtant aux yeux de la plupart des promeneurs comme un parc parmi tant d’autres, et l’enthousiasme conduisant à comparer un simple parc au Louvre ou à la tour Eiffel peut sembler étonnant. Pour comprendre ce phénomène, il faut analyser en quoi ce parc, conçu lors de la modernisation de Paris sous l’égide du préfet Haussmann, était typique des parcs haussmanniens et des valeurs dont ils étaient porteurs. S’inscrivant dans un projet global de réaménagement de la ville, le parc Montsouris devait contribuer à l’intégration du XIVe arrondissement créé lors de l’annexion des communes suburbaines en 1860, à l’instar du parc des Buttes-Chaumont pour le XIXe arrondissement2. Indissociable de l’aménagement urbain, ce parc reflétait également les principes d’aménagement de la ville. Il était aussi porteur des valeurs de la bourgeoisie, qui au travers des jardins publics, cherchait à inculquer de bonnes manières au peuple. Par ailleurs, le parc Montsouris exposait aux promeneurs une nature artificielle afin de montrer la maîtrise de la nature par l’homme grâce au progrès technique, valeur de référence pour cette société en pleine expansion industrielle et scientifique. -

Bois De Boulogne
Hydrology of Bois de Boulogne Hydrology and the Imperial Vision of Bois de Boulogne By KEVIN COFFEE SUMMARY: Bois de Boulogne was a key urban design effort of Second Empire France. This essay surveys the landscape of the park with particular attention to water; social practices that engendered the use of water, and social practices which water enabled. The hydrology of the site – the grand lake, streams, and waterfalls – is a statement and demonstration of imperial mastery and sensibility. Nearly half of the project budget was devoted to hydraulics and, in the opening years, more than 15% of the municipal water supply was diverted to the park; all of which supported a status- laden array of features attractive to elites of the Second Empire and Third Republic. keywords: landscape; water; urban parks; imperialism; Paris. ‘We must have a stream here … to give life to this arid promenade’ – Louis Napoleon, 1848.1 Landscapes, and particularly urban landscapes, are tracings of social practices compressed by time and in space. Ingold describes them as taskscapes collapsed into arrays of features.2 The present survey probes feature compression as a result of practices joined to class, gender and ethnic dispositions, through which many modern cities have emerged or redefined themselves. Modernity requires destruction in order to create its habitus3 and ‘eternal truths.’4 Consequently, as Bender notes, human-landscape relationships are always in-progress and the untidy products of conflict and unease.5 Archaeology assumes the task of untangling and deciphering untidy past practices of production, signification and use. This essay surveys the built encodings that re-made Bois de Boulogne as a public park and the loci of imperial prestige and social solidarity.