Les Peuples De L'antiquité
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Taxonomic Revision of the Andean Killifish Genus Orestias (Cyprinodontiformes, Cyprinodontidae)
A TAXONOMIC REVISION OF THE ANDEAN KILLIFISH GENUS ORESTIAS (CYPRINODONTIFORMES, CYPRINODONTIDAE) I.VNNE R. PARENT] BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY VOLUME 178 : ARTICLE 2 NEW YORK : 1984 A TAXONOMIC REVISION OF THE ANDEAN KILLIFISH GENUS ORESTIAS (CYPRINODONTIFORMES, CYPRINODONTIDAE) LYNNE R. PARENTI Research Associate, Department of Ichthyology American Museum of Natural History BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY Volume 178, article 2, pages 107-214, figures 1-72, tables 1-12 Issued May 9, 1984 Price: $8.40 a copy Copyright © American Museum of Natural History 1984 ISSN 0003-0090 CONTENTS Abstract 110 Introduction 110 Acknowledgments 113 Abbreviations 114 Note on Materials and Methods 115 Relationships of Killifishes of the Tribe Orestiini 116 Phylogenetic Analysis 122 Squamation and Neuromast Pattern 123 Hyobranchial Apparatus 126 Fins 129 Chromosomes 130 Sexual Dimorphism and Dichromatism 131 Jaw and Jaw Suspensorium 133 Skull 134 Meristic Characters 135 Morphometric Characters 146 Explanation of Synapomorphy Diagrams 150 Key to Orestias Species 160 Systematic Accounts 165 Genus Orestias Valenciennes 165 Orestias cuvieri Valenciennes 167 Orestias pentlandii Valenciennes 168 Orestias ispi Lauzanne 169 Orestias forgeti Lauzanne 170 Orestias mulleri Valenciennes 171 Orestias gracilis, New Species 172 Orestias crawfordi Tchernavin 173 Orestias tutini Tchernavin 174 Orestias incae Garman 174 Orestias luteus Valenciennes 175 Orestias rotundipinnis, New Species 176 Orestias farfani, New Species 178 Orestias -

MV1. Registro De Tesis De La UNSCH
REGISTRO DE TESIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA Nº Codigo Titulo Libro Autor Personal 1 Tesis / Ad1 Gui "Un modelo de evaluación del desempeño laboral en el proyecto CICAFOR" Guillén Cavero, Ruth L. 2 Tesis / Ad2 Pal "Evaluación de personal en una empresa industrial" Palomino Infante, Gladis 3 Tesis / Ad3 Per "Metodología de selección de personal para la Región los Libertadores - Wari" Pérez Quispe, Reyna 4 Tesis / Ad4 Barr "Análisis de la organización interna de la municipalidad de San Juan Bautista" Barrón Munaylla, Vilma A. 5 Tesis / Ad5 Led "Evaluación de puesto de la municipalidad provincial de Huamanga" Ledesma Estrada, Walter Américo 6 Tesis / Ad6 Ani El pensamiento administrativo y su aplicación a las empresas e instituciones públicas del departamento de Ayacucho Anicama Córdova, Juan F. 7 Tesis / Ad7 Gal "El sector informal urbano de Ayacucho y su contribución al desarrollo socio-económico" Gálvez Molina, Jorge Antonio "La teoría de los dos factores y el rendimiento académico de los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de 8 Tesis / Ad8 Mir Miranda Campos, Yeny Felícitas San Cristóbal de Huamanga 9 Tesis / Ag11 Bet "Incidencia de la distomatosis hepática en el ganado vacuno de la provincia de Huamanga-Ayacucho" Betalleluz Leaño, Félix 10 Tesis / Ag12 Can "Estructura agraria y tenencia de la tierra en el valle de Huamanga. sector : Distrito de Acos Vinchos" Canales Jerí, Carlos Rolando Análisis de crecimiento de dos ecotipos de achita (Amaranthus Caudatus L.): blanca Glomerulada y negra Amarantiforme bajo las condiciones 11 Tesis / Ag131 Zam Zambrano Ochoa, Lurquín Marino de Ayacucho (2750 m.s.n.m.) 12 Tesis / Ag16 Cas "Fijación y adsorción del P en suelos de puna de 3450 a 4100 m.s.n.m en Allpachaka (Ayacucho)" Castillo Romero, Guillermo 13 Tesis / Ag17 Cer "Estudio Agrológico del Fundo Wayllapampa" Cerrón Pomalaza, Teodoro "Estudio preliminar de la producción y composición de la leche en el Hoyo de Allpachaka, zona alto andina 3500 m.s.n.m. -

“A Translation and Historical Commentary of Book One and Book Two of the Historia of Geōrgios Pachymerēs” 2004
“A Translation and Historical Commentary of Book One and Book Two of the Historia of Geōrgios Pachymerēs” Nathan John Cassidy, BA(Hons) (Canterbury) This thesis is presented for the degree of Doctor of Philosophy of the University of Western Australia. School of Humanities Classics and Ancient History 2004 ii iii Abstract A summary of what a historical commentary should aim to do is provided by Gomme and Walbank in the introductions to their famous and magisterial commentaries on Thoukydidēs and Polybios. From Gomme: A historical commentary on an historian must necessarily derive from two sources, a proper understanding of his own words, and what we can learn from other authorities . To see what gaps there are in his narrative [and to] examine the means of filling these gaps. (A. Gomme A Historical Commentary on Thucydides vol. 1 (London, 1959) 1) And from Walbank: I have tried to give full references to other relevant ancient authorities, and where the text raises problems, to define these, even if they could not always be solved. Primarily my concern has been with whatever might help elucidate what Polybius thought and said, and only secondarily with the language in which he said it, and the question whether others subsequently said something identical or similar. (F. Walbank A Historical Commentary on Polybius vol. 1 (London, 1957) vii) Both scholars go on to stress the need for the commentator to stick with the points raised by the text and to avoid the temptation to turn the commentary into a rival narrative. These are the principles which I have endeavoured to follow in my Historical Commentary on Books One and Two of Pachymerēs’ Historia. -

Inventory of Municipal Wastewater Treatment Plants of Coastal Mediterranean Cities with More Than 2,000 Inhabitants (2010)
UNEP(DEPI)/MED WG.357/Inf.7 29 March 2011 ENGLISH MEDITERRANEAN ACTION PLAN Meeting of MED POL Focal Points Rhodes (Greece), 25-27 May 2011 INVENTORY OF MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS OF COASTAL MEDITERRANEAN CITIES WITH MORE THAN 2,000 INHABITANTS (2010) In cooperation with WHO UNEP/MAP Athens, 2011 TABLE OF CONTENTS PREFACE .........................................................................................................................1 PART I .........................................................................................................................3 1. ABOUT THE STUDY ..............................................................................................3 1.1 Historical Background of the Study..................................................................3 1.2 Report on the Municipal Wastewater Treatment Plants in the Mediterranean Coastal Cities: Methodology and Procedures .........................4 2. MUNICIPAL WASTEWATER IN THE MEDITERRANEAN ....................................6 2.1 Characteristics of Municipal Wastewater in the Mediterranean.......................6 2.2 Impact of Wastewater Discharges to the Marine Environment........................6 2.3 Municipal Wasteater Treatment.......................................................................9 3. RESULTS ACHIEVED ............................................................................................12 3.1 Brief Summary of Data Collection – Constraints and Assumptions.................12 3.2 General Considerations on the Contents -

HUMANITAS Güz / Autumn, Tekirdağ, 2013
Murat ATEŞ HUMANITAS Sayı - Number: 2 Güz / Autumn, Tekirdağ, 2013 ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN KENTSEL TURĠZM ALGILARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: EDĠRNE ĠLĠ ÖRNEĞĠ Murat ATEġ1 Öz: Günümüz dünyasında sosyal ve ekonomik değiĢimleri ele alırken bir yandan da insanların bu olaylarla ilgili algılarını da ortaya koymak bir gereklilik olarak karĢımıza çıkmaktadır. BeĢeri meseleler olarak ele alabileceğimiz sosyal ve ekonomik olayların, günümüzde dünyada hızlı bir Ģekilde yaĢanmakta olan değiĢim ve dönüĢümün önemli birer göstergesi olduğu bilinmektedir. Turizm, son yıllarda toplumsal ve ekonomik bir faaliyet olarak küreselleĢmenin de etkisi ile tüm dünyada hızla geliĢen ve ülkeler tarafından da desteklenen önemli bir faaliyettir. Ancak turizm olgusu sadece ekonomik veya mekânsal boyutları ile değil sosyal ve kültürel yönleri ile de hayatımızda yer almaktadır. Bu bağlamda turizmin, insanların algılarından bağımsız olarak ele alınamayacağı söylenebilir. Günümüz turizm ekonomisi içerisinde, farklı coğrafyalardaki kentlerin de sahip oldukları tüm değerlerle markalaĢma çabasında oldukları görülmektedir. Bu çalıĢma, Edirne ilindeki ortaöğretim öğrencilerinin, Edirne‟de turizmin kaynakları, güçlü ve zayıf yönleri, sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel etkileri ile turizmin geliĢimi için atılması gerekli adımlar konularındaki görüĢ ve farkındalıklarının belirlenmesine yönelik olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına değerlendirildiğinde öğrencilerin genel olarak Edirne‟de turizmin geliĢimi hakkında, ekonomik, çevresel, soysal ve kültürel etkilerbakımından -

Deutsches Archäologisches Institut • Jahresbericht 2008 Archäologischer Anzeiger 2009/1 Beiheft Deutsches Archäologisches Institut
Deutsches Archäologisches Institut • Jahresbericht 2008 Archäologischer Anzeiger 2009/1 Beiheft Deutsches Archäologisches Institut JAHRESBERICHT 2008 Hirmer Verlag · München ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER • BEIHEFT die Zeitschrift erscheint seit 1889, das Beiheft mit dem Jahresbericht des DAI seit 2008 AA 2009/1 Beih. • VI, 430 Seiten mit 581 Abbildungen Herausgeber Deutsches Archäologisches Institut Zentrale Podbielskiallee 69–71 D–14195 Berlin www.dainst.org © 2009 Deutsches Archäologisches Institut / Hirmer Verlag GmbH ISSN: 0003-8105 · ISBN 978-3-7774-2501-6 Gesamtverantwortlich: Redaktion an der Wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin (www.dainst.org) Redaktion, Layout und Satz: Dorothee Fillies, Berlin (www.redaktion-layout-satz.de), nach Standard-Layout des Archäologischen Anzeigers von F217 Sailer/Sohn, Berlin (www.F217.de) Bildbearbeitung und Umschlag: Catrin Gerlach, Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale Herstellung und Vertrieb: Hirmer Verlag GmbH, München (www.hirmerverlag.de) Titelbilder: Nach Projekt-Bildern der Zentrale, 7 Abteilungen und 3 Kommissionen des DAI Abbildungen: Eine Einholung der Nutzungsrechte aller Darstellungen, für die die Projekte des DAI nicht die Rechteinhaber sind, wurde angestrengt. In Einzelfällen konnten Copyright-Inhaber nicht ausfindig gemacht werden bzw. erfolgte keine Rückmeldung auf diesbezügliche Anfragen. Wir möchten Sie bitten, in solchen Fällen einen entsprechenden Hinweis an die Redaktion des DAI ([email protected]) zu senden, damit eine Einholung der Publikationserlaubnis schnellstmöglich noch vorgenommen werden kann. – Länderkarten: Weltkarte nach R. Stöckli, E. Vermote, N. Saleous, R. Simmon and D. Herring (2005). The Blue Marble Next Generation – A true color earth dataset including seasonal dynamics from MODIS. Published by the NASA Earth Observatory. Corresponding author: [email protected]. – Flüsse nach Global Runoff Data Centre (2007): GIS Layers of Major River Basins of the World. -
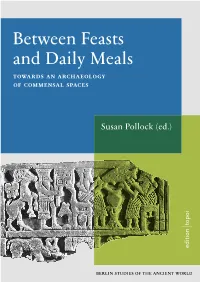
Between Feasts and Daily Meals. Towards an Archaeology Of
Between Feasts and Daily Meals Susan Pollock (ed.) BERLIN STUDIES OF THE ANCIENT WORLD – together in a common physical and social setting – is a central element in people’s everyday lives. This makes com- mensality a particularly important theme within which to explore social relations, social reproduction and the working of politics whether in the present or the past. Archaeological attention has been focused primarily on feasting and other special commensal occasions to the neglect of daily commensality. This volume seeks to redress this imbalance by emphasizing the dynamic relation between feasts and quotidian meals and devoting explicit attention to the micro- politics of Alltag (“the everyday”) rather than solely to special occasions. Case studies drawing on archaeological ( material) as well as written sources range from the Neolithic to the Bronze Age in Western Asia and Greece, Formative to late pre-Columbian com munities in Andean South America, and modern Europe. berlin studies of 30 the ancient world berlin studies of the ancient world · 30 edited by topoi excellence cluster Between Feasts and Daily Meals towards an archaeology of commensal spaces edited by Susan Pollock Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.d-nb.de. © 2015 Edition Topoi / Exzellenzcluster Topoi der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin Cover image: Wall plaque with feasting scene, found in Nippur. Baghdad, Iraq Museum. Winfried Orthmann, Propyläen Kunstgeschichte Vol. 14: Der alte Orient. Berlin: Propyläen, 1975, Pl. 79b. Typographic concept and cover design: Stephan Fiedler Printed and distributed by PRO BUSINESS digital printing Deutschland GmbH, Berlin ISBN 978-3-9816751-0-8 URN urn:nbn:de:kobv:188-fudocsdocument0000000222142-2 First published 2015 Published under Creative Commons Licence CC BY-NC 3.0 DE. -

Freshwater Biodiversity: F^Mm^/M a Preliminary Global Assessment
WCMC Biodiversity Series No. 8 iHWnwm,,, I' ^ ;.*;il^ i.jiiimn I Freshwater Biodiversity: f^mm^/m a preliminary global assessment #:^\ UNEP WORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE Digitized by the Internet Arciiive in 2010 with funding from UNEP-WCMC, Cambridge http://www.archive.org/details/freshwaterbiodiv98wcmc \1\.<^1 WCMC Biodiversity Series No. 8 Freshwater Biodiversity: a preliminary global assessment World Conservation Monitoring Centre Brian Groombridge and Martin Jenkins VTORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE UNEP WCMC - World Conservation Press 1998 The World Conservation Monitoring Centre, based in Cambridge, UK, is a joint venture between three partners in the World Conservation Strategy and its successor Caring for the Earth: lUCN - The World Conservation Union, UNEP - United Nations Environment Programme, and WWF - World Wide Fund for Nature. The Centre provides information services on the conservation and sustainable use of species and ecosystems and supports others in the development of their own information systems. UNEP - The United Nations Environment Programme is a secretariat within the United Nations which has been charged with the responsibility of working with governments to promote environmentally sound forms of development, and to coordinate global action for development without destruction of the environment. UNEP has as its mission "to promote leadership and encourage partnerships in caring for the environment by inspiring, informing and enabling nations and people to improve their qualify of life without compromising that of future generations". WORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE Published by: WCMC - World Conservation Press, Cambridge, UK. ISBN: 1 899628 12 6 Copyright: 1998. World Conservation Monitoring Centre, Cambridge Reproduction of this publication for educational or other non- commercial purposes is authorised without prior permission from the copyright holders, provided the source is acknowledged. -

Στους Γονείς Μου, ∆Ήµητρα Και Κωνσταντίνο to My Parents
Στους γονείς µου, ∆ήµητρα και Κωνσταντίνο To my parents, Demetra and Constantinos THE OTTOMAN CONQUEST OF THRACE ASPECTS OF HISTORICAL GEOGRAPHY BY GEORGIOS C. LIAKOPOULOS THE INSTITUTE OF ECONOMICS ANS SOCIAL SCIENCES OF BİLKENT UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN HISTORY BİLKENT UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY ANKARA, SEPTEMBER 2002 I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Master in History Prof. Dr. Halil İnalcık Thesis supervisor I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Master in History Dr. Eugenia Kermeli Examining Committee Member I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Master in History Associate Professor Dr. Mehmet Öz Examining Committee Member Approval of the Institute of Economics and Social Sciences Prof. Dr. Kürşat Aydoğan Director ABSTRACT In my thesis I examine Thrace as a geographical unity during the Ottoman conquest in the fourteenth century. In the first chapter I present the sources that I used, Byzantine and Ottoman. The life and works of the chronographers are discussed to the extent that they assist us in comprehending their ideology and mentality. I focus on the contemporary sources of the fourteenth century. The second chapter treats with the diplomatic relations between the Byzantines and the Turks in the fourteenth century before and after the Turkish settlement in Thrace. -

Mercury in the Environment: Field Studies from Tampa, Bolivia, and Guyana Joniqua A'ja Howard University of South Florida
University of South Florida Scholar Commons Graduate Theses and Dissertations Graduate School 3-5-2010 Mercury in the Environment: Field Studies from Tampa, Bolivia, And Guyana Joniqua A'ja Howard University of South Florida Follow this and additional works at: http://scholarcommons.usf.edu/etd Part of the American Studies Commons, Civil Engineering Commons, and the Environmental Engineering Commons Scholar Commons Citation Howard, Joniqua A'ja, "Mercury in the Environment: Field Studies from Tampa, Bolivia, And Guyana" (2010). Graduate Theses and Dissertations. http://scholarcommons.usf.edu/etd/3465 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. Mercury In The Environment: Field Studies From Tampa, Bolivia, And Guyana by Joniqua A'ja Howard A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Civil and Environmental Engineering College of Engineering University of South Florida Major Professor: Maya Trotz, Ph.D. Fenda Akiwumi, Ph.D. Mark Rains, Ph.D. Amy Stuart, Ph.D. Date of Approval: March 5, 2010 Keywords: methyl-mercury, global mercury cycle, fish, gold mining, environmental sustainability, education © Copyright 2010 , Joniqua A'ja Howard DEDICATION To the past, present, and future: Reverend Otis Howard Beulah Allen Howard Edward McArthur, Sr. Raymond Howard, Sr. Ora McArthur Leanna McArthur Loretta Howard John Howard Coach Arron Prather All of those who will be impacted positively by my work SANKOFA! ACKNOWLEDGEMENTS “Write the vision and make it plan on tablets, that he may run who reads it. -

The Development of the Ecclesiology and the Political Theology of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople and the Autoceph
The development of the Ecclesiology and the Political Theology of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople and the Autocephalous Greek Orthodox Church in response to Muslim Christian relations in the contemporary context of modern Greece and Turkey until 2014 Nikolaos-Nikodemos Anagnostopoulos Heythrop College, University of London PhD September 2015 1 Abstract Muslims and Christians have been in a challenging symbiotic existence for a long period in many parts of South-Eastern Europe and the Middle East (Antioch, Jerusalem, and Alexandria). The relations of Christian and Muslim communities of each south-eastern European country are unique because of the diverse political, cultural, and socio-economic background of each nation, which however influences one another despite an often shared Ottoman background. The present study investigates the relations between Muslim and Christian communities in the contemporary context of modern Greece and Turkey, which have received many political, governmental, cultural, geographical, and religious influences leading them to the present relational shape. The thesis proposes that a distinct ecclesial development has taken place in the contemporary status of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople and the Autocephalous Greek Orthodox Church in response to Muslim- Christian relations in modern Turkey and Greece, especially after the establishment of the Kingdom of Greece in 1832 and the Republic of Turkey in 1923. In addition, the thesis investigates the modern historical context of the States of Greece and Turkey especially as it relates to the minority question under the light of reciprocity and the International Treaties, Conventions, and the Declaration of Human Rights. Greece, where the prevailing religion is Eastern Orthodoxy, accommodates within its borders an official recognised Muslim minority based in Western Thrace as well as other Muslim populations located at major Greek urban centres and the Islands of the Aegean Sea. -

Page 1 of 72 File://J:\BSP\LAC\Freshwater\06-15-99 Freshwater Pdf.Html 6/15/99 FRESHWATER BIODIVERSITY: Report of a Workshop On
Page 1 of 72 FRESHWATER BIODIVERSITY: Report of a workshop on the Conservation of Freshwater Biodiversity in Latin America and the Caribbean held in Santa Cruz, Bolivia, September 27-30, 1998 Implementers: World Wildlife Fund and Wetlands International Supported by: Biodiversity Support Program Editors: David Olson, Eric Dinerstein, Pablo Canevari, Ian Davidson, Gonzolo Castro, Virginia Morisset, Robin Abell, and Erick Toled WORLD WILDLIFE FUND (WWF), the largest privately-supported international conservation organization in the world, is dedicated to protecting the world's wildlife and wildlands. WWF directs its conservation efforts toward protecting and saving endangered species and addressing global threats. A conservation leader for more than 36 years, WWF has sponsored more than 2,000 projects in 116 countries and has more than one million members in the U.S. alone. The comprehensive global assessment of biological diversity recently completed by WWF scientists has identified more than 200 outstanding terrestrial, freshwater, and marine habitats. This new framework, called the Global 200, is helping to determine where conservation efforts are most needed, and, in the process, shaping the way governments, multilateral financial institutions, corporations, and conservation groups do their work. WETLANDS INTERNATIONAL (WI), created in 1995 through the integration of International Waterfowl and Wetlands Research Bureau, the Asian Wetland Bureau, and Wetlands for the Americas, is a world leader in conserving wetlands and wetland dependent species. WI's mission is to sustain and restore wetlands, their resources, and biodiversity for future generations through research, information exchange, and conservation activities worldwide. Programs are supported by a global network of more than 120 government agencies, national NGOs, foundations, development agencies, and private-sector groups.