Bagneres- De-Bigorre • B
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diagnostic MAIA BS Bagnères
Diagnostic local Personnes âgées V1 bis : décembre 2015 Sommaire 1. Présentation du territoire 2. Découpage administratif 3. Démographie 4. Population des communes 5. Données socio-économiques 6. Etat de santé 7. Consommations de soins 8. Offre de soins libérale et ambulatoire 9. La filière gériatrique 10. Les établissements d’hébergement 11. Les services à domicile 12. Les service sociaux 13. La prévention, l’aide aux aidants et les associations d’usagers 14. Synthèse (Ancien découpage cantonal ) Faiblesses : Forces : • Un relatif enclavement, Présentation • Territoire à taille humaine surtout en période hivernale du territoire Situé au centre sud du département, le bassin de santé de Bagnères se Bassins de vie compose essentiellement d’un bassin de vie. Ce bassin de vie comprend la partie ouest des Baronnies Un bassin de santé à dominante rurale Superficie : 429 km2 (/4464 dans le 65) Densité de 45 ha/km2 (/51 dans le 65) Population rurale à 85% Forces Faiblesses • Le canton de la Haute-Bigorre • Des communes périphériques Découpage qui regroupe une grande partie relevant plutôt des secteurs du territoire du BS administratifs de Lourdes ou administratif Tarbes Cantons (2015) et Bassins de santé Compte-tenu du nouveau découpage cantonal , le bassin de santé de Bagnères se compose : De l’ensemble des 14 communes du canton de la HAUTE- BIGORRE De 11 des 71 communes du canton de la VALLEE DE L'ARROS ET DES BAÏSES De 3 des 15 communes du canton du MOYEN ADOUR De 2 des 17 communes du canton d’OSSUN De 1 des 27 communes du canton -

CC Du Plateau De Lannemezan (Siren : 200070787)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC du Plateau de Lannemezan (Siren : 200070787) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Lannemezan Arrondissement Bagnères-de-Bigorre Département Hautes-Pyrénées Interdépartemental non Date de création Date de création 09/12/2016 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Bernard PLANO Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Numéro et libellé dans la voie Mairie Distribution spéciale Code postal - Ville 65300 LANNEMEZAN Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité additionnelle avec fiscalité professionnelle de zone et sans fiscalité professionnelle sur les éoliennes Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non 1/5 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population Population totale regroupée 18 213 Densité moyenne 42,16 Périmètre Nombre total de communes membres : 57 Dept Commune (N° SIREN) Population 65 Arné (216500280) 215 65 Arrodets (216500348) 20 65 Artiguemy (216500371) 91 65 Asque (216500413) 126 65 Avezac-Prat-Lahitte (216500546) 614 65 Batsère (216500710) 34 65 Bazus-Neste (216500769) 62 65 Benqué-Molère (200064236) 133 65 Bonnemazon (216500967) 67 65 Bonrepos (216500975) 196 65 Bourg-de-Bigorre (216501056) 199 65 Bulan (216501114) 63 65 -

Légende Nestalas Uz Soulom Arcizans- Limites Cantonales Avant Villelongue Beaucens Limites Communales
N PLAN LOCAL D’URBANISME Ouzous Salles Agos- COMMUNE DE CAUTERETS Vidalos Ayzac- LOCALISATION Sère-en-Lavedan Ost Boô- Gez Silhen Saint- Pastous ARGELES-Ayros- GAZOST Arbouix Lau-Préchac Balagnas Vier- Saint- Bordes Savin Adast Artalens- Souin Pierrefitte- Légende Nestalas Uz Soulom Arcizans- Limites cantonales Avant Villelongue Beaucens Limites communales Surface communale Cauterets Saint- Lanne Castelnau- Rivière-Basse Madiran Hères Soublecause Labatut- Rivière Hagedet Caussade- Rivière Villefranque Lascazères Estirac Auriébat Sombrun Sauveterre Maubourguet Lahitte- Toupière Vidouze Monfaucon Larreule Lafitole Buzon Gensac Nouilhan Ansost Barbachen Caixon Liac Artagnan Ségalas Vic-en- Villenave- Bigorre Sarriac- Rabastens- près- Sanous Bigorre de-Bigorre Béarn Saint- Mingot Lézer Bazillac Estampures Escaunets Camalès Fréchède Lacassagne (Canton de Vic-en-Bigorre) Sénac Moumoulous Escondeaux Villenave- Saint-Sever- Mazerolles Talazac Pujo près- Ugnouas Marsac de-Rustan Séron Tarasteix Lescurry Mansan Bernadets- Marsac Tostat Bouilh- Debat Siarrouy Peyrun Sarniguet Castéra-Lou Laméac Devant Fontrailles Andrest Antin Lagarde Soréac Trouley- Oroix Gayan Jacque Aurensan Dours Bouilh- Labarthe Lapeyre Trie-sur- Louit Péreuilh Lubret- Gardères Pintac Chis Saint-Luc Lalanne- Baïse Sadournin Guizerix Peyret- Oursbelille Bazet Osmets Trie Collongues Marseillan Saint-André (Canton d'Ossun) Sabalos Luby- Sariac- Orleix Chelle- Betmont Vidou Larroque Casterets Bours Debat Puntous Magnoac Luquet Bordères- Oléac-Debat Castelvieilh Mun Thermes- sur-l'Echez -

Cataloguecapvern, Saint-Bertrand De Comminges
Les Gîtes Ruraux 2012 CAPVERN, SAINT-BERTRAND DE COMMINGES HAUTES PYRÉNÉES 24/09/2012 Les Gîtes Ruraux La location au week-end ou en séjours en appartement ou maison. Cette formule s’appuie sur un accueil chaleureux et privilégié. Les gîtes confortablement équipés vous donneront la sensation d’un « chez vous ». L’environnement de qualité, à la campagne ou la montagne, fait de leurs espaces extérieurs un atout de la location où règnent tranquillité et calme. Gîtes de France vous garantie des normes de confort suivies et réactualisées, se traduisant parfois pour certains gîtes par des mentions particulières relatives à la protection de l’environnement, l’aménagement d’équipement de loisirs (piscine, sauna, spa) ou encore l’adaptation aux handicaps (tourisme et Handicap). 2 Comment lire les mini-fiches ? Pictogrammes Loisirs Pictogrammes Commodités thermes / remise en forme piscine individuelle tennis piscine collective piscine lave-linge plan d\'eau lave-vaiselle golf télévision équitation cheminée randonnée ski de fond ski alpin escalade gare commerces Pictogrammes Thèmes Bienvenue à la Ferme 3 GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous... N° 1656101 Arrodets CM 342-N4 6 pers. 3 ch. A 4km du gouffre d'Esparros, au cœur des Baronnies, dans un village typique. Situation idéale pour randonneurs et pêcheurs (Arros à 2 km). Circuits balisés sur place. Gîte indépendant, 3 chambres (1 lit 1.60m, 1 lit 1.40m, 2 lits 0.90m), salon, salle à manger/coin-cuisine (en rez-de-jardin), 2 salles d'eau, 3WC dont un indépendant, poêle à bois, chauffage électrique, terrasse, terrain non clos, salon de jardin, barbecue, charges en sus. -

Ensembles Paroissiaux
Pierrefitte E.P. DU PAYS TOY LES DOYENNÉS - ENSEMBLES Préchac Barèges Saint-Pastous PAROISSIAUX - COMMUNES Betpouey Silhen (Commune de Boô-Silhen) Chèze Souin (Commune d’Artalens) Esquièze-Sère Septembre 2020 Soulom Esterre Vier-Bordes Gavarnie Villelongue Gèdre Grust DOYENNÉ D’ARGELÈS. Héas (N.-D. de) Luz Doyen : Abbé Gustave Zarabé. E.P. D’ESTREM DE SALLES ET DU VAL Saint-Sauveur (Commune de Luz) D’AZUN Saligos Sassis Agos-Vidalos E.P. D’ARGELÈS-SAINT-SAVIN Sazos Arcizans-Dessus Sère-Esquièze (Commune de Esquièze-Sère) Adast Arras Sers Arcizans-Avant Arrens-Marsous Viella Argelès-Gazost Aucun Viey Balagnas (Commune de Lau-Balagnas) Ayzac-Ost Villenave (Commune de Luz) Lau-Balagnas Bun Vizos (Commune de Saligos) Saint-Savin Estaing Uz Gaillagos Vieuzac (Commune d’Argelès) Gez Marsous (Commune de Arrens-Marsous) Ost (Commune de Ayzac-Ost) Ouzous E.P. DE PIERREFITTE-DAVANTAYGUES Poueylaün (N.-D. de) ET DE CAUTERETS Salles-Argelès Arbouix (Commune de Ayros-Arbouix) Sère-en-Lavedan Artalens Sireix Asmets (Commune de Boô-Silhen) Vidalos (Commune de Agos-Vidalos) Ayros-Arbouix Beaucens Paroisses rattachées à l'Ensemble paroissial d'Asson Boô-Silhen (diocèse de Bayonne) Bordes (Commune de Vier-Bordes) Arbéost Cauterets Ferrières Nestalas (Commune de Pierrefitte-Nestalas) Ortiac (Commune de Villelongue) 1 Lortet Gembrie DOYENNÉ DE LANNEMEZAN Lutilhous Ilheu Mauvezin Izaourt Doyen : Abbé Dominique Aubian. Mazères-de-Neste Loures-Barousse Mazouau Mauléon-Barousse Montastruc Ourde E.P. DE LANNEMEZAN Montégut Sacoué Anères Montoussé Sainte-Marie Aventignan Montsérié Saléchan Avezac-Prat-Lahitte Nestier Samuran Bazus-Neste Nistos Sarp Bégole Orieux Siradan Bernadets-Dessus Péré Sost Bize Pinas Thèbe Bizous Prat (Commune d’Avezac-Prat-Lahitte) Troubat Burg Rebouc (Commune de Hèches) Caharet Réjaumont Campistrous Saint-Laurent de Neste Cantaous Saint-Paul E.P. -
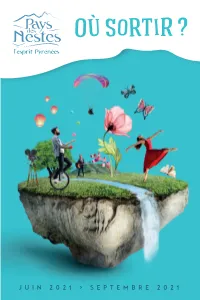
J U I N 2 0 2 1 > S E P T E M B R E 2 0
l'esprit Pyrénées juin 2021 > septembre 2021 Cher public, Une saison culturelle optimiste, porteuse d’espoir et d’énergie ! L’annonce d’une nouvelle saison est toujours un moment très attendu. Pour vous, évidement, qui avez hâte de découvrir les spectacles à l’affiche. Pour les acteurs culturels, c’est un moment très privilégié que de dévoiler leur sélection faite de rencontres, de coup de cœur, de prise de risques ou de découverte. Profitons de ces moments, qui maintenant nous le savons sont essentiels, pour nous évader, flâner, vibrer… Retrouvons le goût de sortir. Réactivons notre engouement culturel, pour plonger dans tous les arts de la scène, pour applaudir les comédiens, les danseurs, les musiciens, tous ceux qui œuvrent pour que chaque représentation soit unique en émotion. Continuons d’aimer et d’encourager la Culture. Une culture de création, de découverte ou de tradition ; une culture avec des têtes d’affiche de notoriété ou des acteurs culturels locaux, tous de grand talent. Découvrons cette nouvelle saison qui permettra, dans tous les lieux de culture du territoire du Pays des Nestes, de nous émouvoir et de partager des moments de convivialité. Maryse BEYRIE, Présidente du PETR du Pays des Nestes. Expositions ................................. p. 5 Animations récurrentes ............ p. 6 Juin ............................................p. 10 Juillet .........................................p. 16 Août .......................................... p. 30 Septembre .............................. p. 42 Fêtes ....................................... -

Rapport Final Du Commissaire Enquêteur
Communauté de Communes de la Haute-Bigorre Antist, Argelès-Bagnères, Asté, Astugue, Bagnères-de-Bigorre, Banios, Beaudéan, Bettes, Campan, Cieutat, Gerde, Hauban, Hitte, Hiis, Labassère, Lies, Marsas, Mérilheu, Montgaillard, Neuilh, Ordizan, Orignac, Pouzac, Trébons et Uzer. Projet de Schéma de Cohérence Territoriale ENQUÊTE PUBLIQUE RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Rapport et conclusions établis le 8 décembre 2020 par Christian FALLIÉRO 2 Sommaire Rapport (Présent dossier 45 pages) I - Cadre de l’enquête……………………….(Page 03) II - Organisation et déroulement…………....(Page 10) III - Relevé des avis et observations…….…(Page 13) IV - Communication de la synthèse des observations et mémoire en réponse de la CCHB…………….………(Page 20) V - Analyse des observations……….……...(Page 23) VI - Synthèse des analyses…………………(Page 44) VII - Avis sur le déroulement de l’enquête…(Page 45) Avis et conclusions (Document Joint 15 pages) Rappel de l’objet de l’enquête et description synoptique du projet………(Page 03) Formulation de l’avis et des conclusions………………………(Page 05) Annexe unique (Document joint) Mémoire en réponse de la CCB……….(23 pages) Nota : Les pièces administratives directement liées au déroulement de l’enquête sont référencées dans le rapport. Les originaux correspondants sont détenus au siège de la CCHB ou ont été remis au titre des pièces jointes. * * * * * 2 3 Communuté de Communes de la Haute-Bigorre Projet de Schéma de Cohérence Territoriale RAPPORT du commissaire d’enquêteur I - Cadre de l’enquête A - Objet et but de l’enquête L’objet de l’enquête concerne le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du périmètre de la Communauté de Communes de la Haute-Bigorre. -

3B2 to Ps Tmp 1..75
1975L0271 — DA — 05.01.1977 — 003.001 — 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor ►B RÅDETS DIREKTIV af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Frankrig) (75/271/EØF) (EFT L 128 af 19.5.1975, s. 33) Ændret ved: Tidende nr. side dato ►M1 Rådets direktiv 76/401/EØFaf 6. april 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Rådets direktiv 77/178/EØFaf 14. februar 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Kommissionens beslutning 77/3/EØFaf 13. december 1976 L 3 12 5.1.1977 Berigtiget ved: ►C1 Berigtigelse, EFT L 288 af 20.10.1976, s. 27 (76/401/EØF) 1975L0271 — DA — 05.01.1977 — 003.001 — 2 ▼B RÅDETS DIREKTIV af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Frankrig) (75/271/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økono- miske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 75/268/EØFaf 28. april 1975 om landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder (1), særlig artikel 2, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg (2), og ud fra følgende betragtninger: Republikken Frankrigs regering har i henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 75/268/EØFgivet Kommissionen meddelelse om de områder, der i henhold til artikel 3, stk. 3, i dette direktiv egner sig til optagelse på fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder, samt oplysninger om disse områders særlige kendetegn; oplysningerne om de områder, der er beliggende i oversøiske departementer, er ikke tilstrækkeligt fuldstændige til, at Kommissionen for øjeblikket kan fremsætte nogen udtalelse herom; som kendetegn for meget vanskelige klimatiske forhold i henhold til artikel 3, stk. -

Zone Nom Commune Seuil Déclenchement 1 31001 AGASSAC
Zone N°Insee Nom commune Seuil déclenchement 1 31001 AGASSAC 72 1 31002 AIGNES 72 1 31003 AIGREFEUILLE 72 1 31004 AYGUESVIVES 72 1 31005 ALAN 72 1 31006 ALBIAC 72 1 31007 AMBAX 72 1 31008 ANAN 72 1 31009 ANTICHAN-DE-FRONTIGNES 72 1 31011 ARBAS 72 1 31012 ARBON 72 1 31013 ARDIEGE 72 1 31014 ARGUENOS 72 1 31018 ARNAUD-GUILHEM 72 1 31020 ASPET 72 1 31021 ASPRET-SARRAT 72 1 31023 AULON 72 1 31024 AURAGNE 72 1 31025 AUREVILLE 72 1 31026 AURIAC-SUR-VENDINELLE 72 1 31027 AURIBAIL 72 1 31028 AURIGNAC 72 1 31029 AURIN 72 1 31030 AUSSEING 72 1 31031 AUSSON 72 1 31033 AUTERIVE 72 1 31034 AUZAS 72 1 31036 AUZIELLE 72 1 31037 AVIGNONET-LAURAGAIS 72 1 31038 AZAS 72 1 31039 BACHAS 72 1 31043 BALESTA 72 1 31044 BALMA 72 1 31045 BARBAZAN 72 1 31047 BAX 72 1 31048 BAZIEGE 72 1 31049 BAZUS 72 1 31050 BEAUCHALOT 72 1 31051 BEAUFORT 72 1 31052 BEAUMONT-SUR-LEZE 72 1 31053 BEAUPUY 72 1 31054 BEAUTEVILLE 72 1 31055 BEAUVILLE 72 1 31057 BELBERAUD 72 1 31058 BELBEZE-DE-LAURAGAIS 72 1 31059 BELBEZE-EN-COMMINGES 72 1 31060 BELESTA-EN-LAURAGAIS 72 1 31061 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE 72 1 31062 BELLESSERRE 72 1 31063 BENQUE 72 1 31065 BERAT 72 1 31066 BESSIERES 72 1 31070 BLAJAN 72 1 31071 BOIS-DE-LA-PIERRE 72 1 31072 BOISSEDE 72 1 31073 BONDIGOUX 72 1 31074 BONREPOS-RIQUET 72 1 31075 BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE 72 1 31076 BORDES-DE-RIVIERE 72 1 31077 LE BORN 72 1 31078 BOUDRAC 72 1 31080 BOULOGNE-SUR-GESSE 72 1 31082 BOURG-SAINT-BERNARD 72 1 31083 BOUSSAN 72 1 31084 BOUSSENS 72 1 31086 BOUZIN 72 1 31087 BRAGAYRAC 72 1 31088 BRAX 72 1 31089 BRETX 72 1 31090 BRIGNEMONT 72 -

3B2 to Ps Tmp 1..96
1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -

Carte Découverte
CARTE DÉCOUVERTE Hitte TARBES Hiis Montgaillard Orignac Château de Mauvezin Cieutat Antist Parc de loisirs de la Demi Lune Mauvezin Lannemezan Zoo d’Asson Abbaye de l’escaladieu A 64 Ordizan L’Escaladieu TOULOUSE Trébons Capvern LOURDES Mérilheu Argèles Bagnères Astugue Hauban 1 Pouzac Neuilh Uzer Bettes BAGNÈRES Lies DE BIGORRE Labassère 2 3 Gerde Col des Palomières 5 Marsas Grottes de Asque Médous Asté Banios LES PLAINES D’ESQUIOU Espace Préhistoire Parc Animalier des Pyrénées Col du Couret Gourge d’Asque Cascade du Pan Labastide 4 Beaudéan Esparros 6 CAMPAN 10 Cascade du Pountil Chemin d’Angoué Lesponne ARGELÈS GAZOST Pic du Montaigu 7 Falaises du Trassouet 2339 m Le Peyras Col de la Courade Cascade de Magenta 12 11 Ste Marie de Campan e Lac d’Aygue Rouye t t Donjon des AIgles i h e r Col de Beyrède y 8 e P e d 24 n i La Séoube Lac d’Isaby LE CHIROULET 9 m e h C 17 18 Col d’Aspin Pic du Midi 1489m Lac d’Ourrec Lac de Peyrelade Bon 2877 m Sarrat de 22 Lac Vert 19 20 PAYOLLE Lac d’Oncet Artigues Lac Bleu Cascade d’Arizes Lac de Payolle Cascade du Garet 21 14 13 Col du Tourmalet 15 2115 m Aigles d’Aure CAUTERETS/ Tournaboup LA MONGIE PONT D’ESPAGNE BARÈGES 16 Lac de Montarrouye Lac Arou 23 ARREAU PLATEAU DU LIENZ Hourquette d’Ancizan Lac de Gréziolles 1564m Lac de Campana Pic de l’Arbizon LUZ-SAINT-SAUVEUR 2831m Néouvielle Pic de Layré Lac dets Coubous ESPAGNE GAVARNIE 2422 m RÉSERVE NATURELLE DU NÉOUVIELLE Départs de randonnées 14 Hiking trails / Senderismo Légende Départs VTT Mountain bike trail / Excursiones VTT Départs VTT de descente Cultural heritage / Patrimonio Cycling trail / Excursiones VTT Parcours de pêche Fishing spots / Lugares para pescar Découverte des villages du nord Les ouvertures pouvant varier selon les Circuits de découverte Découverte des Baronnies 89 km 1h55 42 km du Tourmalet Pic du Midi 1h20 Les visites périodes, merci de vous renseigner auprès du Autour du Col du Tourmalet site concerné ou de l’Office de Tourisme. -

Carte Planning Déploiement FTTH 2018-2024
Déploiements FTTH ORANGE Période 2018 2024 ± Saint-lanne Castelnau-Riviere-Basse Madiran Heres Soublecause Labatut-riviere Légende Hagedet Caussade-riviere Lascazeres 2018 Villefranque Estirac Auriebat 2019 Sombrun Sauveterre 2020 Maubourguet Lahitte-toupiere 2021 Monfaucon Vidouze Larreule Lafitol e Buzon Gensac 2022 Nouilhan Ansost Barbachen Liac 2023 Caixon Segalas Artagnan 2024 Sarriac-bigorre Vic-En-Bigorre Rabastens-De-Bigorre Sanous Estampures Villenave-pres-bearn Mingot Saint-lezer Frechede Camales Moumoulous Bazillac Lacassagne Senac Mazerolles Pujo Saint-sever Escaunets Ugnouas Bernadets Villenave -de-rustan Escondeaux Mansa -debat Talazac -pres-marsac n Bouilh Lameac Fontrailles Seron Marsac Lescurry Peyrun -devant Antin Siarrouy Tostat Tarasteix Castera-lou Lapeyre Andrest Sarniguet Jacque Trouley Trie-Sur-Baise Guizerix Peyret Soreac Bouilh -labarthe Lubret-saint-luc Aurensan -saint-andre Oroix Gayan -pereu Lalanne-trie Sadournin Lagarde Dours ilh Osmets Sariac Casterets Chis Louit Marseillan Larroque -magnoac Oursbelille Luby Vidou Puntous Garderes Pintac Bazet Chelle-debat -betmont Thermes Collongues Puydarrieux Castelnau Sabalos Castelvieilh Tournous -magnoac Villembits Hachan -Magnoac Bours Oleac Mun -darre Barthe Betbeze Orleix Pouyastruc Cabanac Lamarque Luquet Borderes-Sur-L-Echez -debat Campuzan -rustaing Organ Aries-espenan Lizo Aubarede Lustar Lalanne s Sere Betpouy Deveze Marquerie Sentous Thuy -rustaing Aureilhan Boulin Cizos Pouy Hourc Peyriguere Bugard Vieuzos Coussan Tournous Villemur Goudon Ibos Souyeaux Bonnefont