L'harbous Privee Besseges St Hubert Bessegeoise
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

169 CAHIERS DU CENTRE DE GENEALOGIE PROTESTANTE N°136 Quatrième Trimestre 2016 SOMMAIRE Sommaire
CAHIERS DU CENTRE DE GENEALOGIE PROTESTANTE n°136 quatrième trimestre 2016 SOMMAIRE Sommaire 169 - Etude sur une généalogie des Girard de la Vallée Longue (seconde partie) par Claude Jean GIRARD 170 - Les temples protestants de Bordeaux par Séverine PACTEAU de LUZE 198 - Un village protestant du Gard et son seigneur catholique Saint-Victor-de-Malcap et les Castillon de Saint-Victor par Jean-Claude LACROIX 206 - De Londres à Bordeaux, une famille de négociants en vins : les Southhard par Denis FAURE 215 - Les quartiers de Christian Zuber par Valérie GAUTIER 221 Aucune reproduction intégrale ou partielle des articles parus dans les cahiers ne peut être faite sans autorisation de la SHPF. Les opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs. Cahier tiré à 160 exemplaires Dépôt légal : décembre 2016 Commission paritaire des publications et agences de presse: certificat d'inscription n°65.361 Directeur de la publication : Jean-Hugues CARBONNIER Prix au numéro: 8,50 euros 169 ETUDE SUR UNE GENEALOGIE DES GIRARD DE LA VALLEE LONGUE (seconde partie) . Les GIRARD de Pruneyrolles, près d’Alteyrac, à Chamborigaud XIII ba2a - Jean IV GIRARD (°ca 1730 au mas d’Elphène, à Oultre près d’Alteyrac, commune de Chamborigaud, +12 février 1809 au mas de Pruneyrolles) Il est le fils de Jean III GIRARD et de Marie BENOIT (voir XII ba). Ménager à Pruneyrolles. Le mas de Pruneyrolles se situe au-dessus d’Arboussas, et en dessous de Valadier et d’Alteyrac, à Chamborigaud. Il épouse au désert le 26 février 1758, (pasteur Jean ROUX), Suzanne SAIX, fille de François SAIX, cardeur et travailleur de terre à Alteyrac, et de Louise BONDURAND (°ca 1700 à Valmalle). -

Prise En Compte Du Bruit Dans Le P.L.U
COMMUNE DE VERS-PONT-DU-GARD - 4.4 - PRISE EN COMPTE DU BRUIT DANS LE P.L.U. DOSSIER D’ARRÊT DU PROJET Arrêt du projet par D.C.M. du 31/01/2018 Vers-Pont-du-Gard 5 rue Grand du Bourg 30210 VERS-PONT-DU-GARD Tel. 04.66.22.80.55 Fax. 04.66.22.85.23 [email protected] VERS-PONT-DU-GARD *** ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME *** PRISE EN COMPTE DU BRUIT DANS LE P.L.U. *** ➢ Notice relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres - Préfecture du Gard ➢ Arrêté préfectoral n°2014071-0019 du 12.03.2014 portant approbation du classement sonore du réseau départemental du Gard ➢ Prise en compte du bruit dans le PLU – Urba.pro 2017 Vers-Pont-du-Gard / Urba.pro / Élaboration du plan local d'urbanisme / Prise en compte du bruit PRÉFET DU GARD Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Environnement et Forêt Unité Intégration de l’Environnement Classement sonore des infrastructures de transports terrestres Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre constitue un dispositif réglementaire préventif. Il se traduit par la classification du réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont affectés une catégorie sonore, ainsi que par la définition des secteurs dits " affectés par le bruit " (secteurs de nuisance) dans lesquels les futurs bâtiments sensibles au bruit devront présenter une isolation acoustique renforcée pour une meilleure protection. Ainsi l'isolement acoustique minimal des pièces principales des habitations, des établissements d'enseignement, de santé, ainsi que des hôtels sera compris entre 30 et 45 dB(A) de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas 35 dB(A) de jour (6h-22h) et 30 dB(A) de nuit (22h-6h). -

Journée Du Patrimoine - Samedi 21 Septembre 2013 Préfecture Du Gard Contenu Du Dossier
- Journée du patrimoine - Samedi 21 septembre 2013 Préfecture du Gard Contenu du dossier Présentation de l’institution préfectorale Fiches sur l’hôtel de la préfecture du Gard CV de M. le Préfet Biographie d’Yves Brayer Bilan 2012 de l’État dans le Gard Revue « Civique », L'Intérieur dans ses murs Hors-série spécial Journées européennes du patrimoine, septembre 2013 Présentation de l’institution préfectorale Les préfets dans l’Histoire de l’Antiquité à nos jours • Le mot préfet vient du latin Praefectus qui signifie « placé en tête ». Il désigne l’homme qui est à la tête d’une organisation. • Dans l’Antiquité, le mot préfet désignait surtout un chef militaire. • Après la chute de l’Empire romain, les rois francs sentent la nécessité d’avoir des représentants du pouvoir en province : les comtes. • Sous la dynastie capétienne (987-1328), les représentants du Roi sont les baillis au Nord et les sénéchaux au Sud. Ils disposent de pouvoirs très larges. • A la Renaissance, les représentants du pouvoir royal dans les provinces françaises sont les intendants. • En 1790, après la Révolution française, les intendants disparaissent. Un décret de 1790 crée les départements. La représentation du pouvoir central est confiée à une assemblée locale élue dans chaque département. • Napoléon Bonaparte institue, par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), un préfet dans chaque département. Les grandes dates de la fonction Objectif : assurer l’efficacité des politiques gouvernementales Principe de déconcentration : « On peut gouverner de loin, on administre bien que de près » • 1790 : création des départements; • 1800 : création des préfets (un préfet par département et un sous-préfet par arrondissement); • 1926 : suppression de 100 sous-préfectures dont celle d’Uzès; • 1982 : première loi de décentralisation (le préfet n’est plus l’exécutif du conseil général); • 1992 : loi administration territoriale de la République, charte de la déconcentration. -

Notice De Gestion Du Site De La Téronde, Commune De Saint-Jean-Du-Pin (30)
Notice de gestion du site de la Téronde, commune de Saint-Jean-du-Pin (30) Gard Nature - janvier 2011 a b c d Photographies de couverture : a. Aspect des boisements qui seront défrichés et concassés pour l’accueil du parc photovoltaïque (second plan). b. Le Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus chasse dans les zones ouvertes de la Téronde. c. Le Lézard vert Lacerta bilineata est un reptile présent dans les zones de garrigues enfrichées. d. La Rainette méridionale Hyla meridionalis est présente dans l’aire d’étude. Les photographies illustrant ce document sont l’œuvre collective des participants à l’étude. Elles peuvent être utilisées en citant «photo Gard Nature». Cette étude a été commanditée par la Compagnie du Vent. L’indication bibliographique conseillée est la suivante : BERNIER C. (2011) : Notice de gestion du site de la Téronde, commune de Saint-Jean-du-Pin (30), Gard Nature. Vous pouvez télécharger le document sur le site de Gard Nature. Pour toute remarque ou information complémentaire veuillez vous adresser à : Gard Nature Mas du Boschet Neuf 30300 Beaucaire Tél. : 04 66 02 42 67 E-mail : [email protected] Web : gard-nature.com & naturedugard.org Sommaire I. Description du site 2 1. Rappel du contexte 3 2. Localisation géographique 2 3. Description du milieu physique 3 4. Utilisation des parcelles concernées 3 5. Zonages existants 5 II. Evaluation écologique des zones d’emprise 6 1. Les habitats naturels 7 2. Bilan des connaissances naturalistes sur le site de la Téronde 9 3. Fonctionalités écologiques 9 4. Evaluation de l’intérêt écologique du site de la Téronde 10 III. -
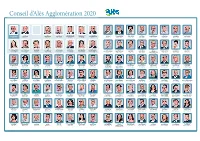
Conseil D'alès Agglomération 2020
Conseil d’Alès Agglomération 2020 ALÈS ALÈS ALÈS ALÈS SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX LA GRAND-COMBE LA VERNARÈDE SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES SAINT-PAUL-LA-COSTE CHAMBON CONCOULES SÉNÉCHAS LES PLANS SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON Christophe RIVENQ Max ROUSTAN Valérie MEUNIER Aimé CAVAILLÉ Jean-Charles BÉNÉZET Philippe RIBOT Patrick MALAVIEILLE Henri CROS Jean-Michel BUREL Adrien CHAPON Marc SASSO Jean-Marie MALAVAL René MEURTIN Gérard BARONI Patrick JULLIAN Président 1er vice-président 3e vice-présidente 4e vice-président 5e vice-président 6e vice-président 7e vice-président Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES ROUSSON SAINT-JEAN-DU-GARD LÉZAN MÉJANNES-LÈS-ALÈS CHAMBORIGAUD MASSILLARGUES-ATUECH CASTELNAU-VALENCE SERVAS MASSANES AUJAC SEYNES CORBÈS SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES LAMELOUZE SOUSTELLE Jennifer WILLENS Ghislain CHASSARY Michel RUAS Éric TORREILLES Christian TEISSIER Patrick DELEUZE Aurélie GÉNOLHER Christophe BOUGAREL Roch VARIN D’AINVELLE Laurent CHAPELLIER Firmin PEYRIC Thierry JONQUET Monique Georges DAUTUN Laure BARAFORT Georges RIBOT 8e vice-présidente 9e vice-président 10e vice-président 11e vice-président 12e vice-président 13e vice-président 14e vice-présidente 15e vice-président Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau CRESPON-LHERISSON Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS ANDUZE SALINDRES SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS -

Profil Santé Pays Cévennes
Profil Santé Contrat Local de Santé Pays Cévennes POPULATION ET TERRITOIRE - DÉTERMINANTS SOCIAUX DE SANTÉ - DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX DE SANTÉ - ÉTAT DE SANTÉ ET PROBLÈMES DE SANTÉ - ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS - OFFRE DE SOINS DE PREMIER RECOURS - PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DE DÉPENDANCE 2018 AVANT-PROPOS Le profil santé du Pays Cévennes rassemble les principales données quantitatives disponibles qui permettent de dégager certaines caracté- ristiques sociales et sanitaires, ainsi que celles de l’offre de soins et de services de ce territoire. Les données et indicateurs mobilisés sont présentés pour l’ensemble du Pays. Les indicateurs sont référés à la situation observée sur l’ensemble du département ou de la région ou au niveau national. Ce dossier s’organise autour de plusieurs chapitres : – les caractéristiques de la population et du territoire – les déterminants sociaux de santé – les déterminants environnementaux de santé – l’état de santé et les problèmes de santé – la santé des enfants et des jeunes – les comportements de santé en Occitanie – l’accès à la prévention et aux soins – l’offre de soins de premier recours – les personnes en situation de handicap et de dépendance Ces éléments doivent servir de support à un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs et des professionnels intervenant sur ce terri- toire afin de déterminer un projet de santé adapté aux spécificités lo- cales. TABLE DES MATIÈRES 1 POPULATION ET TERRITOIRE _________________________________________ 1 Descriptif et localisation ........................................................................................... 1 Un faible dynamisme démographique ..................................................................... 1 Un indice de vieillissement qui augmente et une part élevée de personnes âgées 2 2 DETERMINANTS SOCIAUX DE SANTE ___________________________________ 3 Une part importante de la population avec un faible niveau d’études................... -
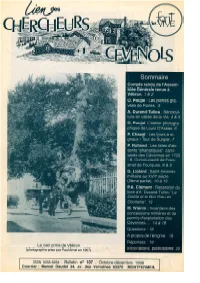
Sans Douleur, Le Lien Des Chercheurs Anciens De L.C.C
Assemblée Générale de L.C.C. A Vébron, le 22 août 1996 Participants à l'assemblée : Mmes : Bréjon de Lavergnée, Breton, Duthu, de Fontanès, Forgiel, Gauthron, Illien, Khoyan, Laporte, Moreau, Nétondal, Puech. Mmess et MM. : Allègre, Aubin, Bruguerolle, Canonge, Chéron, Clément, Daudet, Drouet, Forget, Gardiès, Lafont, Polge, Poujol Jacques, Poujol Olivier, Poujol Robert, Trélis. MM. : Alègre de la Soujeole, Benoït, Bruneton, Cabanel, Chabrol, Chapel, Chapus, Comte, Delauzun, Du Guerny, Elzière, Forest, Galtier, Liotard, Maurin, Nordez, Poulon, Rolland, Travier, Voisin-Roux, Wienin. Excusés : Mmes : Durand-Tullou, Lavenue, Lahaye-Daudet -Mmes et MM. : Méric, Thème -MM.: Baudouï, Calcat, Claveirole, Girard, Penchinat. Le président du Guerny ouvre la séance en présentant nos Il renvoie sur le parcours difficile des années 1955-1970 au invités : M. Benoît, directeur du P.N.C., M. Argilier, maire de numéro spécial de Causses et Cévennes (premier trimestre Vébron et enfin M. Robert Poujol, préfet honoraire. 1992) et intitulé : “Pellet - Richard - Bieau et les autres... Il Il signale que notre Assemblée Générale se tient à Vébron ajoute que c’est donc sur un chemin déblayé, et sous un ciel en hommage à M. Robert Poujol, un des membres les plus dégagé que va naître, sans douleur, le Lien des Chercheurs anciens de L.C.C. qui a collaboré dès le premier numéro au Cévenols.... Il cite les passages concernant les personnalités Comité de Rédaction, et qui a inauguré la première publica- des créateurs : Jean-François Breton et Jean Pellet, et il se tion hors-série “Les Châteaux de l’arrondissement de Florac”. félicite que malgré la disparition de ces deux créateurs.. -

Exploitations Minières Connues Sur Le Bassin D'alès Synthèse Des
Antenne SUD Pist Oasis 3 – Bât A Rue de la Bergerie 30319 ALES CEDEX Tél : +33 (0)4.66.61.09.80 Fax : +33 (0)4.66.25.89.68 Exploitations minières connues sur le bassin d’Alès Synthèse des résultats concernant les aléas Commune d’Alès (Gard) RAPPORT S 2018/038DE - 18LRO22010 Date : 26/03/2018 Siège - 1 Rue Claude Chappe – CS 25198 - 57075 METZ CEDEX 3 +33 (0)3 87 17 36 60 - +33 (0)3 87 17 36 89 – Internet www.geoderis.fr GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC - SIRET : 185 722 949 00020 - APE : 7120B Exploitations minières connues sur le bassin d’Alès Synthèse des résultats concernant les aléas Commune d’Alès (Gard) RAPPORT S 2018/038DE - 18LRO22010 Diffusion : DREAL Occitanie Philippe CHARTIER 4 ex. papier (2 DREAL, 1 commune, 1 DDT) 5 CD (2 DREAL, 1 commune, 1 DDT, 1 Préfecture) Pôle Après Mines Sud Jehan GIROUD GEODERIS Rafik HADADOU Rédaction Vérification Approbation NOM F. SAMARCQ C. VACHETTE C. VACHETTE Visa Page 4 RAPPORT S 2018/038DE - 18LRO22010 SOMMAIRE 1 Cadre et objectif .......................................................................................................... 3 2 Bassin d’Alès ............................................................................................................... 5 2.1 Zone géographique concernée .............................................................................. 5 2.1.1 Titres miniers concernés .................................................................................... 5 2.1.2 Communes concernées ....................................................................................10 -

'Châtaigne D'ardèche'
14.8.2013 EN Official Journal of the European Union C 235/13 Publication of an application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2013/C 235/06) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council ( 1 ). SINGLE DOCUMENT COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs ( 2) ‘CHÂTAIGNE D’ARDÈCHE’ EC No: FR-PDO-0005-0874-12.04.2011 PGI ( ) PDO ( X ) 1. Name ‘Châtaigne d’Ardèche’ 2. Member State or Third Country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals, fresh or processed 3.2. Description of product to which the name in (1) applies The designation of origin ‘Châtaigne d’Ardèche’ is reserved for fruit of ancient local varieties of Castanea sativa Miller belonging to a population adapted to the local environmental conditions of the Ardèche region (ecotype) and displaying the following common characteristics: the fruit is elliptical in shape, with a pointed apex, terminating with a style. They are light chestnut brown to dark brown in colour and are marked by vertical grooves. They have a small hilum. After peeling, their kernel is creamy white to pale yellow in colour and has a ribbed surface. The pellicle (or inner skin) can penetrate the kernel to the point of dividing it in two. -

2017-0000001
LETTRE CIRCULAIRE n° 2017-0000001 Montreuil, le 14/03/2017 DIRREC OBJET Sous-direction Modification du champ d'application du versement transport (art. L. modernisation des comptes 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) cotisants Texte(s) à annoter : Affaire suivie par : LCIRC-2016-0000020 ANGUELOV Nathalie Par arrêté préfectoral du 9 décembre 2016, le Préfet a décidé de revenir sur l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2016 par lequel il avait validé l’extension du périmètre du Syndicat Mixte des Transports Publics du Bassin d’Ales En conséquence, les communes qui devaient être intégrées au 01/01/2017, ne le sont plus Par arrêté préfectoral du 9 décembre 2016, le Préfet a décidé d’annuler les dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2016 qui prévoyait une extension de périmètre du Syndicat Mixte des Transports Publics du Bassin d’Ales (9303005) au 01/01/2017 Dans ces conditions, les communes suivantes ne sont plus intégrées au périmètre : - AUJAC - BONNEVAUX - CHAMBON - CONCOULES - GENOLHAC - ST JULIEN DE CASSAGNAS - STE CECILE D ANDORGE - SENECHAS Les informations relatives au champ d’application, au taux, au recouvrement et au reversement du versement transport sont regroupées dans le tableau ci-joint 1/1 CHAMP D'APPLICATION DU VERSEMENT TRANSPORT (Art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DU BASSIN D’ALES IDENTIFIANT N° 9303005 COMMUNES CONCERNEES CODE CODE TAUX DATE ORGANISME INSEE POSTAL D'EFFET DE RECOUVREMENT - ALES 30007 30100 - ANDUZE -

La Carte Suivante Se Réfère Au Risque Inondation Par Remontée De Nappe
LE RISQUE INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE La carte suivante se réfère au risque inondation par remontée de nappe. Lorsque des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, dans une période où la nappe est d’ores et déjà en situation de hautes eaux, une recharge exceptionnelle s’ajoute à un niveau piézométrique déjà élevé. Le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l’eau lors de la montée du niveau de la nappe. Ce risque est très élevé dans la partie Ouest de la commune située en bordure de la Crique de l’Angle. Carte des inondations par remontée de nappe Source. BRGM LE RISQUE EROSION DES BERGES La prise en compte de cet aléa vient se superposer à la prise en compte des aléas débordement de cours d'eau et ruissellement pluvial afin de prendre en compte les risques d'érosion de berges. Cette disposition permet par ailleurs de faciliter l’entretien du chevelu hydrographique et la réalisation d’une Trame verte et bleue. Des francs bords de 10 mètres doivent être appliqués à partir du haut des berges, de part et d’autre de l’ensemble du chevelu hydrographique répertorié. Les zones constituant les francs bords sont totalement inconstructibles. UN RISQUE SISMIQUE FAIBLE Faisant suite au Plan Séisme qui s’est étalé sur une période de 6 ans entre 2005 et 2010, le Ministère en chargé de l’écologie a rendu publique le nouveau zonage sismique de la France entré en vigueur le 1er mai 2011. Les différentes zones correspondent à la codification suivante : Zone 1 = Sismicité très faible Zone 2 = Faible sismicité Zone 3 = Sismicité modérée Zone 4 = Sismicité moyenne Zone 5 = Sismicité forte La commune de Saint-Jean-du-Pin est soumise au risque séisme. -

Cahier Des Charges De L'igp
Publié au BO du MAA le 12 décembre 2019 CAHIER DES CHARGES DE L’INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE « COTEAUX DU PONT DU GARD » Homologué par arrêté du 6 décembre 2019 publié au JORF du 8 décembre 2019 CHAPITRE 1 – DENOMINATION – CONDITIONS DE PRODUCTION 1 - Nom de l’indication géographique protégée Seuls peuvent prétendre à l’indication géographique protégée « Coteaux du Pont du Gard », initialement reconnue vin de pays des Coteaux du Pont du Gard par le décret du 16 novembre 1981, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. 2 – Mentions et unités géographiques complémentaires L’indication géographique protégée « Coteaux du Pont du Gard » peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages. L’indication géographique protégée « Coteaux du Pont du Gard » peut être complétée par les mentions « primeur » ou « nouveau ». 3 – Description des produits 3.1- Type de produits L’indication géographique protégée « Coteaux du Pont du Gard » est réservée aux vins tranquilles et aux vins de raisins surmûris, rouges, rosés, blancs. La mention d’un à plusieurs cépages est réservée aux vins tranquilles et aux vins de raisins surmûris. Les mentions « primeur » ou « nouveau » sont réservées aux vins tranquilles. 3.2 – Normes analytiques spécifiques Les vins tranquilles bénéficiant de l’indication géographique protégée « Coteaux du Pont du Gard » présentent un TAV acquis minimum de 9%. 3.3 – Descriptif organoleptique des vins Les très bonnes conditions de maturation et l’adaptation des cépages permettent d’obtenir des vins au caractère méditerranéen affirmé. Elaborés majoritairement à partir des cépages grenache, syrah, merlot et cabernet sauvignon, les vins rouges sont en général d’une couleur assez soutenue, offrant une robe rouge avec des reflets violines, de l’éclat et de la brillance.