Diagnostic Territorial
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Baignade Swimming Area
BAIGNADE SWIMMING AREA . BADEPLATZ ©Sonia Blin L’ Albagne Arrigas / Aumessas : D999 direction Alzon, prendre Aumessas tournez à droite au niveau des 3 ponts, rivière l’Albagne. Aire de loisirs pour enfants, jeux, baignade, pique-nique, eau potable, toilettes, analyses régulières. L’ Arre Avèze : sortie du Vigan direction Millau, à 1km tournez à gauche direction Avèze, prendre la 1re à droite camping du Pont Vieux, rivière l’Arre. Aire de pique-nique. Le Souls Molières-Cavaillac : D999 direction Alzon, traverser le village de Cavaillac direction la promenade du viaduc. A 200 m tournez à gauche sur le parking de la piste de BMX, chaussée du Mas Rouch. Bréau et Salagosse : direction D48 Mont Aigoual, suivre Intermarché en direction de Bréau, au carrefour prendre la direction de Salagosse sur 1km, le rieumage est là, la rivière la Souls. AU BORD DE L’eau AU Office de Tourisme Cévennes & Navacelles Bureau du Vigan Place du marché - 30120 LE VIGAN +33 (0)4 67 81 01 72 Bureau du Cirque de Navacelles Maison du Grand Site, Belvédères de Blandas - 30770 Blandas +33 (0)9 62 64 35 10 [email protected] www.tourismecevennesnavacelles.com La Vis Navacelles : descendre dans le cirque de Navacelles et garez-vous au parking. Rivière la Vis, très fraîche même en été ! Saint-Laurent-le-Minier : après le pont du Super U, prendre direction Saint-Bresson puis Saint-Laurent-le- Minier. La cascade de la Meuse, la rivière la Vis la plus fraîche et la plus revigorante... Parking aménagé et payant. La cascade est en partie privée sur sa rive gauche. -

Le Cirque De Navacelles Mai Le Paysage Comme Fil Rouge 2019 De La Démarche Grand Site De France
Dossier du réseau n° 9 Le cirque de Navacelles mai Le paysage comme fil rouge 2019 de la démarche Grand Site de France Cirque de Navacelles. Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Occitanie www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr LES DOSSIERS DU RÉSEAU | N° 9 — MAI 2019 Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Occitanie Sommaire 4 Introduction 4 Le paysage, un des fondement des Grands Sites 5 Exemple du Cirque de Navacelles 5 Territoire et perception 11 Acteurs et gouvernance 13 Démarches et outils 21 Le paysage et les Grands Sites de France 21 Protéger, gérer et aménager : des actions à mener de concert 21 Le paysage, une entrée transversale pour associer tous les acteurs et mettre en œuvre une gouvernance durable 23 Sources 3 LES DOSSIERS DU RÉSEAU | N° 9 — MAI 2019 Introduction Le paysage, un des fondements des Grands Sites Le caractère exceptionnel, unique ou singulier de certains paysages justifie certaines protections fortes, à commencer par le classement au titre de la loi de 1930, en fonction de valeurs partagées locale- ment et qui tiennent au caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du territoire considéré. Ces valeurs uniques ou cumulatives ont soutenu le développement du tourisme qui peut générer une fréquentation très importante sur ces sites ou sur leurs abords immédiats. Cette pression humaine plus ou moins intense peut conduire à une dégradation partielle ou totale, réversible ou non des espaces ainsi convoités. Afin d’assurer une protection, une gestion et une mise en valeur de ces sites exceptionnels, une politique nationale « Grands Sites » s’est construite depuis une trentaine d’années en vue d’assurer une pérennité à ces territoires et de préserver les valeurs qui en font tout l’attrait et la qualité. -

Le Gard Rapport Final
Inventaire du Patrimoine Géologique en Languedoc-Roussillon – Phase 2 : Le Gard Rapport final BRGM/RP-61622-FR juin 2014 Inventaire du Patrimoine Géologique en Languedoc-Roussillon – Phase 2 : Le Gard Rapport final BRGM/RP-61622-FR juin 2014 Étude réalisée dans le cadre des opérations de Service public du BRGM 2009 - PSP09LRO15 - 08GEOD21 Elisabeth Le Goff Avec la collaboration de P. Le Strat, L. Baillet et des Membres de la CRPG du Languedoc-Roussillon Vérificateur : Approbateur : Nom : Graviou Pierrick Nom : Blum Ariane Date : 22 septembre 2014 Date : 23 janvier 2015 Signature : Signature : En l’absence de signature, notamment pour les rapports diffusés en version numérique, l’original signé est disponible aux Archives du BRGM. Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2008. Partenaires de l’Inventaire • Financeurs \ maîtres d’œuvre : DREAL - Chef de service Nature : Jacques Regad ; - Chargée de mission, serviceNature: Capucine Crosnier (2008-2011) puis Valentin Le Tellier. BRGM - Chefs de projet Géologues : Paul Le Strat (2008-2010) puis Elisabeth Le Goff ; - Géologue : Laura Baillet. • Membres de la Commission Régionale du Patrimoine Géologique (CRPG) : Le CSRPN a validé, le 25 mars 2008, la liste des membres de la CRPG, amendée et actée le 16 juin 2008, après réponses des membres sollicités : • Coordonnateur régional (membre du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)) : Jean-Yves Crochet (nomination validée par le CSRPN le 17 décembre 2007). • Référents par département : - Aude -

Notice De Gestion Du Site De La Téronde, Commune De Saint-Jean-Du-Pin (30)
Notice de gestion du site de la Téronde, commune de Saint-Jean-du-Pin (30) Gard Nature - janvier 2011 a b c d Photographies de couverture : a. Aspect des boisements qui seront défrichés et concassés pour l’accueil du parc photovoltaïque (second plan). b. Le Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus chasse dans les zones ouvertes de la Téronde. c. Le Lézard vert Lacerta bilineata est un reptile présent dans les zones de garrigues enfrichées. d. La Rainette méridionale Hyla meridionalis est présente dans l’aire d’étude. Les photographies illustrant ce document sont l’œuvre collective des participants à l’étude. Elles peuvent être utilisées en citant «photo Gard Nature». Cette étude a été commanditée par la Compagnie du Vent. L’indication bibliographique conseillée est la suivante : BERNIER C. (2011) : Notice de gestion du site de la Téronde, commune de Saint-Jean-du-Pin (30), Gard Nature. Vous pouvez télécharger le document sur le site de Gard Nature. Pour toute remarque ou information complémentaire veuillez vous adresser à : Gard Nature Mas du Boschet Neuf 30300 Beaucaire Tél. : 04 66 02 42 67 E-mail : [email protected] Web : gard-nature.com & naturedugard.org Sommaire I. Description du site 2 1. Rappel du contexte 3 2. Localisation géographique 2 3. Description du milieu physique 3 4. Utilisation des parcelles concernées 3 5. Zonages existants 5 II. Evaluation écologique des zones d’emprise 6 1. Les habitats naturels 7 2. Bilan des connaissances naturalistes sur le site de la Téronde 9 3. Fonctionalités écologiques 9 4. Evaluation de l’intérêt écologique du site de la Téronde 10 III. -

Syndicat Mixte D’Etude Et De Pilotage Du Grand Site De Navacelles
SYNDICAT MIXTE D’ETUDE ET DE PILOTAGE DU GRAND SITE DE NAVACELLES Journée thématique d’échanges et Ateliers des territoires Vendredi 1 juin 2018, Blandas La démarche Grand Site de France pour le Cirque de Navacelles 1 Localisation 2 Le Cirque de Navacelles 33 Cascade du Cirque de Navacelles La cascade de la Vis au hameau de Navacelles 4 Le Cirque de Navacelles 55 Le Cirque et les gorges Les gorges de la Vis et le Cirque de Navacelles 6 Les Gorges 8 Nov. 2011 77 Les Causses 8 Les Causses Les causses, les gorges de la Vis et les Cévennes 9 Valeur patrimoniale et esprit des lieux 10 Une forte notoriété et fréquentation touristique 11 Les mesures de protection et de gestion 1291 ha 12 Bien Causses et Cévennes et Grands Sites • Inscription en 2011 sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco du Bien Causses et Cévennes au titre des paysages culturels vivants de l’agropastoralisme méditerranéen • Le Grand Site du Cirque : de constitue 15% de la surface du Bien Causses et Cévennes • Le Grand Site est un des 6 opérateurs locaux de la gestion du Bien Causses et Cévennes. 13 La construction de la démarche Le contexte institutionnel 14 Déroulé de la démarche depuis le premier classement Prise en compte Inscription au Premières mesures des paysages des patrimoine mondial d’ouverture des Grands Causses du Bien Causses Label milieux et candidature à et Cévennes l’UNESCO 15 LE SYNDICAT MIXTE, GESTIONNAIRE DU GSF SYNDICAT MIXTE Conseil Conseil Communauté Communauté départemental départemental de communes du de communes du du Gard de l'Hérault Pays -

Profil Santé Pays Cévennes
Profil Santé Contrat Local de Santé Pays Cévennes POPULATION ET TERRITOIRE - DÉTERMINANTS SOCIAUX DE SANTÉ - DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX DE SANTÉ - ÉTAT DE SANTÉ ET PROBLÈMES DE SANTÉ - ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS - OFFRE DE SOINS DE PREMIER RECOURS - PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DE DÉPENDANCE 2018 AVANT-PROPOS Le profil santé du Pays Cévennes rassemble les principales données quantitatives disponibles qui permettent de dégager certaines caracté- ristiques sociales et sanitaires, ainsi que celles de l’offre de soins et de services de ce territoire. Les données et indicateurs mobilisés sont présentés pour l’ensemble du Pays. Les indicateurs sont référés à la situation observée sur l’ensemble du département ou de la région ou au niveau national. Ce dossier s’organise autour de plusieurs chapitres : – les caractéristiques de la population et du territoire – les déterminants sociaux de santé – les déterminants environnementaux de santé – l’état de santé et les problèmes de santé – la santé des enfants et des jeunes – les comportements de santé en Occitanie – l’accès à la prévention et aux soins – l’offre de soins de premier recours – les personnes en situation de handicap et de dépendance Ces éléments doivent servir de support à un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs et des professionnels intervenant sur ce terri- toire afin de déterminer un projet de santé adapté aux spécificités lo- cales. TABLE DES MATIÈRES 1 POPULATION ET TERRITOIRE _________________________________________ 1 Descriptif et localisation ........................................................................................... 1 Un faible dynamisme démographique ..................................................................... 1 Un indice de vieillissement qui augmente et une part élevée de personnes âgées 2 2 DETERMINANTS SOCIAUX DE SANTE ___________________________________ 3 Une part importante de la population avec un faible niveau d’études................... -
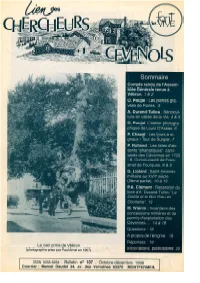
Sans Douleur, Le Lien Des Chercheurs Anciens De L.C.C
Assemblée Générale de L.C.C. A Vébron, le 22 août 1996 Participants à l'assemblée : Mmes : Bréjon de Lavergnée, Breton, Duthu, de Fontanès, Forgiel, Gauthron, Illien, Khoyan, Laporte, Moreau, Nétondal, Puech. Mmess et MM. : Allègre, Aubin, Bruguerolle, Canonge, Chéron, Clément, Daudet, Drouet, Forget, Gardiès, Lafont, Polge, Poujol Jacques, Poujol Olivier, Poujol Robert, Trélis. MM. : Alègre de la Soujeole, Benoït, Bruneton, Cabanel, Chabrol, Chapel, Chapus, Comte, Delauzun, Du Guerny, Elzière, Forest, Galtier, Liotard, Maurin, Nordez, Poulon, Rolland, Travier, Voisin-Roux, Wienin. Excusés : Mmes : Durand-Tullou, Lavenue, Lahaye-Daudet -Mmes et MM. : Méric, Thème -MM.: Baudouï, Calcat, Claveirole, Girard, Penchinat. Le président du Guerny ouvre la séance en présentant nos Il renvoie sur le parcours difficile des années 1955-1970 au invités : M. Benoît, directeur du P.N.C., M. Argilier, maire de numéro spécial de Causses et Cévennes (premier trimestre Vébron et enfin M. Robert Poujol, préfet honoraire. 1992) et intitulé : “Pellet - Richard - Bieau et les autres... Il Il signale que notre Assemblée Générale se tient à Vébron ajoute que c’est donc sur un chemin déblayé, et sous un ciel en hommage à M. Robert Poujol, un des membres les plus dégagé que va naître, sans douleur, le Lien des Chercheurs anciens de L.C.C. qui a collaboré dès le premier numéro au Cévenols.... Il cite les passages concernant les personnalités Comité de Rédaction, et qui a inauguré la première publica- des créateurs : Jean-François Breton et Jean Pellet, et il se tion hors-série “Les Châteaux de l’arrondissement de Florac”. félicite que malgré la disparition de ces deux créateurs.. -

Exploitations Minières Connues Sur Le Bassin D'alès Synthèse Des
Antenne SUD Pist Oasis 3 – Bât A Rue de la Bergerie 30319 ALES CEDEX Tél : +33 (0)4.66.61.09.80 Fax : +33 (0)4.66.25.89.68 Exploitations minières connues sur le bassin d’Alès Synthèse des résultats concernant les aléas Commune d’Alès (Gard) RAPPORT S 2018/038DE - 18LRO22010 Date : 26/03/2018 Siège - 1 Rue Claude Chappe – CS 25198 - 57075 METZ CEDEX 3 +33 (0)3 87 17 36 60 - +33 (0)3 87 17 36 89 – Internet www.geoderis.fr GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC - SIRET : 185 722 949 00020 - APE : 7120B Exploitations minières connues sur le bassin d’Alès Synthèse des résultats concernant les aléas Commune d’Alès (Gard) RAPPORT S 2018/038DE - 18LRO22010 Diffusion : DREAL Occitanie Philippe CHARTIER 4 ex. papier (2 DREAL, 1 commune, 1 DDT) 5 CD (2 DREAL, 1 commune, 1 DDT, 1 Préfecture) Pôle Après Mines Sud Jehan GIROUD GEODERIS Rafik HADADOU Rédaction Vérification Approbation NOM F. SAMARCQ C. VACHETTE C. VACHETTE Visa Page 4 RAPPORT S 2018/038DE - 18LRO22010 SOMMAIRE 1 Cadre et objectif .......................................................................................................... 3 2 Bassin d’Alès ............................................................................................................... 5 2.1 Zone géographique concernée .............................................................................. 5 2.1.1 Titres miniers concernés .................................................................................... 5 2.1.2 Communes concernées ....................................................................................10 -

'Châtaigne D'ardèche'
14.8.2013 EN Official Journal of the European Union C 235/13 Publication of an application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2013/C 235/06) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council ( 1 ). SINGLE DOCUMENT COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs ( 2) ‘CHÂTAIGNE D’ARDÈCHE’ EC No: FR-PDO-0005-0874-12.04.2011 PGI ( ) PDO ( X ) 1. Name ‘Châtaigne d’Ardèche’ 2. Member State or Third Country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals, fresh or processed 3.2. Description of product to which the name in (1) applies The designation of origin ‘Châtaigne d’Ardèche’ is reserved for fruit of ancient local varieties of Castanea sativa Miller belonging to a population adapted to the local environmental conditions of the Ardèche region (ecotype) and displaying the following common characteristics: the fruit is elliptical in shape, with a pointed apex, terminating with a style. They are light chestnut brown to dark brown in colour and are marked by vertical grooves. They have a small hilum. After peeling, their kernel is creamy white to pale yellow in colour and has a ribbed surface. The pellicle (or inner skin) can penetrate the kernel to the point of dividing it in two. -

Cirque De Navacelles : a Lire Au Format
VULNERABILITE Total : 1 /9 Public Géomorphologie Vulnérabilité naturelle : Aucune 0 *1 Protection effective : Maximale 0 *1 Menaces anthropiques : Faibles 1 *1 Site naturel de surface : Géosite LRO-0020 BESOIN EN PROTECTION Total : 4/12 ** intérêt patrimonial Statut : Protection physique : Non Protection juridique : Oui Cirque de Navacelles Nom du propriétaire : Propriétaires multiples Nom du gestionnaire : Gestionnaires multiples Statut : Anonyme Statut : Anonyme *** Anonyme Anonyme LOCALISATION Commentaire sur la Site classé par décret ministériel du 08 décembre 1983 (Cirque de Navacelles et des gorges de la Vis). Site inscrit par protection : arrêté ministériel du 15 mai 1991 (Abords du cirque de Navacelles et des gorges de la Vis). Problème de surfréquentation du site. Cadastre : REFERENCES CHOISIES Bibliographie (voir la liste bibliographique pour les références complètes) : LRO-0015B Ambert P., Ambert M., Coulet E. et Le causse de Blandas et les gorges de la Vis, étude géomorphologique 01/01/1978 LRO-0060B Bousquet J.-C. Découverte géologique : les plus beaux sites de l'Hérault 01/07/2008 Département(s) : Commune(s) : Coordonnées des noeuds d'emprise du site : LRO-0023B Bousquet J.-C. et collaborateurs La géologie de l'Hérault 01/01/1991 30 Gard 30040 BLANDAS 34277 SAINT-MAURICE-NAVACELLES Ordre X(Lambert2e) Y(Lambert2e) LRO-0504B Camus H. Causses méditerranéens: structuration du karst profond et creusement des vall 01/01/2010 34 Hérault 1 694051 1876930 LRO-0043B Dubois P., Yapaudjian L. Excursion dans le Jurassique moyen et supérieur des Grands Causses et du Bas 24/05/1975 2 694051 1878457 LRO-0047B Gèze B. Guides géologiques régionaux : Languedoc méditerranéen - Montagne Noire 01/01/1995 Lieu-dit : 3 694861 1878457 Navacelles. -

Gardtourisme Blog
General GARD TOURISM Press kit The march of history The Romans Nîmes Nature activities Cultural itineraries Wild landscapes An appealing The Cévennes, the Camargue, lifestyle Vineyards and Garrigue… Traditions The Gard of and terroirs a thousand faces Plus Beaux Villages de France Clermont-Ferrand Mende Grands Sites de France A75 Villefort E 11 Les Causses et les Cévennes E Villes d’Art et d’Histoire H Le Pont du Gard C È Villages de caractère Chemin de Saint-Jacques de Compostelle D En cours de labellisation Vallon-Pont-d’Arc R Paris L Aubenas O A Montélimar Lyon Z Génolhac È C h trimoine m R e Barjac Aiguèze Pa on m - d i Bessèges e ia l n m l E a d is de R e l D E ég Cèze ra L S C l’ Mende o Pont-Saint- o A É U rda t N V n Florac ne Saint-Ambroix Montclus Esprit s O E e a I N s Saint-Jean- Méjannes- p T c - N o le-Clap o A de-Valériscle r N E g Meyrueis S La Grand- R a Florac Allègre- h ’ C Combe La Roque- l Les Fumades ô sur-Cèze R n A7 e Bagnols- e E 714 d A enson Lussan ev sur-Cèze V l t P Mont Aigoual Saint-André- S e C Alès A Arles de-Valborgne h r Saint-Jean- 1567 m em Marseille u in du-Gard U t de l Valleraugue Trèves C u c VIGNES Roquemaure L e Anduze Vézénobres Dourbies C ÉVENNES U g Lasalle G a Uzès a s N Saint-Martial r S d A9 y o Villeneuve- n Le Pont a Aumessas E 15 E O Sumène Saint-Hippolyte- Lédignan lès-Avignon P du-Fort ET du Gard R Vidou Saint-Chaptes - Millau Le Vigan rle Gorges du Gardon Avignon Y Alzon s Remoulins e E Cirque de Sauve G n a Aramon r n Navacelles Quissac d A75 V o e GARRIGUE E 11 n v Saint-Mamert-du-Gard -

La Carte Suivante Se Réfère Au Risque Inondation Par Remontée De Nappe
LE RISQUE INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE La carte suivante se réfère au risque inondation par remontée de nappe. Lorsque des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, dans une période où la nappe est d’ores et déjà en situation de hautes eaux, une recharge exceptionnelle s’ajoute à un niveau piézométrique déjà élevé. Le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l’eau lors de la montée du niveau de la nappe. Ce risque est très élevé dans la partie Ouest de la commune située en bordure de la Crique de l’Angle. Carte des inondations par remontée de nappe Source. BRGM LE RISQUE EROSION DES BERGES La prise en compte de cet aléa vient se superposer à la prise en compte des aléas débordement de cours d'eau et ruissellement pluvial afin de prendre en compte les risques d'érosion de berges. Cette disposition permet par ailleurs de faciliter l’entretien du chevelu hydrographique et la réalisation d’une Trame verte et bleue. Des francs bords de 10 mètres doivent être appliqués à partir du haut des berges, de part et d’autre de l’ensemble du chevelu hydrographique répertorié. Les zones constituant les francs bords sont totalement inconstructibles. UN RISQUE SISMIQUE FAIBLE Faisant suite au Plan Séisme qui s’est étalé sur une période de 6 ans entre 2005 et 2010, le Ministère en chargé de l’écologie a rendu publique le nouveau zonage sismique de la France entré en vigueur le 1er mai 2011. Les différentes zones correspondent à la codification suivante : Zone 1 = Sismicité très faible Zone 2 = Faible sismicité Zone 3 = Sismicité modérée Zone 4 = Sismicité moyenne Zone 5 = Sismicité forte La commune de Saint-Jean-du-Pin est soumise au risque séisme.