Modèle De Développement Des Athlètes – 2016-2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Water Polo for Players and Teachers of Aquatics
1 WATER POLO FOR PLAYERS & TEACHERS OF AQUATICS Pete Snyder, Ph. D. Professor, Fullerton College, Fullerton, California Layout Design: Mary Jo Reutter ©2008, updated 2017. All rights reserved. This manual may not, in whole or in part, be copied, photocopied, reproduced, translated, or converted to any electronic or machine readable form without prior written consent of the author. It is Web-pub- lished by the LA84 Foundation under a license from the author. Printed in the USA 2 Acknowledgements This book would not have been completed and had its particular attention to detail without the help and support of the following individuals. First I’d like to thank Mr. Lundy Smith, an English teacher and head Girls Water Polo Coach at Phillips Exeter Academy in Exeter, New Hampshire. Lundy was most helpful in points of emphasis and grammatical structure in the book. I’d also like to thank Roger Nekton from Phillips Exeter. Roger just retired as head boys water polo and swimming coach after a long and very distinguished career of over thirty years at the Academy. Roger provided valuable technical input as well as encouragement regarding the need for written material in the sport of water polo. As a picture is worth a thousand words, I’m very indebted to Mrs. Chris Kittredge of CMK Enterprises (www.tudorgraphics.com). Chris was able to capture some of the more difficult team aspects of the game only because of her dedication, extensive knowledge of over twenty years with the sport and her brilliance as a photographer. Matt Brown (www.mattbrownphoto.com) is another photographer who exhibited a tremendous amount of alacrity in his water polo photos. -

Historique Du Waterpolo
Historique du waterpolo Écrit par Water Polo Canada. Posted in Le waterpolo L'origine du water polo peut être retracée dans l'est de l'Inde, où des officiers de l'armée britannique ont fait l'expérience du "pulu" jeu de balle à cheval. De là, le polo a été amené en Europe et il a été joué sous le nom de rugby et finalement comme football dans l'eau pour devenir water polo – on y jouait dans des rivières et des lacs. À l'origine, une vésicule de porc servait de balle, mais comme elle éclatait facilement, elle a été vite remplacée par un ballon de caoutchouc. En 1870, le London Swimming Club a établi les premiers règlements de ce jeu de football dans l'eau. Ils acceptaient la force brutale. Submerger ses adversaires était permis, de même que plonger avec le ballon et le transporter dans le maillot, à travers l'eau boueuse, vers le but. Un point était marqué en mettant le ballon dans le but à deux mains, ou dans un bateau ou sur la pleine largeur d'un ponton. Le gardien de but demeurait hors de l'eau et il sautait dans l'eau quand l'équipe adverse approchait pour marquer. Lentement, par essais et erreurs, des règlements plus appropriés ont été trouvés. Toutefois, ce n'est qu'en 1884 que l'Association de natation de la Grande-Bretagne a reconnu le sport comme étant de sa juridiction. En 1880, en Écosse, l'introduction de la nage Sullivan a permis des changements aux règlements pour rendre le sport plus rapide, et la force brutale a été remplacée par des mouvements plus techniques, plus rapides et par des mouvements tactiques. -

Long-Term Athlete Development
Long-Term Athlete Development “The pursuit of excellence and an active lifestyle” Table of Contents Acknowledgements ......................................................................................................................................................................5 Glossary of Acronyms ..................................................................................................................................................................6 Glossary of Terms .........................................................................................................................................................................7 Introduction ...............................................................................................................................................................................11 A Systematic Review of Water Polo Canada ..........................................................................................................................15 Sensitive Periods of Trainability ...............................................................................................................................................21 Periodization .............................................................................................................................................................................26 Physical Literacy .......................................................................................................................................................................28 -
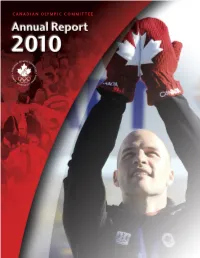
Annual Report 2010
CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE CONTENTS PRESIDENT ’S MESSAGE 2 CEO & S ECRETARY GENERAL ’S MESSAGE 3 VANCOUVER 2010 4 PARADE OF ATHLETES 6 2010 H ALL OF FAME 8 A C LEAR VISION AND DIRECTION 10 OLYMPIC PREPARATION : B UILDING TOWARD LONDON 2012 12 PAN AM GAMES PREPARATION 14 EYE ON THE FUTURE 15 OWN THE PODIUM 16 FUNDRAISING 18 ATHLETE EXCELLENCE FUND 19 POST -O LYMPIC EXCELLENCE SERIES 20 CANADIAN OLYMPIC SCHOOL PROGRAM 22 OLYMPIC PARTNERS IN ACTION 24 A S OCIAL MEDIA CHANGE 26 FINANCIAL STATEMENTS 27 COC AND SESSION MEMBERS 28 ON THE COVER: Chris Le Bihan, Bronze Medallist/Bobsleigh, Vancouver 2010 Olympic Winter Games 1 PRESIDENT’S MESSAGE Ontario, plans are heating up for the 2015 Pan American Games, where Toronto and the Greater Golden Horseshoe will showcase a major international sport event. All the COC's ongoing initiatives, such as the Canadian Olympic School Program, Olympic With renewed energy, a new focus and keen Voice, Adopt-an-Athlete and the Post-Olympic hunger for success, we have set off on a new Excellence Seminar, took on a greater significance trajectory to capitalize on the momentum as athletes take centre stage in the new direction. 2010 BROUGHT ON AN created by the Vancouver Games’. To be among IMPORTANT EVOLUTION OF the world’s best sport governing bodies, we As our athletes experience increased success THE OLYMPIC MOVEMENT must think, plan and execute like the best. on the world stage, so should the COC play IN CANADA , A CHANGE As detailed below, initial changes incorporated a larger role within the international sport a new vision, a more distinct brand, a new direc - community. -
Dodgeball Canada 94
Canadian Sport 2020 Major Provincial, National Tourism Alliance Sport Events Directory & International Events TABLE OF CONTENTS 365 Sports 5 Aboriginal Sport Circle 6 Alberta Fencing Association 7 Alberta Table Tennis Association 8 Archery Canada 10 Athletics Canada 11 Badminton Canada 13 Baseball Canada 19 Boxing Alberta 21 Bowls Alberta 23 Bowls Canada 25 Canada Basketball 27 Canada Running Series 37 Canada Snowboard 38 Canadian Ball Hockey Association 40 Canadian Collegiate Athletic Association (CCAA) 42 Canadian Lacrosse Association 44 Canadian Soccer Association 46 CAN-AM Police-Fire Games 53 Canoe Kayak Canada 54 Cheer Canada 69 Chess Federation of Canada 71 Coaching Association of Canada 82 Commonwealth Games Canada 85 2 Canadian Sport 2020 Major Provincial, National Tourism Alliance Sport Events Directory & International Events Curling Alberta 87 Cycling Canada 89 Diving Canada 91 Dodgeball Canada 94 Football Canada 96 Golf Canada 106 Gymnastics Canada 133 Hockey Canada 149 Judo Canada 163 Karate Canada 168 Luge Canada 170 Motivate Canada 172 Orienteering Canada 173 Pickleball Canada 175 Quidditch Canada 177 Ringette Canada 178 Rowing Canada 180 The Royal Canadian Legion – National Headquarters 183 Rugby Canada 185 Sail Canada 187 Skate Canada: Alberta-NWT/Nunavut 189 Slo-Pitch National Alberta 196 Slo-Pitch National 199 Spartan Race 200 Special Olympics Alberta 202 3 Canadian Sport 2020 Major Provincial, National Tourism Alliance Sport Events Directory & International Events Special Olympics Canada 205 Speed Skating Canada 207 STIHL Timbersports 209 Surf Canada 215 Tennis Canada 217 Triathlon Alberta 219 Triathlon Canada 221 Tribu Expérientiel 232 U SPORTS 242 Ultimate Canada 244 Volleyball Canada 248 Water Polo Canada 257 Water Ski & Wakeboard Alberta 262 Wrestling Canada 269 4 Canadian Sport 2020 Major Provincial, National Tourism Alliance Sport Events Directory & International Events 365 SPORTS Address: 71 Edwin St. -

Rapport-Annuel-2013.Pdf
ANNUAL EMBRACE REPORT PERFORM 2012-2013 INSPIRE TABLE OF CONTENTS PRESIDENT’S MESSAGE 6 CEO’S MESSAGE 8 NATIONAL TEAM PROGRAM 9 PARA-SWIMMING PROGRAM 15 NATIONAL DEVELOPMENT TEAM PROGRAM 17 REGISTRATION INFORMATION 24 SWIMMING CANADA OPERATIONS 26 CHIEF FINANCIAL OFFICER – EXECUTIVE REVIEw 29 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30 STATEMENT OF OPERATIONS 31 OUR VISIon We inspire Canadians through world leading performances to embrace a lifestyle of swimming, sport, fitness and health. OUR MISSIon We create and develop an environment that allows people to achieve sustained success and leadership; We ensure a welcoming and safe environment; We promote our brand so that Canadians view swimming as a premier sport and activity in Canada; We drive growth through innovation, quality programming and partnerships; We lead and govern with organizational excellence and business performance. All of this is achieved by holding true to our core values 4 OUR CORE VALUES Excellence & Professionalism Everyone delivers peak performance and proactively seizes the opportunities that come from change in the quest for continuous improvement. It is not only up to the national coaching staff or the national centers or the athletes to win medals and go for gold. Everyone shares in this responsibility, including the Board, staff, officials, volunteers, clubs, provinces and territories. We must all strive for excellence with a “no excuses” policy. Respect We value respect as integral to our culture. By collaborating, proactively communicating and cooperating with our swimming community and stakeholders, we promote and build on this value for the betterment of our sport, our people and our society. Integrity We are committed to honest and accountable delivery of its programs, services and activities. -

2007 Inductees Dr. Robert Clayton
2007 INDUCTEES DR. ROBERT CLAYTON (1942 – 1947) Robert attended Delta from 1942 until 1947. While at Delta he became a “Scholarship Winner” and continued his education at Queen’s University in Kingston, Ontario. In those days, Queen’s was much smaller with about 2500 students and Robert says he never regretted his decision to go to Queen’s as he had a wonderful time during his student years. Robert graduated with a B.Sc. in 1951 and a M.Sc. in 1952. He continued his Ph.D. studies at the California Institute of Technology in Pasadena, California and earned a Ph.D. in chemistry in 1955. Robert joined the University of Chicago in 1958 and became a leader in the field of geochemistry which involves studying the earth’s chemistry. He is currently Professor Emeritus in Chemistry and Geophysical Sciences at the University. In 2004, President Bush named Robert among the recipients of the National Medal of Science, the nation’s highest science honour. His research has included the isotopic studies of terrestrial materials (rocks, oceans and atmosphere) and extraterrestrial materials (lunar samples and meteorites). He is renowned for his work on the origin of the Earth, Moon and Solar System and was entrusted with lunar samples which were brought to earth by the Apollo space missions. Robert is being cited for his leading contributions to cosmic chemistry and for being an exemplary role model as a mentor, teacher and science advocate. Robert is a Fellow of the Royal Society of London and The Royal Society of Canada. DR. JACK GAULDIE (1955 – 1960) While at Delta, Jack started his illustrious career in water polo which he played all 5 years, leading the junior team to an undefeated season and the city championship. -

Water Polo for Players and Teachers of Aquatics
1 WATER POLO FOR PLAYERS & TEACHERS OF AQUATICS Pete Snyder, Ph. D. Professor, Fullerton College, Fullerton, California Layout Design: Mary Jo Reutter ©2008, updated 2017. All rights reserved. This manual may not, in whole or in part, be copied, photocopied, reproduced, translated, or converted to any electronic or machine readable form without prior written consent of the author. It is Web-pub- lished by the LA84 Foundation under a license from the author. Printed in the USA 2 Acknowledgements This book would not have been completed and had its particular attention to detail without the help and support of the following individuals. First I’d like to thank Mr. Lundy Smith, an English teacher and head Girls Water Polo Coach at Phillips Exeter Academy in Exeter, New Hampshire. Lundy was most helpful in points of emphasis and grammatical structure in the book. I’d also like to thank Roger Nekton from Phillips Exeter. Roger just retired as head boys water polo and swimming coach after a long and very distinguished career of over thirty years at the Academy. Roger provided valuable technical input as well as encouragement regarding the need for written material in the sport of water polo. As a picture is worth a thousand words, I’m very indebted to Mrs. Chris Kittredge of CMK Enterprises (www.tudorgraphics.com). Chris was able to capture some of the more difficult team aspects of the game only because of her dedication, extensive knowledge of over twenty years with the sport and her brilliance as a photographer. Matt Brown (www.mattbrownphoto.com) is another photographer who exhibited a tremendous amount of alacrity in his water polo photos. -

Développement À Long Terme De L'athlète
Développement à long terme de l’athlète « À la poursuite de l’excellence et d’un style de vie actif » Table des matières Remerciements ............................................................................................................................................................................5 Glossaire des acronymes .............................................................................................................................................................6 Glossaire des termes ....................................................................................................................................................................7 Introduction ...............................................................................................................................................................................11 Un examen méthodique de Water Polo Canada ....................................................................................................................15 Périodes critiques d’entraînement .........................................................................................................................................21 Périodisation .............................................................................................................................................................................26 Le savoir-faire physique ............................................................................................................................................................28 -

2019 Sport Events Directory
Canadian Sport 2019 Major Provincial, National Tourism Alliance Sport Events Directory & International Events 1 Canadian Sport 2019 Major Provincial, National Tourism Alliance Sport Events Directory & International Events TABLE OF CONTENTS Badminton Canada 4 Baseball Canada 10 Bowls Canada Boulingrin 13 Boxing Canada 15 C2C Sports (Corporate Games Canada) 24 Canada Artistic Swimming 26 Canadian Ball Hockey Association 38 Canadian Collegiate Athletic Association 39 Canadian Soccer Association 42 Canoe Kayak Canada 49 CARHA Hockey 63 Chess Federation of Canada 66 Commonwealth Games Canada 82 Curling Canada 85 Cycling Canada 97 Diving Canada 100 Football Canada 102 Golf Canada 112 GWN Events 122 Hockey Canada 125 Judo Canada 139 Little League Canada 145 Ontario Curling Association 153 Ontario Ministry of Tourism, Culture & Sport 155 Pickleball Canada 160 Rick Davis Promotions 162 2 Canadian Sport 2019 Major Provincial, National Tourism Alliance Sport Events Directory & International Events Ringette Canada 163 Skate Canada 165 Slo-Pitch National 171 Softball Canada 173 Special Olympics Canada 175 Speed Skating Canada 178 STIHL Timbersports 180 Swimming Canada 186 Tribu Expérientiel 191 USPORTS 196 Volleyball Canada 199 Water Polo Canada 205 3 Canadian Sport 2019 Major Provincial, National Tourism Alliance Sport Events Directory & International Events BADMINTON CANADA Address: 700 Industrial Ave Contact Name: Joe Morissette City: Ottawa Contact Telephone: 613-569-2424 Province/Territory: ON Contact Email: [email protected] Postal Code: -

Governing with Integrity and Transparency
News Release April 26, 2017 Alberta’s best honoured at sport leadership conference Banff – Olympian Gilmore Junio will join the Alberta Sport Connection in honouring the 2016 Alberta Athletes and Teams of the Year, and the 2017 Alberta Sport Award winners for coaching, officiating and volunteer service at the Alberta Sport Leadership Conference in Banff, Friday, April 28. “Sport calls out and demands the best in all of us, and that is what we get with these outstanding athletes, coaches and volunteers. The significant contributions these recipients have made to their sport and to their communities have made our province proud,” said Ricardo Miranda, Minister of Culture of Tourism, responsible for sport in Alberta. “Congratulations to all of the recipients of this year’s awards. They are shining examples of what it means to be an Albertan.” “We’re proud and honoured to celebrate the achievements of these special Albertans with their families, friends, supporters and colleagues,” said Andrew Ference, Chair of Alberta Sport Connection. “Athletes know their achievements can only happen because of the help and support they get along the way. Everyone looks back and remembers the ones who made the difference for them and ASC is pleased to recognize some of the most dedicated and hard-working individuals in sport, our coaches, officials and sport volunteers.” 2016 Athletes and Teams of the Year: Ms. Erica Wiebe Open Female Wrestling Calgary Mr. Alister McQueen Open Male Athletics - Javelin Calgary Ms. Rebecca Smith Junior Female Swimming Red Deer Mr. Stefan Ritter Junior Male Cycling - Track Edmonton Biathlon Relay Team Open Team Biathlon Canmore Mr. -

Smart Cities & Sport Summit 2017
Smart Cities & Sport Summit 2017 - Participants Last name First name Title Company City Country Allen James Responsible for the legacy of sport events Canadian government Montréal CANADA Angelini Luigi Member of the board of directions Wellness foundation Cesena ITALY Barrette Hélène Communication advisor Olympic Park Montréal CANADA Bauer Eleonora Citizenship Development Secretary´s Chief of Staff Buenos Aires Martinez ARGENTINA Baumann Wolfgang Secretary General TAFISA Frankfurt am Main GERMANY Beauchesne Jean Marc Manager, The Fit Stop City of Summerside Summerside CANADA Beis Dimitrios (Jim) Member of Montréal Executive Committee, Responsible for Sports and Recreation Ville de Montréal Montréal CANADA Bélanger Catherine Planning advisor, Direction des sports et de l'activité physique Ville de Montréal Montréal CANADA Boucher Dany Director of Maintenance and event support Olympic Park Montréal CANADA Bourdon Michel Vice President, Sales and Convention Services Tourisme Montréal Montréal CANADA Braga Tania Head of Legacy International Olympic Committee Lausanne SWITZERLAND Bremer Ronna Director, Partnerships & Event Strategy City of Edmonton Edmonton CANADA Breton Olivier Project Manager Tourisme Montréal Montréal CANADA Brian Mulhall Director of Operations Olympic Park Montréal CANADA Brochu Alain Director of Protection of infrastructure, monitoring and event logistics Olympic Park Montréal CANADA Bruce Aaron Acting Director of Sport & Games Canada Games Council Ottawa CANADA Brunelle Charles-Mathieu Director Espace pour la vie - Ville