Manduel-Redessan Et Acces Modes Doux Depuis La Rd3
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Of Council Regulation (EC)
2.10.2012 EN Official Journal of the European Union C 296/9 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2012/C 296/08) This publication confers the right to object to the application pursuant to Article 7 of Council Regulation (EC) No 510/2006 ( 1 ). Statements of objection must reach the Commission within six months of the date of this publication. SINGLE DOCUMENT COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 ‘FRAISES DE NÎMES’ EC No: FR-PGI-0005-0809-02.06.2010 PGI ( X ) PDO ( ) 1. Name: ‘Fraises de Nîmes’ 2. Member State or Third Country: France 3. Description of the agricultural product or foodstuff: 3.1. Type of product: Class 1.6: Fruit, vegetables and cereals, fresh or processed 3.2. Description of product to which the name in point 1 applies: ‘Fraises de Nîmes’ are presented fresh. The fruit is healthy, without deformities, bright and unsoiled. The fruit must have a minimum sugar content of 7,5 % Brix and its colour at harvest must be homogenous. The fruit must have a fresh and green peduncle and calyx. Marketed fruit are arranged in layers, regardless of the type of packaging (punnet, tray). ‘Fraises de Nîmes’ must be marketed in the ‘Extra’ or ‘I’ class. Each batch must contain fruit of a uniform size of at least 18 mm. ‘Fraises de Nîmes’ stem from varieties listed by the applicant group. ( 1 ) OJ L 93, 31.3.2006, p. -

Prise En Compte Du Bruit Dans Le P.L.U
COMMUNE DE VERS-PONT-DU-GARD - 4.4 - PRISE EN COMPTE DU BRUIT DANS LE P.L.U. DOSSIER D’ARRÊT DU PROJET Arrêt du projet par D.C.M. du 31/01/2018 Vers-Pont-du-Gard 5 rue Grand du Bourg 30210 VERS-PONT-DU-GARD Tel. 04.66.22.80.55 Fax. 04.66.22.85.23 [email protected] VERS-PONT-DU-GARD *** ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME *** PRISE EN COMPTE DU BRUIT DANS LE P.L.U. *** ➢ Notice relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres - Préfecture du Gard ➢ Arrêté préfectoral n°2014071-0019 du 12.03.2014 portant approbation du classement sonore du réseau départemental du Gard ➢ Prise en compte du bruit dans le PLU – Urba.pro 2017 Vers-Pont-du-Gard / Urba.pro / Élaboration du plan local d'urbanisme / Prise en compte du bruit PRÉFET DU GARD Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Environnement et Forêt Unité Intégration de l’Environnement Classement sonore des infrastructures de transports terrestres Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre constitue un dispositif réglementaire préventif. Il se traduit par la classification du réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont affectés une catégorie sonore, ainsi que par la définition des secteurs dits " affectés par le bruit " (secteurs de nuisance) dans lesquels les futurs bâtiments sensibles au bruit devront présenter une isolation acoustique renforcée pour une meilleure protection. Ainsi l'isolement acoustique minimal des pièces principales des habitations, des établissements d'enseignement, de santé, ainsi que des hôtels sera compris entre 30 et 45 dB(A) de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas 35 dB(A) de jour (6h-22h) et 30 dB(A) de nuit (22h-6h). -

Mai 2017 N°24
Le bulletin des habitants de la commune Mai 2017 n°24 . B U L L E T I N M U N I C I P A L - - - 2 - REPUBLIQUE FRANCAISE AIRIE DE LEDENON ------------------------------------ DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2017 (EXTRAITS) SOMMAIRE Le mot du Maire p.5 Compte rendu Conseil Municipal p.6 Tel : 04 66 37 19 52 La mairie vous informe p.10 Vente à distance (CB) Manifestations passées p.15 Associations du village p.22 Le Pont du Gard p.28 Manifestations à venir p.30 Agenda p. 32 Lédenon, le bulletin de la commune, n° 24, mai 2017 Les manifestations de l’Agglo p.34 Tirage à 800 exemplaires. Comité de lecture : Isabelle BELMONTE, Chantal DECLE-LOPEZ, Delphine SILVESTRE. Responsable de la rédaction : Delphine SILVESTRE. Directeur de la publication : Frédéric BEAUME. Impression : AGR- Etat Civil p.39 DIFFUSION Conqueyrac. Photos : M. GOSSELIN, Mr CHAMONTIN, Mr TOURNIGAN, Mme BELMONTE, Mairie, Associations. Coordonnées Associations p.40 Permanences du Maire et de ses adjoints Contacts Utiles p.41 Renseignements au 04 66 37 26 46 Contacter la mairie : [email protected] Retrouver l’information : www.ledenon.fr - 3 - NOUVEAU : ouverture le MERCREDI après-midi Côté Parc 04 66 74 05 06 BAR TABAC PRESSE EPICERIE Française des Jeux COTE PARC vous accueille du lundi au jeudi de 06h à 13h30 et de 16h à 23h Du vendredi au dimanche de 07h à 23h - 4 - LE MOT DU MAIRE Chers Lédenonnaises et Lédenonnais, Cette année 2017 s’annonce riche en actions menées par l’équipe municipale. -
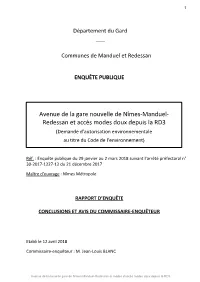
Redessan Et Accès Modes Doux Depuis La RD3 (Demande D’Autorisation Environnementale Au Titre Du Code De L’Environnement)
1 Département du Gard ____ Communes de Manduel et Redessan ENQUÊTE PUBLIQUE Avenue de la gare nouvelle de Nîmes-Manduel- Redessan et accès modes doux depuis la RD3 (Demande d’autorisation environnementale au titre du Code de l’environnement) Réf. : Enquête publique du 29 janvier au 2 mars 2018 suivant l’arrêté préfectoral n° 30-2017-1227-12 du 21 décembre 2017 Maître d’ouvrage : Nîmes Métropole RAPPORT D’ENQUÊTE CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR Etabli le 12 avril 2018 Commissaire-enquêteur : M. Jean-Louis BLANC Avenue de la nouvelle gare de Nîmes-Manduel-Redessan et modes d’accès modes doux depuis le RD3 2 SOMMAIRE I. RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR ..................................... 4 1. GENERALITES ........................................................................................................................... 4 1.1. Préambule ................................................................................................................................................................................ 4 1.2. Objet et contexte de l’enquête.............................................................................................................................................. 4 1.3. Cadre juridique........................................................................................................................................................................ 5 2. DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES DU PROJET ......................................................................... 6 2.1. Objectifs du projet -

Notre Village Info N°44 S
Meyne Informations municipales – 1er Semestre 2014 – Notre Village Info N°44 S Le spectacle de Noël offert aux enfants des écoles. La veillée de Noël. La prévention routière à l’école. Les écoliers au pied du sapin de Noël. Octobre Nature au château de Lédenon. Meyne InfoS Meynoises, Meynois, En mars 2014, vous allez élire votre conseil municipal pour les six pro- chaines années. Après 31 ans de mandat d’élu local dont 6 ans en tant qu’adjoint et 19 ans en tant que maire, je vous ai déjà informés de ma décision de ne pas être candidat à cette élection. Aujourd’hui, je tiens à vous dire tout le plaisir que j’ai eu à gérer notre belle commune et je vous remercie toutes et tous de m’avoir accordé votre confiance pendant toutes ces années. Avec mes collègues élus, nous avons œuvré, au fil des mandats, pour faire évoluer la qualité de vie au sein du village et contribué à son embellissement. Je ne citerai pas toutes les réalisations qui sont nombreuses et touchent tous les secteurs de la vie de chacun même s’il reste toujours à faire. Une de mes grandes satisfactions est de laisser un conseil municipal uni, solidaire et dynamique, un conseil municipal qui vit bien. Le plus important cependant reste la gestion financière rigoureuse que j’ai su appliquer à la commune avec le soutien de mes collègues élus. Si comme de nombreuses communes Meynes dispose de peu de ressources, elle possède par contre des finances très saines : les charges de fonctionnement et l’endettement sont maîtrisés. -

Projet De Plan De Prevention Des Risques Inondation
PREFET DU GARD Direction départementale des Territoires et de la Mer du Gard Service Observation Territoriale Urbanisme et Risques Unité Risques Inondations PROJET DE PLAN DE PREVENTION DESRISQUES INONDATION COMMUNEDEREDESSAN Rapport de Présentation Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DES COMMUNES DU BASSIN VERSANT DU VISTRE Rapport de présentation 1. OBJECTIFS ET DÉMARCHE ...................................................................... 1 1.1 Préambule 1 1.2 Le risque inondation dans le Gard 2 1.3 Les objectifs de la politique de prévention des risques 5 1.4 La démarche PPRi 6 1.5 La raison de la prescription du PPRi et le périmètre concerné 10 1.6 L’approche méthodologique (études techniques préalables) 12 2. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE .............................. 14 2.1 Hydrographie et morphologie 15 2.2 Nature et occupation du sol 20 2.2.1 Entités géologiques 20 2.2.2 Entités hydrogéologiques 22 2.2.3 Occupation du sol 24 2.3 Climat et pluviométrie 25 2.4 Aménagements structurants et ouvrages hydrauliques 26 2.4.1 Historique des aménagements 26 2.4.2 Ouvrages hydrauliques actuels 29 2.5 Les crues historiques 30 2.5.1 Les crues du Vistre depuis plus d’un siècle 30 2.5.2 Les crues majeures récentes 32 2.5.3 Repères de crue 38 3. CARTOGRAPHIE DU RISQUE .................................................................. 39 3.1 Cartographie de l’aléa du Vistre et de ses affluents 39 3.1.1 Analyse hydrogéomorphologique 39 3.1.2 Description générale du fonctionnement hydraulique 41 3.1.3 Modélisation hydrologique et hydraulique des crues 42 3.1.4 Intégration des résultats des études existantes 45 3.2 Cartographie de l’aléa du Rhone (Vauvert et Beauvoisin) 46 3.3 Cartographie et analyse des enjeux urbains 49 3.3.1 Méthodologie 49 3.3.2 Typologie des enjeux urbains 49 3.3.3 Analyse des enjeux urbains 50 PPRi des communes du bassin versant du Vistre – Rapport de présentation 4. -

Bulletin Avril 2019
AVRIL 2019 Bulletin 95 page 1 Habitat du Gard doit réaliser 17 peti- La sortie de ce bulletin de prin- tes villas sociales sur ce site. Cer- temps me donne l’opportunité de tains permis de construire sont enco- faire un point d’étape sur les divers re en instruction et de fait retardent le chantiers en cours et à venir. démarrage de la construction. Certains projets arrivent au terme Je connais l’attente de beaucoup de de leur réalisation . personnes et nous mettons tout en œuvre pour activer ce dossier. C’est ainsi que les importants tra- vaux de voirie engagés sur le che- min de Caveroque et rue Frédéric La vidéo protection est maintenant Mistral sont à présent terminés. opérationnelle sur l’ensemble du vil- lage. Au Poumon Vert, un deuxième Le choix du positionnement des dou- tennis est dès aujourd’hui à la dis- ze caméras a été identifié, conseillé position de tous les amateurs de ce et choisi par un expert de la gendar- sport . merie . Un espace de plus de 3000 m² a été arboré de diverses essences, toutes faisant partie de notre espa- Dans ce numéro ce naturel, dans un soucis de cohé- rence environnementale : micocou- Mot du Maire Page 2 liers, arbres de Judée, amandiers, pins parasols, cèdres … Etat Civil Page 5 Infos municipales Page 6 En parallèle, l’aménagement de la dernière tranche du lotissement Vie associative Page 12 « Caveroque ,Ducroze »s’achève . Divers Page 18 Délibérations du CM Page 20 Bulletin 95 page 2 Ce maillage ainsi réalisé apporte une cohérence et une performan- Une vague de chaleur au mois de ce essentielle à la sécurité de la Juin 2017 avait fait émerger le sou- commune . -

Commune Ordures Menageres Collecte Selective Verre
COMMUNE ORDURES MENAGERES COLLECTE SELECTIVE VERRE BERNIS MARDI-VENDREDI à partir de 5H00 MERCREDI à partir de 5H00 BEZOUCE LUNDI-JEUDI à partir de 5H00 VENDREDI à partir de 5H00 BOUILLARGUES LUNDI-VENDREDI à partir de 5h00 MARDI section A -JEUDI section B à partir de 5h00 CABRIERES LUNDI-JEUDI à partir de 5H00 MERCREDI à partir de 5H00 CAISSARGUES LUNDI-JEUDI à partir de 5H00 MERCREDI à partir de 5H00 CALMETTE LA LUNDI-VENDREDI à partir de 5h00 MERCREDI à partir de 5H00 CAVEIRAC LUNDI-JEUDI à partir de 5H00 MERCREDI à partir de 5h00 CLARENSAC MARDI-VENDREDI à partir de 5H00 MERCREDI à partir de 5H00 DIONS LUNDI-VENDREDI à partir de 5h00 MERCREDI à partir de 5H00 GARONS LUNDI-VENDREDI village à partir de 4h00- VENDREDI écarts à partir de 6h00 MERCREDI à partir de 4H00 GENERAC LUNDI-VENDREDI à partir de 5h00 MARDI à partir de 5H00 LANGLADE LUNDI-JEUDI à partir de 5h00 MERCREDI à partir de 5H00 LEDENON LUNDI-JEUDI à partir de 5h00 MERCREDI à partir de 5H00 LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI Centre Ville - LUNDI-JEUDI secteur 1 - MARDI-VENDREDI MERCREDI à partir de 5H00 MANDUEL secteur 2 à partir de 5h00 MARGUERITTES LUNDI-JEUDI à partir de 5H00 MERCREDI à partir de 5H00 MILHAUD MARDI-VENDREDI à partir de 5H00 MERCREDI à partir de 5H00 LUNDI - MERCREDI - VENDREDI- à NIMES Voir tableau ci-dessous partir de 5h00 POULX LUNDI-JEUDI à partir de 5h00 MERCREDI à partir de 5H00 MARDI Secteur 1 - VENDREDI Secteur 2 à partir de REDESSAN MARDI-VENDREDI à partir de 5h00 5H00 RODILHAN MARDI-VENDREDI à partir de 5h00 JEUDI à partir de 5h00 SAINT COME MARDI-VENDREDI -

Mise En Page 1 12/05/14 12:24 Page2
VN14passEteDepliant-5_Mise en page 1 12/05/14 12:24 Page1 Conditions d’accès Mode d’emploi du passeport Destination • Etre âgé de 13 à 23 ans. • Le passeport est composé d’une carte et d’un chéquier numérotés à usage strictement personnel. sorties entre amis ! • Habiter Nîmes ou Aubord, Bernis, Bezouce, Bouillargues, Caissargues, Caveirac, Clarensac, Garons, Générac, • Chaque chèque n’est valable que sur présentation de la carte. La Calmette, Langlade, Lédenon, Manduel, RESTOS • Le chèque vous permet de bénéficier gratuitement d’une offre Marguerittes, Milhaud, Poulx, Redessan, Du 15 juin au CINÉ du passeport. Rodilhan, St-Anastasie, St-Chaptes, 15 septembre BOWLING St-Cômes et Maruejols, St-Dionisy, • Le passeport est valable du 15 juin au 15 septembre 2014. 2014 LASER GAME St-Gervasy, St-Gilles, Uchaud et Vauvert. • Un seul passeport sera délivré par personne pour la période. KARTING ACCROBRANCHE SQUASH PISCINE Comment se procurer le passeport ? EXPOS • LES LIBRAIRIES : Aux Lettres De Mon Moulin, BONS D’ACHAT ... MODA, Goyard, La Bulle, Fnac POUR LES NÎMOIS : A l’Orloj : 8 rue de l’Horloge, 30000 Nîmes. • LES RESTAURANTS : McDonald’s de la Coupole, Ouverture du lundi au vendredi de 10h-12h30 et 13h30-17h. le Bistro Romain. POUR LES HABITANTS DES COMMUNES PARTENAIRES, à la mairie • LES CINÉMAS : Cinéma Sémaphore, de : Aubord, Bernis, Bezouce, Bouillargues, Caissargues, Caveirac, Cinéma Kinépolis. mai 2014. Clarensac, Garons, Générac, La Calmette, Langlade, Lédenon, • LES PRESTATAIRES : Edgard, Tango, Manduel, Marguerittes, Milhaud, Poulx, Redessan, Rodilhan, Canoë le Tourbillon, Tour Magno Gardiano, St-Anastasie, St-Chaptes, St-Cômes et Maruejols, St-Dionisy, Aquatropic, La Fnac, Squash Club des Arènes, St-Gervasy, St-Gilles, Uchaud et Vauvert. -
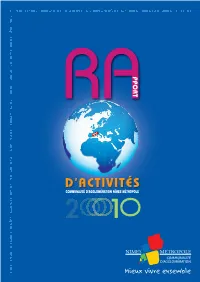
Rapport D'activités 2010
RAPPORT D’ACTIVITÉS COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION NÎMESo MÉTROPOLE Mieux vivre ensemble • LÉDENON • MANDUEL • MARGUERITTES • MILHAUD • NÎMES • POULX • REDESSAN • RODILHAN • SAINTE ANASTASIE • SAINT CHAPTES • SAINT CÔME & MARUÉJOLS • SAINT DIONISY • SAINT GERVASY • SAINT GILLES • SERNHAC GLADE GLADE PPORT o COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION NÎMES MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BERNIS • BEZOUCE • BOUILLARGUES • CABRIÈRES • CAISSARGUES • CAVEIRAC • CLARENSAC • DIONS • GARONS • GÉNÉRAC • LA CALMETTE • LAN BERNIS • BEZOUCE • BOUILLARGUES • CABRIÈRES • CAISSARGUES • CAVEIRAC sommaireRAPPORT D’ACTIVITÉSo EDITORIAL PARTIE 1 PARTIE 2 2-3 Pour une Agglomération solidaire et conviviale : renforcer les solidarités de Jean-Paul Fournier.......................................................6 Nîmes Métropole : un territoire, Une année d’action et des territoriales et le “vivre ensemble” ........................66 Sénateur du Gard, une organisation, pour un service engagements pour construire Président de Nîmes Métropole, A/ SPORTS, CULTURE, CULTURES ET public plus performant.....................................................8 un avenir meilleur ............................................................32 Maire de Nîmes. TRADITIONS REGIONALES : contribuer à l’épanouissement de tous les habitants ..............66 1-1 Un territoire.......................................................10 2-1 Vers Nîmes Métropole équilibrée B/ DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE DU 1-2 Nîmes Métropole, c’est 27 communes et moins vulnérable : répondre et s’adapter TERRITOIRE : garantir -

Projet De Realisation De La Gare Nouvelle De Nimes Manduel Redessan Sur Les Communes De Manduel Et Redessan _____
Département du Gard _____ Communes de MANDUEL et de REDESSAN _____ PROJET DE REALISATION DE LA GARE NOUVELLE DE NIMES MANDUEL REDESSAN SUR LES COMMUNES DE MANDUEL ET REDESSAN _____ ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE du 06 février 2017 au 17 mars 2017 DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) ENQUETE PARCELLAIRE MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D'URBANISME DES COMMUNES DE MANDUEL ET REDESSAN DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES SOUMIS A AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT (Nomenclature IOTA) DELIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUIRE DES COMMUNES DE MANDUEL ET REDESSAN Dossier déposé par SNCF Réseau _____ RAPPORT D’ENQUETE ____ CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE Avril 2017 Projet de réalisation de la Gare nouvelle de Nîmes Manduel Redessan Référence dossier n° E16000168/30 1/151 SOMMAIRE A - RAPPORT D’ENQUETE 1 – GENERALITES 8 1.1 - Objet des enquêtes 8 1.2 - Cadre juridique 10 1.3 - Composition du dossier 12 1.3.1-Dossier préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du Projet, à la cessibilité et à l’approbation des nouvelles dispositions d’urbanisme 12 1.3.2-Dossier de demande d'Autorisation Unique au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'Environnement (IOTA) 12 1.3.3-Dossier de demande de permis de construire commune de Manduel 13 1.3.4-Dossier de demande de permis de construire commune de Redessan 14 1.4 - Caractéristiques du projet 15 1.4.1-Localisation du projet 15 1.4.2-Objectifs du projet 15 1.4.3-Caractéristiques des ouvrages 16 1.4.4- Conventions 16 1.4.5-Déroulement prévisionnel -

Rentrée Scolaire Tango Mode D'emploi
Rentrée scolaire Tango Mode d’emploi Mai 2021 SECTEUR COSTIÈRES EST/OUEST & SAINT-GILLES: Bouillargues –Caissargues –Garons –Manduel –Redessan -St-Gilles Sommaire Le réseau TANGO TANGO & vous Acheter un titre de transport - Votre offre sur mesure - Où trouver l’information - Où acheter un titre de transport - Fonctionnement du réseau - Tutos outils digitaux - La vente à distance - Gamme tarifaire - Le transport à la demande Votre guide pratique pour utiliser les transports en communs de votre territoire Rentrée scolaire Tango 2021 2 Le réseau TANGO - Votre offre sur mesure - Fonctionnement du réseau - Gamme tarifaire - Le transport à la demande Réunion publique - 2021 3 Votre offre transport sur mesure Secteur Costières Est Ouest : Redessan • Desserte de Redessan par la ligne 31 « Redessan <> Nîmes Gare routière » - Fréquence à l’heure avec des renforts en heure de pointe • Collège de rattachement : Collège de Manduel - Desserte via la Tempo 212 « Redessan <> Collège de Manduel » • Lycée de rattachement : Lycée P. Lamour - Desserte assurée par la ligne 31 Titre de la présentation | Date 4 Votre offre transport sur mesure Secteur Costières Est Ouest : Manduel • Desserte de Manduel par la ligne 32 « Manduel <> Nîmes Gare Triaire » - Fréquence à l’heure avec des renforts en heure de pointe • Pôle de correspondance : - Gare triaire (à proximité de l’arrêt Gare Feuchères) pour les lignes T2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 51, 52, 61, 76, 87 • Collège de rattachement : Collège de Manduel - Desserte via la Tempo 212 « Manduel <> Collège de Manduel