Les Ensembles Monumentaux Du
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
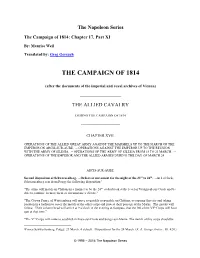
The Campaign of 1814: Chapter 17, Part XI
The Napoleon Series The Campaign of 1814: Chapter 17, Part XI By: Maurice Weil Translated by: Greg Gorsuch THE CAMPAIGN OF 1814 (after the documents of the imperial and royal archives of Vienna) _____________________ THE ALLIED CAVALRY DURING THE CAMPAIGN OF 1814 ________________________ CHAPTER XVII. OPERATIONS OF THE ALLIED GREAT ARMY AGAINST THE MARSHELS UP TO THE MARCH OF THE EMPEROR ON ARCIS-SUR-AUBE. -- OPERATIONS AGAINST THE EMPEROR UP TO THE REUNION WITH THE ARMY OF SILESIA. -- OPERATIONS OF THE ARMY OF SILESIA FROM 18 TO 23 MARCH. -- OPERATIONS OF THE EMPEROR AND THE ALLIED ARMIES DURING THE DAY OF MARCH 24. _________ ARCIS-SUR-AUBE. Second disposition of Schwarzenberg. --Orders of movement for the night of the 23rd to 24th. --At 4 o'clock, Schwarzenberg sent from Pougy the following disposition:1 "The army will march on Châlons in a manner to be the 24th at daybreak at the level of Vésigneul-sur-Coole and be able to continue its movement as circumstances dictate." "The Crown Prince of Württemberg will move as quickly as possible on Châlons, occupying this city and taking position in a fashion to cover the march of the other corps and protect their passage of the Marne. The guards will follow. Their column head will arrive at 9 o'clock in the evening at Sompuis, that the left of the VIth Corps will have quit at that time." "The Vth Corps will come to establish in Faux-sur-Coole and Songy-sur-Marne. The march of this corps should be 1Prince Schwarzenberg, Pougy, 23 March, 4 o'clock. -

ZRR - Zone De Revitalisation Rurale : Exonération De Cotisations Sociales
ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales URSSAF Présentation du dispositif Les entreprises en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) peuvent être exonérée des charges patronales lors de l'embauche d'un salarié, sous certaines conditions. Ces conditions sont notamment liées à son effectif, au type de contrat et à son activité. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Toute entreprise peut bénéficier d'une exonération de cotisations sociales si elle respecte les conditions suivantes : elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, elle a au moins 1 établissement situé en zone de revitalisation rurale (ZRR), elle a 50 salariés maximum. Critères d’éligibilité L'entreprise doit être à jour de ses obligations vis-à-vis de l'Urssaf. L'employeur ne doit pas avoir effectué de licenciement économique durant les 12 mois précédant l'embauche. Pour quel projet ? Dépenses concernées L'exonération de charges patronales porte sur le salarié, à temps plein ou à temps partiel : en CDI, ou en CDD de 12 mois minimum. L'exonération porte sur les assurances sociales : maladie-maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocations familiales. URSSAF ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales Page 1 sur 5 Quelles sont les particularités ? Entreprises inéligibles L'exonération ne concerne pas les particuliers employeurs. Dépenses inéligibles L'exonération de charges ne concerne pas les contrats suivants : CDD qui remplace un salarié absent (ou dont le contrat de travail est suspendu), renouvellement d'un CDD, apprentissage ou contrat de professionnalisation, gérant ou PDG d'une société, employé de maison. -

La Bataille De Berry-Au-Bac
1917 BATAILLE LA BATAILLE DE BERRY AU-BAC LE BAPTÊME RATÉ DES CHARS FRANÇAIS Le 16 avril 1917, les premiers « appareils » [1] français sont engagés au combat dans le cadre de l’offensive du Chemin des Dames conçue par le généralissime Nivelle. Leur participation est un échec sanglant, marqué à la fois par le choix d’attaquer un secteur particulièrement bien défendu et par l’emploi de tactiques de combat inadaptées. Par Sylvain Ferreira 68 La bataille de Berry-au-Bac Sur cette photo, on voit clairement le canon de 75 BS (Blockhaus Schneider), dont l’angle de tir est limité par sa position. Il doit permettre d’engager les nids de mitrailleuses allemands avec précision jusqu’à 200 m. On distingue également une des deux mitrailleuses Hotchkiss installées sur chaque flanc pour notamment prendre les tranchées allemandes en enfilade. logiquement subi un revers opérationnel important. LES PREMIÈRES DOCTRINES Les Britanniques ont également balayé du revers de Le 20 août 1916, dans le cadre de la constitution de la main les objections formulées par Estienne lors ce qui s’appelle l’Artillerie spéciale (AS), le colonel de sa visite à Lincoln en juin 1916 pour estimer Estienne, qui supervise sa création, rédige une pre- l’avancement du programme britannique. mière instruction [2] sur l’emploi des chars d’assaut, Suite au retour d’expérience anglais, Estienne, dans laquelle il décrit les modalités d’utilisation de qui deviendra général de brigade le 17 octobre, cette nouvelle Arme. Selon Estienne, les « appareils » revoit intégralement sa copie sur la doctrine d’em- doivent pouvoir prendre l’offensive sur un vaste front ploi des chars français, qu’il décide de modifier en afin de pénétrer enfin le dispositif allemand dans la deux phases. -

Villages Disparus
CIRCUIT des Villages Calais Circuit routier Bruxelles Lille artez à la découverte des Distance Temps Particularité Repères A26 villages disparus du Chemin des A1 disparus Dames et revivez le destin tragique 35 km 1 à 4 heures Ce circuit n'est Suivez le Amiens du Chemin des Dames (parcours pas une boucle jalonnement de ces lieux de mémoire. Sur chaque complet) routier RD 18 CD A29 Laon site, un panneau d'information (lignes latérales Rouen Soissons bleues) A4 Reims retrace leur passé. RN2 A26 Mémorial de Musée du Paris Mémorial de Musée du Cerny-en-Laonnois Chemin des Dames Cerny-en-Laonnois Chemin des Dames Laon Laon Laon Laon Pancy-Courtecon Chamouille Pancy-Courtecon Chamouille Monampteuil Chermizy-Ailles Monampteuil Chermizy-Ailles Lac de Lac de D2 Chavignon Monampteuil Corbeny D2 Chavignon Monampteuil Corbeny L’Ailette Bouconville-Vauclair L’Ailette Bouconville-Vauclair Laffaux Lac de l’Ailette Retrouvez tout le Chemin des Dames sur Laffaux Lac de l’Ailette A B K A B K Vieux Ailles E D1044 www.cc-chemindesdames.fr Vieux Ailles E D1044 Chemin d Courtecon Cerny J Chemin d Courtecon Cerny J RD 18 CD C RD 18 CD C Vieux Chevreux A 26 Vieux Chevreux A 26 es Beaulne D es Beaulne D Dames H Craonne Dames H Craonne Soissons et Chivy L Soissons et Chivy L Braye-en-Laonnois Troyon La Vallée Craonne Braye-en-Laonnois Troyon La Vallée Craonne Vailly/Aisne Foulon Vailly/Aisne Foulon Craonnelle Craonnelle Vendresse- F G La Ville-aux-Bois Vendresse- F G La Ville-aux-Bois Beaulne Paissy lès-Pontavert Beaulne Paissy lès-Pontavert Vassogne Vassogne L’Aisne Moussy-Verneuil Berry-au-Bac L’Aisne Moussy-Verneuil Berry-au-Bac (Courtonne) Autres sites (Courtonne) Beaurieux Reims Beaurieux Reims L’Aisne L’Aisne Vallée de l’Aisne A Moulin de Laffaux Vallée de l’Aisne B Fort de Malmaison C Cerny-en-Laonnois Mémorial du Chemin des Dames D Caverne du Dragon, musée du Chemin des Dames, Constellation de la Douleur Vieux-Craonne En 1931 la gestion du site E Ruines de l'Abbaye de Vauclair a été confiée aux Eaux et Forêts (actuel ONF). -

La Lettre Du Chemin Des Dames
du Cheminla lettre des Dames BULLETIN d’INFORMATION édité par le CONSEIL GÉNÉRAL de l’AISNE - MAI 2006 - N° 9 17 mars 1916 - 16 heures Apollinaire est blessé au Bois des Buttes sites et du Chemin monuments des Dames Le Bois des Buttes : le Bois-le- Prêtre du Chemin des Dames ? Situé au pied de l’extrémité est du plateau de Craonne, le Bois des Buttes a été dès l’automne 1914 âprement disputé entre Français et Allemands. Dorgelès Un village martyr photographié sur le front Les combats de mars-avril 1916 vus par de l’Aisne in septembre 1915, La Ville-aux- e F début 1915 un adjudant du 96 Régiment d’infanterie Bois-lès-Pontavert qui est occupé par les Allemands, subit un violent feu « Le 14 mars, nous prenons la route sortir, avec hésitation, mais étaient roulant de l’artillerie française. Ce pour monter en secteur. Après une nuit tout de suite rentrés, l’ennemi étant village qui comptait avant la guerre à Meurival, nous partons relever au Bois sur ses gardes. 150 habitants, n’est plus qu’un champ de ruines. des Buttes. Les journaux relatèrent cette opération L’ennemi avait attaqué dans ce coin et avec force détails, et comme une belle Une ferme avant septembre 1915 réussi un beau coup, puisqu’il s’était action d’éclat. Je me rappelle en avoir « Ce Bois des Buttes emparé de la quasi-totalité du bois. lu le récit, complètement inexact et où les nuits de patrouille, […] Telle était la situation lorsque nous fait pour bourrer le crâne. -

Mangeons Local !
N° 18 2020 1 4 DOSSIER 17 Mangeons local ! www.cc-champagnepicarde.fr EXPÉRIENCE 2 3 ul doute que cette année 2020 restera dans les esprits Depuis quelques mois, tous nos projets ont également N pour un long moment. repris leur cours. Le gros chantier d'extension de la CLIC, CLAC… dans la photothèque ! Cette crise sanitaire mondiale durable aura des répercus- piscine a débuté le 15 juin, les travaux de la nouvelle sions sur le long terme pour notre tissu économique, sur crèche de Villeneuve-sur-Aisne sont en cours et les Donner une image positive du territoire, ÉDITO le plan social ou pour le monde associatif local... premières actions pour le développement de la mobilité favoriser l'attractivité, véhiculer un sentiment durable en Champagne Picarde sont engagées. d'appartenance... Voici les principaux objectifs Il nous appartient néanmoins de faire face ensemble avec dynamisme et optimisme. Toute cette activité dans une période diffcile est le fruit de la photothèque réalisée par la Champagne de la compétence et de l’implication des services de Picarde. Durant le confnement, la Champagne Picarde a rapi- la Champagne Picarde mais aussi des nouveaux élus Découvrez les villages, les équipements, nos dement mis en place un fonds d'aides aux entreprises communaux et conseillers communautaires, tous mobili- plus beaux paysages et atouts touristiques. qui a permis, depuis mai, le versement d'une subvention sés pour rendre notre territoire accueillant et attractif. Véritable outil de promotion en libre d'accès, à 71 entreprises locales. Une autre enveloppe de Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour cette cette photothèque permettra d'alimenter les pu- 100 000 € a été votée pour accorder des prêts d'honneur nouvelle année 2021. -

Le Village De Pontavert
Hauts-de-France, Aisne Pontavert Le village de Pontavert Références du dossier Numéro de dossier : IA02001966 Date de l'enquête initiale : 2003 Date(s) de rédaction : 2003 Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames Degré d'étude : étudié Désignation Dénomination : village Compléments de localisation Milieu d'implantation : en village Références cadastrales : Historique Maximilien Melleville précise que, tirant son nom du pont sur l'Aisne par lequel la route de Laon à Reims passait, Pontavert est attesté dans les textes dès le 9e siècle sous le vocable de Varocium puis Pons-Varium en 1112, Pontavaire au 13e siècle et Pontavert en 1683. Appartenant aux seigneurs de la Bove, le village fut plusieurs fois pillé et brûlé : par les Anglais en 1373 et en 1380, par les troupes de la Fronde en 1652, par les Prussiens en 1814. L'ancien Pontavert, qui comptait 101 maisons au milieu du 19e siècle, était composé d'une route principale traversée perpendiculairement par plusieurs voies plus étroites et le village était desservi par un chemin de fer. D'après Marcel Mulot, Pontavert fut occupé par les Allemands entre le 2 et le 13 septembre 1914. Les bombardements du 15 septembre détruisirent une partie du village. Le 4 mai 1917, la Grande Rue était presque totalement détruite. L'invasion ennemie, qui s´étendit du 28 mai 1918 jusqu'au mois d´octobre, fut suivie par de violents combats qui l´anéantirent totalement. Les Français le reprirent alors et rasèrent tous les villages bordant l'Aisne. La rédaction des dossiers de dommages de guerre de la commune ainsi que celle du plan d'alignement fut assurée dès 1919 par les architectes rémois Raoul Drouin Deligne et Bossard. -

Rapport De Phase 1
Étude de faisabilité d’aires de ralentissement des fortes crues de l’Aisne, à l’amont et à l’aval de Soissons Rapport de phase 1 Avril 2006 Entente Oise-Aisne. Etude de faisabilité d’aires de ralentissement des fortes crues de l’Aisne, à l’amont et à l’aval de Soissons Phase 1 SOMMAIRE 1 OBJECTIF DE L’ÉTUDE ET CONTENU DU RAPPORT................................................. 5 2 RECUEIL DE DONNÉES.................................................................................................. 8 2.1 BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................. 8 2.2 ENQUÊTES ET VISITES DE TERRAIN .............................................................................. 10 2.2.1 Enquêtes avec les communes ............................................................................ 10 2.2.2 Enquêtes auprès des carriers ............................................................................. 15 2.2.3 Services de l’état et administrations.................................................................... 17 2.3 BILAN DES USAGES ET DES CONTRAINTES ................................................................... 18 3 HYDROLOGIE................................................................................................................. 20 3.1 CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE D ’ÉTUDE ET STATIONS DE MESURE ............................ 20 3.2 CRUES DE L ’A ISNE ...................................................................................................... 21 3.2.1 -

Partie 5 : Économie
SCoT de la Champagne Picarde SOMMAIRE PARTIE 5 – L’ECONOMIE ................................................................................................. 3 1 - LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL : UN TERRITOIRE MARQUE PAR LE SECTEUR AGRICOLE ET L’ARTISANAT ........ 3 1.1 - Une activité économique fortement marquée par l’agriculture .......................................................................................... 3 1.2 - Une activité portée à la fois par le développement des TPE et la présence d’établissements de 50 salariés et plus ....... 3 1.3 - Une économie équilibrée entre économie présentielle et non présentielle ....................................................................... 4 1.4 - L’artisanat : un tissu économique de proximité essentiel.................................................................................................... 5 2 - L’AGRICULTURE EN CHAMPAGNE PICARDE .................................................................................................. 7 2.1 - La place des activités agricoles sur le territoire .................................................................................................................... 7 2.2 - Des cultures majoritairement tournées vers les céréales .................................................................................................... 8 2.3 - Une évolution à la baisse de la Superficie Agricole Utile (SAU) ........................................................................................... 8 2.4 - Une baisse du nombre d’exploitants agricoles -

Liste Des Maires - Département De L'aisne 20/10/2020
Liste des maires - Département de l'Aisne 20/10/2020 Commune Civilité Nom Prénom Code postal E-mail_mairie ABBÉCOURT M PÂRIS René 02300 [email protected] ACHERY M LEGARD Marc 02800 [email protected] ACY M MATHAUT Dominique 02200 [email protected] AGNICOURT-ET-SÉCHELLES M LETURQUE Patrice 02340 [email protected] AGUILCOURT M PREVOT Gérard 02190 [email protected] AISONVILLE-ET-BERNOVILLE M PARENT Christian 02110 [email protected] AIZELLES M MERLO Jean-Marie 02820 [email protected] AIZY-JOUY M NECA Amadéo 02370 [email protected] ALAINCOURT M ANTHONY Stéphan 02240 [email protected] ALLEMANT M HENNEVEUX Marc 02320 [email protected] AMBLENY M BOUVIER Jean-Marie 02290 [email protected] AMBRIEF M BERTIN Nicolas 02200 [email protected] AMIFONTAINE M SERIN Denis 02190 [email protected] AMIGNY-ROUY M DUHENOY Joël 02700 [email protected] ANCIENVILLE M DESBOVES Alain 02600 [email protected] ANDELAIN Mme WENDLING MARLIERE Julie 02800 [email protected] ANGUILCOURT-LE-SART M LEMIRE Bernard 02800 [email protected] ANIZY-LE-GRAND M CENTONZE SANDRAS Ambroise 02320 [email protected] ANNOIS M DEMAREST Hugues 02480 [email protected] ANY-MARTIN-RIEUX Mme VAN DER SYPT Carine 02500 [email protected] ARCHON M DUFOURG Nicolas 02360 [email protected] ARCY-SAINTE-RESTITUE M BOUREL Patrick 02130 [email protected] ARMENTIÈRES-SUR-OURCQ M BOCQUET Jean-Pierre 02210 [email protected] -

The Campaign of 1814: Chapter 16, Part I
The Napoleon Series The Campaign of 1814: Chapter 16, Part I By: Maurice Weil Translated by: Greg Gorsuch THE CAMPAIGN OF 1814 (after the documents of the imperial and royal archives of Vienna) _____________________ THE ALLIED CAVALRY DURING THE CAMPAIGN OF 1814 ________________________ CHAPTER XVI. OPERATIONS OF THE ARMY OF SILESIA UNTIL THE MARCH OF THE EMPEROR ON ARCIS-SUR-AUBE (from 5 to 17 March). CRAONNE. - LAON. - REIMS. 5 March 1814. --Surprise of Reims by the French. --Fortune had been unable to decide to stay long faithful to Napoleon. After having smiled for a few days, it already had to make him pay dearly for his momentary good graces. The surrender of Soissons was to be the starting point of a new series of misfortunes and disappointments, failures and disasters under the weight of which the Emperor's genius was to eventually succumb. One day, one fact had been enough to bring a serious and unexpected change in the situation of the two armies. Misfortune caused by the criminal failure of Moreau had destroyed the legitimate expectations of the Emperor without lessening his indomitable energy, to veil and obscure his wonderful lucidity. Appalled at first by the sudden collapse of his strategy, he had already resumed his composure, regained his usual presence of mind and held that if the damage was great, it was not yet irreparable. Unable as he had hoped, in cornering Blücher at the Aisne, to make him fight at a disadvantage with a river behind him and prevent his junction with Bülow, he recognized the impossibility of abandoning the offensive operations that perhaps now he regretted having begun, but that he could not give up. -

Attention ! Nos Associations Et Bibliotheque Municipale
NOS ASSOCIATIONS ET BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : N° 60 Mois de Octobre 2020 Comité des fêtes Familles Rurales de Pontavert Resp : Sylvain CROSSE - 03.23.25.08.57 Activités : Loto, Brocante, Feu d’artifice... A cause du Covid19, cette association ne peut fonctionner correctement. Du coup ces activités sont momentanément suspendues. Dès qu’il y a du nouveau, nous vous en ferons part. LE TRAVERPONTOIS Association de parents d’élèves de Pontavert (APE) COMPTEUR LINKY DU 5/10 AU 6/11/2020, EN MAIRIE L’APE du regroupement scolaire de l’école de Pontavert, est une association à but non lucratif, dont le but est de travailler avec En décembre 2020, ENEDIS procédera au Demande de déclaration d’intérêt général et l’équipe éducative pour monter des projets en faveur des en- remplacement de votre ancien compteur par d’autorisation environnementale au titre du le nouveau compteur communiquant LINKY. fants de l’école. Elle accueille en son sein tous les parents d’élèves code de l’environnement concernant le pro- Chacun sera prévenu individuellement par gramme pluriannuel de restauration, d’entre- volontaires, élus en conseil lors de l’assemblée générale qui se tient courrier. à chaque début d’année scolaire. Elle participe principalement à l’or- Plus besoin d’attendre un technicien d’Ene- tien et de maîtrise du ruissellement des bas- ganisation de la kermesse. A Pontavert, nous organisons également dis pour relever votre compteur électrique ou sins versants des affluents de l’Aisne. des ventes diverses pour récolter des fonds, une récolte de bonbons changer sa puissance… tout se fait à distance, Une enquête publique sera ouverte du 5/10 pour les petits monstres d’Halloween, une journée pour les enfants du coup certains frais d’interventions tech- au 6/11/2020 inclus, sur la demande de DIG pour fêter les fêtes de fin d’année.