340197.Fre.Pdf (1.211Mb)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
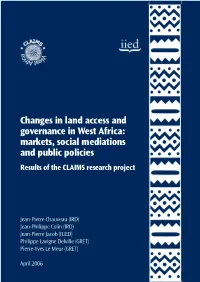
Changes in Land Access and Governance in West Africa: Markets, Social Mediations and Public Policies Results of the CLAIMS Research Project
Changes in land access and governance in West Africa: markets, social mediations and public policies Results of the CLAIMS research project Jean-Pierre Chauveau (IRD) Jean-Philippe Colin (IRD) Jean-Pierre Jacob (IUED) Philippe Lavigne Delville (GRET) Pierre-Yves Le Meur (GRET) April 2006 Changes in land access and governance in West Africa: markets, social mediations and public policies Results of the CLAIMS research project Jean-Pierre Chauveau (IRD) Jean-Philippe Colin (IRD) Jean-Pierre Jacob (IUED) Philippe Lavigne Delville (GRET) Pierre-Yves Le Meur (GRET) April 2006 This document brings together the results of the research project “Changes in Land Access, Institutions and Markets in West Africa (CLAIMS)”, which ran from 2002 to 2005. The project was funded by the European Union (Directorate General for Research), with contributions from DFID (Department for International Development, UK) and AFD (Agence Française de Développement, France). The publication of this synthesis has been funded by DFID, which supports policies, programmes and projects to promote international development. DFID provided funds for this study as part of that objective but the views and opinions expressed are those of the authors alone. Co-ordinated by IIED, CLAIMS involved fieldwork in four West African countries (Benin, Burkina Faso, Ivory Coast and Mali) and mobilised a network of eight research institutions: • GIDIS-CI (Groupement Interdisciplinaire en Sciences Sociales – Côte d’Ivoire; Abidjan, Ivory Coast) • GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques; -
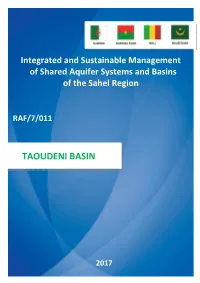
Taoudeni Basin Report
Integrated and Sustainable Management of Shared Aquifer Systems and Basins of the Sahel Region RAF/7/011 TAOUDENI BASIN 2017 INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHARED AQUIFER SYSTEMS AND BASINS OF THE SAHEL REGION EDITORIAL NOTE This is not an official publication of the International Atomic Energy Agency (IAEA). The content has not undergone an official review by the IAEA. The views expressed do not necessarily reflect those of the IAEA or its Member States. The use of particular designations of countries or territories does not imply any judgement by the IAEA as to the legal status of such countries or territories, or their authorities and institutions, or of the delimitation of their boundaries. The mention of names of specific companies or products (whether or not indicated as registered) does not imply any intention to infringe proprietary rights, nor should it be construed as an endorsement or recommendation on the part of the IAEA. INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHARED AQUIFER SYSTEMS AND BASINS OF THE SAHEL REGION REPORT OF THE IAEA-SUPPORTED REGIONAL TECHNICAL COOPERATION PROJECT RAF/7/011 TAOUDENI BASIN COUNTERPARTS: Mr Adnane Souffi MOULLA (Algeria) Mr Abdelwaheb SMATI (Algeria) Ms Ratoussian Aline KABORE KOMI (Burkina Faso) Mr Alphonse GALBANE (Burkina Faso) Mr Sidi KONE (Mali) Mr Aly THIAM (Mali) Mr Brahim Labatt HMEYADE (Mauritania) Mr Sidi Haiba BACAR (Mauritania) EXPERT: Mr Jean Denis TAUPIN (France) Reproduced by the IAEA Vienna, Austria, 2017 INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHARED AQUIFER SYSTEMS AND BASINS OF THE SAHEL REGION INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHARED AQUIFER SYSTEMS AND BASINS OF THE SAHEL REGION Table of Contents 1. -
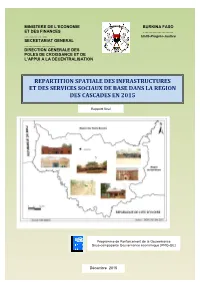
Repartition Spatiale Des Infrastructures Et Des Services Sociaux De Base Dans La Region Des Cascades En 2015
MINISTERE DE L’ECONOMIE BURKINA FASO ET DES FINANCES ………..………... …..……….... Unité-Progrès-Justice SECRETARIAT GENERAL ………..……….... DIRECTION GENERALE DES POLES DE CROISSANCE ET DE L’APPUI A LA DECENTRALISATION REPARTITION SPATIALE DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES SOCIAUX DE BASE DANS LA REGION DES CASCADES EN 2015 Rapport final Programme de Renforcement de la Gouvernance Sous-composante Gouvernance économique (PRG-GE) Décembre 2015 TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS ................................................................................................................... III LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ............................................................................... IV RESUME .............................................................................................................................. VIII INTRODUCTION ..................................................................................................................... 1 PREMIERE PARTIE: CADRE GENERAL ................................................................................ 2 I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE ................................................................... 2 II- OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS ......................................................................... 3 III- METHODOLOGIE DE TRAVAIL ........................................................................................ 4 III-1- Collecte des données secondaires .................................................................................. 4 III-2- -

Commune De Niangoloko Stratégie Pour Des Services Durables D’Eau Potable Et D’Assainissement Comité Technique : Edition : IRC Burkina
Commune de Niangoloko Stratégie pour des services durables d’eau potable et d’assainissement COMITÉ TECHNIQUE : Edition : IRC Burkina Rédaction : Denis ZOUNGRANA Richard BASSONO Christian Armand BERE Hamado OUEDRAOGO Supervision : Juste NANSI Assistance technique : Joseph WETHE Benjamin ZOUNGRANA Amidou YONABA Laurent David TIEMTORE Jean Edouard Odilon DOAMBA Karim SAVADOGO Jean Martin KI Relecture : Anne MIMAULT Mise en page : Sésame Pictures, Burkina Faso Photos : Anne MIMAULT / IRC © Mairie de Niangoloko, mars 2018 Contacts : Tél. : (226) 20 91 00 09 / 20 91 02 43 E-mail : [email protected] Plan stratégique communal Site Web : www.mairie-niangoloko.bf des services publics Ce document est protégé par une licence Creative Commons - Attribution - Utilisation non commerciale - Pas d’oeuvre dérivée 4.0 d’eau potable et international. Sa modification, même partielle, est interdite. Il peut être utilisé, reproduit et cité librement à des fins non-commerciales, à condition que la citation soit exacte et complète et que la mention suivante y soit apposée : d’assainissement Commune de Niangoloko, 2018. Plan Stratégique communal des services publics d’eau et d’assainissement des eaux usées et excreta. 2018 - 2030 Pour plus d’informations : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fr Plan stratégique communal des services publics d’eau et d’assainissement des eaux usées et excrétas 2018-2030 TABLE DES MATIÈRES Sigles et abréviations 8 INTRODUCTION 11 1. DIAGNOSTIC DE L’ACCÈS A L’EAU POTABLE ET L’ASSSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET EXCRETA 12 1.1. Profil de la commune 14 1.2. Déterminants socio-économiques des services d’AEPHA 17 1.3. -

Annuaire Statistique 2018 Des Cascades
ANNUAIRE STATISTIQUE 2018 DES CASCADES de larégiondes Cascades Annuaire statistique 2018 Institut national de la statistique et de et delastatistique national Institut la démographie (INSD) la démographie Septembre 2019 Septembre Ministère de l'économie, des finances BURKINA FASO et du développement Unité - Progrès - Justice ----------------------------- Secrétariat général ----------------------------- Institut national de la statistique et de la démographie ----------------------------- Direction régionale des Hauts Bassins Annuaire statistique 2018 de la région des Cascades Septembre 2019 AVANT PROPOS L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), à travers sa direction régionale des Hauts Bassins, a le plaisir de mettre à la disposition des utilisateurs l’annuaire statistique de la région des Cascades édition 2019. Ce document contient des informations démographiques, sociales, économiques, financières et environnementales se rapportant à la région et couvrant la période 2009- 2018. L’annuaire statistique est conçu dans un but premier de contribuer à une plus grande diffusion des statistiques produites par l’ensemble des producteurs sectoriels, dans la mesure de l’existence et de la qualité des données. Nous espérons que cette publication suscitera davantage chez les acteurs de la vie sociale et économique, en particulier ceux de la région, l’intérêt pour les statistiques et que chaque utilisateur pourra y trouver des points de repère et des références pour le guider et l’informer de l’évolution de la situation économique et sociale de la région des Cascades. Nous réitérons notre profonde gratitude aux services publics, notamment à tous les agents chargés des statistiques au sein de ces structures pour leur contribution combien indispensable à la réalisation du présent document et espérons que cette collaboration ira en s’intensifiant. -

Vrs - Burkina Faso
VRS - BURKINA FASO Ouagadougou, le 27/10/2012BAGASSIBALE STATISTIQUES DES BUREAUX DE VOTES PAR COMMUNES \ ARRONDISSEMENTS REGION BOUCLE DU MOUHOUN PROVINCE BALE COMMUNE BAGASSI Secteur/Village Emplacement Bureau de vote Inscrits ASSIO ASSIO II\ECOLE Bureau de vote 1 219 BADIE ECOLE Bureau de vote 1 177 BAGASSI ECOLE Bureau de vote 1 542 BAGASSI TINIEYIO\ECOLE Bureau de vote 1 470 BANDIO ECOLE Bureau de vote 1 253 BANOU ECOLE Bureau de vote 1 191 BASSOUAN ECOLE Bureau de vote 1 201 BOUNOU ECOLE1 Bureau de vote 1 246 BOUNOU ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 233 DOUSSI ECOLE B Bureau de vote 1 206 HAHO CENTRE\CENTRE ALPHABETISATION Bureau de vote 1 177 KAHIN ECOLE Bureau de vote 1 258 KAHO ECOLE Bureau de vote 1 273 KANA ECOLE Bureau de vote 1 269 KAYIO ECOLE Bureau de vote 1 220 KOUSSARO ECOLE Bureau de vote 1 305 MANA ECOLE Bureau de vote 1 495 MANA ECOLE Bureau de vote 2 264 MANZOULE HANGAR Bureau de vote 1 132 MOKO HANGAR Bureau de vote 1 308 NIAGA HANGAR Bureau de vote 1 128 NIAKONGO ECOLE Bureau de vote 1 293 OUANGA HANGAR Bureau de vote 1 98 PAHIN ECOLE Bureau de vote 1 278 SAYARO ECOLE Bureau de vote 1 400 SIPOHIN ECOLE Bureau de vote 1 249 SOKOURA ECOLE Bureau de vote 1 152 VY ECOLE1 Bureau de vote 1 360 VY ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 369 VYRWE MAGASIN Bureau de vote 1 127 YARO ECOLE Bureau de vote 1 327 Nombre de bureaux de la commune 31 Nombre d'inscrits de la commune 8 220 2 REGION BOUCLE DU MOUHOUN PROVINCE BALE COMMUNE BANA Secteur/Village Emplacement Bureau de vote Inscrits BANA KOKOBE\PREFECTURE Bureau de vote 1 353 BANA -

Line-Transect Data May Not Produce Reliable Estimates of Interannual Sex-Ratio and Age Structure Variation in West African Savannah Ungulates
Tropical Zoology, 2020 Vol. 33 | Issue 1 | 14-22 | doi:10.4081/tz.2020.67 Line-transect data may not produce reliable estimates of interannual sex-ratio and age structure variation in West African savannah ungulates Emmanuel M. Hema1-3, Yaya Ouattara4, Maomarco Abdoul Ismael Tou4, Giovanni Amori5*, Mamadou Karama4 and Luca Luiselli3,6,7 1Université Dédougou, UFR/Sciences Appliquées et Technologiques, Dédougou, Burkina Faso; 2Laboratoire de Biologie et Ecologie Animales, Université Ouaga 1 Prof Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou Burkina Faso; 3Institute for Development, Ecology, Conservation and Cooperation, Rome, Italy; 4Secrétariat Exécutif, AGEREF/CL, Banfora, Burkina Faso; 5Research Institute on Terrestrial Ecosystems, CNR, Rome, Italy; 6Department of Applied and Environmental Biology, Rivers State University of Science and Technology, Port Harcourt, Nigeria; 7Département de Zoologie, Faculté des Sciences, Université de Lomé, Togo Received for publication: 30 April 2019; Revision received: 8 March 2020;only Accepted for publication: 13 March 2020 Abstract: Adult sex ratios and age structures are importantuse wildlife population parameters, but they have been poorly investigated in ungulate species in West African savannahs. We used line transects to investigate these parameters in 11 ungulates from a protected area in south-western Burkina Faso during the period 2010-2018. We created an empirical model of “detectability” for each species based on its main ecological characteristics (habitat and group size) and body size, and then compared the observed interannual inconsistency in sex ratios and age structures with the a priori detectability score. Six out of 11 species showed low interannual inconsistency in sex ratio and age structure. In 82% of the study species, however, the predicted detectability score matched the observed score, with two exceptions being Tragelaphus scriptus and Sincerus caffer. -

Ceni - Burkina Faso
CENI - BURKINA FASO ELECTIONS COUPLEES PRESIDENTIELLE / LEGISLATIVES DU 22/11/2020 STATISTIQUES DES BUREAUX DE VOTE PAR COMMUNE / ARRONDISSEMENTS LISTE DEFINITIVE REGION : AFRIQUE PROVINCE : AFRIQUE DU SUD COMMUNE : PRETORIA AMBASSADE PRETORIA SECTEUR / VILLAGE LIEU EMPLACEMENT BUREAU DE VOTE NB_INSCRITS PRETORIA PRETORIA AMBASSADE Bureau de vote 1 85 Nombre de bureau de vote PRETORIA/AMBASSADE PRETORIA : 1 Nombre d'inscrits de la commune de PRETORIA/AMBASSADE PRETORIA :85 REGION : AFRIQUE PROVINCE : BENIN COMMUNE : COTONOU CONSULAT COTONOU SECTEUR / VILLAGE LIEU EMPLACEMENT BUREAU DE VOTE NB_INSCRITS COTONOU COTONOU CONSULAT Bureau de vote 1 494 COTONOU COTONOU CONSULAT Bureau de vote 2 286 Nombre de bureau de vote COTONOU/CONSULAT COTONOU : 2 Nombre d'inscrits de la commune de COTONOU/CONSULAT COTONOU :780 REGION : AFRIQUE PROVINCE : COTE D'IVOIRE COMMUNE : ABIDJAN AMBASSADE ABIDJAN SECTEUR / VILLAGE LIEU EMPLACEMENT BUREAU DE VOTE NB_INSCRITS ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade1 Bureau de vote 1 294 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade1 Bureau de vote 2 294 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade2 Bureau de vote 1 418 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade4 Bureau de vote 1 299 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade4 Bureau de vote 2 299 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade5 Bureau de vote 1 355 Nombre de bureau de vote ABIDJAN/AMBASSADE ABIDJAN : 6 Nombre d'inscrits de la commune de ABIDJAN/AMBASSADE ABIDJAN :1.959 REGION : AFRIQUE PROVINCE : COTE D'IVOIRE COMMUNE : ABIDJAN CONSULAT ABIDJAN SECTEUR / VILLAGE LIEU EMPLACEMENT BUREAU DE VOTE NB_INSCRITS ABIDJAN ABIDJAN CONSULAT2 -

Burkina Faso
CENI - BURKINA FASO ELECTIONS COUPLEES PRESIDENTIELLE/LEGISLATIVES DU 29/11/2015 STATISTIQUES DES BUREAUX DE VOTE PAR COMMUNES \ ARRONDISSEMENTS LISTE DEFINITIVE CENI 29/11/2015 REGION : BOUCLE DU MOUHOUN PROVINCE : BALE COMMUNE : BAGASSI Secteur/Village Emplacement Bureau de vote Inscrits ASSIO ASSIO II\ECOLE Bureau de vote 1 348 BADIE ECOLE Bureau de vote 1 239 BAGASSI ECOLE Bureau de vote 1 441 BAGASSI ECOLE Bureau de vote 2 393 BAGASSI TINIEYIO\ECOLE Bureau de vote 2 202 BAGASSI TINIEYIO\ECOLE Bureau de vote 1 439 BANDIO ECOLE Bureau de vote 1 325 BANOU ECOLE Bureau de vote 1 314 BASSOUAN ECOLE Bureau de vote 1 252 BOUNOU ECOLE1 Bureau de vote 1 353 BOUNOU ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 329 DOUSSI ECOLE B Bureau de vote 1 369 HAHO CENTRE\CENTRE ALPHABETISATION Bureau de vote 1 212 KAHIN ECOLE Bureau de vote 1 390 KAHO ECOLE Bureau de vote 1 347 KANA ECOLE Bureau de vote 1 322 KAYIO ECOLE Bureau de vote 1 301 KOUSSARO ECOLE Bureau de vote 1 415 MANA ECOLE Bureau de vote 1 458 MANA ECOLE Bureau de vote 2 443 MANZOULE MANZOULE\ECOLE Bureau de vote 1 166 MOKO HANGAR Bureau de vote 1 393 NIAGA NIAGA\ECOLE Bureau de vote 1 196 NIAKONGO ECOLE Bureau de vote 1 357 OUANGA OUANGA\ECOLE Bureau de vote 1 164 PAHIN ECOLE Bureau de vote 1 375 SAYARO ECOLE Bureau de vote 1 461 SIPOHIN ECOLE Bureau de vote 1 322 SOKOURA ECOLE Bureau de vote 1 184 VY ECOLE1 Bureau de vote 1 531 VY ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 451 VYRWA VIRWA\ECOLE Bureau de vote 1 141 YARO ECOLE Bureau de vote 1 476 Nombre de bureaux de la commune 33 Nombre d'inscrits de la commune 11 109 CENI/ Liste definitive des Bureaux de Vote 29 - Nov. -

Kojo Section
Changes in land access and governance in West Africa: markets, social mediations and public policies Results of the CLAIMS research project Jean-Pierre Chauveau (IRD) Jean-Philippe Colin (IRD) Jean-Pierre Jacob (IUED) Philippe Lavigne Delville (GRET) Pierre-Yves Le Meur (GRET) April 2006 Changes in land access and governance in West Africa: markets, social mediations and public policies Results of the CLAIMS research project Jean-Pierre Chauveau (IRD) Jean-Philippe Colin (IRD) Jean-Pierre Jacob (IUED) Philippe Lavigne Delville (GRET) Pierre-Yves Le Meur (GRET) April 2006 This document brings together the results of the research project “Changes in Land Access, Institutions and Markets in West Africa (CLAIMS)”, which ran from 2002 to 2005. The project was funded by the European Union (Directorate General for Research), with contributions from DFID (Department for International Development, UK) and AFD (Agence Française de Développement, France). The publication of this synthesis has been funded by DFID, which supports policies, programmes and projects to promote international development. DFID provided funds for this study as part of that objective but the views and opinions expressed are those of the authors alone. Co-ordinated by IIED, CLAIMS involved fieldwork in four West African countries (Benin, Burkina Faso, Ivory Coast and Mali) and mobilised a network of eight research institutions: • GIDIS-CI (Groupement Interdisciplinaire en Sciences Sociales – Côte d’Ivoire; Abidjan, Ivory Coast) • GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques; -

Carte Sanitaire 2010
MINISTERE DE LA SANTE BURKINA FASO -------------- Unité-Progrès-Justice Carte sanitaire 2010 Janvier 2012 SOMMAIRE SIGLES ET ABBREVIATIONS ................................................................................................................................ 5 INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 6 I. SITUATION DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES .......................................................................... 7 I.1. Carte de la région sanitaire de la Boucle du Mouhoun ........................................................... 7 I.1.1. Carte district sanitaire de Boromo ........................................................................................ 8 I.1.2. Carte district sanitaire de Dédougou .................................................................................... 9 I.1.3. Carte du district sanitaire de Nouna ...................................................................................11 I.1.4. Carte district sanitaire de Solenzo .......................................................................................12 I.1.5. Carte district sanitaire de Toma ...........................................................................................14 I.1.6. Carte district sanitaire de Tougan .......................................................................................15 I.2. Carte de la région des Cascades .....................................................................................................16 -

Description of the First Sleeping Sickness Case Diagnosed in Burkina Faso Since Two Decades
RESEARCH ARTICLE Description of the first sleeping sickness case diagnosed in Burkina Faso since two decades Emilie Dama1,2*, Aboubacar Drabo3, Jacques KaboreÂ1,2, Elie OueÂdraogo4, Bamoro Coulibaly5, Hamidou Ilboudo2, Justin Kabore 1,2, Charlie Franck Compaore 2, Hassane SakandeÂ2, Micheline OueÂdraogo4, Jean-Baptiste RayaisseÂ2, Fabrice Courtin5,6, Philippe Solano6, FrancËois Drabo4, Vincent Jamonneau2,5,6 1 Universite Nazi Boni, Unite de Formation et de Recherche Sciences et Techniques, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 2 Centre International de Recherche-DeÂveloppement sur l'Elevage en zones Subhumides, Unite de recherches sur les bases biologiques de la lutte inteÂgreÂe, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 3 Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OueÂdraogo, Ouagadougou, Burkina Faso, 4 Programme National de Lutte a1111111111 contre les Maladies Tropicales NeÂgligeÂes, Ouagadougou, Burkina Faso, 5 Institut Pierre Richet, Unite de a1111111111 Recherche ªTrypanosomosesº, BouakeÂ, CoÃte d'Ivoire, 6 Institut de Recherche pour le DeÂveloppement, a1111111111 INTERTRYP, Universite de Montpellier-IRD-CIRAD, Montpellier, France a1111111111 a1111111111 * [email protected] Abstract OPEN ACCESS Burkina Faso belongs to a group of countries in which human African trypanosomiasis Citation: Dama E, Drabo A, Kabore J, OueÂdraogo E, (HAT), caused by Trypanosoma brucei gambiense, is no longer considered to be a public Coulibaly B, Ilboudo H, et al. (2018) Description of health problem. Although no native cases have been detected since 1993, there is still the the first sleeping sickness case diagnosed in risk of HAT re-emergence due to significant population movements between Burkina Faso Burkina Faso since two decades. PLoS Negl Trop and active HAT foci in CoÃte d'Ivoire. Since 2014, Burkina Faso receives support from the Dis 12(8): e0006677.