MA THESE FINALE.1 Docx
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Impact De La Mise E Chance Dans La Régio
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de République du Mali la Recherche Scientifique ------------- ----------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi Universités des Sciences, des Techniques et des Te chnologies de Bamako (USTTB) --------------- Thèse N°…… Faculté de Médecine et d’Odonto -Stomatologie Année Universitaire 2011/2012 TITRE : Impact de la mise en œuvre de la stratégie chance dans la région de Mopti : résultat de l’enquête 2011 Thèse présentée et soutenue publiquement le………………………/2013 Devant la Faculté de Médecine et d’Odonto -Stomatologie Par : M. Boubou TRAORE Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine (Diplôme d’Etat) JURY : Président : Pr Tiéman COULIBALY Membre : Dr Alberd BANOU Co-directeur : Dr Mamadou DEMBELE Directeur de thèse : Pr Sanoussi BAMANI Thèse de Médecine Boubou TRAORE 1 DEDICACES A MA MERE : Fanta FANE Je suis fier de t’avoir comme maman Tu m’as appris à accepter et aimer les autres avec leurs différences L’esprit de tolérance qui est en moi est le fruit de ta culture Tu m’as donné l’amour d’une mère et la sécurité d’un père. Tu as été une mère exemplaire et éducatrice pour moi. Aujourd’hui je te remercie d’avoir fait pour moi et mes frères qui nous sommes. Chère mère, reçois, à travers ce modeste travail, l’expression de toute mon affection. Q’ALLAH le Tout Puissant te garde longtemps auprès de nous. A MON PERE : Feu Tafara TRAORE Ton soutien moral et matériel ne m’as jamais fait défaut. Tu m’as toujours laissé dans la curiosité de te connaitre. Tu m’as inculqué le sens du courage et de la persévérance dans le travail A MON ONCLE : Feu Yoro TRAORE Ton soutien et tes conseils pleins de sagesse m’ont beaucoup aidé dans ma carrière scolaire. -

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune
FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -
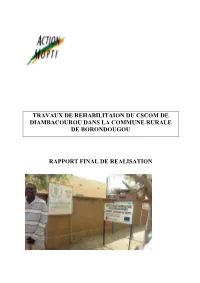
Rapport Final Réhabilitation CSCOM Diambacourou 2017
TRAVAUX DE REHABILITAION DU CSCOM DE DIAMBACOUROU DANS LA COMMUNE RURALE DE BORONDOUGOU RAPPORT FINAL DE REALISATION I -Introduction Dans le cadre du renforcement des capacités en gouvernance et de la qualité des services en santé à travers son Programme d’Appui au Développement Local de Mopti (PADLM 2), l’ONG Action Mopti a entrepris les travaux de réhabilitation du CSCOM de Diambacourou. La commune de Borondougou dispose du seul CSCOM et d’un dépôt pharmaceutique fonctionnel pour ses cinq (05) villages. Les activités menées sont la vaccination, les consultations prénatales, les consultations curatives et les accouchements. Le personnel est composé d’un (1) infirmier, d’un (1); d’une matrone et d’un gérant (1) du dépôt pharmaceutique. II-Situation Géographique de la commune La commune rurale de Borondougou est limitée à l’Est et au Nord par la commune de Konna, à l’Ouest et au Sud par les communes de Fatoma et Bassiro. Elle est située à 45 km au Nord de Mopti (chef lieu du cercle). La commune compte cinq (5) villages : Singo, Foussi, Bogo, Komio et le chef lieu de commune : Diambacourou. Elle s’étend sur une superficie de 35 km2. III -Consistance du Projet Les travaux de réhabilitation du CSCOM consistent à: • Installation et replis de chantier y compris toutes suggestions (évacuation des gravas); • Démolition : Béton,dépose du plafonnage, dépose de la toiture, décapage de la chape existante ; • Bétons maçonneries en élévation :Correction de toutes les fissures • Enduit revêtements :Carreaux pour sol,carreaux de faïence,étanchéité sur -

World Bank Document
Report No. 1561c-MLI Appraisalof the MOPTI11 Rice Project Mali Public Disclosure Authorized FILECOPY November2, 1977 Agriculture ProjectsDepartment West Africa RegionalOffice FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Document of the World Bank This document hasa restricteddistribution and may be used by recipients only in the performanceof their official duties. Its contents may not otherwise be disclosedwithout World Bankauthorization. Currency Equivalents Currency Unit - Mali Franc (MF) US$ 1 - MF 490 MF 1 - US$ 0.0020408 MF I Million - US$ 2,041 Weights and Measures I hectare (ha) 2.47 acres 1 metric ton (t) - 2,205 lbs. Fiscal Year Government Jan. 1 - Dec. 31 ORM Jan. 1 - Dec. 31 Abbreviations ADF African Developmeiit Fund BDM Banque de Developpement du Mali DNAFLA Direction Nationale de l'Alphabetisation Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquee EDF European Development Fund FAC Fonds d'Aide et de Cooperation GERDAT Groupement d'Etudes et de Recherches pour le Developpement de l'Agronomie Tropicale IDA International Development Association IER Institut de l'Economie Rurale IRAT Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et des Produits Vivriers OACV Operation Arachides et Cultures Vivrieres OPAM Office des Produits Agricoles du Mali ORM Operation Riz Mopti RMWA Regional Mission in Western Africa (of the World Bank/IDA) RWD Rural Works Department SCAER Societe de Credit Agricole et d'Equipement Rural SCET Societe Centrale pour l'Equipement du Territoire USAID United States Agency for International Development WARDA West Africa Rice Development Association Foa OFFIAL USE ONLY MALI MOPTI II RICE PROJECT Page No. SUMMARY AND CONCLUSIONS i-v I. -
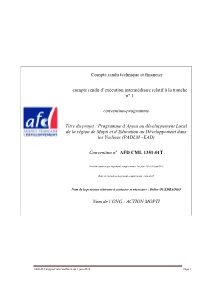
AFD Rapport an 1 PADLM 2 30 06 2015
Compte rendu technique et financier compte rendu d’exécution intermédiaire relatif à la tranche n° 1 convention-programme Titre du projet : Programme d’Appui au développement Local de la région de Mopti et d’Education au Développement dans les Yvelines (PADLM –EAD) Convention n° AFD CML 1351-01T Période couverte par le présent compte rendu: 1er juin 2014-30 juin2015 Date de rédaction du présent compte rendu : juin 2015 Nom de la personne référente à contacter si nécessaire : Didier OUEDRAOGO Nom de l’ONG : ACTION MOPTI PADLM 2 Rapport intermédiaire An 1 juin 2015 Page 1 SIGLES ET ABBREVIATIONS AE Académie d’Enseignement AESN Agence des Eaux Seine Normandie AFD Agence Française de Développement AGR Activités Génératrices de Revenus AIMF Association Internationale des Maires Francophones AJLM Association des jeunes lecteurs de Mopti ANICT Agence Nationale des Investissements des Collectivités Territoriales ARM Assemblée Régionale de Mopti ASACO Association de Santé Communautaire ATPC Assainissement Total piloté par la communauté BICO Bilan Communal CAPE Centre d’Animation Pédagogique CASQY Communauté d’Agglomération de St Quentin en Yvelines CECI Coopération canadienne CEFODE Coopération et formation au développement CFEPCEF Certificat de Fin d’Etude du Premier Cycle de l’Enseignement Fondamental CCO Comité Communal d’Orientation CGS Comité de gestion scolaire CRSB Comité Régional de suivi budgétaire COSC-EPT Coalition des Organisations de la Société Civile pour l’Education Pour Tous au Mali CRSB Comité Régional de Suivi Budgétaire Comité -

DNGR - Rapport Annuel 2014
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- N PEUPLE- UN BUT- UNE FOI DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL -o-o-o-o-o-o- -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Rapport annuel 2014 Décembre 2014 DNGR - Rapport annuel 2014 Sommaire Pages I. INTRODUCTION………………………………………………………………………….…………………………………… 4 1.1 Rappel des missions de la DNGR………………………………………………………………………………………………… 5 1.2 Rappel des principaux résultats attendus du plan d’actions 2013………………………………………………... 6 II. SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE……………………………………………………………….. 8 2.1 Situation du personnel…………………………………………………………………………………………….......................... 8 2.2 Principaux actes administratifs intervenus (lois, décret, arrêté, décision)……………….…………………... 9 2.3 Situation des matériels et locaux……………………………………………………………..…………………………… …. 10 2.4 Situation financière………………………………………………………………………………………………………………….. 12 III. SITUATION DE L'EXECUTION DES ACTIVITES…………………………………………………………………. 13 3.1 ELABORATION DES ELEMENTS DE POLITIQUES ET STRATEGIES……………………………………………… 13 3.1.1 La Politique Nationale de Maîtrise de l’Eau Agricole (PNMEA)…………………………………………………. 14 3.1.2 Les textes réglementaires de la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre…………………………….. 14 3.1.3 Adoption des textes de création des Agences du Moyen Bani et du Sourou………………………….. 14 3.1.4 La Politique de modernisation et de développement des équipements agricoles…………………… 15 3.1.5 Programme de Mécanisation et de Motorisation Agricole……………………………………………………… 15 3.1.6 Projet de création de Centres Ruraux de Prestations de Services…………………………………………. -

Note De Service Admis BAC 2017
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI -------------------------------- Un Peuple-Un But-Une Foi CENTRE NATIONAL DES EXAMENS -------------- ET CONCOURS DE L'EDUCATION -------------------------------- ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE MOPTI Tel: 21 420 155/21 420 883/Fax: 21 420 544 E-mail: [email protected] -------------------------------- NOTE DE SERVICE N° 2017\_____________ /AE_MOPTI Portant admission de candidats au BACCALAUREAT MALIEN, SESSION DE JUIN 2017 Les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis à l'examen du Baccalauréat Malien, Session de Juin 2017, Pôle de Correction de Mopti PÔLE DE CORRECTION DE MOPTI SERIE : TERMINALE ARTS LETTRES (T.A.L.) N° DATE PRENOM NOM SEXE LIEU NAISS PÈRE MERE STAT ETABLISS AE MENTION PLACE NAISS. Hamssatou M 07/06/1996 Mopti Khalifa BORE R LPLSM Mopti PASSABLE 429 Aly BORE DICKO Ferdinand Hadjiratou F 22/11/1998 BANDIAGARA R LBAND DOUENTZA PASSABLE 862 Honorine DAKOUO DAKOUO MAIGA 1864 Ogobara DOLO M 31/12/1998 SANGHA Amakéné DOLO Nagalou DOLO R LBAND DOUENTZA ASSEZ-BIEN 1875 Yarion DOLO M 31/12/1996 DAGA-TERELI Jacob DOLO Yatégué SAYE R LBAND DOUENTZA PASSABLE Kadidiatou F 03/03/2000 Bamako Issa DOUMBIA R LPLSM Mopti ASSEZ-BIEN 1964 Djinédié DOUMBIA KONE Sanelou M 31/12/1999 NOMBORI Pierre GUINDO R LBAND DOUENTZA PASSABLE 2489 Amadimé GUINDO GUINDO Antimbe Dit M 23/06/1998 BANDIAGARA Hawa GUINDO R LBAND DOUENTZA PASSABLE 2523 Ansama GUINDO Leon GUINDO Monique M 31/12/1999 Koro Marc GUINDO R LPLSM Mopti PASSABLE 2716 Joel GUINDO BAMIA Moussa Mariam K M 31/12/1999 GOLOMBO R -

The Verb in Bozo Jenaama Thesis in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master Studies in African Linguistics of the University of Leiden
Christiane Lauschitzky E.A.Borgerstraat 37 2225AN Katwijk The Verb in Bozo Jenaama Thesis in partial fulfillment of the requirements for the Master Studies in African Linguistics of the University of Leiden Leiden, August 2007 This paper is dedicated to my friend Maggie whose kindness and prayers kept me at it, when it was tough going. Thank you, for your company and encouragement along the way. Table of Contents TABLE OF CONTENTS ........................................................................................................... 3 1 INTRODUCTION ........................................................................................................... 5 1.1 CLASSIFICATION ................................................................................................................... 5 1.1.1 Dialects ................................................................................................................... 6 1.2 GEOGRAPHY , DEMOGRAPHY .................................................................................................. 6 1.3 LANGUAGE DATA AND INFORMANTS ........................................................................................ 7 1.3.1 Language Data ....................................................................................................... 7 1.3.2 Informants .............................................................................................................. 8 1.4 PHONOLOGY ...................................................................................................................... -

Rapid Mental Health and Psychosocial Support Needs Assessment in Mali
DECEMBER 2018 – JANUARY 2019 Rapid mental health and psychosocial support needs assessment in Mali Regions of Ségou, Mopti, Timbuktu and Sikasso Mental Health and Psychosocial Support Assessment, August 2019 2 ACKNOWLEDGMENTS International Medical Corps is thankful for the generous support of the Swiss Development Cooperation (SDC), which funded this mental health and psychosocial support (MHPSS) rapid-needs assessment. We thank all our informants in the administrative structures as well as the health structures, NGO partners and in the community. Without your valuable information, this work could not have been successful. This report and MHPSS rapid needs assessment was undertaken by Guy Bertrand Tengpe Wabette, MHPSS consultant, on behalf of International Medical Corps Mali country office. We thank the supervisors and investigators who agreed to explore deep in Mali, often in areas where security issues may have driven back people who lacked temerity. Thanks to the International Medical Corps team: I am especially thinking of Dr. Djuma Mnitima, Pacifique Kigongwe, Dr. Kouadio Jules Alla, Karol Bassim, Degninou Yehadji, Dr. Niare Boubakar, Djibril Coulibaly, Sambo Souley, Natalya Kostandova, Dr. Marcia Brophy and Claire Whitney. Your support, advice and feedback were invaluable in carrying out this work. Finally, thank you to Marius Tchassep, Aurèle Njientcheu, Georgia Bodiong and Cyril Mbia from the research action department of 3sh for their quality control and data analysis support. FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT: Dr. Jules Alla Dr. Marcia Brophy Medical Director, Mali country team Global MHPSS Technical Advisor, HQ [email protected] [email protected] TABLE OF CONTENTS Acknowledgments 2 List of Abbreviations 4 SECTION 1 Background and Rationale 5 1 1. -

Ministere De L'administration Republique Du Mali Territoriale ******************** Region De Mopti ********** Gouvernor
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION REPUBLIQUE DU MALI TERRITORIALE Un Peuple – Un But – Une Foi ******************** REGION DE MOPTI ********** GOUVERNORAT ****** Revue sectorielle conjointe du Sous-Secteur de l’Agriculture /campagne agricole 2018/2019 1 SOMMAIRE Liste des tableaux ................................................................................................................................ 3 Liste des sigles et abréviations ......................................................................................................... 4 INTRODUCTION .................................................................................................................................... 6 I. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA REGION ............................................................................ 6 1.1 Localisation : ................................................................................................................................. 6 1.2 Population :.................................................................................................................................... 6 1.3 Potentialités socioéconomiques : ................................................................................................... 6 II. PRINCIPAUX RESULTATS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE ET BILAN CEREALIER ............... 7 2.1 Bilan global de la campagne agricole (agriculture, élevage, pêche, environnement) : ................. 7 2.1.1 Agriculture : ......................................................................................................................... -

Pv Def 2014 Ae Mopti
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI -------------------------------- Un Peuple-Un But-Une Foi CENTRE NATIONAL DES EXAMENS ET CONCOURS DE L'EDUCATION -------------------------------- ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE MOPTI -------------------------------- NOTE DE SERVICE N° 14-_043_ /AE_MOPTI Portant admission de candidats au Diplôme d'Etudes Fondamentales Classique et Medersa, Session de Juin 2014 Les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis à l'examen du Diplôme d'Etudes Fondamentales (DEF), Session de Juin 2014 CAP DE DJENNE N° Date Lieu de PRENOMS NOM ECOLE Père Mère MENTION CENTRE PLACE Nais. Naissance Diondiori/Macin Allaye 440 Saïdou BOLLY Diabolo 1998 Adia DIALL PASSABLE DIABOLO a BOLLY N'Djé Djominé 470 Araba BOUARE Diabolo 1999 Diabolo/Djenné PASSABLE DIABOLO BOUARE TANGARA Daouda Bintou 847 Aly COULIBALY Diabolo 1999 Soala/Djenné PASSABLE DIABOLO COULIBALY COULIBALY Amadou 905 Djelika COULIBALY Diabolo 1998 Soala/Djenné Alimata BOIRE PASSABLE DIABOLO COULIBALY Sirabougou Dramane Molobaly 1752 Hamidou DIARRA Diabolo 1999 Bambara/Djenn PASSABLE DIABOLO DIARRA TANGARA é Sirabougou Issa Maïmouna 1796 Mamoutou DIARRA Diabolo 1999 PASSABLE DIABOLO Peulh/Djenné DIARRA PLEA Sirabougou Zoumana 1871 Soumaïla DIARRA Diabolo 1999 Bambara/Djenn Sitan PLEA PASSABLE DIABOLO DIARRA é Aminata 1953 Amidou DICKO Diabolo 1999 Tortya/RCI Allaye DICKO PASSABLE DIABOLO DIALLO Fatoumata 2002 Mahamadou DICKO Diabolo 1998 Diabolo/Djenné Allaye DICKO PASSABLE DIABOLO DIALLO Oumou 3369 Amadou KOITA Diabolo 2000 Diabolo/Djenné Hama