La Pointe Du Raz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
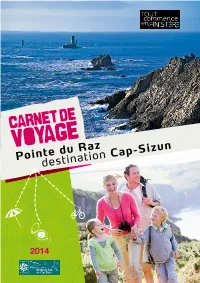
Pointe Du Raz Destination Cap-Sizun
Pointe du Raz destination Cap-Sizun 2014 Balade au bout du monde ! nfin ! Je vais pouvoir découvrir enfin la mythique pointe du Raz, carte postale du tonton Louis qui me faisait rêver, gamin. Le client brestois était pressé mais semblait intéressé, il avait d’ailleurs accepté de garder les échantillons. Du coup, j’avais une journée de rab avant mon rendez-vous à Nantes. L’occasion ou jamais : Géraldine et les enfants pourraient m’en vouloir pour cette escapade buissonnière en solitaire, mais quand il s’agit de repérage pour d’éventuelles vacances, je suis prêt à tout… Châteaulin, Douarnenez – tiens, bizarre ce panneau Bienvenue en Cap-Sizun, qu’est-ce que c’est le “Cap-Sizun“ ? –, Confort-Meilars, Pont-Croix, ah, c’est bon, encore une demi-heure et je suis à la pointe du Raz… “Cap sur les embruns” // Carnet de voyage Bienvenue en Cap-Sizun Welcome to Cap-Sizun Herzlich willkommen am Cap-Sizun Cap-Sizun historique ............................. Quel héritage ! Le Cap-Sizun en vert et bleu ................... La force d’une nature préservée Une journée à Sein ............................... Petite île, grande aventure Le grand bleu ....................................... Sans vague à l’âme ! Les plaisirs du terroir .......................... Entre terre et mer En famille ............................................ Le bon plaisir de chacun L’été sera chaud ................................. À fond la fête Plaisirs variés ...................................... Une palette étendue Plein les mirettes ................................ Le Cap-Sizun inspire les artistes Pointe du Raz // destination Cap-Sizun Cap-Sizun historique Quel héritage ! e passage en Bretagne pour le boulot, il voulait faire un crochet par la pointe du Raz. L’affaire de quelques heures, avant de repartir vers l’est… Quand le hasard… En panne ! Le garagiste est formel : rupture du machin-truc de l’arbre à cames, le temps de commander la pièce, compter deux jours. -

World Geomorphological Landscapes
World Geomorphological Landscapes Series Editor: Piotr Migoń For further volumes: http://www.springer.com/series/10852 Monique Fort • Marie-Françoise André Editors Landscapes and Landforms o f F r a n c e Editors Monique Fort Marie-Françoise André Geography Department, UFR GHSS Laboratory of Physical CNRS UMR 8586 PRODIG and Environmental Geography (GEOLAB) University Paris Diderot-Sorbonne-Paris-Cité CNRS – Blaise Pascal University Paris , France Clermont-Ferrand , France Every effort has been made to contact the copyright holders of the fi gures and tables which have been reproduced from other sources. Anyone who has not been properly credited is requested to contact the publishers, so that due acknowledgment may be made in subsequent editions. ISSN 2213-2090 ISSN 2213-2104 (electronic) ISBN 978-94-007-7021-8 ISBN 978-94-007-7022-5 (eBook) DOI 10.1007/978-94-007-7022-5 Springer Dordrecht Heidelberg New York London Library of Congress Control Number: 2013944814 © Springer Science+Business Media Dordrecht 2014 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifi cally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfi lms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. Exempted from this legal reservation are brief excerpts in connection with reviews or scholarly analysis or material supplied specifi cally for the purpose of being entered and executed on a computer system, for exclusive use by the purchaser of the work. -

En/Media/173/Download
Factors Chain International Annual Review 2015 Fa ct or in g N – E x p l o NW r i n g NO W n e w h o r i z SW E o n s SE S Fa ct or in g The factoring industry is exploring new N – horizons, both in geographical terms and in E functionality. x p l Factors Chain International plays a very o NW r important role in that process, introducing i the factoring concept in more and more n g markets and by extending the range of NO services typically offered by its members. W n e w The world economy is still in turmoil but the factoring industry has shown to be an h excellent service provider, even in difficult o times, supporting and facilitating domestic r i and international trade. z SW E o n International trade in particular is heavily s relying on ocean transportation, and SE lighthouses have played for many centuries an essential role in providing ships with safe passage. Lighthouses symbolise, both at night and during day time, the guiding hand S in this process. Found all around the world, lighthouses and horizons are inseparable, like factoring and trade. Factors Chain International Annual Review 2015 Letter from the Chairman 3 Introduction 5 The Latest Developments in FCI 6 The Mission of Factors Chain International 9 A Growing Industry 1o Fa ct A Global Network 11 or in g The Role of Factoring in International Trade 12 N – How E Export Factoring Works with FCI 13 x Casep study : International Factoring 14 l o NW r Selling Morei Competitively Overseas 15 n g Invoice Verification 16 NO W n Case studye : Supply Chain Finance 18 w Spotlight onh FCI Education Programme 20 o FCI Expressedr in Figures 21 i z SW E Factoring o Turnover by Country in 2014 23 n s SE Total Factoring Volume by Country in the Last 7 Years 24 S Factoring – Exploring new horizons Gibraltar, Europa Point Light Gibraltar, Europa Point Light 2 FCI Annual Review 2015 Letter from the Chairman By Daniela Bonzanini, FCI Chairman The Global Factoring Industry and FCI are moving forward! The weak recovery which began in 2014 has continued even being members. -

Pointe Du Raz
CARTE BUREAU DE r' GÉOLOGIQUE RECHERCHES GEDlDGIDUES 1 DE LA FRANCE A 1/50000 ET MINIÈRES POINTE DU RAZ POINTE DU RAZ La carte géologique à 1/50000 POINTE DU RAZ est recouverte par ta coupure QUIMPER (N° 72) de la carte géologique de la France à 1/80 000. ~;;:'~l POINI( lIU RAi~,.c.al' MINtST(RE DE l'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE BUR!:AU DE REtHHICHES GEOLOGIQUES n MINIÈRES SERVICE GÊOlOGIOUE NATIONAL ~ BOIte l'OS!"'" 6009 45060 O'léllns Clldll_ l"aflC" NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE POINTE DU RAZ A 1/50 000 par M. BARRIÈRE, L. CHAURIS, Y. FOUQUET A. GUILCHER, J.-P. LEFORT, A. PELHATE 1985 Éditions du B.R.G.M. - B.P. 6009 - 45060 ORLÉANS CEDEX-FRANCE SOMMAIRE INTRODUCTION 5 CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DE LA CARTE ET DE LA NOTICE EXPLICA TIVE 5 PRÉSENTATION DELA CARTE 5 DESCRIPTION DES FORMATIONS GÉOLOGIQUES 6 ROCHES CRISTALLOPHYLLIENNES ET CRISTALLINES 6 Pointe du Van 6 Pointe du Raz 8 Ile de Sein 11 ROCHES SÉDIMENTAIRES 14 Paléozoïque de la baie des Trépassés 14 Quaternaire 14 GÉOLOGIE DU PLATEAU CONTINENTAL 19 SYNTHÈSE GÉOLOGIQUE 24 RESSOURCES DU SOUS-SOL 25 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 29 SITES CLASSIQUES ET ITINÉRAIRES 29 BIBLIOGRAPHIE 30 TRAVAUX CONSULTÉS 32 CARTES CONSULTÉES 32 ANAL YSES CHIMIQUES 33 DOCUMENTS ET COLLECTIONS CONSULTABLES 38 AUTEURS DE LA NOTICE 38 - 5 - INTRODUCTION CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DE LA CARTE ET DE LA NOTICE EXPLICA TIVE Pour la partie terrestre, les explorations et les tracés géologiques de cette première édition de la feuille Pointe du Raz à l'échelle de 1/50 000 ont été effectués par des géologues de l'université de Bretagne occidentale. -

LE CAP SIZUN - LA POINTE DU RAZ Douarnenez - Audierne
BRETAGNE - LE CAP SIZUN - LA POINTE DU RAZ Douarnenez - Audierne a Pointe du Raz, classée grand site national depuis 1989, fait partie des lieux mythiques que redoutent les marins !!! De nombreux sentiers vous permettent de découvrir ce « voyage du bout du monde » : diversités du patrimoine, traditions du Pays Bigouden, du Cap Sizun et du Pays de Douarnenez. Vous pourrez profiter de la succession des falaises de Douarnenez jusqu'à la Pointe du Raz L et des étendues dunaires ou étangs de la Baie d'Audierne. Le retour des bateaux dans les ports de pêche ajoutera une note de charme à cette randonnée typique !!! La Pointe du Raz est sans aucun doute le site le plus connu de Bretagne, avec plus d’un million de visiteurs par an. La pointe marque l’extrémité occidentale de la France. Elle est célèbre dans le monde entier. Victime de son succès, la zone a été ravagée par le passage des touristes et la laideur des constructions. Depuis quelques années, une ambitieuse campagne de réhabilitation a été entreprise. Les voitures ont été éloignées. L’ensemble du site a été complètement réaménagé afin de lui redonner sa beauté d’antan. Maintenant la pointe a retrouvé son aspect sauvage et les seuls êtres vivants présents en dehors des promeneurs, sont les oiseaux. Alors n’hésitez pas, allez parcourir cette lande battue par les vents au pied de laquelle les vagues se brisent contre les rochers. Le spectacle est grandiose. Et par beau temps, restez admirer le coucher de soleil sur le raz de sein. C’est magique ! Tiré du site : www.jedecouvrelafrance.com › LE PROGRAMME FL011 7 jours, 6 nuits et 5 jours de randonnée. -

Contesting the Foreshore the University of Amsterdam
aup_mare_2 18-08-2004 16:52 Pagina 1 2 MARE PUBLICATION SERIES 2 T Jeremy Boissevain and This collection of essays is about tourism and social, political, and economic relations in coastal om Selwyn (Eds.) locations in various parts of the world. The starting point of each chapter is the ethnographic study of one particular place. However, the authors are also concerned with wider regional, national, and global forces which shape and influence the local economies and societies under review. Although most of the essays focus on the European coastline, the book is intended to have implications for other geographical areas. Jeremy Boissevain is Emeritus In most parts of the world, coastal settlements and contexts are changing rapidly and markedly. These contexts are routinely characterised by conflict between different interest groups contesting Professor of Social Anthropology at the ownership and control of the foreshore and its resources. One of the threads running through Contesting the Foreshore the University of Amsterdam. the volume is that coastal regions are often sites of fishing and related ‘traditional’ activities. The chapters discuss the relationships between traditional stakeholders, such as fishermen and local residents, and new stakeholders including new residents, second-home owners, tourists and tourism Edited by property developers, and fish farm managers as they vie for status, influence, and ultimately for Jeremy Boissevain and space on the foreshore. Tom Selwyn The underlying preoccupation of the volume as a whole is the extent of penetration and transformation resulting from the onward march of capitalism and the market system in the coastal Tom Selwyn is Professor of locations studied. -

CAP SIZUN Audierne Quimper Douarnenez
Transport Désireux de s’adapter à votre mobilité, la Région Bretagne et la Communauté de Communes du Cap Sizun vous proposent A la Demande des services de transports collectifs à la demande (TAD) en complément des services existants. Des services toute l’année Ces services vous permettent d’effectuer un déplacement : Cap Sizun Depuis ou vers : Plogoff, Cléden-Cap-Sizun, Goulien, Esquibien, Primelin, Mahalon et Beuzec-Cap-Sizun vers Audierne, Quimper et Douarnenez Vers ou depuis : · Audierne · Quimper ou Douarnenez grâce à la mise en place d’une correspondance avec les lignes du réseau BreizhGo : BEUZEC - CAP-SIZUN › Ligne n° 52 Audierne - Pont Croix - Douarnenez, CLÉDEN-CAP-SIZUN puis la ligne 51 Douarnenez - Quimper Route de DOUARNENEZ Lescoff la Baie › Ligne n° 53 Audierne - Plouhinec - Quimper GOULIEN St Yves CONFORT-MEILARS L53B PONT-CROIX Les services TAD sont assurés par de petits véhicules. Ils fonctionnent PLOGOFF Bourg Rugolva Croix rouge Bourg L52 uniquement sur réservation de votre part sur des itinéraires définis La pointe PRIMELIN ESQUIBIEN MAHALON à l’avance et à partir de points d’arrêt identifiés. du Raz Croas Landrer Le Loc’h Kerloc’h AUDIERNE PLOUHINEC Huella Quai Anatole France réservation QUIMPER Sainte - Evette L53 Embarcadère Par téléphone au 02 98 90 88 89 (prix d’un appel local) de 7h à 17h du lundi au vendredi, au plus tard la veille de votre TRANSPORT À LA DEMANDE déplacement (le vendredi pour vos déplacements du lundi). RÉSEAU PRINCIPAL BREIZHGO Vous devez indiquer au standard du réseau BreizhGo : votre nom, votre numéro de téléphone et votre destination, le jour, l’horaire et le point de départ qui vous intéressent parmi ceux proposés sur la fiche horaire. -

Site D'intérêt Géologique : Conglomérat De La Baie Des
___________________________________________________________________________ « Dossier préparatoire des arrêtés-listes départementaux des sites d’intérêt géologique » Site d’intérêt géologique : Conglomérat de la Baie des Trépassés _____________________________________________________________________________________________________ Département : Finistère (29) Communes : Cleden-Cap-Sizun et Plogoff Référence de l’inventaire national du patrimoine géologique : BRE 0112 Alternances -cisaillées- de niveaux argileux à éléments figurés et de niveaux grossiers quartzo-feldspathiques. I – Description physique du site Bas de falaises littorales et estrans sur les terminaisons nord et sud de la plage bordée d’un cordon sableux. Superficie : 1,8 hectare Accès : À partir de Plogoff, prendre la D784 en direCtion de la Pointe du Raz. À Kerveur tourner à droite en direCtion de la Baie des Trépassés. Au niveau de la plage, se garer près du restaurant. Les deux zones du site sont visibles en bas de falaise aux deux extrémités de la plage. En fonCtion du CoeffiCient de marée, diffiCiles observations lors des Hautes marées. 1 Fond IGN 1/50 000e avec la localité du site d’intérêt géologique. Fond IGN 1/3 500e avec les deux polygones du site d’intérêt géologique. Photo aérienne avec les deux polygones du site d’intérêt géologique. 2 Photo aérienne de l’année 2013 Numéros de sections - parcelles : AE0064 ; ZT0145 à ZT0148 et DPM. Coordonnées des polygones proposés au classement : en Lambert 93 X (m) Y (m) 126796 6800075 126772 6799935 126736 6799951 126680 6800189 126719 6800169 126796 6800075 126678 6799699 126723 6799680 126669 6799613 126634 6799619 Description géologique Le fossé stéphanien (-300 Millions d’années) du Cap Sizun, en dépression, est bordé au nord par la trondHjémite de Douarnenez-Pointe du Van et au sud par les lames leucogranitiques de la pointe du Raz. -

France, Country of Tradition and Culture
English version FRANCE, COUNTRY OF TRADITION AND CULTURE PARIS NORMANDY AND LOIRE CASTLES FROM NORMANDY TO BRITTANY FROM THE FRENCH RIVIERA TO THE ITALIAN LAKES THE BEST FROM PROVENCE AND FRENCH RIVIERA THE TREASURES OF SOUTH WEST OF FRANCE CORSICA CHAMPAGNE FLAVOURS AND MEMORIES OF ALSACE ROUEN CAEN MONT ST. MICHEL FRANCE PARIS PARIS NORMANDY ST MALO ALLEMAGNE AND LOIRE CASTLES RENNES CHAMBORD AUTRICHE AMBOISE SUISSE TOURS Tour of 9 days / 8 nights PORTO FINO DAY 1 – PARIS / ROUEN Arrival in Rouen, welcomed by your guide. Panoramic tour of the Norman capital where you will see Gothic and Norman buildings and more than 700 typical houses. You will pass through Rue de la Grande Horloge, Place du Vieux Marché, Beaux-Arts Museum and the Palais de Justice. Dinner and ITALIE accommodation. DAY 2 – ROUEN / HONFLEUR / DEAUVILLE / CAEN Departure for Honfleur, known for its port, its old pond and picturesque houses with slate roofs. It’s one of the most romantic city in France and also the starting point of lots of French sailors. Continue to Deauville, seaside resort known all over the world for its luxurious houses and events. Lunch. In the afternoon, departure for Caen. Visit the emblematic places of the city: Men’s Abbey, Women’s Abbey and Ducal Castle. Then, you will continue with the visit of the famous Memorial of Caen, museum dedicated to Landings during WWII. Dinner and accommodation. DAY 3 – CAEN / MONT SAINT MICHEL / SAINT MALO Departure for the Mont Saint Michel. On the way you will pass through Norman beaches famous for Landings of Allied troops, Arromanches, Omaha and American cemetery. -

Pointe Du Raz Destination Cap-Sizun
Pointe du Raz destination Cap-Sizun 2014 Bienvenue en Cap-Sizun Welcome to Cap-Sizun Herzlich willkommen am Cap-Sizun Cap-Sizun historique ............................. Balade au bout du monde ! Quel héritage ! Le Cap-Sizun en vert et bleu ................... La force d’une nature préservée Une journée à Sein ............................... nfin ! Je vais pouvoir découvrir enfin la Petite île, grande aventure mythique pointe du Raz, carte postale du tonton Le grand bleu ....................................... Louis qui me faisait rêver, gamin. Le client brestois Sans vague à l’âme ! était pressé mais semblait intéressé, il avait d’ailleurs accepté de garder les échantillons. Les plaisirs du terroir .......................... Du coup, j’avais une journée de rab avant mon Entre terre et mer rendez-vous à Nantes. En famille ............................................ L’occasion ou jamais : Géraldine et les enfants Le bon plaisir de chacun pourraient m’en vouloir pour cette escapade buissonnière en solitaire, mais quand il s’agit de L’été sera chaud ................................. repérage pour d’éventuelles vacances, je suis prêt À fond la fête à tout… Plaisirs variés ...................................... Châteaulin, Douarnenez – tiens, bizarre Une palette étendue ce panneau Bienvenue en Cap-Sizun, qu’est-ce Plein les mirettes ................................ que c’est le “Cap-Sizun“ ? –, Confort-Meilars, Le Cap-Sizun inspire les artistes Pont-Croix, ah, c’est bon, encore une demi-heure et je suis à la pointe du Raz… “Cap sur les embruns” // Carnet de voyage Pointe du Raz // destination Cap-Sizun Visites guidées (juillet-août) Et toute l’année sur réservation • Audierne Le vieil Audierne Cap Accueil. Tél. 02 98 70 28 72 • Beuzec-Cap-Sizun Le circuit des Korrigans Office de tourisme. -

From Sea to Plate in West Cornouaille. Caption: Taste the Delights of the Sea and Awaken Your Taste Buds During a Stay at the Tip of Brittany
TRIP IDEA From sea to plate in West Cornouaille. Caption: Taste the delights of the sea and awaken your taste buds during a stay at the tip of Brittany. On the menu: gulps of salty air and sweet & savoury strolls to consume without moderation! AT A GLANCE Stunning views of Pointe du Raz, endless fine sandy beaches, fishing ports where crayfish and line-caught sea bass are unloaded… In West Cornouaille, the sea is on your doorstep wherever you go! The tip of Brittany is also the birthplace of some essential regional dishes, including kouign-amann and Hénaff pâté From the narrow streets of Douarnenez, a city with a history based on sardine-fishing, to the cookery workshop of a sea fisherwoman in Guilvinec, via a sea trip in Audierne bay, this stay will make your mouth water! Day 1 Douarnenez, in the footsteps of the "Penn Sardin" First get settled and then discover Douarnenez at your pace. Follow the "Chemin des sardines” to understand the town’s rich sardine past. Stroll along the quays. Once thriving thanks to the cannery business, they now bustle with the activity of numerous cafés and restaurants. For a seaside atmosphere, head to the Tréboul neighbourhood and its beautiful beaches lapped by crystalline water. Don’t miss out on the guided tour of Tristan Island. This haven of greenery has a wonderful exotic garden. Between the sea and the countryside, the natural site of Plomarc'h is an exceptional place for a walk, with its old fishermen's houses. Here you can enjoy a breathtaking view of Rosmeur port. -

Pointe Du Van
Ein Schitterende Il raduno Wanderparadies routes d’eccellenza Die Grand Site de France ist ideal De Grand Site de France biedt Il sito offre percorsi ideali um sie zu Fuss, mit dem Rad oder ideale tochten voor wandelaars, per escursionisti, ciclisti e chi auf dem Pferd zu erforschen. fietsers en ruiters. preferisce le escursioni a cavallo. Oder Sie genießen die Schönheit De grote route GR®34 Il sentiero GR®34 conduce i turisti von Cap Sizun von der voert wandelaars langs de alla scoperta spettacolare costa, Küstenstrasse GR®34 aus. indrukwekkende kustlijn en de mentre per più piccoli è possibile kleinere routes (PR) door het fare passeggiate nell’entroterra Programm binnenland langs verschillende (PR) che danno accesso a tesori Für alle Altersklassen ist Pointe culturele schatten. culturali. du Raz ein Naturwunder und Wat te doen ? Da non perdere natürlich ist auch eine begleitete Führung möglich. La pointe biedt avontuur voor Pointe du Raz offre meraviglie iedereen, met of zonder gids. da scoprire per tutti, con o senza Unsere Touristen Informationen Misschien vangt u zelfs een glimp guida. Si può anche vedere di teilt Ihnen jederzeit die aktuellen op van de legendaire stad Ys. sfuggita la leggendaria città di Ys! Angebote mit. De sportievelingen volgen de Per gli sportivi, con la nostra guida route GR®34 langs de baaien, of potrete percorre il sentiero GR®34 ontdek de geheime schatten van tra le due baie (Sentier des deux Baie des Trépass en Pointe du Van. baies), o esplorare i segreti della Baie des Trépassés e di Pointe du Van. Pointe du Raz eN Cap SIzun KontaKt / ContaCt / Contatti Maison de la Pointe du Raz et du Cap-Sizun BP1 29 770 PLOGOFF Tél.