Etude D'impact Environnemental Et Social Des
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

Circonscription Electorale De Kati
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- ARRET N° 07-177/CC-EL DU 14 Juillet 2007 ARRET N°07-177/CC-EL DU 14 JUILLET 2007 PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DU PREMIER TOUR DE L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE (Scrutin du 1er Juillet 2007) La Cour Constitutionnelle Vu la constitution ; Vu la loi organique n° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi n° 02-011 du 05 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ; Vu la loi n° 02 – 010 du 05 mars 2002 portant loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote et ses textes modificatifs ; Vu la loi n° 06 – 044 du 06 septembre 2006 portant loi électorale ; Vu le décret n°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; Vu le décret n°07–039/P-RM du 31 janvier 2007 portant convocation du collège électoral et ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale et ses textes modificatifs ; Vu le décret n°07–040/P-RM du 31 janvier 2007 fixant le modèle de 2 déclaration de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ; Vu le décret -

Production Et Consommation D'eau Potable Période D'audit Du 01/07/2010 Au 31/12/2010
Production et consommation d'eau potable Période d'audit du 01/07/2010 au 31/12/2010 Cercle de BAFOULABE Centre PopulationProduction m3 Consom. m3 Perte m3 Perte % Consom l/h/j BAFOULABE 3 70013 653 10 355 3 298 24% 15,5 DIAKABA 3 001400 352 48 12% 0,7 OUSSOUBIDIAGNA 4 5736 336 5 516 820 13% 6,7 SIBINDI 7 0865 528 4 948 580 10% 3,9 Total BAFOULABE 18 360 25 917 21 171 4 746 18% Moyenne par centre 4 590 6 479 5 293 1 187 18% 6,7 Cercle de DIEMA Centre PopulationProduction m3 Consom. m3 Perte m3 Perte % Consom l/h/j BEMA 5 4221 759 1 643 116 7% 1,7 DIANGOUNTE CAMARA 11 05110 365 9 083 1 282 12% 4,6 DIEMA 8 35034 072 32 642 1 430 4% 21,7 FASSOUDEBE 5 0501 958 1 921 37 2% 2,1 FATAO 6 3848 215 7 390 825 10% 6,4 KAINERA 2 6262 681 2 309 372 14% 4,9 LAKAMANE 1 5142 697 2 560 137 5% 9,4 LAMBIDOU 8 53915 156 9 728 5 428 36% 6,3 MADIGA SACKO 7 8418 780 8 850 -70 -1% 6,3 MOUNTAN-SONINKE 1 3022 640 2 153 487 18% 9,2 Total DIEMA 58 079 88 323 78 279 10 044 11% Moyenne par centre 5 808 8 832 7 828 1 004 11% 7,3 Cercle de KAYES Centre PopulationProduction m3 Consom. m3 Perte m3 Perte % Consom l/h/j AOUROU 3 2505 332 4 798 534 10% 8,2 BATAMA 8 46912 274 13 065 -791 -6% 8,6 DARSALAM OULOUMA 723348 303 45 13% 2,3 DIABADJI 2 4361 691 1 691 0 0% 3,9 DIALANE 4 94812 616 12 694 -78 -1% 14,3 DIAMOU 4 48010 829 8 576 2 253 21% 10,6 DIATAYA 3 38014 293 14 992 -699 -5% 24,6 FEGUI 3 38413 719 11 930 1 789 13% 19,6 GAGNY 4 0706 158 5 120 1 038 17% 7,0 GAKOURA RIVE DROITE 1 888990 863 127 13% 2,5 GORY GOPELA 4 0177 526 7 033 493 7% 9,7 GOUSSELA 4 7366 664 6 625 39 1% 7,8 KABATE 4 5305 312 7 283 -1 971 -37% 8,9 KONIAKARY 14 32042 827 33 782 9 045 21% 13,1 KOUSSANE 11 6167 755 7 284 471 6% 3,5 KROUKETO 2 60011 476 11 476 0 0% 24,5 MARENA DJOMBOUGOU 4 46427 127 22 955 4 172 15% 28,6 NAYELA 4 3997 378 6 180 1 198 16% 7,8 SEGALA 3 25017 789 17 432 357 2% 29,8 SELIFELY 5 65411 337 8 308 3 029 27% 8,2 DNH - KfW - AfD 2AEP Opérateur STEFI : [email protected] Tél. -

Mli0006 Ref Region De Kayes A3 15092013
MALI - Région de Kayes: Carte de référence (Septembre 2013) Limite d'Etat Limite de Région MAURITANIE Gogui Sahel Limite de Cercle Diarrah Kremis Nioro Diaye Tougoune Yerere Kirane Coura Ranga Baniere Gory Kaniaga Limite de Commune Troungoumbe Koro GUIDIME Gavinane ! Karakoro Koussane NIORO Toya Guadiaba Diafounou Guedebine Diabigue .! Chef-lieu de Région Kadiel Diongaga ! Guetema Fanga Youri Marekhaffo YELIMANE Korera Kore ! Chef-lieu de Cercle Djelebou Konsiga Bema Diafounou Fassoudebe Soumpou Gory Simby CERCLES Sero Groumera Diamanou Sandare BAFOULABE Guidimakan Tafasirga Bangassi Marintoumania Tringa Dioumara Gory Koussata DIEMA Sony Gopela Lakamane Fegui Diangounte Goumera KAYES Somankidi Marena Camara DIEMA Kouniakary Diombougou ! Khouloum KENIEBA Kemene Dianguirde KOULIKORO Faleme KAYES Diakon Gomitradougou Tambo Same .!! Sansankide Colombine Dieoura Madiga Diomgoma Lambidou KITA Hawa Segala Sacko Dembaya Fatao NIORO Logo Sidibela Tomora Sefeto YELIMANE Diallan Nord Guemoukouraba Djougoun Cette carte a été réalisée selon le découpage Diamou Sadiola Kontela administratif du Mali à partir des données de la Dindenko Sefeto Direction Nationale des Collectivités Territoriales Ouest (DNCT) BAFOULABE Kourounnikoto CERCLE COMMUNE NOM CERCLE COMMUNE NOM ! BAFOULABE KITA BAFOULABE Bafoulabé BADIA Dafela Nom de la carte: Madina BAMAFELE Diokeli BENDOUGOUBA Bendougouba DIAKON Diakon BENKADI FOUNIA Founia Moriba MLI0006 REF REGION DE KAYES A3 15092013 DIALLAN Dialan BOUDOFO Boudofo Namala DIOKELI Diokeli BOUGARIBAYA Bougarybaya Date de création: -

World Bank Document
ReportNo. 340a-MLI FILECOPY Appraisalof Integrated RuralDevelopment Project Public Disclosure Authorized Mali May 13, 1974 Agriculture ProjectsDepartment West Africa RegionalOffice Not for PublicUse Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Document of the InternationalBank for Reconstructionand Development InternationalDevelopment Association This report was preparedfor officiai use only by the BankGroup. Rt may not be published, quoted or cited without BankCroup authorization.The BankCroup dors not dacept responsibility for the accuracyor completenessof the report. CURRENCY EQUIVALENTS US$ 1 = MF 500 MF 100 US$ 0.200 WEIGHTS AND MEASURES 1 metric ton 0.984long ton 1 kilometre = 0.6215 mile 1 hectare 5 2.47acres ABBREVIATIONS AF Alphabétisation Fonctionnelle EDM Banque de Développement du Mali BDPA Bureau pour le Développement de la Production Agricole DGP Direction Générale de la Production DNS Direction Nationale de la Santé DNTP Direction Nationale des Travaux Publics FAC Fonds dtAide et de Coopération FED Fonds Européen de Développement GERDAT Groupement d'Etudes et de Recherches pour le Développement de l'Agronomie Tropicale ICRISAT International Crops Research Institute for the Semi Arid Tropics (Hyderabad, India) 1ER Institut d'Economie Rurale IFAC Institut Français de Recherches Fruitières Outremer IRAT Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et des Cultures -Vivrières IROT Institut de Recherches du Coton et des Textiles Exotiques IRHO Institut de Recherches pour les Huiles -

Academie D'enseignement De Kayes
MEN LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU D.E.F. SESSION DE JUIN 2017 ------ PAR ORDRE ALPHABETIQUE ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KAYES. 01- CENTRE DE DIBOLI N° ANNEE STATUT PRENOMS NOM SEXE LIEU/NAIS ECOLE MENTION PLACE NAISS ELEVE 13 Ahamada Ag AMAR M 1999 Gossi CL Diboli ASSEZ-BIEN 56 Hawo BA F 2002 Nayé Peulh REG Diboli PASSABLE 219 Mahamadou B BAH M 2001 Diboli REG Diboli ASSEZ-BIEN 233 Mamadou A BAH M 2001 Diboli REG Diboli PASSABLE 288 Assétou BÄH F 2002 Diboli REG Diboli PASSABLE 292 Coumba B BAKHAYOGO F 1999 Bamako REG Diboli PASSABLE 307 Issa BALDE M 2001 Kayes REG Diboli ASSEZ-BIEN 343Sira BANE F 2001 Nayé Peulh REG Diboli PASSABLE 388 Mamadou M BARRO M 2003 Kidira REG Diboli ASSEZ-BIEN 426 Soulemane BARRY M 2000 Diboli REG Diboli PASSABLE 509 Mamadou BATHILY M 2001 Toubaboukané REG Diboli PASSABLE 999 Tidiane CAMARA M 1999 Dakassenou CL Dakassénou PASSABLE 1039Ami CISSE F 2003 Kayes REG Diboli ASSEZ-BIEN 1299 Assitan COULIBALY F 2001 Diboli REG Diboli PASSABLE 1423 Fatoumata COULIBALY F 2002 Dakassenou REG Dakassénou PASSABLE 1510 Kadiatou COULIBALY F 2001 Ségou REG Diboli PASSABLE 1542 Lassana COULIBALY M 2002 Dakassenou REG Dakassénou PASSABLE 1592 Mamadou COULIBALY M 2000 Diboli REG Diboli PASSABLE 1642 Moussa COULIBALY M 1999 Dakassenou REG Dakassénou PASSABLE 1663 Niéné M COULIBALY M 2002 Diboli REG Diboli PASSABLE 2460 Daouda DIABATE M 1999 Nayé Peulh REG Diboli PASSABLE 2561 Mamadou B DIABY M 2000 Diboli REG Diboli PASSABLE 3012 Aissé DIALLO F 2000 Diboli REG Diboli PASSABLE 3100 Cheick S DIALLO M 2002 Gakoura REG Diboli PASSABLE -

Admis Def 2018 Ae Nioro
LISTE DES ADMIS AU DEF 2018 - ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE NIORO N° Place PRENOMS NOM Sexe Année de Naiss Lieu de Naiss. Opon DEF Statut élève Ecole CAP 117 Aliou BOLY M 2003 Fasssoudébé CLASS REG Fassoudébé 2ème C DIEMA 118 Yacouba BOLY M 2002 Fassoudébé CLASS REG Fassoudébé 2ème C DIEMA 189 Mahamadou CAMARA M 2001 Libreville CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 262 Mariam CISSE F 2002 Fassoudébé CLASS REG Fassoudébé 2ème C DIEMA 293 Assa COULIBALY F 2002 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 360 Konsou Fatoumata COULIBALY F 2003 Bamako CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 388 Minata COULIBALY F 2000 M'Pèssoba CLASS CL Béma 2ème C DIEMA 496 Oumou DIA F 2004 Niantanso CLASS REG Fassoudébé 2ème C DIEMA 562 Djibril DIAKITE M 2002 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 842 Ousmane Chérif DIARRA M 2003 Bamako CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 905 Diougoudou DIAWARA M 2002 Libreville CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 910 Douga DIAWARA M 2002 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 965 Yatté DIAWARA M 2000 Grouméra CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1123 Moctar FOFANA M 2003 Touna CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1188 Foussény HAÏDARA M 2002 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1195 Tidiane KAH M 2003 Fassoudébé CLASS REG Fassoudébé 2ème C DIEMA 1198 Issouf KALOGA M 2000 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1202 Abdoulaye KAMISSOKO M 2002 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1205 Dengoumé KAMISSOKO M 2000 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1209 Komakan KAMISSOKO M 2002 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1211 Madi Tidiane KAMISSOKO M 2004 Bamako CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1241 Mohamed KANTE M 2003 Guédébiné CLASS REG -

GE84/210 BR IFIC Nº 2747 Section Spéciale Special Section Sección
Section spéciale Index BR IFIC Nº 2747 Special Section GE84/210 Sección especial Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Date/Fecha : 25.06.2013 Expiry date for comments / Fecha limite para comentarios / Date limite pour les commentaires : 03.10.2013 Description of Columns / Descripción de columnas / Description des colonnes Intent Purpose of the notification Propósito de la notificación Objet de la notification 1a Assigned frequency Frecuencia asignada Fréquence assignée 4a Name of the location of Tx station Nombre del emplazamiento de estación Tx Nom de l'emplacement de la station Tx B Administration Administración Administration 4b Geographical area Zona geográfica Zone géographique 4c Geographical coordinates Coordenadas geográficas Coordonnées géographiques 6a Class of station Clase de estación Classe de station 1b Vision / sound frequency Frecuencia de portadora imagen/sonido Fréquence image / son 1ea Frequency stability Estabilidad de frecuencia Stabilité de fréquence 1e carrier frequency offset Desplazamiento de la portadora Décalage de la porteuse 7c System and colour system Sistema de transmisión / color Système et système de couleur 9d Polarization Polarización Polarisation 13c Remarks Observaciones Remarques 9 Directivity Directividad -

Pdf, 355.11 Kb
Généré par mamadoufoune, Apr 20, 2020 12:04 Sections: 13, Sous-sections: 0, Questionnaire créé par eouaya, Sep 26, 2018 17:07 Questions: 59. Dernière modification par eouaya, Oct 16, 2018 21:10 Questions avec des conditions d'activation: 11 Partagé avec: Questions avec des conditions de mamadoufoune (jamais modifié) validation: 22 sodio (jamais modifié) Tableaux: 22 Variables: 0 Qx_EHCVM_PRIX_ML INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE COUVERTURE Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 2, Textes statiques: 3. IDENTIFICATION Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 13. CÉRÉALES ET PAINS Pas de sous-sections, Tableaux: 2, Questions: 4. VIANDE Pas de sous-sections, Tableaux: 2, Questions: 4. POISSON ET FRUITS DE MER Pas de sous-sections, Tableaux: 2, Questions: 4. LAIT, FROMAGE ET OEUFS Pas de sous-sections, Tableaux: 2, Questions: 4. HUILES ET GRAISSES Pas de sous-sections, Tableaux: 2, Questions: 4. FRUITS Pas de sous-sections, Tableaux: 2, Questions: 4. LÉGUMES Pas de sous-sections, Tableaux: 2, Questions: 4. LEGUMINEUSES ET TUBERCULES Pas de sous-sections, Tableaux: 2, Questions: 4. SUCRE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE Pas de sous-sections, Tableaux: 2, Questions: 4. EPICES, CONDIMENTS ET AUTRES Pas de sous-sections, Tableaux: 2, Questions: 4. BOISSONS Pas de sous-sections, Tableaux: 2, Questions: 4. ANNEXE A — CATÉGORIES LÉGENDE 1 / 29 INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE Informations de base Titre Qx_EHCVM_PRIX_ML INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE -

Region De Kayes
Répartition par commune de la population résidente et des ménages Taux Nombre de Nombre Nombre Population Population d'accroissement ménages d’hommes de femmes en 2009 en 1998 annuel moyen (1998-2009) Cercle de Kita Madina 1 514 4 655 5 153 9 808 13 447 -2,8 Makano 1 459 4 910 4 916 9 826 8 141 1,7 REGION DE KAYES Namala Guimba 2 007 7 654 8 013 15 667 8 590 5,6 Niantanso 732 2 546 2 419 4 965 4 005 2,0 En 2009, la région de Kayes compte 1 996 812 habitants répartis dans 308 794 ménages, Saboula 841 3 031 3 162 6 193 7 063 -1,2 ce qui la place au 5ème rang national. La population de Kayes est composée de 984 805 Sebekoro 6 455 19 259 19 771 39 030 18 443 7,1 Sefeto Nord 1 167 4 500 5 171 9 671 8 037 1,7 hommes et de 1 012 007 femmes, soit 97 hommes pour 100 femmes. Les femmes repré- Sefeto Ouest 2 778 9 194 10 224 19 418 14 690 2,6 sentent 50,7% de la population contre 49,3% pour les hommes. Senko 1 481 4 709 4 992 9 701 7 813 2,0 La population de Kayes a été multipliée par près de 1,5 depuis 1998, ce qui représente un Sirakoro 1 485 5 011 5 314 10 325 8 849 1,4 taux de croissance annuel moyen de 3,5%. Cette croissance est la plus importante jamais Souransan Tomoto 495 2 073 2 032 4 105 5 004 -1,8 constatée depuis 1976. -
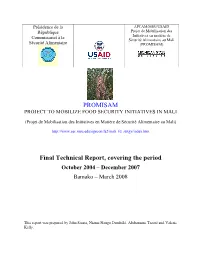
PROMISAM Final Technical Report, Covering the Period
Présidence de la APCAM/MSU/USAID République Projet de Mobilisation des Commissariat à la Initiatives en matière de Sécurité Alimentaire au Mali Sécurité Alimentaire (PROMISAM) PROMISAM PROJECT TO MOBILIZE FOOD SECURITY INITIATIVES IN MALI (Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire au Mali) http://www.aec.msu.edu/agecon/fs2/mali_fd_strtgy/index.htm Final Technical Report, covering the period October 2004 – December 2007 Bamako – March 2008 This report was prepared by John Staatz, Niama Nango Dembélé, Abdramane Traoré and Valerie Kelly. PROMISAM Bamako Office ACI 2000, rue 339, porte 158 Hamdallaye Bamako, Mali Tel.: +223 222 34 19 Fax: +223 223 34 82 Name Position Email Nango Dembélé Director, COP [email protected] Abdramane Traore Project Assistant [email protected] Maïmouna Traore Admin. Asst./ Accountant [email protected] Office in the US: Department of Agricultural Economics Michigan State University 202 Agriculture Hall East Lansing, MI 48824-1039 Tel.: +1-517-355-1519 Fax: +1-517-432-1800 Contact Persons Position Email John Staatz Co-Director & Professor [email protected] Valerie Kelly Associate Professor, International Development [email protected] TABLE OF CONTENTS Executive Summary...................................................................................................................... ii 1. Background and Objectives .................................................................................................. 1 1.1 Background and Context ............................................................................................... -

Rapport Résultats PAICT 2016 Version Finale Signée
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L’ETAT DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES RAPPORT RESULTATS 2016 PROJET D’APPUI AUX INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES- MLI0903411 (Maternité à Kita – FNACT Droits de Tirage 2015) ACRONYMES ....................................................................................................... 4 1 APERÇU DE L'INTERVENTION .............................................................. 5 1.1 FICHE D 'INTERVENTION ............................................................................ 5 1.2 EXECUTION BUDGETAIRE ......................................................................... 6 1.3 AUTOEVALUATION DE LA PERFORMANCE ................................................. 6 1.3.1 Pertinence ............................................................................................ 6 1.3.2 Efficacité .............................................................................................. 7 1.3.3 Efficience ............................................................................................. 7 1.3.4 Durabilité potentielle .......................................................................... 7 1.4 CONCLUSIONS ......................................................................................... 8 2 MONITORING DES RESULTATS ............................................................. 9 2.1 ÉVOLUTION DU CONTEXTE ....................................................................... 9 2.1.1 Contexte général