Drap De 1861 a 1939
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Of Regulation (EEC) No 2081/92 on the Protection of Geographical Indications and Designations of Origin
12.7.2005 EN Official Journal of the European Union C 172/7 Publication of an application for registration pursuant to Article 6(2) of Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin (2005/C 172/05) This publication confers the right to object to the application pursuant to Articles 7 and 12d of the above- mentioned Regulation. Any objection to this application must be submitted via the competent authority in a Member State, in a WTO member country or in a third country recognized in accordance with Article 12(3) within a time limit of six months from the date of this publication. The arguments for publication are set out below, in particular under 4.6, and are considered to justify the application within the meaning of Regulation (EEC) No 2081/92. SUMMARY COMMISSION REGULATION (EC) No 2081/92 ‘HUILE D'OLIVE DE NICE’ EC No: FR/00322/29.10.2003 PDO (X) PGI ( ) This summary has been drawn up for information purposes only. For full details, in particular for the producers of the PDO or PGI concerned, please consult the complete version of the product specification obtainable at national level or from the European Commission (1). 1. Responsible department in the Member State: Name: Institut National des Appellations d'Origine Address: 138, Champs-Élysées, F-75008 Paris From 1 January 2005: 51, rue d'Anjou, F-75008 Paris Tel.: 01 53 89 80 00 Fax: 01 42 25 57 97 2. Group: 2.1 Name: Syndicat Interprofessionnel de l'Olive de Nice 2.2 Address: Box 116, Min Fleurs 6, F-06296 Nice Cedex 3 Tel.: 04 97 25 76 40 Fax: 04 97 25 76 59 2.3 Composition: — Members: all natural and legal persons producing, processing, packing and marketing ‘Olive de Nice’ registered designation of origin olives and olive paste and ‘Huile d'olive de Nice’ registered designation of origin olive oil. -

Touët-De-L'escarène L'escarène Blausasc La Grave De Peille Peillon
Ligne 360S Ligne 304 L’Escarène / La Grave de Peille / Peillon Touët-de-l’Escarène êé êé Touët-de-l’Escarène Nice Drap / Cantaron L’Escarène Place Camous Touët-de-l’Escarène Pont de Serre L’Ecole Blausasc L’Escarène Le Verger Pissandrus Chemin Ste Anne La Grave de Peille Col de Nice Le Moulin Neuf La Blancarde La Grave de Peille Mairie Blausasc Peillon Villa Vicat Lou Cannet Le Stade Centre Ménager La Grave de Peille Mairie La Cité Villa Vicat Le Square Centre Ménager ligne ligne Le Jardin La Cité 340 304 Le Moulin Le Square Le Jardin Hôtel de Ville ligne Le Moulin Scolaires La Soutrana Hôtel de Ville 360S Les Mazues La Soutrana Châteauvieux Les Mazues Prom. Passeron Châteauvieux Prom. Passeron Borgheas de Peillon / PI Milo Borgheas de Peillon / PI Milo Andrio Andrio Pont de Peille Pont de Peille La Trinité Les Vernes Nice Vauban Pont Chemin de Fer Pont de Cantaron Nice Square Toja N° Vert Gare de Drap / Cantaron www.cg06.fr N° Vert www.cg06.fr HORAIRES SEMAINE hors jours fériés HORAIRES SAMEDI HORAIRES DIMANCHE hors jours fériés et jours fériés Direction du lundi au vendredi Direction Direction Dimanche et fêtes Nice toute l’année période toute l’année Samedi - toute l’année scolaire Nice Nice toute l’année Touët-de-l'Escarène - - - - 08:30 - - - - 17:15 - - L’Escarène 06:40 07:40 07:40 09:10 12:40 13:30 14:10 16:55 17:55 18:55 L’Escarène 09:40 17:40 L'Escarène 06:40 06:40 07:30 07:40 08:35 09:10 12:40 14:10 16:55 17:20 17:55 18:55 La Grave de Peille - - 7:50 - - 13:40 - - - - Blausasc 06:50 - 07:40 07:50 08:45 - 12:50 14:20 - 17:30 - - Blausasc 09:50 17:50 Blausasc 06:50 07:50 - - 12:50 - 14:20 - - - La Grave de Peille - 06:50 - - 08:50 - - - 14:10 - 17:35 - - Nice Vauban Nice Vauban 10:20 18:20 Peillon - 06:55 - - 08:55 - - - - - 17:40 - - 07:30 08:30 8:30 09:50 13:20 14:20 14:50 17:35 18:35 19:35 Lycée de Drap - - 07:55 - - - - - - - - - - Direction Direction Pont de Cantaron Dimanche et fêtes 07:05 07:05 - 08:05 09:00 09:35 13:05 14:35 14:20 17:20 17:45 18:20 19:20 Samedi - toute l’année Blausasc et Blausasc et toute l’année corresp. -

GORGES DU PAILLON (Identifiant National : 930020136)
Date d'édition : 03/06/2021 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020136 GORGES DU PAILLON (Identifiant national : 930020136) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 06100113) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Benoît OFFEHAUS, Sonia RICHAUD, Stéphane BENCE, Julien RENET, Mathias PIRES, .- 930020136, GORGES DU PAILLON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020136.pdf Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur Rédacteur(s) :Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Benoît OFFEHAUS, Sonia RICHAUD, Stéphane BENCE, Julien RENET, Mathias PIRES Centroïde calculé : 1005867°-1881518° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : Date actuelle d'avis CSRPN : 27/11/2020 Date de première diffusion INPN : Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

Hydrologiques Et Hydrogéologiques
MINISTERE DE L'AGRICULTURE Circonscription d'Action Régionale Provence - Côte d'Azur - Corse SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DES EAUX 5, boulevard de la République 13- AIX-EN-PROVENCE Tél. : 26-19.78 et 26-41 -28 ETUDE DES RESSOURCES HYDROLOGIQUES ET HYDROGÉOLOGIQUES DU SUD -EST DE LA FRANCE Fascicule 9 BASSINS DU VAR ET DU PAILLON (Département des Alpes -Maritimes) BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES D.S.G.N. Boittt postale 818 45-Orléans-La Source - Tél. 87-06-60 à 64 Service géologique régional Provence - Corse 16, boulevard Pèbre - 13-Marseille-8ème Tél. 76-00-40 69 SGL 194 PRC Marseille, mai 1969 - 2 - Le présent ouvrage a été réalisé par le Service géologique régional Provence Corse du B.R.G.M. à Marseille pour le compte du Service régional de l'aménagement des eaux de la circonscription d'action régionale Provence - Côte d'Azur - Corse. La rédaction a été assurée par Ch. GLINTZBOECKEL et G. DUROZOY avec la collaboration technique de P. THEILLIER et sous le contrôle de L. MONITION et de J. MARGAT, Chef du Département hydrogéolo¬ gique du B.R.G.M. à Orléans. L'étude a été réalisée en collaboration avec Ch. OLIVO du Service régional de l'aménagement des eaux et sous les directives de F. PELISSIER, ingénieur en chef du Génie rural des eaux et des forêts. 3 - RESUME Les bassins du Var et du Paillon couvrent une partie importante du département des Alpes Maritimes. La région est très montagneuse (Argentera alt. 3299 m) et les plaines côtières sont rares et étroites ; l'altitude moyenne est rapidement de 1000 m pour atteindre 3000 m à la frontière italienne. -
Nice La Grave De Contes
300 Nice La Grave de Contes Lundi à Vendredi Nice Vauban 05.30 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 Drap - Place Cauvin 05.50 06.20 07.20 08.20 09.20 10.20 Nice Vauban La Grave de Contes 06.10 06.40 07.40 08.40 09.40 10.40 Saint-Jean d’Angely Tende Gendarmerie Nice Vauban 11.00 12.15 13.00 14.00 15.00 16.00 Pont V. Auriol Drap - Place Cauvin 11.20 12.35 13.20 14.20 15.20 16.20 Cité PLM La Grave de Contes 11.40 12.55 13.40 14.40 15.40 16.40 Ancien Octroi Les Ecoles Nice Nice Vauban 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.20 Parc à Fourrages Drap - Place Cauvin - 16.50 17.20 17.50 18.20 18.40 Lycée de Drap - - - 18.10 - - Lavoir La Grave de Contes 16.40 17.10 17.40 18.20 18.40 - La Chaumière Sclos de Contes - - - - - 19.05 Bon Voyage Coaraze Village 17.00 - - - - - Riba Roussa Pont de l’Ariane Nice Vauban 19.00 20.00 L’Oli La Nuit Drap - Place Cauvin 19.20 20.20 Trinité La La Grave de Contes 19.40 20.40 Sainte-Anne Route de Laghet La Trinité Samedi Pont de la Roma Nice Vauban 05.30 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 Les Chênes Verts Drap - Place Cauvin 05.50 07.20 08.20 09.20 10.20 11.20 La Grave de Contes 06.10 07.40 08.40 09.40 10.40 11.40 Le Vallon Place Cauvin Drap Nice Vauban 12.15 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 Carlin Drap - Place Cauvin 12.35 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 Pont de Cantaron Pont de Chemin de Fer La Grave de Contes 12.55 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 Lycée Sclos de Contes 13.10 de Drap Les Vernes Nice Vauban 18.00 19.00 20.00 Plan du Blavet Drap - Place Cauvin 18.20 19.20 20.20 Pont de Peille La Grave de Contes 18.40 19.40 20.40 La Condamine -

Dossier Départemental Sur Les RISQUES MAJEURS Dans Les
Cet ouvrage a été réalisé par : la Direction de la Défense et de la Sécurité de la Préfecture des Alpes-Maritimes Dossier Départemental Avec l’active participation de : sur les RISQUES MAJEURS dans les Alpes-Maritimes 06 06 Direction Régionale de l'Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur – 2007 Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur Direction Départementale de l'Équipement des Alpes-Maritimes Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Alpes-Maritimes Office National des Forêts - Service départemental de Restauration des Terrains en Montagne des Alpes-Maritimes Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes ALPES-MARITIMES Que soient également remerciés : Le Cyprès, la Délégation Régionale d’EDF PACA, Météo France, le BRGM et tous ceux qui ont répondu à nos sollicitations. DANS LES DANS RISQUES MAJEURS DOSSIER DÉPARTEMENTAL SUR LES DÉPARTEMENTAL DOSSIER > Préface > Sommaire général Le RISQUE NATUREL ou TECHNOLOGIQUE MAJEUR ............................. 3 Les ENJEUX en PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR et la SITUATION dans les ALPES-MARITIMES ............................. 13 Le RISQUE NATUREL dans les ALPES-MARITIMES ............................. 19 > Mouvement de terrain ........................................... 20 > Inondation ....................................................... 27 > Feu de forêt ...................................................... 35 > Sismique ......................................................... 42 > Avalanche -

Rapport De Présentation
1 SOMMAIRE 1. Articulation du PLU avec les documents de rang supérieur ........................................................................................... 5 1.1 Articulation du PLU de Blausasc avec la DTA et le SCoT ...................................................................................... 5 1.2 Articulation du PLU au travers de sa compatibilité au SCoT avec le SDAGE du Bassin Méditerranée .................. 5 2. Le diagnostic .................................................................................................................................................................. 6 2.1 Introduction ............................................................................................................................................................. 6 2.2 Le contexte géographique de Blausasc : une approche physique du territoire ....................................................... 8 2.2.1 - De l’eau et des pentes ............................................................................................................................... 8 2.2.2 - Le grand paysage ...................................................................................................................................... 8 2.2.3 - L’occupation de l’espace ........................................................................................................................... 9 2.2.4 - Les enjeux .............................................................................................................................................. -

01 Diss Cover Page
UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations Title The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860-1880 Permalink https://escholarship.org/uc/item/8dj2f20d Author Sawchuk, Mark Publication Date 2011 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860–1880 by Mark Alexander Sawchuk A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in Charge Professor Carla Hesse, Chair Professor James P. Daughton Professor John Connelly Professor Jonah Levy Spring 2011 The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860–1880 Copyright 2011 Mark Alexander Sawchuk Abstract The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860–1880 by Mark Alexander Sawchuk Doctor of Philosophy in History University of California, Berkeley Professor Carla Hesse, Chair Using the French philosopher Ernest Renan’s dictum that the “nation’s existence is ... a daily plebiscite” as an ironic point of departure, this dissertation examines the contours of oppositional political culture to the French annexation of the County of Nice and the Duchy of Savoy in 1860. Ceded by treaty to France by the northern Italian kingdom of Piedmont-Sardinia, these two mountainous border territories had long been culturally and geo-strategically in the French orbit. Unlike their counterparts in any other province of France, the inhabitants of the two territories were asked to approve or reject the annexation treaty, and thus their incorporation into France, in a plebiscite employing universal male suffrage. -

3.2.2.2. Un Axe À Fort Trafic, En Cours D'aménagement
3.2.2.2. Un axe à fort trafic, en cours d’aménagement La vallée du Paillon n’est pas seulement une voie de circulation intra-urbaine, elle est surtout le seul axe de circulation desservant le bassin de population des Préalpes de Nice. Chaque jour, un flux important de navetteurs en provenance de Contes, Lucéram, l’Escarène, Blausasc, emprunte cette vallée pour aller travailler dans l’agglomération niçoise. La circulation moyenne y est de 60 000 véhicules par jour. De nombreux secteurs sont saturés aux heures de pointe, notamment la D 2204 entre Drap et la Pointe de Contes ainsi que la D 19, à la sortie de Saint-André. Devant l’augmentation constante du trafic routier entre Nice et son arrière-pays, de nouvelles voies de circulation ont été réalisées depuis une quinzaine d’années dans le lit du Paillon et de nouveaux aménagements sont prévus dans les prochaines années, sur la commune de Nice ainsi que sur les communes situées plus à l’amont. • Le premier tronçon de voie souterraine date de 1983. Cet axe de 700 m de long, situé sur la rive gauche, relie Barla au Palais des Expositions ; 15 000 véhicules en moyenne, l’empruntent chaque jour, 6 véhicules/10 sortent à Saint-Roch et 4/10 à Riquier. • En novembre 1997, le tunnel Masséna-Paillon a été ouvert. Ce tunnel de près de 2 Km de long, prolonge le premier tronçon et permet de relier la Promenade des Anglais au quartier Saint Roch. La circulation se fait sur 2 voies de 3 m de large chacune, dans un seul sens. -
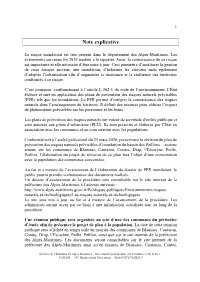
Note Explicative Concertation Ppripaillons
1 Note explicative Le risque inondation est très présent dans le département des Alpes-Maritimes. Les évènements survenus fin 2019 tendent à le rappeler. Ainsi, la connaissance de ce risque est importante et elle nécessite d’être mise à jour. Ceci permettra d’améliorer la gestion de crise lorsque survient une inondation, d’informer les citoyens mais également d’adapter l’urbanisation afin d’augmenter la résistance et la résilience des territoires confrontés à ce risque. C’est pourquoi, conformément à l’article L.562-1 du code de l’environnement, l’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) tels que les inondations. Le PPR permet d’intégrer la connaissance des risques naturels dans l’aménagement du territoire. Il définit des mesures pour réduire l’impact de phénomènes prévisibles sur les personnes et les biens. Les plans de prévention des risques naturels ont valeur de servitude d’utilité publique et sont annexés aux plans d’urbanisme (PLU). Ils sont prescrits et élaborés par l’État en association avec les communes et en concertation avec les populations. Conformément à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2020, prescrivant la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du bassin des Paillons – secteur amont, sur les communes de Blausasc, Cantaron, Contes, Drap, l’Escarène, Peille, Peillon, l’élaboration du projet de révision de ce plan fera l’objet d’une concertation avec la population des communes concernées. Au fur et à mesure de l’avancement de l’élaboration du dossier de PPR inondation, le public pourra prendre connaissance des documents réalisés. -

Horaires-2019-TER-.Pdf
5 NICE ➜ BREIL ➜ CUNEO Horaires donnés sous réserve de modification. Consultez régulièrement les mises à jour sur le site TER PACA, sur HORAIRES valables DU 09 DÉCEMBRE 2018 AU 14 DÉCEMBRE 2019 l’appli SNCF ou via contact TER au 0 800 11 40 23. N’oubliez pas de vous reporter aux renvois sous la grille horaire. L à V TLJ TLJ TLJ TLJ TLJ TLJ L à V TLJ L à V TLJ TLJ TLJ 1 2 2 2 TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER Ventimiglia (D) 10.37 18.37 Nice-Ville (D) 05.48 07.30 08.33 09.17 - 12.24 14.55 16.43 17.13 18.02 - 18.59 19.41 Nice Pont Michel 05.54 07.35 08.39 09.23 - 12.29 15.00 16.48 17.18 18.08 - 19.04 19.46 L'Ariane-la-Trinité 05.58 07.38 08.43 - - 12.33 15.04 16.52 17.22 18.13 - 19.09 19.50 La Trinité-Victor 06.01 07.41 08.46 09.28 - 12.36 15.07 16.55 17.25 18.16 - 19.12 19.53 Drap-Cantaron 06.05 07.45 08.50 09.32 - 12.40 15.11 16.59 17.29 18.21 - 19.16 19.57 Fontanil-Lycée de Drap 06.09 07.49 08.55 09.36 - 12.44 15.15 17.03 17.33 18.26 - 19.21 20.01 Peillon-Ste-Thècle 06.13 07.54 9.00 09.40 - 12.48 15.19 17.07 17.37 18.31 - 19.26 20.04 Peille 06.19 08.00 09.06 09.46 - 12.53 15.24 17.12 17.43 18.38 - 19.34 20.10 L'Escarène 06.41 08.10 09.19 09.57 - 13.04 15.35 17.23 17.54 18.53 - 19.52 20.20 Touët-de-l'Escarène 06.45 08.14 09.23 10.01 - 13.08 15.39 17.27 17.58 18.57 - 19.56 20.24 Sospel 6.58 08.25 09.35 10.12 - 13.19 15.51 17.38 18.12 19.08 - 20.08 20.36 Breil-sur-Roya (A) 07.10 08.37 09.47 10.24 11.08 13.32 16.03 17.50 18.24 19.20 19.08 20.20 20.49 Breil-sur-Roya (D) 08.42 10.29 11.09 13.36 16.08 19.17 Fontan-Saorge 08.57 10.44 11.22 13.51 16.25 19.30 St-Dalmas-de-Tende 09.20 11.07 11.44 14.14 16.48 19.52 La Brigue 09.30 11.15 11.52 14.22 16.56 20.00 Tende 09.39 11.24 12.01 14.31 17.04 20.09 Vievola 12.17 20.25 Limone 12.32 20.40 Vernante 12.42 20.50 Robilante 12.49 20.57 Roccavione 12.54 21.02 Borgo-S.-Dalmazzo 13.01 21.05 Cuneo 13.11 21.15 numéro de circulation 881301 22941 881307 22945 22970 22947 22953 881313 881315 881319 22982 881323 881327 (A) Heure d’arrivée. -

Lutte Contre Le Frelon Asiatique
Instauré en 2015 dans le but de préserver les populations de ruchers d’abeilles des attaques de Vespa Velutina Nigrithorax (frelons asiatiques), le dispositif de lutte porté par le Département s’adresseprioritairement aux apiculteurs. Dans un cadre plus élargi, il est mis à la disposition de l’ensemble de la population des Alpes-Maritimes. En effet, les particuliers et les responsables de collectivités locales apportent également leurcontribution citoyenne dans cette lutte. Dans un souci d’efficacité, les services départementaux s’attachent à faire évoluer les procédures de signalements que vous pourrez découvrir lors de la future campagne annuelle. Il s’agit en effet de tout mettre en oeuvre pour limiter les ravages engendrés par cette espèce invasive de catégorie 2 sur les acteurs Comment Ne confondez pas principaux de la pollinisation, étape essentielle à la préservation de reconnaître le frelon asiatique la biodiversité. le frelon asiatique ? avec : Lors de la campagne 2018, la prise en compte de 1624 • Taille : 3 cm (plus petit que signalements a abouti à la destruction de 724 nids (primaires Le frelon européen le frelon européen) • Taille : 4 cm environ et adultes) effectuées par l’intermédiaire de nos prestataires en • Tête orange, front noir, charge de cette mission. • Abdomen à dominante jaune pattes jaunes clair avec bandes noires Grâce à la qualité de leur professionnalisme allié au sens du service • Thorax entièrement brun noir • Thorax et pattes noirs public, le département s’assure d’une solide collaboration à travers • Fine bande jaune sur abdomen et brun-rouge eux, au service de l’ensemble de la population.