Alain De Benoist
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reactionary Postmodernism? Neoliberalism, Multiculturalism, the Internet, and the Ideology of the New Far Right in Germany
University of Vermont ScholarWorks @ UVM UVM Honors College Senior Theses Undergraduate Theses 2018 Reactionary Postmodernism? Neoliberalism, Multiculturalism, the Internet, and the Ideology of the New Far Right in Germany William Peter Fitz University of Vermont Follow this and additional works at: https://scholarworks.uvm.edu/hcoltheses Recommended Citation Fitz, William Peter, "Reactionary Postmodernism? Neoliberalism, Multiculturalism, the Internet, and the Ideology of the New Far Right in Germany" (2018). UVM Honors College Senior Theses. 275. https://scholarworks.uvm.edu/hcoltheses/275 This Honors College Thesis is brought to you for free and open access by the Undergraduate Theses at ScholarWorks @ UVM. It has been accepted for inclusion in UVM Honors College Senior Theses by an authorized administrator of ScholarWorks @ UVM. For more information, please contact [email protected]. REACTIONARY POSTMODERNISM? NEOLIBERALISM, MULTICULTURALISM, THE INTERNET, AND THE IDEOLOGY OF THE NEW FAR RIGHT IN GERMANY A Thesis Presented by William Peter Fitz to The Faculty of the College of Arts and Sciences of The University of Vermont In Partial Fulfilment of the Requirements For the Degree of Bachelor of Arts In European Studies with Honors December 2018 Defense Date: December 4th, 2018 Thesis Committee: Alan E. Steinweis, Ph.D., Advisor Susanna Schrafstetter, Ph.D., Chairperson Adriana Borra, M.A. Table of Contents Introduction 1 Chapter One: Neoliberalism and Xenophobia 17 Chapter Two: Multiculturalism and Cultural Identity 52 Chapter Three: The Philosophy of the New Right 84 Chapter Four: The Internet and Meme Warfare 116 Conclusion 149 Bibliography 166 1 “Perhaps one will view the rise of the Alternative for Germany in the foreseeable future as inevitable, as a portent for major changes, one that is as necessary as it was predictable. -
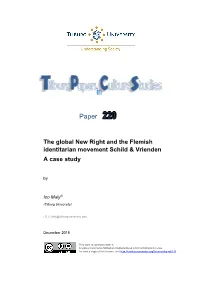
The Global New Right and the Flemish Identitarian Movement Schild & Vrienden a Case Study
Paper The global New Right and the Flemish identitarian movement Schild & Vrienden A case study by Ico Maly© (Tilburg University) [email protected] December 2018 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ The global New Right and the Flemish identitarian movement Schild & Vrienden. A case study. Ico Maly Abstract: This paper argues that nationalism, and nationalistic activism in particular are being globalized. At least certain fringes of radical nationalist activists are organized as ‘cellular systems’ connected and mobilize-able on a global scale giving birth to what I call ‘global nationalistic activism’. Given this change in nationalist activism, I claim that we should abandon all ‘methodological nationalism’. Methodological nationalism fails in arriving at a thorough understanding of the impact, scale and mobilization power (Tilly, 1974) of contemorary ‘national(istic)’ political activism. Even more, it inevitably will contribute to the naturalization or in emic terms the meta-political goals of global nationalist activists. The paradox is of course evident: global nationalism uses the scale- advantages, network effects and the benefits of cellular structures to fight for the (re)construction of the old 19th century vertebrate system par excellence: the (blood and soil) nation. Nevertheless, this, I will show, is an indisputable empirical reality: the many local nationalistic battles are more and more embedded in globally operating digital infrastructures mobilizing militants from all corners of the world for nationalist causes at home. Nationalist activism in the 21st century, so goes my argument, has important global dimensions which are easily repatriated for national use. -

La Nouvelle Droite, Ses Pompes Et Ses Œuvres D’Europe Action (1963) À La NRH (2002)
La Nouvelle Droite, ses pompes et ses œuvres D’Europe Action (1963) à la NRH (2002) par Geoffroy Daubuis Après avoir bénéficié d’une forte publicité dans les années 1978- 1985, la mouvance néopaïenne dite « Nouvelle Droite » peut sembler aujourd’hui passée de mode. En réalité, son influence perdure, tant dans les milieux universitaires que dans les milieux nationalistes. Depuis une dizaine d’années, c’est principalement par les publica- tions d’histoire que la Nouvelle Droite atteint le grand public. Geoffroy Daubuis présente ici un historique de cette mouvance, en trois de ses aspects : I. La revue Europe Action, qui est à l’origine de la Nouvelle Droite. II. Le GRECE, qui en est le noyau dur depuis 1968. III. La NRH (Nouvelle Revue d’Histoire) qui assure depuis 2002 une diffusion « douce » de ses idées. Le Sel de la terre. — I — A l’origine de la Nouvelle Droite : Europe Action A GÉNÉRATION SPONTANÉE n’existe pas plus dans l’ordre intellec- tuel que dans l’ordre physique, et l’on pourrait remonter fort loin pour L établir la généalogie de la Nouvelle Droite. Peut-être faudrait-il revenir à Celse et Porphyre, les polémistes païens de l’Antiquité, dont les attaques anti- chrétiennes préfigurent toutes celles qui viendront par la suite 1. Nous nous contenterons ici de remonter à la fondation d’Europe Action, en 1962-1963, dont les meneurs (Dominique Venner, Alain de Benoist 2, Jean Mabire, 1 — Sur Celse et Porphyre, voir le maître-ouvrage de Pierre DE LABRIOLLE, La Réaction païenne, étude sur la polémique antichrétienne du Ier au VIe siècle, Paris, Cerf, 2005. -

Rechtsextreme Ideologien Rhetorische Textanalysen Als Weg Zur Erschließung Rechtsradikalen Und Rechtsextremistischen Schriftmaterials
RolfBachem Rechtsextreme Ideologien Rhetorische Textanalysen als Weg zur Erschließung rechtsradikalen und rechtsextremistischen Schriftmaterials 44 Rech ts extreme Ideologien Rhetorische Textanalysen BKA Redaktion: Heinrich Schielke Bundeskriminalamt Kriminalistisches Institut ISSN 0174-5433 Nachdruck und Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe und mit Genehmigung des 13undeskriminalamts Gesamtherstellung: DruckVerlag Kettler GmbH, Bönen Rolf Bachern Rechtsextreme Ideologien Rhetorische Textanalysen als Weg zur Erschließung rechtsradikalen und rechtsextremistischen Schriftmaterials Bundeskrirninalarnt Wiesbaden 1999 BKA - Forschungsreihe herausgegeben vom Bundeskriminalamt Kriminalistisches Institut Band 44 Beirat: Prot. Dr. Hans-Jürgen Kerner Direktor des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen Wolfgang Sielatt Leiter des Landeskriminalamts Hamburg Prof. Dr. Dr. h. c. mulf. Klaus Tieäemann Direktor des Instituts für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht der Universität Freiburg i. Sr. Klaus Jürgen Timm Direktor des Hessischen Landeskriminalarnts Vorwort Rechtsextremisten verbreiten ihre Ideologie nicht mehr nur mit traditionellen Mitteln wie Plakaten, Flugblättern, Aufklebern, Broschüren und Büchern. Die modeme Informationstechnologie hat ihnen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten eröffnet. Massenhaft werden zum Beispiel Tonträger mit rassistischen Inhalten (vorwiegend im Ausland) produziert und verbreitet, Mailboxen oder das Internet für Propaganda, Agitation, den Austausch von Nachrichten und zur Verabredung -
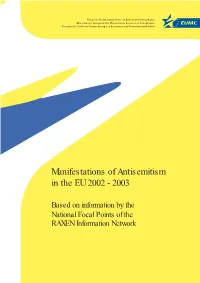
Manifestations of Antisemitism in the EU 2002 - 2003
Manifestations of Antisemitism in the EU 2002 - 2003 Based on information by the National Focal Points of the RAXEN Information Network Manifestations of Antisemitism in the EU 2002 – 2003 Based on information by the National Focal Points of the EUMC - RAXEN Information Network EUMC - Manifestations of Antisemitism in the EU 2002 - 2003 2 EUMC – Manifestations of Antisemitism in the EU 2002 – 2003 Foreword Following concerns from many quarters over what seemed to be a serious increase in acts of antisemitism in some parts of Europe, especially in March/April 2002, the EUMC asked the 15 National Focal Points of its Racism and Xenophobia Network (RAXEN) to direct a special focus on antisemitism in its data collection activities. This comprehensive report is one of the outcomes of that initiative. It represents the first time in the EU that data on antisemitism has been collected systematically, using common guidelines for each Member State. The national reports delivered by the RAXEN network provide an overview of incidents of antisemitism, the political, academic and media reactions to it, information from public opinion polls and attitude surveys, and examples of good practice to combat antisemitism, from information available in the years 2002 – 2003. On receipt of these national reports, the EUMC then asked an independent scholar, Dr Alexander Pollak, to make an evaluation of the quality and availability of this data on antisemitism in each country, and identify problem areas and gaps. The country-by-country information provided by the 15 National Focal Points, and the analysis by Dr Pollak, form Chapter 1 and Chapter 2 of this report respectively. -

Media & Migration
RVI ADVISORY BRIEFS Sophia Kluge Media & Migration 2 Resonant Voices Initiative Advisory Briefs Media and Migration Sophia Kluge Introduction Since 2015, the refugee debate has increasingly brought the topic of flight and migration into the media spotlight. Migration is a contested, emotionally charged, and high- ly politicised subject over which audiences in Europe are greatly polarised. The right-wing media in particular, have used the debate to criticise European migration policy. But how do these right-wing outlets contribute to the percep- tion of refugees and migrants among their readers and how do they influence the public discussion? Words hold great power and the choice of terms the me- dia use when referring to migrants and refugees not only often encodes author’s and outlet’s political views, but in turn influences how other people perceive migration and its associated implications for the society as a whole. An experiment at Stanford University conducted by psy- chologist Lera Boroditsky in 2011, explored how metaphors influence people’s reasoning about complex issues.1 She presented two groups of test subjects with a short report discussing the rapidly increasing crime rate in a fictional American city. Afterwards, people participating in the test were tasked with working out solutions to the problem. Both groups read texts that were almost identical, with only one difference. One described crime in the city as a virus, the other one compared it to a beast. Participants who read the text using the virus metaphor, presented mainly preven- tive solutions and pleaded for educational programs and poverty reduction to address rising crime rates. -

Jean-Claude Jacquard, Präsident Des GRECE, Über Die
Jean-Claude Jacquard, Präsident des GRECE, über die intellektuelle Debatte in Frankreich "Wir wollen Einfluß auf die Kultur" JUNGE FREIHEIT | 7 novembre 1997 | von Dieter Stein /Hans B. von Sothen JUNGE FREIHEIT : Der GRECE wurde 1968 vor allem von Studenten gegründet. War das ein Gegenprojekt zu der damaligen linken Studentenbewegung? JACQUARD: Es war vor allem eine Analyse der Situation, die unter Beweis stellte, daß man die damaligen Probleme nicht allein mit politischen Mitteln angreifen konnte, sondern sie metapolisch lösen mußte: man mußte die Frage des kulturellen Vorfelds der Politik mit einbeziehen. JUNGE FREIHEIT : Wie kam es, daß diese Gründung jenseits der traditionellen Rechten stattfand? JACQUARD : Die alte Rechte hatte keine Antworten auf die Fragen der Zeit. Der GRECE glaubte und glaubt noch immer, daß der kulturelle Kampf, der Kampf der Ideen das Wichtigste ist. Auf einem rein politischen Weg kann man die anstehenden Probleme nicht lösen. JUNGE FREIHEIT : Was ist das Hauptziel Ihrer Organisation? JACQUARD : Die direkte politische Aktion liegt etwas außerhalb unseres Betätigungsfeldes. Was wir hauptsächlich wollen, ist, Einfluß zu gewinnen auf die bestehende Kultur; wir wollen die Ideen in eine bestimmte Richtung lenken, ohne selbst politisch aktiv zu werden, und zwar auf der Grundlage dessen, was wir veröffentlichen und was wir sagen. Für solche kulturellen Umwälzungen im politischen Vorfeld gibt es historische Beispiele. Die französische Revolution etwa läßt sich nicht denken ohne die vorhergehende ideologische Arbeit, die ihr den Weg bereitet hat. Die Aufklärung hatte in diesem Falle die ideologische Vorarbeit geleistet und die Revolution ist nach ihr gekommen. JUNGE FREIHEIT : Anfang der 80er Jahre sprach man von einem bedeutenden Einfluß der "Nouvelle Droite" auf die intellektuelle Debatte in Frankreich. -

Glossaire D'articles.Pdf
A ABATTAGE RITUEL : n°53, p.7, Cousinage, Front monothéiste. ABBE PIERRE : n°31, p.42, Pierre VIAL, Saint abbé Pierre ? ABEILLE n°11, p.7, Nos sœurs les abeilles. ABKHAZIE : n°37, pp.43 à 52, Jean-Patrick ARTEAULT, Comprendre le conflit entre Russie et Géorgie. n°41, pp.36 à 48, Alain CAGNAT, Géorgie 2009, Etat des lieux. ABRAMOVITCH Roman : n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques. ABROMAVICIUS Aivaras : n°70, pp. 35 à 38, Thierry THODINOR, L'Ukraine ou le capitalisme du désastre made in USA. ACADEMIE DES BEAUX ARTS: n°3, p.4, Eric DELCROIX, Le combat exemplaire de Claude Autant-Lara. ACCULTURATION : n°3, Arnaud MENU, La colonisation de l’Europe (Guillaume Faye). n°62, pp.33 à 35, Robert DRAGAN, Bretagne, l'identité difficile. n°69, pp.18-19, Pierre VIAL, Ces jeunes Européens qui se convertissent au culte du Djihad. Pourquoi ? n°72, pp. 25 à 32, Alain CAGNAT, Les années Europe Action de Dominique Venner à Jean Mabire. ACHARD Guy : n°49, p.50, La com’ au pouvoir (Guy Achard). ACTION DIRECTE : n°71, pp. 36 à 40, Roberto FIORINI, Georges Sorel, au-delà de la Raison ? ACTION FRANCAISE : n°71, pp. 47-49, Jean HAUDRY, Actualité de Maurras. ADG : n°32, p.15, Pierre VIAL, Pour saluer ADG. ADIMAD (Association amicale pour la Défense des Intérêts Moraux et matériels des Anciens détenus et exilés politiques de l’Algérie Française) : n°21, p.4, Fors l’Honneur (Claude Micheletti). n°22, p.40, Mémoire et chants d’Honneur (ADIMAD). -

Mise En Page 1
ALAIN DE BENOIST BIBLIOGRAPHIE 1960-2010 © Alain de Benoist, Paris 2009. ISBN: 978-2-9528321-4-4 EAN: 9782952832144 Association des Amis d’Alain de Benoist 48 boulevard de la Bastille 75012 Paris ALAIN DE BENOIST BIBLIOGRAPHIE 1960-2010 Livres • Articles • Préfaces • Contributions à des recueils collectifs • Entretiens • Littérature secondaire Avant-propos de Michel Marmin TABLE DES MATIÈRES MICHEL MARMIN : Avant-propos……………………………… 9 Note liminaire………………………………………………… 13 1 TEXTES PUBLIÉS PAR ALAIN DE BENOIST A. LIVRES …………………………………………………… 19 B. ARTICLES PARUS DANS DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES …… 75 C. PRÉFACES, POSTFACES, ANTHOLOGIES …………………… 301 D. CONTRIBUTIONS À DES RECUEILS COLLECTIFS ……………… 313 E. ENTRETIENS ……………………………………………… 341 F. T EXTES TRADUITS PAR ALAIN DE BENOIST ………………… 383 2 SUR ALAIN DE BENOIST ET LA NOUVELLE DROITE G. TRAVAUX UNIVERSITAIRES ………………………………… 393 H. LIVRES …………………………………………………… 403 I. ARTICLES CHOISIS ………………………………………… 417 J. SUR LES NOUVELLES DROITES EN EUROPE. ……………… 453 AVANT-PROPOS Une question se posera immédiatement à l’esprit du lecteur en se plongeant, c’est le mot, dans l’océanique bibliographie d’Alain de Benoist – bibliographie très provisoire d’ailleurs puisque, à 65 ans, il lui reste au moins deux bonnes décennies pour en dou- bler le volume! Comment fait-il? Je ne suis pas dans le secret de sa forge, mais un pre- mier souvenir me vient immédiatement à l’esprit. Je l’ai rencontré pour la première fois en 1971, mais ce n’est qu’en 1972 que j’ai eu un aperçu de sa méthode de travail. Dans un bureau de Valeurs actuelles, je l’ai surpris un jour en train de découper des bandelettes de papier sur lesquelles étaient écrites, à la machine à écrire, des phrases, des paragraphes, des citations, des notes, des références, tout cela rédigé en vrac, au hasard de ses recherches et de ses réflexions, en vue d’un article. -

Australian Nationalist Ideological, Historical, and Legal Archive
AUSTRALIAN NATIONALIST IDEOLOGICAL, HISTORICAL, AND LEGAL ARCHIVE www.alphalink.com.au/~radnat MISSION STATEMENT (as updated, August 24 2002): This Site is a document archive linked to other Australian Nationalist political and information sites. A few Australian authors are on-line. As further works are prepared for Internet publication, additional Australian authors shall appear here. This document archive shall: (i) Ground Australian Nationalism ideologically and historically; this task is related to the legitimacy of the cause as well as the discussion of its favoured political expressions and historical place and activism; providing an accurate analysis is vital in combatting the misrepresentation of Nationalist ideology and politics by its opponents in politics and the media. (ii) Answer (when appropriate) the State-liberal-political-police propaganda which attempts to delegitimize the Nationalist organizations by an assertion that they have operated, or do operate, in a criminal manner; this task shall be addressed by relevant exposé of various "legal processes" operated against Nationalist leaders and other patriotic identities in the past. This Archive shall be continually updated and maintained as a resource for the instruction of a new generation of Nationalist leaders and activists. Texts of a general relevancy to the development of Australian Nationalist ideology and politics will also be placed upon this site. This includes material drawn from the corpus of Euro-nationalist discourse. The Editors welcome that our attention is drawn to selective material. The Editors will permit some debate around the issue of ideological and political formation and shall not censor any reasonable view on any subject which advances this objective. -

Scarica Il Numero Completo
Il Pensiero Storico Rivista internazionale di storia delle idee Fondata da Antonio Messina 8 dicembre 2020 . la causa della difficoltà della ricerca della verità non sta nelle cose, ma in noi. Infatti, come gli occhi delle nottole si comportano nei confronti della luce del giorno, così anche l’intelligenza che è nella nostra anima si comporta nei confronti delle cose che, per natura loro, sono le più evidenti di tutte. Aristotele, Metafisica, II Il focus della rivista è la ricostruzione della nascita, dell’espressione e dell’evoluzio- ne delle idee umane e del modo in cui sono state prodotte, trasmesse e trasformate attraverso la storia, nonché dell’influenza da esse esercitata sulla storia stessa. In tal senso, si pone in rilievo la duplice e dinamica valenza delle grandi forme di concettualizzazione: da un lato prodotti di contesti storici, dall’altro profondi crea- tori dei mutamenti e degli avvenimenti che hanno costellato il corso del tempo. Considerato il carattere strutturalmente transdisciplinare, pluridisciplinare e multi- disciplinare della materia, la rivista include anche contributi di storia della filosofia, del pensiero politico, della letteratura e delle arti, delle religioni, delle scienze naturali e sociali, ponendone in rilievo la marcata interconnessione. Il « Pensiero Storico » incentiva l’internazionalità della ricerca, attraverso la costituzione di un comitato scientifico internazionale, e pubblica interventi in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola e portoghese. Tutti i contenuti sono sottoposti a double blind peer review e sono promossi e condivisi gratuitamente in formato digitale attraverso la rete (open access), mentre il formato cartaceo è edito da Aracne editrice a partire dal 2019. -

Götz Kubitschek Provokation Pdf
Götz kubitschek provokation pdf Continue Goetz Kubicek ist ein deutscher Verleger, Publizist und Politiker. Kubicek, mitglied der Gruppe Junge Freiheit, ist Mitbegründer des neuen rechten Think Tanks Institute for Public Policy (IFS). Seit 2002 ist er Geschäftsführer des heute ansässigen Antaios Verlags (bis 2012 Edition Antaios), seit 2003 verantwortet er auch das Secession-Magazin und den Blog-Betreiber Sezession on the Net, der später hinzugefügt wurde. Er initiierte mehrere politische Kampagnen, wie die Konservativ-Subversive Aktion (KSA) und Ein Prozent für unser Land, und war verantwortlich für die inhaltliche Basis der rechtsextremistischen Identitätsbewegung (IB) in Deutschland. 2015 war er Hauptredner bei Pegida-Demonstrationen in Sachsen. Er unterstützt auch einen engen Austausch mit Vertretern des ehemaligen AfD-Flügels, wie Bjorn Hhocke. Leben Kubicek wurde im oberschwäbischen Ravensburg geboren. Nach dem Abitur 1990 absolvierte er den Wehrdienst bei der Fernsp'hekompanie 200 in Weingarten. Von 1992 bis 1999 studierte er Germanistik, Geographie und Philosophie an der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover und an der Universität Ruprecht-Karls-Heidelberg in deutscher Sprache, Geographie und Philosophie (Dissertation über Friedrich Georg Younger). Wie seine späteren Weggefährten Dieter Stein (Gründer der Jungen Freiheit) und Karlheinz Weimann vor ihm wurde er Mitglied der Deutschen Zunftgesellschaft (DG). Von 1996 bis 2002 war er zweiter Vorsitzender und Sprecher der Aktivisten. Nach eigenen Angaben (2003) trat er später