Quelle Stratégie ? Groupe SNCF
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

List of Numeric Codes for Railway Companies (RICS Code) Contact : [email protected]
List of numeric codes for railway companies (RICS Code) contact : [email protected] reference : http://www.uic.org/rics code short name full name country request date allocation date modifieddate beginvalidityof validityendof recent Freight Passenger Infra- structure Holding Integrated Other url 0006 StL Holland Stena Line Holland BV NL 01/07/2004 01/07/2004 x http://www.stenaline.nl/ferry/ 0010 VR VR-Yhtymä Oy FI 30/06/1999 30/06/1999 x http://www.vr.fi/ 0012 TRFSA Transfesa ES 30/06/1999 30/06/1999 04/10/2016 x http://www.transfesa.com/ 0013 OSJD OSJD PL 12/07/2000 12/07/2000 x http://osjd.org/ 0014 CWL Compagnie des Wagons-Lits FR 30/06/1999 30/06/1999 x http://www.cwl-services.com/ 0015 RMF Rail Manche Finance GB 30/06/1999 30/06/1999 x http://www.rmf.co.uk/ 0016 RD RAILDATA CH 30/06/1999 30/06/1999 x http://www.raildata.coop/ 0017 ENS European Night Services Ltd GB 30/06/1999 30/06/1999 x 0018 THI Factory THI Factory SA BE 06/05/2005 06/05/2005 01/12/2014 x http://www.thalys.com/ 0019 Eurostar I Eurostar International Limited GB 30/06/1999 30/06/1999 x http://www.eurostar.com/ 0020 OAO RZD Joint Stock Company 'Russian Railways' RU 30/06/1999 30/06/1999 x http://rzd.ru/ 0021 BC Belarusian Railways BY 11/09/2003 24/11/2004 x http://www.rw.by/ 0022 UZ Ukrainski Zaliznytsi UA 15/01/2004 15/01/2004 x http://uz.gov.ua/ 0023 CFM Calea Ferată din Moldova MD 30/06/1999 30/06/1999 x http://railway.md/ 0024 LG AB 'Lietuvos geležinkeliai' LT 28/09/2004 24/11/2004 x http://www.litrail.lt/ 0025 LDZ Latvijas dzelzceļš LV 19/10/2004 24/11/2004 x http://www.ldz.lv/ 0026 EVR Aktsiaselts Eesti Raudtee EE 30/06/1999 30/06/1999 x http://www.evr.ee/ 0027 KTZ Kazakhstan Temir Zholy KZ 17/05/2004 17/05/2004 x http://www.railway.ge/ 0028 GR Sakartvelos Rkinigza GE 30/06/1999 30/06/1999 x http://railway.ge/ 0029 UTI Uzbekistan Temir Yullari UZ 17/05/2004 17/05/2004 x http://www.uzrailway.uz/ 0030 ZC Railways of D.P.R.K. -

General Court of the European Union PRESS RELEASE No 5/15 Luxembourg, 15 January 2015
General Court of the European Union PRESS RELEASE No 5/15 Luxembourg, 15 January 2015 Judgment in Case T-1/12 Press and Information France v European Commission The General Court confirms that the aid granted by the SNCF to SeaFrance is incompatible with the internal market SeaFrance, now wound up, was a French public limited company that was indirectly 100% owned by the French public entity the SNCF. It operated maritime passenger and freight transport services between the ports of Calais and Dover. In 2009, SeaFrance owned six vessels and employed 1 550 staff. From 2008, SeaFrance’s financial situation systematically deteriorated owing to unfavourable conditions, internal difficulties and industrial action. The SNCF therefore set up a credit line in favour of SeaFrance. That rescue aid was approved by the Commission on 18 August 2010.1 The French authorities subsequently notified the Commission of a restructuring aid package in favour of SeaFrance along with a restructuring plan. That restructuring was to be financed mainly by State aid in the form of a recapitalisation of SeaFrance in the amount of €223 million. Following a complaint of a competitor of SeaFrance, the French authorities communicated, at the end of 2011, a modified restructuring plan: the recapitalisation of SeaFrance was now to be limited to €166.3 million and to be accompanied by two loans granted by the SNCF. The first loan, of €99.7 million, was intended to finance the restructuring, while the second loan sought to replace a loan pertaining to one of the vessels of the fleet. By decision of 24 October 2011,2 the Commission found that the rescue aid agreed in 2010 and the restructuring measures set out in the 2011 plan (recapitalisation and loans) constituted State aid incompatible with the internal market. -

Transport Research Market Uptake (Market-Up) Deliverable: D 2.1
Project ID: 265841 Transport Research Market Uptake (Market-up) Deliverable: D 2.1 Characterisation of the context of RTD initiatives per sectoral area Lead partner: UNIZA Consortium: Project co-funded by the European Commission TIS (PORTUGAL) - Co-ordinator within the Seventh Framework Programme CLEPA (BELGIUM) EMEC (BELGIUM) FRAUNHOFER (GERMANY) BME (HUNGARY) INOVA+ (PORTUGAL) UNIZA (SLOVAKIA) UA (BELGIUM) INNOVA (ITALY) Due Date of Deliverable: October 2011 Start Date of Project: 1 October 2010 Completion Date of Deliverable: December 2011 Duration: 24 Months Dissemination Level PU Public X PP Restricted to other programme participants (including the Commission Services) RE Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission Services) CO Confidential, only for members of the consortium (including the Commission Services) Market-up D2.1: Characterisation of the context of RTD initiatives per sectoral area Foreword This report, FP7 Market-up project Deliverable 2.1, was prepared by the team at UNIZA with contributions from all members of the project consortium. The key data concerning Member States was collected by the Market-up team and provided to Transport NCP‟s for validation purposes. Market-up team is particularly thankful to the NCPs from Denmark, Austria, Latvia, Portugal, Slovakia, France and Lithuania for their contribution in the review of our findings. Opinions on main findings on barriers and particularly those faced by the transport SMEs were discussed with Technological Platforms during data collection and specific discussion topics have circulated and feedback asked for. Main findings from D2.1 were also presented in the Review Workshop held on the 26th October in Brussels, which discussion helped to improve our analysis and to enrich the discussion on perspectives for innovation in the transport sector. -
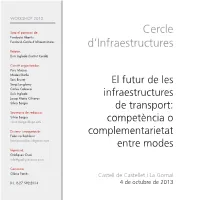
Workshop 2013 02-2
WORKSHOP 2013 Sota el patrocini de: Cercle Fundació Abertis Fundació Cercle d'Infraestructures d’Infraestructures Relator: Lluís Inglada (Institut Cerdà) Comitè organitzador: Pere Macias Modest Batlle Toni Brunet Sergi Loughney El futur de les Carles Cabrera Lluís Inglada infraestructures Josep Maria Oliveras Sílvia Borges de transport: Secretaria de redacció: Silvia Borges [email protected] competència o Disseny i maquetació: complementarietat Fabrizio Rodilossi [email protected] entre modes Impressió: Gràfiques Ossó [email protected] Correcció: Glòria Farrés Castell de Castellet i La Gornal D.L. B-27.592-2013 4 de octubre de 2013 El futur de les infraestructures de transport: competència o complementarietat entre modes a jornada de treball de les Fundacions Abertis i participació del director del Port de Barcelona, José Al- Cercle d'Infraestructures al Castell de Castellet berto Carbonell, de Jaume Bonavia, director d'Alfil Lo- de Foix es va dedicar, el 2013, a les relacions de gistics, i del director de Logística de BASF, José Curado. complementarietat i de competència entre mo- Com és habitual, en el Workshop van participar també Ldes de transport. alts dirigents de les administracions competents en in- Cal recordar que aquell any la crisi econòmica era espe- fraestructures i transports, el secretari general d’Infraes- cialment intensa, i que en el camp de les infraestructu- tructures del Ministeri de Foment, Manuel Niño, el se- res tots els indicadors d'activitat assenyalaven mínims. cretari general de Territori i Mobilitat de la Generalitat, En aquest context van voler presentar experiències que Ricard Font, i el Sr. Patrick Boeuf, responsable del sector poguessin assenyalar camins de sortida al sector. -

A RPL Through RDF: Expressive Navigation in RDF Graphs
A RPL through RDF: Expressive Navigation in RDF Graphs Harald Zauner1, Benedikt Linse1,2,TimFurche1,3, and François Bry1 1 Institute for Informatics, University of Munich, Oettingenstraße 67, 80538 München, Germany 2 Thomson Reuters, Landsberger Straße 191a, 80687 München, Germany 3 Oxford University Computing Laboratory, Wolfson Building, Parks Road, Oxford, OX1 3QD, England http://rpl.pms.ifi.lmu.de/ Abstract. RPL (pronounced “ripple”) is the most expressive path lan- guage for navigating in RDF graphs proposed to date that can still be evaluated with polynomial combined complexity. RPL is a lean language well-suited for integration into RDF rule languages. This integration en- ables a limited form of recursion for traversing RDF paths of unknown length at almost no additional cost over conjunctive triple patterns. We demonstrate the power, ease, and efficiency of RPL with two appli- cations on top of the RPL Web interface. The demonstrator implements RPL by transformation to extended nested regular expressions (NREs). For these extended NREs we have implemented an evaluation algorithm with polynomial data complexity. To the best of our knowledge, this demo is the first implementation of NREs (or similarly expressive RDF path languages) with this complexity. 1Motivation With the promise of exciting “new kinds of usage scenarios”, you finally got your boss at company C to embrace linked data and connect your community forum and contact database to other online communities and FOAF profiles of your contacts. Your boss now wants to put that technology to use: “I want to cooperate with X on topic Y ! Can you get me the name of any person that works at X and that’s connected to us via people that are also interested in Y (so that they have an interest in connecting us). -

Concurrence Et Transport
Concurrences REVUE DES DROITS DE LA CONCURRENCE | COMPETITION LAW REVIEW Concurrence et transport Conférence l Concurrences N° 4-2015 www.concurrences.com Jean-François Cordet Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais Lille Grégoire Marlot Directeur régulation Europe économie, SNCF Réseau, Paris Anne Yvrande-Billon Vice-présidente, Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), Paris Umberto Berkani Rapporteur général adjoint, Autorité de la concurrence, Paris Sylvain Justier Avocat associé, Magenta, Paris Jean-François Benevise Directeur régional, DIRECCTE du Nord-Pas-de-Calais, Lille Conférence Concurrence et transport Lille, 16 avril 2015 Institut Pasteur DISCOURS D’oUVERTURE DEUXIÈME PARTIE Jean-François Cordet Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais Lille Enjeux et problématiques du secteur du transport PREMIÈRE PARTIE au regard du droit Concurrence et de la concurrence régulation dans L’action de l’Autorité de la concurrence dans le secteur des transports Art. Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits Intellectuelle and DRM protection. L. 335-2 Code de la Propriété L 122-5 le secteur ferroviaire Umberto Berkani Rapporteur général adjoint, Autorité de la concurrence, Paris La concurrence dans le transport ferroviaire : Enjeux et problématique Complémentarité et interaction du droit Grégoire Marlot de la concurrence et du droit sectoriel Directeur régulation Europe économie, SNCF Réseau, Paris Sylvain Justier Avocat associé, Magenta, Paris Quelles perspectives d’ouverture à la concurrence du marché du transport ferroviaire en France ? Anne Yvrande-Billon DISCOURS DE CLÔTURE Jean-François Benevise Vice-présidente, Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), Paris Directeur régional, DIRECCTE du Nord-Pas-de-Calais, Lille Concurrences + www.concurrences.com The papers of this conference délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. -

Reference List Ferries and River Cruise Vessels
REFERENCE LIST FERRIES AND RIVER CRUISE VESSELS DAMEN SHIPREPAIR & CONVERSION Member of the DAMEN SHIPYARDS GROUP Admiraal de Ruyterstraat 24 phone +31 (0)10 204 12 22 [email protected] 3115 HB Schiedam fax +31 (0)10 473 25 77 www.damenshiprepair.com P.O. Box 22 311 AA Schiedam The Netherlands VESSEL CUSTOMER COUNTRY TYPE OF WORK YEAR VESSEL CUSTOMER COUNTRY TYPE OF WORK YEAR BERLIOZ MyFerryLink France Docking 2015 COUTANCES Brittany Ferries BAI SA France Docking 2008 PONT AVEN Brittany Ferries BAI SA France Docking 2015 STENA BRITANNICA Stena Line UK Ltd. UK PROJ-Yard 2008 RODIN MyFerryLink France Docking 2015 PRIDE OF HULL P&O Ferries Limited UK PROJ-Port 2008 NORD PAS DE CALAIS MyFerryLink France Docking 2015 PRIDE OF ROTTERDAM P&O Ferries Limited UK PROJ-Port 2008 SPIRIT OF FRANCE P&O Ferries Limited UK Docking 2015 KING OF SCANDINAVIA Cedervall & Söner Ab SWEDEN PROJ-VERT 2008 PRIDE OF BURGUNDY P&O Ferries Limited UK Docking 2015 STENA PARTNER Stena Line B.V The Netherlands PROJ-Yard 2008 PRIDE OF KENT P&O Ferries Limited UK Docking 2015 PRIDE OF ROTTERDAM P&O North Sea Ferries B.V. The Netherlands PROJ-Port 2008 PRIDE OF CUTERBURY P&O Ferries Limited UK Docking 2014 PRIDE OF HULL P&O Ferries Limited UK PROJ-Port 2008 SVEN SISTERS DFDS France Afloat repair 2014 STENA TRANSFER Stena Line UK Ltd. UK PROJ-Yard 2008 EUROPEAN SEAWAYS P&O Ferries Limited UK Docking 2014 STENA PARTNER Stena Line B.V The Netherlands PROJ-Yard 2008 DIEPPE SEAWAYS DFDS UK Docking 2014 STENA TRANSPORTER Stena Line UK Ltd. -

Management Report 2012
Management Report 2012 Société anonyme with share capital of 300,219,278 euros Registered offIce: 2, rue Robert Esnault-Pelterie, 75007 Paris Mailing address: 10-14, rue de Rome, 93290 Tremblay-en-France Paris Trade and Company Register: 552,043,002 1 Contents Page 1 CORPORATE GOVERNANCE .................................................................................................................. 3 1.1 The Board of Directors ............................................................................................................................ 3 1.2 The CEO Committee ............................................................................................................................ 36 1.3 The Group Executive Committee .......................................................................................................... 36 1.4 Share capital and shareholder structure ............................................................................................... 39 2 ACTIVITY ................................................................................................................................................. 44 2.1 Highlights of the 2012 financial year ..................................................................................................... 44 2.2 Market and environment ....................................................................................................................... 46 2.3 Strategy ................................................................................................................................................ -

1St Edition, Dezember 2010
EUROPEAN RAILWAY AGENCY INTEROPERABILITY UNIT DIRECTORY OF PASSENGER CODE LISTS FOR THE ERA TECHNICAL DOCUMENTS USED IN TAP TSI REFERENCE: ERA/TD/2009-14/INT DOCUMENT REFERENCE FILE TYPE: VERSION: 1.1.1 FINAL TAP TSI DATE: 08.03.2012 PAGE 1 OF 77 European Railway Agency ERA/TD/2009-14/INT: PASSENGER CODE LIST TO TAP TSI AMENDMENT RECORD Version Date Section Modification/description number 1.1 05.05.2011 All sections First release 1.1.1 27.09.2011 Code list New values added B.4.7009, code list B.5.308 ERA_TAP_Passenger_Code_List.doc Version 1.1.1 FINAL Page 2/77 European Railway Agency ERA/TD/2009-14/INT: PASSENGER CODE LIST TO TAP TSI Introduction The present document belongs to the set of Technical Documents described in Annex III „List of Technical Documents referenced in this TSI‟ of the COMMISSION REGULATION (EU) No 454/2011. ERA_TAP_Passenger_Code_List.doc Version 1.1.1 FINAL Page 3/77 European Railway Agency ERA/TD/2009-14/INT: PASSENGER CODE LIST TO TAP TSI Code List ERA_TAP_Passenger_Code_List.doc Version 1.1.1 FINAL Page 4/77 European Railway Agency ERA/TD/2009-14/INT: PASSENGER CODE LIST TO TAP TSI Application : With effect from 08 March 2012. All actors of the European Union falling under the provisions of the TAP TSI. ERA_TAP_Passenger_Code_List.doc Version 1.1.1 FINAL Page 5/77 European Railway Agency ERA/TD/2009-14/INT: PASSENGER CODE LIST TO TAP TSI Contents AMENDMENT RECORD ....................................................................................................................................................... -
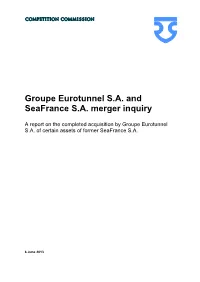
Groupe Eurotunnel S.A. and Seafrance S.A. Merger Report
Groupe Eurotunnel S.A. and SeaFrance S.A. merger inquiry A report on the completed acquisition by Groupe Eurotunnel S.A. of certain assets of former SeaFrance S.A. 6 June 2013 Competition Commission 2013 Website: www.competition-commission.org.uk Members of the Competition Commission who conducted this inquiry Alasdair Smith (Chairman of the Group) Robin Aaronson Ivar Grey Malcolm Nicholson Chief Executive and Secretary of the Competition Commission David Saunders The Competition Commission has excluded from this published version of the final report information which the Inquiry Group considers should be excluded having regard to the three considerations set out in section 244 of the Enterprise Act 2002 (specified information: considerations relevant to disclosure). The omissions are indicated by []. Non-sensitive wording is also indicated in square brackets. iii Contents Page Summary .............................................................................................................................. 4 Findings ................................................................................................................................ 7 Appendices A Terms of reference and conduct of the inquiry B GET’s financials C Event analysis—freight and passenger cross-Channel ferry and tunnel services D Prices and volumes E Capacity and its utilization F Bundling of tunnel- and ferry-based services G Horizontal unilateral effects H Likelihood of entry I Analysis of GET’s corporate documents and board minutes J Assessment of the effect -

How to Get to Les Coches
Trompe l’oeil 16 & 17 Les Coches Getting to Les Coches The Montchavin – Les Coches web site has information on how to get to Les Coches. www.montchavin-lescoches.com/en/winter-montchavin/more-details/access- montchavin.html By plane: Chambery is the nearest airport to Les Coches with a transfer time of roughly 1hr 30mins. Geneva is roughly 2 hrs 15mins away. Grenoble and Lyon are both roughly 2hrs 30mins. Lyon tends to be the busiest airport, Chambery, and Grenoble the quietest. You have the option of budget and scheduled airlines. There are various companies on the internet offering ski transfers – search for ski transfers from your preferred airport. Alternatively you can arrange car hire from the airport. Make sure that they provide snow chains in the ski season. Do check the snow chains and make sure that you know how to fit them (and that they are the correct size) before you leave the airport. See also driving advice below. If you are travelling by car please ensure that you leave enough time to get to the airport on your return as the road off the mountain gets very busy in high season. On a bad day it can take nearly 2 hours to get to Moûtiers, a journey that normally only takes 30 - 40 minutes! It is also possible to get a local train from Chambery to the Alps – you can connect to Chambery by train from Lyon, Geneva and Grenoble. Visit www.raileurope.co.uk for information. Get the train to Bourg-St-Maurice or Landry and pre-book a taxi. -

1235/4/8/14, 1233/4/12/14 Groupe Eurotunnel S.A; the Société
Neutral citation [2015] CAT 1 Case Nos.: 1233/4/12/14 IN THE COMPETITION 1235/4/12/14 APPEAL TRIBUNAL Victoria House Bloomsbury Place 9 January 2015 London WC1A 2EB Before: THE HONOURABLE MR JUSTICE ROTH (Chairman) PROFESSOR JOHN BEATH JOANNE STUART OBE Sitting as a Tribunal in England and Wales BETWEEN: GROUPE EUROTUNNEL S.A. Applicant - v - COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY Respondent - and - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE PRODUCTION SEA FRANCE S.A. DFDS A/S Interveners AND BETWEEN: SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE PRODUCTION SEA FRANCE S.A. Applicant - v - COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY Respondent - and - GROUPE EUROTUNNEL S.A. DFDS A/S Interveners Heard at Victoria House on 24 and 25 November 2014 JUDGMENT APPEARANCES Mr. Richard Gordon Q.C. and Mr. Alistair Lindsay (instructed by Pinsent Masons LLP) appeared for Groupe Eurotunnel S.A., the Applicant in Case No. 1233/4/12/14 and an Intervener in Case No. 1235/4/12/14. Mr. Daniel Beard Q.C. and Mr. Rob Williams (instructed by Reynolds Porter Chamberlain LLP) appeared for the Société Coopérative de Production Sea France S.A., the Applicant in Case No. 1235/4/12/14 and an Intervener in Case No. 1233/4/12/14. Mr. Paul Harris Q.C., Mr. Ben Rayment and Mr. Thomas Sebastian (instructed by the Treasury Solicitor) appeared for the Competition and Markets Authority, the Respondent in both Cases. Mr. Meredith Pickford and Ms. Ligia Osepciu (instructed by Hogan Lovells LLP) appeared for DFDS A/S, an Intervener in both Cases. I. INTRODUCTION 1. This judgment concerns two applications brought under section 120 of the Enterprise Act 2002 (“the Act”)1 for judicial review of a decision of the Competition and Markets Authority (“the CMA”) in relation to the completed acquisition by Groupe Eurotunnel S.A.