Befeo 0336-1519 2010 Num 97 1 6128
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Violence and Predation, Mainly in the Form of Piracy, Were Two Of
violence and predation robert j. antony Violence and Predation on the Sino-Vietnamese Maritime Frontier, 1450–1850 iolence and predation, mainly in the form of piracy, were two of V the most persistent and pervasive features of the Sino-Vietnamese maritime frontier between the mid-fifteenth and mid-nineteenth cen- turies.1 In the Gulf of Tonkin, which is the focus of this article, piracy was, in fact, an intrinsic feature of this sea frontier and a dynamic and significant force in the region’s economic, social, and cultural devel- opment. My approach, what scholars call history from the bottom up, places pirates, not the state, at center stage, recognizing their impor- tance and agency as historical actors. My research is based on various types of written history, including Qing archives, the Veritable Records of Vietnam and China, local Chinese gazetteers, and travel accounts; I also bring in my own fieldwork in the gulf region conducted over the past six years. The article is divided into three sections: first, I discuss the geopolitical characteristics of this maritime frontier as a background to our understanding of piracy in the region; second, I consider the socio-cultural aspects of the gulf region, especially the underclass who engaged in clandestine activities as a part of their daily lives; and third, I analyze five specific episodes of piracy in the Gulf of Tonkin. The Gulf of Tonkin (often referred to here simply as the gulf), which is tucked away in the northwestern corner of the South China Sea, borders on Vietnam in the west and China in the north and east. -

Waves of Piracy in Late Imperial China
CHINA RESEARCH MONOGRAPH 56 FM, INSTITUTE OF EAST ASIAN STUDIES ~ \,.J UNIVERSITY OF CALIFORNIA • BERKELEY ccs CENTER FOR CHINESE STUDIES Like Froth Floating on the Sea The World of Pirates and Seafarers in Late Imperial South China Robert J. Antony A publication of the Institute of East Asian Studies, University of Califor nia, Berkeley. Although the Institute of East Asian Studies is responsible for the selection and acceptance of manuscripts in this series, responsibil ity for the opinions expressed and for the accuracy of statements rests with their authors. Correspondence and manuscripts may be sent to: Ms. Joanne Sandstrom, Managing Editor Institute of East Asian Studies University of California Berkeley, California 94720-2318 E-mail: [email protected] The China Research Monograph series is one of several publications series sponsored by the Institute of East Asian Studies in conjunction with its constituent units. The others include the Korea Research Monograph series, the Japan Research Monograph series, and the Research Papers and Policy Studies series. A list of recent publications appears at the back of the book. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Antony, Robert J. Like froth floating on the sea : the world of pirates and seafarers in late imperial south China I Robert J. Antony. p. em. - (China research monograph) Includes bibliographical references and index. ISBN 1-55729-078-4 (alk. paper) 1. Pirates-China, Southeast. 2. China, Southeast-Social conditions. 3. China-History-Ming dynasty, 1368-1655. 4. China-History-Qing dynasty, 1644-1912. I. Title. II. China research monographs ; no. 56. DS753.2 .A57 2003 910'.9164'72-dc21 2002192209 Copyright © 2003 by The Regents of the University of California. -
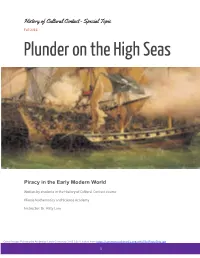
Plunder on the High Seas
History of Cultural Contact - Special Topic Fall 2016 Plunder on the High Seas Piracy in the Early Modern World Written by students in the History of Cultural Contact course Illinois Mathematics and Science Academy Instructor: Dr. Kitty Lam Cover Image: Painting by Ambroise-Louis Garneray (1783-1857), taken from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PirateShip.jpg 1 Table of Contents Introduction --------------------------------------------- 3 How is piracy defined? -------------------------------- 4-5 Who were pirates? -------------------------------------- 6-7 Where did pirates go? ---------------------------------- 8 What did pirates do? What did they want? -------- 9-10 What kind of social order did pirates form? ------- 11-12 Piracy: Official and Popular Perception ------------ 13 Endurance of Piracy ------------------------------------- 14-15 Glossary ---------------------------------------------------- 16 Bibliography and Additional Resources ------------ 17 2 Introduction By Angitha Bright, Jessica Hoos, and Angelica Villegas The word ‘piracy’ conjures infamous tales of adventures on the high sea. Often, piracy is associated with images of men screaming and ransacking ships, the look of unclean clothes and unhygienic skin, inherent violence and inherent treachery, the never-ending lust for riches - all the makings of uncivilized human beings. But the idea that all pirates fit this description is a misconception. Pirates tended to be more complex than that, and some even established special codes that denoted a social order and rules to be followed. In the Golden Age of pirates, from the 17th to 19th century, pirates ruled the seas and affected some major civilizations. Essentially, piracy was directly proportional to the proliferation of trade during that time period. But this was not necessarily for glory, violence, or chaos. Ultimately, a pirate’s goal was to get resources to live on. -
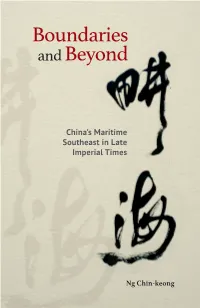
Boundaries Andbeyond
Spine width: 32.5 mm Ng Chin-keong Ng Ng Chin-keong brings together the work Throughout his career, Professor Ng of forty years of meticulous research Chin-keong has been a bold crosser on the manifold activities of the coastal Boundaries of borders, focusing on geographical Fujian and Guangdong peoples during boundaries, approaching them through the Ming and Qing dynasties. Since the one discipline after another, and cutting publication of his classic study, The Amoy and Beyond across the supposed dividing line Network on the China Coast, he has been between the “domestic” and the “foreign”. sing the concept of boundaries, physical and cultural, to understand the pursuing deeper historical questions Udevelopment of China’s maritime southeast in Late Imperial times, and He demonstrated his remarkable behind their trading achievements. In its interactions across maritime East Asia and the broader Asian Seas, these Boundaries versatility as a scholar in his classic the thirteen studies included here, he linked essays by a senior scholar in the field challenge the usual readings book, Trade and Society: The Amoy Network deals with many vital questions that help of Chinese history from the centre. After an opening essay which positions on the China Coast, 1683–1735, which China’s southeastern coast within a broader view of maritime Asia, the first us understand the nature of maritime explored agriculture, cities, migration, section of the book looks at boundaries, between “us” and “them”, Chinese China and he has added an essay that and other, during this period. The second section looks at the challenges and commerce. -

Chinese Sea Merchants and Pirates
Chinese Sea Merchants and Pirates 著者 Matsuura Akira journal or A Selection of Essays on Oriental Studies of publication title ICIS page range 63-84 year 2011-03-31 URL http://hdl.handle.net/10112/4345 Chinese Sea Merchants and Pirates MATSUURA Akira Key words: Chinese Sea, Sea Merchants, Pinates, Junks, East Asia Introduction: the course of research in Chinese maritime history Studies of global maritime history have frequently dealt with questions involving the Mediterranean and Atlantic, focusing on the history of Western Europe. However, there have been few studies dealing specifically with the waters surrounding East Asia. It would be fair to say that up until now historical studies looking at the seas lying within the area contained by the Chinese mainland, the Korean penin- sula, the Japanese archipelago, the Ryukyu Islands, Taiwan, the Philippine and Indonesian archipelagos, the Malay peninsula, and mainland Indochina, namely the Bohai, Yellow, East China and South China Seas, have been slow to appear. This is perhaps because existing studies of Chinese history have mostly taken a continental view of history, as Kawakatsu Heita points out in ‘Launching Maritime History’ (Kaiyō shikan no funade): ‘postwar Japanese have not had a view of history that takes account of the sea.’ It has been said that Chinese history emerged from the Yellow River basin. Although the importance of the culture of the Yangtze River basin has recently been acknowledged, the cultural activity of the maritime regions, with their broad coastline, has been neglected and for a long time has received little attention. As archaeological surveys of the coastal regions have progressed, the history of the maritime life of Chinese people living in coastal areas has gradually come to be re-thought. -

Bowl Round 13 Bowl Round 13 First Quarter
NHBB Nationals Bowl 2015-2016 Bowl Round 13 Bowl Round 13 First Quarter (1) One district in this city was dubbed \Electric Town" for its booming black market. Six island fortresses were built on the artificial island of Odaiba in this city, which may be reached through Rainbow Bridge. In 1960 in this city's Hibiya Hall, a nationalist stabbed a socialist politician on live TV; that hall is in this city's Chiyoda ward. For ten points, name this city where Frank Lloyd Wright's Imperial Hotel survived the 1923 Great Kanto earthquake. ANSWER: Tokyo (2) This sort of event is the subject of the \Saga of the Seven Suns" in the Pali Canon, in which it is associated with the Maitreya Buddha in a belief that inspired the White Lotus Rebellion. A battle between the forces of Necho II and King Josiah which led to the vassalization of Judah may have inspired one term for this type of event, as possibly did an earlier battle in which Thutmose III defeated the King of Kadesh at the same site. In 2011, Harold Camping planned for, for ten points, what oft-predicted eschatological event described in the Book of Revelation as \Armageddon"? ANSWER: End of the World (accept Armageddon before mentioned; accept Apocalypse; accept equivalent descriptions like the Last Days) (3) One candidate for the Democratic nomination in this election year was a New Jersey senator who had played for the New York Knicks. The South Carolina primary in this year was won by a \compassionate conservative." This election was the last in which the Green Party nominated Ralph Nader for president; he was accused of causing a spoiler effect in this year. -
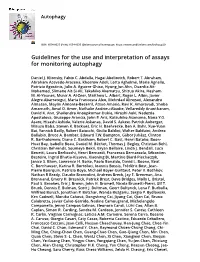
Guidelines for the Use and Interpretation of Assays for Monitoring Autophagy
Autophagy ISSN: 1554-8627 (Print) 1554-8635 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/kaup20 Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy Daniel J. Klionsky, Fabio C. Abdalla, Hagai Abeliovich, Robert T. Abraham, Abraham Acevedo-Arozena, Khosrow Adeli, Lotta Agholme, Maria Agnello, Patrizia Agostinis, Julio A. Aguirre-Ghiso, Hyung Jun Ahn, Ouardia Ait- Mohamed, Slimane Ait-Si-Ali, Takahiko Akematsu, Shizuo Akira, Hesham M. Al-Younes, Munir A. Al-Zeer, Matthew L. Albert, Roger L. Albin, Javier Alegre-Abarrategui, Maria Francesca Aleo, Mehrdad Alirezaei, Alexandru Almasan, Maylin Almonte-Becerril, Atsuo Amano, Ravi K. Amaravadi, Shoba Amarnath, Amal O. Amer, Nathalie Andrieu-Abadie, Vellareddy Anantharam, David K. Ann, Shailendra Anoopkumar-Dukie, Hiroshi Aoki, Nadezda Apostolova, Giuseppe Arancia, John P. Aris, Katsuhiko Asanuma, Nana Y.O. Asare, Hisashi Ashida, Valerie Askanas, David S. Askew, Patrick Auberger, Misuzu Baba, Steven K. Backues, Eric H. Baehrecke, Ben A. Bahr, Xue-Yuan Bai, Yannick Bailly, Robert Baiocchi, Giulia Baldini, Walter Balduini, Andrea Ballabio, Bruce A. Bamber, Edward T.W. Bampton, Gábor Juhász, Clinton R. Bartholomew, Diane C. Bassham, Robert C. Bast, Henri Batoko, Boon- Huat Bay, Isabelle Beau, Daniel M. Béchet, Thomas J. Begley, Christian Behl, Christian Behrends, Soumeya Bekri, Bryan Bellaire, Linda J. Bendall, Luca Benetti, Laura Berliocchi, Henri Bernardi, Francesca Bernassola, Sébastien Besteiro, Ingrid Bhatia-Kissova, Xiaoning Bi, Martine Biard-Piechaczyk, Janice S. Blum, Lawrence H. Boise, Paolo Bonaldo, David L. Boone, Beat C. Bornhauser, Karina R. Bortoluci, Ioannis Bossis, Frédéric Bost, Jean- Pierre Bourquin, Patricia Boya, Michaël Boyer-Guittaut, Peter V. Bozhkov, Nathan R Brady, Claudio Brancolini, Andreas Brech, Jay E. -

S-Zone Poster Class of 21 18X24
Congratulations Class of 2021! WELCOME TO THE PENN STATE ALUMNI ASSOCIATION Mohammed Abdulla Aal Abdulla, Kaylee Aaron, Raphael Abadilla, Muna Abalkhail, Carlos Abarca, Matthew Abazia, Marcello Abbate, Amina Abdalla, Amir Abdelnaby, Abraheem Abdelqader, Adelaide Abdool, Ahmed Abdou, Muhammad Raziq Abdul Halim, Denise Abdulahad, Daniah Abdulameer, Suleiman Abdulle, Talal Abdulrauf, Sydnee Abele, Madyn Abeles, Cullen Abelson, G M Akand Abir, David Abitan, Michelle Able, Sarah Abolehiah, Ameer Aboneaaj, Jad Abou Samra, Sarah Aboulhosn, Ziad Aboushousha, Aaron Abraham, Melissa Abraham, Sabin Abraham, Samuel Abraham, Taniya Abraham, Timothy Abrahms, Peter Abraldes, John Abrams, Samantha Abrams, Kyle Abramson, Miraydi Abreu Batista, Sylvia Abuissa, Hind Abuzaid, Shifa Abuzaid, Alexis Acca, Gabriela Acevedo, Alexandra Achampong, Sharup Acharya, Zachary Achille, John Acierno, Victoria Acker, Jeffrey Ackerman, Kevin Ackley, Carlos Acosta, Khabirah Acosta, Leeann Acuna, Andrew Adair, Patrick Adair, Karina Adajar, Anthony Adamcheck, Enrique Adames, Caitlin Adamo, Geremia Adamo, John Paul Adamonis, Autumn Adams, Christina Adams, Connor Adams, Darryl Adams, Jordan Adams, Joshua Adams, Lillian Adams, Matthew Adams, Milena Adams, Minor Adams, Nathaniel Adams, Nick Adams, Nickolas Adams, Olivia Adams, Trey Adams, Nageshwari Adavelly, Brandon Adde, Chandyce Adden, Richard Addison, Waliyu Adediran, Ibijoke Adegboyega, Lok Adhikari, Nabin Adhikari, Sanath Adiga, Shayan Adil, Danielle Adler, Jordan Adler, Woudasie Admasu, Venkata Aduri, Jacob Aferiat, Farah -
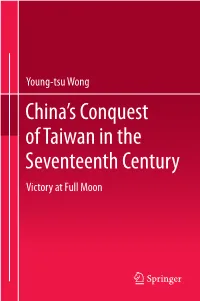
China's Conquest of Taiwan in the Seventeenth Century
Young-tsu Wong China’s Conquest of Taiwan in the Seventeenth Century Victory at Full Moon China’s Conquest of Taiwan in the Seventeenth Century Young-tsu Wong China’s Conquest of Taiwan in the Seventeenth Century Victory at Full Moon 123 Young-tsu Wong National Central University Taoyuan Taiwan ISBN 978-981-10-2247-0 ISBN 978-981-10-2248-7 (eBook) DOI 10.1007/978-981-10-2248-7 Library of Congress Control Number: 2017943236 © Springer Science+Business Media Singapore 2017 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. The publisher remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. -

Hanoi Conference
Violence and Predation on the Sino-Vietnamese Maritime Frontier, 1450-1850 Robert J. Antony University of Macau [email protected] This paper presents an overview of violence and predation in the form of piracy on the Sino-Vietnamese maritime frontier between the mid-fifteenth and mid-nineteenth centuries, with a focus on the Gulf of Tonkin.1 My research is based on written historical documents, including Qing archives, the Veritable Records of Vietnam and China, local Chinese gazetteers, and travel accounts, as well as fieldwork in the region conducted over the past five years. I argue that piracy was a persistent and intrinsic feature of this sea frontier and that it was a dynamic and significant force in the region‘s economic, social, and cultural development. The paper is divided into three sections: first, I discuss the geopolitical characteristics of this maritime frontier as a background to our understanding of piracy in the region; second, I consider the socio-cultural aspects of the gulf region, especially the underclass who engaged in clandestine activities as a part of their daily lives; and third, I analyze five specific episodes of piracy in the Gulf of Tonkin. The Gulf of Tonkin, which is tucked away in the northwestern corner of the South China Sea, borders on Vietnam in the west and China in the north and east. (See Map 1.) It has always been a dynamic and diversified political, social, and economic contact zone. Besides a vibrant maritime trade, fishing, pearl collecting, and salt production also constituted important factors in the political-economy of the region. -

Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia
CONTEMPORARY MARITIME PIRACY IN SOUTHEAST ASIA XU KE NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 2006 CONTEMPORARY MARITIME PIRACY IN SOUTHEAST ASIA XU KE Master of Economics, Xiamen University A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY SOUTHEAST ASIAN STUDIES PROGRAMME NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 2006 ACKNOWLEDGEMENTS Many people deserve my thanks for making this dissertation possible. I should like to express my deepest gratitude to my supervisor, Natasha Hamilton- Hart, for her brilliant advice and encouragement from start to finish of this study. I would also like to express my thanks to my thesis committee at NUS, Anthony Reid and Liu Hong, who have given valuable suggestions during my thesis writing. I am grateful for other professors in NUS, Reynaldo C. Ileto, Goh Ben Lan, Robert Beckman and K. Raguraman for their helpful comments, and I would like to thank the maritime security experts in IDSS, NTU, Sam Bateman, Joshua Ho and Gerard Graham Ong, for generously sharing their views with me. I would particularly like to thank the following scholars and maritime experts who I have learned very much from during my fieldwork in Indonesia, Malaysia, Singapore and China: James F. Warren, Hasjim Djalal, Mak Jun Num and Iskandar Sazlan of the Maritime Institute of Malaysia (MIMA); Zou Keyuan of the East Asian Institute (EAI); Li Jinmin, Nie Deling of the Research School of Southeast Asian Studies, Xiamen University; Wang Yizhou of the Chinese Academy of Social Sciences; Philips J. Vermonte, Begi Hersulanto and Edy Prasetyono of the Centre for Strategic and International Studies, Indonesia (CSIS); and Jayant Abhyankar and Noel Choong of the ICC International Maritime Bureau Piracy Reporting Centre. -

Nummer 40/14 1 Oktober 2014 Nummer 40/14 1 1 Oktober 2014
Nummer 40/14 1 oktober 2014 Nummer 40/14 1 1 oktober 2014 Inleiding Introduction Hoofdblad Patent Bulletin Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de The Patent Bulletin appears on the 3rd working derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum day of each week. If the Netherlands Patent Nederland op deze dag is gesloten, wordt de Office is closed to the public on the above verschijningsdag van het blad verschoven naar de mentioned day, the date of issue of the Bulletin is eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum the first working day thereafter, on which the Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in Office is open. Each issue of the Bulletin consists elektronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat of 14 headings. uit 14 rubrieken. Bijblad Official Journal Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, Appears four times a year (January, April, July, oktober) in elektronische vorm via October) in electronic form on the www.rvo.nl/octrooien. Het Bijblad bevat officiële www.rvo.nl/octrooien. The Official Journal mededelingen en andere wetenswaardigheden contains announcements and other things worth waarmee Octrooicentrum Nederland en zijn klanten knowing for the benefit of the Netherlands Patent te maken hebben. Office and its customers. Abonnementsprijzen per (kalender)jaar: Subscription rates per calendar year: Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in Patent Bulletin and Official Journal: free of elektronische vorm op de website van Octrooicentrum charge in electronic form on the website of the Nederland.