Le Musée René Magritte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

André Breton Och Surrealismens Grundprinciper (1977)
Franklin Rosemont André Breton och surrealismens grundprinciper (1977) Översättning Bruno Jacobs (1985) Innehåll Översättarens förord................................................................................................................... 1 Inledande anmärkning................................................................................................................ 2 1.................................................................................................................................................. 3 2.................................................................................................................................................. 8 3................................................................................................................................................ 12 4................................................................................................................................................ 15 5................................................................................................................................................ 21 6................................................................................................................................................ 26 7................................................................................................................................................ 30 8............................................................................................................................................... -
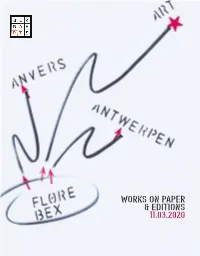
Works on Paper & Editions 11.03.2020
WORKS ON PAPER & EDITIONS 11.03.2020 Loten met '*' zijn afgebeeld. Afmetingen: in mm, excl. kader. Schattingen niet vermeld indien lager dan € 100. 1. Datum van de veiling De openbare verkoping van de hierna geïnventariseerde goederen en kunstvoorwerpen zal plaatshebben op woensdag 11 maart om 10u en 14u in het Veilinghuis Bernaerts, Verlatstraat 18 te 2000 Antwerpen 2. Data van bezichtiging De liefhebbers kunnen de goederen en kunstvoorwerpen bezichtigen Verlatstraat 18 te 2000 Antwerpen op donderdag 5 maart vrijdag 6 maart zaterdag 7 maart en zondag 8 maart van 10 tot 18u Opgelet! Door een concert op zondagochtend 8 maart zal zaal Platform (1e verd.) niet toegankelijk zijn van 10-12u. 3. Data van afhaling Onmiddellijk na de veiling of op donderdag 12 maart van 9 tot 12u en van 13u30 tot 17u op vrijdag 13 maart van 9 tot 12u en van 13u30 tot 17u en ten laatste op zaterdag 14 maart van 10 tot 12u via Verlatstraat 18 4. Kosten 23 % 28 % via WebCast (registratie tot ten laatste dinsdag 10 maart, 18u) 30 % via After Sale €2/ lot administratieve kost 5. Telefonische biedingen Geen telefonische biedingen onder € 500 Veilinghuis Bernaerts/ Bernaerts Auctioneers Verlatstraat 18 2000 Antwerpen/ Antwerp T +32 (0)3 248 19 21 F +32 (0)3 248 15 93 www.bernaerts.be [email protected] Biedingen/ Biddings F +32 (0)3 248 15 93 Geen telefonische biedingen onder € 500 No telephone biddings when estimation is less than € 500 Live Webcast Registratie tot dinsdag 10 maart, 18u Identification till Tuesday 10 March, 6 pm Through Invaluable or Auction Mobility -

RENÉ MAGRITTE : LES PROSES DE DISTANCES (1928) Clio Elizabeth De Carvalho Meurer
49 RENÉ MAGRITTE : LES PROSES DE DISTANCES (1928) Clio Elizabeth de Carvalho Meurer >«@MH¿QLVSDUWURXYHUGDQVO¶DSSDUHQFHGXPRQGHUpHOOXLPrPHOD même abstraction que dans mes tableaux ; car, malgré les combinaisons de détails et de nuances d’un paysage réel, je pouvais le voir comme s’il n’était qu’un rideau placé devant mes yeux. Je devins peu certain de la profondeur des campagnes, très peu persuadé de l’éloignement du bleu léger de l’horizon, l’expérience immédiate le situant simplement à la hauteur de mes yeux. J’étais dans le même état d’innocence que l’enfant qui croit pouvoir saisir de son berceau l’oiseau qui vole dans le ciel. Paul Valéry a ressenti ce même état devant la mer qui, dit-il, « se dresse devant les yeux du spectateur » […] Il me fallait maintenant animer ce monde qui, même en mouvement, n’avait aucune profondeur et avait perdu toute consistance. Je songeai alors que les objets eux-mêmes devaient révéler éloquemment leur existence et je recherchai comment je pourrais rendre manifeste la réalité. (René Magritte, 1938)1 En 1928, les surréalistes belges font paraître DistancesOHXUSUHPLqUHUHYXHOLWWpUDLUHRI¿FLHOOH. René Magritte, qui vit l’un des moments les plus fertiles de sa carrière, y contribue activement. À la revue au concept novateur, il fait parvenir non seulement des illustrations, mais aussi des proses, OHVTXHOOHVV¶LQWqJUHQWDXÀX[G¶pFULWXUHLPDJLQpSDU3DXO1RXJpHW&DPLOOH*RHPDQV Ces textes, écrits à un moment où il cherche à appliquer un ordre et un sens à sa peinture, ne sont pas ses premières incursions dans le registre littéraire. Dans ses années de formation à l’Académie Royale de Bruxelles, Magritte, qui commençait déjà une habitude de se lier d’amitié avec des poètes et écrivains, avait collaboré au comité de rédaction de la revue Au Volant des frères Bourgeois (1919). -

Irène Hamoir Et Louis Scutenaire : Une Symbiose En Littérature Plutôt Qu’Une Imposture
Etudes Francophones Vol. 29 Automne 2018 Dossier plurithématique Irène Hamoir et Louis Scutenaire : Une symbiose en littérature plutôt qu’une imposture Séverine Orban The College of Idaho Elle ? C’est Irène Hamoir ou Irine de son nom de plume. Elle naît en 1906 dans la banlieue bruxelloise et côtoie le milieu du cirque : ses oncles, The Noiset’s, sont des acrobates à deux ou quatre roues. Au terme d’études de secrétariat, puis de journalisme, elle rencontre Marc Eemans, son compagnon de route pour les trois années suivantes. C’est grâce à lui et à sa collaboration à la revue Distances qu’elle rencontre Jean Scutenaire — Lui — en 1928 chez Marcel Lecomte. Deux ans plus tard, Elle et Lui se marient. De 1931 à 1939, elle est fonctionnaire à la Cour permanente de justice de La Haye et de Genève. Après la guerre, elle entre à la rédaction du journal Le Soir, seule femme parmi un personnel de journalistes exclusivement masculin. Seule femme également — du moins seule femme active sur le plan artistique — au sein du groupe surréaliste de Bruxelles : elle écrit ; elle signe des tracts ; elle participe à de nombreuses revues par de petits textes poétiques, des articles sur des peintres ou poètes du temps, des proses, etc. Elle, c’est aussi la « voix » du groupe surréaliste : on aime entendre sa voix de « stentor », comme le dit Magritte, l’ami du couple depuis les années trente, quand elle lit des poèmes de Paul Colinet, de Paul Éluard ou de René Char, ou quand elle prend la parole à des ouvertures d’exposition. -

Download the Faithful Images, Renðfiâ© Magritte, The
The faithful images, RenГ© Magritte, the cinemaphotography and the photography, Midland Group (Nottingham, England), Louis Scutenaire, A. Clarke, Midland Group, 1978, 0950491160, 9780950491165, . DOWNLOADHERE RenГ© Magritte paintings, drawings, sculpture : May 11-June 30, 1990, RenГ© Magritte, Pace Gallery, 1990, Photography, 58 pages. Magritte, ideas and images , RenГ© Magritte, Harry Torczyner, 1977, Art, 277 pages. RenГ© Magritte , Patrick Waldberg, 1965, Art, 353 pages. RenГ© Magritte, 135 rue Esseghem, Jette-Brussels , Jan Ceuleers, 1999, Art, 125 pages. In 1930 Rene Magritte left Paris -- and the Surrealist scene with which he was identified -- to settle in Jette, a suburb of Brussels, in Magritte's native country of Belgium .... RenГ© Magritte: catalogue raisonnГ©, Volume 5 catalogue raisonnГ©, RenГ© Magritte, David Sylvester, Sarah Whitfield, Michael Raeburn, 1997, Art, 357 pages. This is the fifth and final volume of the critically acclaimed catalogue raisonne of the Belgian surrealist artist Rene Magritte, edited by David Sylvester. This volume is the .... Oil paintings, objects and bronzes, 1949-1967 , RenГ© Magritte, David Sylvester, Sarah Whitfield, Michael Raeburn, 1993, Art, 496 pages. The five volume work presents an authoritative survey of the artist's oeuvre, from 1916 to his death in 1967.. Magritte and photography , Patrick Roegiers, Palais des beaux-arts (Brussels, Belgium), Dec 5, 2005, , 167 pages. "Rene Magritte, the great Surrealist painter, begin experimenting with photography at an early age. While still a young student at the Academy of Fine Arts in Brussels, he .... Magritte The Hayward Gallery , the South Bank Centre, London, 21 May-2 August 1992 .. -

Ars Libri Ltd Modernart
MODERNART ARS LIBRI LT D 149 C ATALOGUE 159 MODERN ART ars libri ltd ARS LIBRI LTD 500 Harrison Avenue Boston, Massachusetts 02118 U.S.A. tel: 617.357.5212 fax: 617.338.5763 email: [email protected] http://www.arslibri.com All items are in good antiquarian condition, unless otherwise described. All prices are net. Massachusetts residents should add 6.25% sales tax. Reserved items will be held for two weeks pending receipt of payment or formal orders. Orders from individuals unknown to us must be accompanied by pay- ment or by satisfactory references. All items may be returned, if returned within two weeks in the same con- dition as sent, and if packed, shipped and insured as received. When ordering from this catalogue please refer to Catalogue Number One Hundred and Fifty-Nine and indicate the item number(s). Overseas clients must remit in U.S. dollar funds, payable on a U.S. bank, or transfer the amount due directly to the account of Ars Libri Ltd., Cambridge Trust Company, 1336 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02238, Account No. 39-665-6-01. Mastercard, Visa and American Express accepted. June 2011 avant-garde 5 1 AL PUBLICO DE LA AMERICA LATINA, y del mondo entero, principalmente a los escritores, artistas y hombres de ciencia, hacemos la siguiente declaración.... Broadside poster, printed in black on lightweight pale peach-pink translucent stock (verso blank). 447 x 322 mm. (17 5/8 x 12 3/4 inches). Manifesto, dated México, sábado 18 de junio de 1938, subscribed by 36 signers, including Manuel Alvárez Bravo, Luis Barragán, Carlos Chávez, Anto- nio Hidalgo, Frieda [sic] Kahlo, Carlos Mérida, César Moro, Carlos Pellicer, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Frances Toor, and Javier Villarrutia. -

The Artist Who Was Master of the Double Take
1 THE ARTIST WHO WAS MASTER OF THE DOUBLE TAKE By Bennett Schiff, Smithsonian, Sept. 1992 Magritte is called a Surrealist, but what he really did was show us the mystery that's there when our basic assumptions are challenged Stroll along with Rene Magritte, the maker of improbable images, his wife, Georgette, and their beloved little dog, Loulou. They are in that solid bourgeois neighborhood of Brussels known for its restaurants and movie houses. It's about 1955. As usual, Magritte is wearing a good suit and a bowler, his favorite headgear. Like a face in one of his paintings, Magritte's is expressionless. In fact, he looks as if he's just stepped out of one of his paintings. It is legitimate to imagine him stepping back in, a passenger in a revolving door set right into the canvas. All is sober and ordinary, except that he and Georgette, as is their custom, are taking Loulou, the tiny, powderpuff Pomeranian, to the movies. One of the things about Magritte, this gentle man with the stockbroker's face, is that he can always surprise you. He can make you ask questions, but don't expect answers. Magritte deals in images, in poetry and, ultimately, in mystery. If you must have answers, it is best that you make them up to suit yourself. At heart Magritte was a detonator, a bombardier. "I detest my past," he wrote, "and anyone else's. I detest resignation, patience, professional heroism and obligatory beautiful feelings. I also detest the decorative arts, folklore, advertising, voices making announcements, aerodynamism, boy scouts, the smell of mothballs, events of the moment, and drunken people." His images were meant to upset the pattern, to undermine conventional expectations. -

René Magritte by James Thrall Soby
René Magritte by James Thrall Soby Author Museum of Modern Art (New York, N.Y.) Date 1965 Publisher Distributed by Doubleday, Garden City, N.Y. Exhibition URL www.moma.org/calendar/exhibitions/1898 The Museum of Modern Art's exhibition history— from our founding in 1929 to the present—is available online. It includes exhibition catalogues, primary documents, installation views, and an index of participating artists. MoMA © 2017 The Museum of Modern Art 8o pages, 72 illustrations (75 in color) $6.95 RENE MAGRITTE by James Thrall Soby rene magritte, born in Belgium in 1898, has lived in Brussels all his adult life except for a few years in the late 1920s when he joined the surrealist group in Paris. Outwardly his life has been uneventful, but the interior world of imagination revealed in his art has been varied and extraordinarily inventive and has won him a leading place among the fantasists of our time. In this catalogue of The Museum of Modern Art exhibition of the work of Rene Magritte, Mr. Soby traces Magritte's career, describing its enigmatic development and throwing light on the abrupt changes of style, the recurring symbolic motifs, and the audacious spatial relationships. His analysis of individual paint ings—from the first surrealist pictures to his most recent works—reveals the sources of Magritte's imagery and provides new inter pretations for some of his major works. A brief chronology, an extensive bibliography, and a listing of many of his own published writings supplement the text. James Thrall Soby, Chairman of the Collec tion Committee of The Museum of Modern Art and also of its Department of Painting and Sculpture Exhibitions, is the author of many distinguished books on modern artists, among them Giorgio de Chirico, Yves Tanguy, and Balthus. -
Surrealist Brussels Thematic Kit BRUSSELS IS REVELLING MORE THAN EVER in ITS REPUTATION AS a SURREALIST CITY
surrealist brussels thematic kit BRUSSELS IS REVELLING MORE THAN EVER IN ITS REPUTATION AS A SURREALIST CITY. IT HAS SUCCEEDED IN EMBODYING THE INFLUENCE OF ONE OF THE MOST ASTONISHING ARTISTIC MOVEMENTS OF THE 20TH CENTURY: SURREALISM. THIS MOVEMENT WAS CARRIED BY ICONIC FIGURES SUCH AS RENÉ MAGRITTE, LOUIS SCUTENAIRE, MARCEL MARIËN OR AGAIN THE MUSICIAN ANDRÉ SOURIS. DISCOVER THE BRUSSELS OF YOUR WILDEST DREAMS! 1. A BIT OF HISTORY 3 2. CULTURAL INSTITUTIONS 4 3. SURREALISM, PART OF BRUSSELS’HERITAGE 6 4. GUIDED TOURS 7 5. RESTAURANTS & BARS 9 6. PUBLICATION 10 7. CONTACTS 11 WWW.VISITBRUSSELS.BE 1. A BIT OF HISTORY BETWEEN ART AND POLITICS Surrealism is an artistic movement born in the concrete context of the aftermath of the First World War. The war symbolised the failure of two ideals that had marked the societal debate before 1914: internationalism and positivism. Due to the commitment of the various socialist parties to a war of nations, the hope that the international workers’ movement would defeat nationalism evap- orated. The use of scientific knowledge for the purposes of the most atrocious war in history also dispelled the hope that a better world would emerge from the victory of knowledge over obscurantism (enlightenment over darkness, knowledge over superstition). Surrealism was born at the point where these two failures converged. Several Belgian protagonists of the movement joined various revolutionary socialist tendencies that arose in response to the «betrayal of social democracy» (Communists, Trotskyists, Mao- ists). Paul Nougé was one of the founders of the Belgian Communist Party. Rene Magritte joined this party three times, but also left it. -

Mise En Page 1
expert claude oterelo Vendredi 25 mars 2016 - Paris Drouot ÉDITIONS ORIGINALES - LIVRES ILLUSTRÉS - REVUES MANUSCRITS - LETTRES AUTOGRAPHES PHOTOGRAPHIES - DESSINS DU XX E SIÈCLE VENDREDI 25 MARS 2016 PARIS - HÔTEL DROUOT - SALLE 7 - 14H00 EXPERT Claude OTERELO Membre de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés 5, rue La Boétie - 75008 Paris Tél. : +33 6 84 36 35 39 [email protected] EXPOSITIONS PRIVÉES EXPOSITIONS PUBLIQUES Étude Binoche et Giquello Hôtel Drouot - salle 7 5 rue la Boétie Jeudi 24 mars de 11h à 18h Lundi 21 et mardi 22 mars de 14h à 18h et vendredi 25 mars de 11h à 12h Téléphone pendant l’exposition +33 (0)1 48 00 20 07 5, rue La Boétie - 75008 Paris - tél. +33 (0)1 47 70 48 90 - fax. +33 (0)1 47 42 87 55 [email protected] - www.binocheetgiquello.com Jean-Claude Binoche - Alexandre Giquello - Commissaires-priseurs judiciaires s.v.v. agrément n°2002 389 - Commissaire-priseur habilité pour la vente : Alexandre Giquello 4 1 ABBOTT Bérénice. PORTRAIT DE PAUL MORAND. PHOTOGRAPHIE ORIGINALE. (1928) ; 22,3 x 16,5 cm sous passe partout. 1 200/1 500 € Tirage argentique d’époque monté sur carton, signé dans la plaque par Bérénice Abbott, représentant le portrait de Paul Morand. 2 ALECHINSKY Pierre. BENOIT Pierre-André. PETITE POÉSIE POUR PIERRE ALECHINSKY. Rivières, P.A.B., 1985 ; in-4 en feuilles, couverture illustrée par Pierre Aléchinsky. 500/600 € Édition originale limitée à 40 exemplaires numérotés signés par l’auteur et l’illustrateur. Texte autographe reproduit et texte de Pierre André Benoît gravé et enluminé par Pierre Alechinsky. -
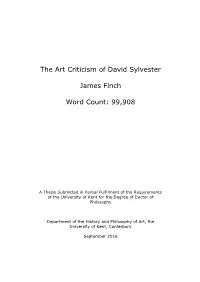
The Art Criticism of David Sylvester James Finch Word Count
The Art Criticism of David Sylvester James Finch Word Count: 99,908 A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements of the University of Kent for the Degree of Doctor of Philosophy Department of the History and Philosophy of Art, the University of Kent, Canterbury September 2016 2 © Copyright James Finch, 2016. All rights reserved. 3 Abstract The English art critic and curator David Sylvester (1924-2001) played a significant role in the formation of taste in Britain during the second half of the twentieth century. Through his writing, curating and other work Sylvester did much to shape the reputations of, and discourse around, important twentieth century artists including Francis Bacon, Alberto Giacometti, Henry Moore and René Magritte. At the same time his career is of significant sociohistorical interest. On a personal level it shows how a schoolboy expelled at the age of fifteen with no qualifications went on to become a CBE, a Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres and the first critic to receive a Leone d’Oro at the Venice Biennale, assembling a personal collection of artworks worth millions of pounds in the process. In terms of the history of post-war art more broadly, meanwhile, Sylvester’s criticism provides a way of understanding developments in British art and its relation to those in Paris and New York during the 1950s and 1960s. This thesis provides the first survey of Sylvester’s entire output as an art critic across different media and genres, and makes a case for him as a commentator of comparable significance to Roger Fry, Herbert Read, and other British critics who have already received significant scholarly attention. -

Cavalier History of Surrealism, A
will massacre the priests themselves by way of an Amen The bases of a practical approach to religion were laid down in L’Action immédiate by René Magritte, E.L.T Mesens, Paul A Cavalier History of Nougé, Louis Scutenaire and André Souris: Surrealism We are convinced that what has been done to op- pose religion up to now has been virtually without effect and that new means of action must be envis- aged. Raoul Vaneigem At the present time the Surrealists are the people best fitted to undertake this task. So as not tolose any time, we must aim for the head: the outra- geous history of religions should be made known to all, the lives of young priests should be made un- bearable, and all sects and organizations of the Sal- vation Army or of the Evangelical variety should be discredited by means of every kind of mockery our imagination can devise. Think how exhilarat- ing it would be if we could persuade the better part of our youth to mount a well prepared and sys- tematic campaign of disruption of church services, baptisms, communions, funerals and so on. Mean- while roadside crosses might usefully be replaced by images promoting erotic love or poetically eu- logizing the natural surroundings, particularly if these happen to be grim. In an article published in Intervention surréaliste (1934) which went scandalously unheeded, Pierre Yoyotte set the tone for a debate that ought by rights to have sparked action of the broadest scope: The Communists have always officially evinced 1977 an extremely unintelligent suspicion with respect 44 The struggle against Christianity, for instance, by now aban- doned by Bolshevism, suffered not a little from this miscon- ceived modesty.