La Grammaire Du Noon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Concours Direct Cycle a Option "Diplomatie Arabisant"
N° de Date de Prénom(s) Nom Lieu de naissance table naissance 1 Abdel Kader AGNE 01/03/1989 Diourbel 2 Dieng AIDA 01/01/1991 Pattar 3 Adjaratou Sira AIDARA 02/01/1988 Dakar 4 Alimatou Sadiya AIDARA 06/01/1992 Thiès 5 Marieme AIDARA 06/02/1991 Nioro Du Rip 6 Mouhamadou Moustapha AIDARA 28/09/1991 Touba 7 Ndeye Maguette Laye ANE 10/06/1995 Dakar 8 Sileye ANNE 10/06/1993 Boinadji Roumbe 9 Tafsir Baba ANNE 19/12/1993 Rufisque 10 Gerard Siabito ASSINE 03/10/1991 Samatite 11 Tamba ATHIE 19/08/1988 Colibantan 12 Papa Ousseynou Samba AW 02/11/1992 Thiès Laobe 13 Ababacar BA 02/09/1991 Pikine 14 Abdou Aziz BA 08/02/1992 Rufisque 15 Abdoul BA 02/02/1992 Keur Birane Dia 16 Abdoul Aziz BA 22/11/1994 Ourossogui 17 Abdoul Mamadou BA 30/08/1992 Thiaroye Gare 18 Abdrahmane Baidy BA 10/02/1991 Sinthiou Bamambe 19 Abibatou BA 08/08/1992 Dakar 20 Aboubacry BA 01/01/1995 Dakar 21 Adama Daouda BA 08/04/1995 Matam 22 Ahmet Tidiane BA 22/02/1991 Mbour 23 Aliou Abdoul BA 26/05/1993 Goudoude Ndouetbe 24 Aly BA 20/01/1988 Saint-Louis 25 Amadou BA 01/12/1996 Ngothie 26 Amidou BA 06/12/1991 Pikine 27 Arona BA 02/10/1989 Fandane 28 Asmaou BA 03/10/1991 Dakar 29 Awa BA 01/03/1990 Dakar 30 Babacar BA 01/06/1990 Ngokare Ka 2 31 Cheikh Ahmed Tidiane BA 03/06/1990 Nioro Du Rip 32 Daouda BA 23/08/1990 Kolda 33 Demba Alhousseynou BA 06/12/1990 Thille -Boubacar 34 Dieynaba BA 01/01/1995 Dakar 35 Dior BA 17/07/1995 Dakar 36 El Hadji Salif BA 04/11/1988 Diamaguene 37 Fatimata BA 20/06/1993 Tivaouane 38 Fatma BA 12/01/1988 Dakar 39 Fatou BA 02/02/1996 Guediawaye 40 Fatou Bintou -

Senegalese Writers Between French, Wolof and World Literature By
The Limits of the Literary: Senegalese Writers Between French, Wolof and World Literature By Tobias Dodge Warner A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor in Philosophy in Comparative Literature in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Karl Britto, Chair Professor Judith Butler Professor Samba Diop Professor Susan Maslan Professor Gautam Premnath Spring 2012 ! ! "! Abstract The Limits of the Literary: Senegalese Writers Between French, Wolof and World Literature by Tobias Dodge Warner Doctor of Philosophy in Comparative Literature University of California, Berkeley Professor Karl Britto, Chair ! ! This dissertation argues that the category of the literary emerged in colonial Senegal through the exclusion of some indigenous textual cultures and the translation of others. In readings of Mariama Bâ, Ousmane Sembène, Cheikh Aliou Ndao, Maam Yunus Dieng and others, I examine how postcolonial Senegalese authors working in French and Wolof have responded to this legacy. Through analyses of a variety of 19th-20th century texts, this dissertation explores how the Senegalese literary field has been crosscut by a series of struggles over how to define proper reading and authorship, and what the shape of a future literary public might be. I argue that Senegalese writers working at the interstices of French and Wolof have engaged with a variety of crises of authorship and audience by addressing their work to a public that is yet to come. The dissertation begins in the 19th century with a reading of works by an influential 19th- century métis intellectual, the Abbé David Boilat, in whose scholarly activities one can perceive the discursive preconditions of a future francophone literary field. -

2-Fac-Lettres
TESTS PSYCHOTECHNIQUES DU CONCOURS DIRECT DU CYCLE B Dimanche 02 décembre 2018 à 08H LIEU : FAC. LETTRES AMPHI A. GROUPE 1 DATE NUMERO PRENOM NOM LIEU NAISSANCE NAISSANCE 2901 Nouha DIAMANKA 28/12/1997 Kolda 2902 Oumar DIAMANKA 20/10/1990 Sam Pathe 2903 Samba DIAMANKA 10/03/1986 Kolda 2904 Youssef DIAMANKA 16/10/1993 Kolda 2905 Fatimata DIAMCOUMBA 30/06/1993 Oubavol 2906 Ibnou Arab DIAME 07/05/1991 Niodior 2907 Malang DIAME 02/03/1993 Toubacouta 2908 Moussa DIAME 20/03/1993 Yeumbeul 2909 Ndeye Fatou DIAME 03/03/1996 Fatick 2910 Papa Souleymane DIAME 06/07/1986 Pout 2911 Rosalie DIAME 10/12/1999 Bignona 2912 Souleymane DIAME 19/02/1991 Nemabah 2913 Thierno DIAME 16/11/1993 Pikine 2914 Soukeyna Yeume Diagne DIAMÉ 05/03/1998 Dakar 2915 Toussaint Diehe DIAMÉ 01/11/1990 Kaolack 2916 Alexandra Marcelle DIANDY 22/09/1994 Kaolack 2917 Antoine Georges DIANDY 08/04/1993 Dakar 2918 Jeanne Arc Nathalie DIANDY 29/07/1991 Diamagueune 2919 Paul Joseph DIANDY 25/06/1991 Dakar 2920 Silvain DIANDY 04/11/1987 Fatick Keur Amady 2921 Lamine Ousmane DIANE 08/08/1993 Nguenar 2922 Yama DIANE 03/07/1989 Diamafara 2923 Awa Cheikh DIANÉ 03/08/1994 Kaffrine 2924 Mamadou Lamine DIANÉ 11/03/1994 Mbour 2925 Hawa DIANFO 13/09/1995 Kolda 2926 Maimouna DIANGO 03/02/1989 Dakar 2927 Amadou Tidiane DIANKA 18/08/1987 Ourossogui 2928 Mody DIANKA 05/11/1993 Ourossogui 2929 Niakasso DIANKA 18/12/1990 Thiancone Hiraye 2930 Babacar DIANKHA 15/11/1993 Passy 2931 El Hadji DIANKHA 08/03/1989 Taïba Niassène 2932 Habib DIANKHA 10/10/1988 Ziguinchor 2933 Mary Gaye DIANKHA 24/12/1998 -
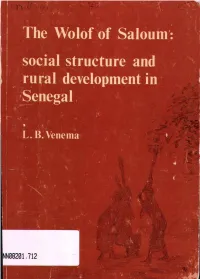
The Wolof of Saloum: Social Structure and Rural Development in Senegal Stellingen
The Wolof of Saloum: social structure and rural development in Senegal Stellingen 1. Ein van de voorwaarden voor succesvolle toepassing van ossetrekkracht in de landbouw is een passende bedrijfsgrootte. In vele samenlevingen in West-Afrika wordt aan deze voor- waarde niet voldaan, omdat de leden van de huishoudgroep niet gezamenlijk, maar afzonder- lijk een bedrijf beheren. Dit proefschrift. 2. De conclusie dat in niet-westerse gebieden de positie van de vrouw verslechtert door opname in de marktecanomie en modernisering van de landbouw, is niet van toepassing op de Wolof-samenleving. Door de verbouw van handelsgewassen werd haar rol in de landbouw be- langrijker en nam haar inkomen toe. De recente toepassing van dierlijke trekkracht ver- lichtte haar taak op haar eigen veld. Postel-Coster, E. & J. Schrijvers, 1976. Vrouwen op weg; ontwikkeling naar emanci- patie. Van Gorcum, Assen. Dit proefschrift. 3. Moore verklaart de deelname aan werkgroepen met een maaltijd als beloning ('festive labour') mede uit de afhankelijkheid van de deelnemers ten opzichte van de begunstigde. Hierbij wordt over het hoofd gezien dat het voorkomt dat slechts een persoon deelneemt vanwege zijn afhankelijkheid van de begunstigde en dat deze persoon de overige deelnemers rekruteert volgens de regels van reciprociteit. Moore, M.P., 1975. Co-operative labour in peasant agriculture. Journal of Peasant Studies 2(3): 270-291. Dit proefschrift. 4. De gebruikelijke definitie van een marabout als zijnde een heilige en religieus leider met erg veel invloed is niet van toepassing op de Wolof, omdat hier vele marabouts slechts lokale bekendheid genieten. Dit proefschrift. 5. Er wordt vaak geen rekening gehouden met het feit dat de materiele positie van de kleine boer in ontwikkelingslanden niet alleen bepaald wordt door zijn activiteit als pro- ducent, maar tevens door zijn activiteit als handelaar. -

Bourses Sociales UCAD
REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE juin-15 Direction des Bourses ETAT RECAPITULATIF DES BOURSIERS ET ALLOCATAIRES(AYANTS DROIT) (COMM SOCIALE) DE L'UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP(UCAD) DE DAKAR N° N° de la CNI Prénoms Nom Date nais Lieu de nais Etablissement Montants mensuels 1 1306201000102 ABDOULAYE LAH 15/11/1993 PODOR FLSH 1/2 BOURSE 2 2583200401021 SOW ADAMA 15/09/1995 NDIOBENE WALO FLSH 1/2 BOURSE 3 1755199301256 JULIUS COLES ADIOYE 23/03/1993 DAKAR FLSH 1/2 BOURSE 4 1944201000178 ABDOURAHMANE AIDARA 23/12/1992 PIKINE FLSH 1/2 BOURSE 5 1762199200206 ARONA AIDARA 09/06/1994 BAKADADJI FLSH 1/2 BOURSE 6 1099199900346 MALAINY AIDARA 13/01/1994 DARSALAM CHERIF FLSH 1/2 BOURSE 7 2612199400189 NDAO AISSATOU 20/02/1994 NGUENIENE FLSH 1/2 BOURSE 8 2088200603028 ANA AKAPO 10/06/1996 KOLDA FLSH 1/2 BOURSE 9 1571200401096 MANE AMATH 18/09/1994 KEUR BIRANE DIA FLSH 1/2 BOURSE 10 1277199400059 HAROUNA ABD LABO AMEYTA 12/03/1994 OUROSSOGUI FLSH 1/2 BOURSE 11 2548200603830 OUMAR AMADOU ANNE 22/05/1992 PETE FLSH 1/2 BOURSE 12 1771199400761 ISABELLE ELLA ASSINE 13/09/1996 DAKAR FLSH 1/2 BOURSE 13 2870199000962 JACQUELINE ASSINE 13/06/1992 SAMATITE FLSH 1/2 BOURSE 14 182199600033 GOUDIABY ATAB 11/02/1996 KAGNAROU FLSH 1/2 BOURSE 15 1070199002823 MOUHAMADOU AW 22/09/1990 ZIGUINCHOR FLSH 1/2 BOURSE 16 1571200200314 ABDOULAYE BA 20/01/1994 KEUR BIDJI AWA FLSH 1/2 BOURSE 17 1680199400308 ABDOULAYE BA 25/09/1994 KEBEMER FLSH 1/2 BOURSE 18 1720199300124 ABDOULAYE BA 22/10/1993 ROTTO FLSH 1/2 BOURSE 19 2277200500109 -

Cosaani Sénégambie Juillet 2014
The Seereer Resource Centre Traduit et transcrit par The Seereer Resource Centre : Cosaani Sénégambie Juillet 2014. « Cosaani Sénégambie » (« L’Histoire de la Sénégambie») : 1ere Partie relatée par Macoura Mboub du Sénégal. 2eme Partie relatée par Jebal Samba de la Gambie [in] programme de Radio Gambie: « Chosaani Senegambia ». Présentée par: Alhaji Mansour Njie. Directeur de programme: Alhaji Alieu Ebrima Cham Joof. Enregistré a la fin des années 1970, au début des années 1980 au studio de Radio Gambie, Bakau, en L'histoire Gambie (2eme partie) et au Sénégal (1ere partie) [in] onegambia.com [in] The Seereer Resource Centre (SRC) (« le Centre de Resource Seereer ») : orale URL: www.seereer.com. Traduit et transcrit par The Seereer Resource Centre : Juillet 2014. Titre: « Cosaani Sénégambie » (« l’histoire de la Sénégambie ») 1ere Partie: Sohna Chenaba Saar, la famille Seck du Sénégal et la bataille de Samba Sajo. 2eme Partie: l’histoire du Saluum (ou Saloum), histoire de Ama Juuf Jaame et l’histoire de la famille Samba de Gambie (descendants de Sainey Mbissin Njaay Samba). Date ou année (ou année approximative de l'enregistrement) : Fin des années 1970 au début des années 80. La date exacte de l'enregistrement est inconnue. Objet: Tradition orale Cet enregistrement audio est en deux parties: 1ere Partie (de 00:00:00 à 00:26:41 minutes). Interview de Macoura Mboub (du Sénégal) par Dodou Jego Jobe de Radio Gambie. Cette section parle de Sohna Chenaba Saar / Sarr (le nom Chenaba ou Thienaba peut être écrit de plusieurs manières: Thiénaba, Tienaba ou Cénaba); la famille Seck du Sénégal et la bataille de Samba Sajo. -

Lances Males Léopold Sédar Senghor Et Les Traditions Sérères
COLLECTION ETUDES Marcel Mahawa Diouf LANCES MALES LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR ET LES TRADITIONS SÉRÈRES CELHTO LANCES MÂLES A Saliou Sambou, Gouverneur deFatick A tousnos cousins et voisins,pour perpétuer lepacte ancestral Remerciements aux Éditions du Seuil Collection Etudes Marcel Mahawa Diouf LANCES MÂLES Léopold Sédar Senghor et les traditions sérères Centre d'Etudes Linguistiques et Historiques par Tradition Orale (CELHTO) B.P. 878 Niamey· Niger @ CELHTO,1996 B.P. 878 Niamey· Niger Droitsde reproductionreservés pour tous pays TABLE DES MATIÈRES Préface ....................................................................................................... 9 Avertissement ................................... ..... ...... ......................... ......... ......... 11 Introduction ............................................................................................ 13 PREMIÈRE PARTIE: L'EXODE .............................. ...................... 23 A la recherche du temps perdu .................................................... 28 Les voies nord-orientales .............................................................. 46 La voie royale ................................................................................. 68 La guerre du Tourban ..................................................................... 71 L'odyssée guelwar .......................................................................... 83 DEUXIÈME PARTIE: LES MAITRES DE LA VOIE ......................... 101 Les saltiguis, pasteurs de peuples ............................................... -
Entretien : Cheikh Bécaye Kounta Et Bouna Kounta, Ndankh, Le 30 Juillet 2011
Entretien : Cheikh Bécaye Kounta et Bouna Kounta, Ndankh, le 30 juillet 2011 00:06-Madame Haïdara(MH): Au nom de Dieu Le Miséricordieux, Le Très-Miséricordieux. Paix et Salut de Dieu soient sur le Prophète Mouhamed. Bonjour tout le monde ! Nous sommes aujourd’hui à Ndankh qui est une cité historique, la terre de Cheikh Bounama. Nous sommes venus rencontrer sa famille pour discuter de leurs ancêtres afin de retracer leur origine pour mieux connaitre la famille. Telle est notre mission. Nous tenons à préciser que nous faisons un travail de recherche. Si nous le terminons, par la grâce de Dieu, il sera disponible sur internet et accessible à toute personne faisant des recherches sur les Kounta d’ici, chez Cheikh Bounama à Ndankh, ou de chez Bou Kounta à Ndiassane. Tel est notre but. C’est un travail de recherche à but non lucratif. Les étudiants, les élèves ou les chercheurs qui s’intéressent à la famille pourront accéder à ce travail sur internet. Nous sommes en face de Cheikh Bécaye aujourd’hui à Ndankh. Maintenant dites-nous qui vous êtes, votre place dans la famille avant qu’on ne commence la discussion. Nous voulons aussi nous assurer que nous pouvons utiliser les informations collectées dans cette discussion, que nous pouvons les publier et que nous pouvons enregistrer la discussion. Il nous faut votre autorisation dans ce sens. Vous avez la parole. Serigne Bécaye(SB) : Je cherche protection contre Satan auprès de Dieu. Au nom de Dieu Le Miséricordieux, Le Très Miséricordieux. Que Dieu répande paix et bonheur sur vous. -

Cosaani Sénégambie Resource Centre : Juillet 2014
The Seereer Resource Centre Traduit et transcrit par The Seereer Cosaani Sénégambie Resource Centre : Juillet 2014. « Cosaani Sénégambie » (« L’Histoire de la Sénégambie ») avec El Hadji Demba Lamine Diouf du Sénégal [in] programme de Radio Gambie: « Chosaani Senegambia ». Présentée par: Alhaji Mansour Njie et Alhaji Ousman Secka de Radio Gambie. Intervieweur : Dodou Jego Jobe de Radio Gambie. Directeur de programme: Alhaji Alieu Ebrima Cham Joof. Enregistré a la fin des années 1970, au début des années 1980 au Sénégal [in] onegambia.com [in] The Seereer Resource Centre (SRC) (« le Centre de Resource Seereer ») : URL: www.seereer.com. Traduit et transcrit par The Seereer Resource Centre : Juillet 2014. L'histoire orale Titre: Cosaani Sénégambie (« l’Histoire de la Sénégambie ») avec El Hadji Demba Lamine Diouf Date ou année (ou année approximative de l'enregistrement) : Fin des années 1970 au début des années 80. La date exacte de l'enregistrement est inconnue. Objet: Tradition orale Cet enregistrement audio est en deux parties: Dans cet enregistrement audio, El Hadji Demba Lamine Diouf du Sénégal relate l'histoire de la Sénégambie. Il parle de la signification du mot « Damel » et « Tëën » (variation: « teeñ » ou « teign »). Demba Lamine discute également de la création de plusieurs anciens villages et villes dans la région de la Sénégambie y compris Lambaye.1 On a également discuté de la bataille de Danki (1549) dans cet enregistrement avec l'intronisation d'Amary Ngoné Sobel Fall2 (roi du Cayor) et de Mbegaan Nduur (variation : Mbegane Ndour, roi du Saluum). Lieu : Studios de Radio Sénégal et Radio Gambie, Bakau, en Gambie Durée: 00 :54 : 44 minutes Langue source : cet enregistrement audio est en Wolof Langue cible : le Français Moyen: dossier audio Présentateurs : Alhaji Mansour Njie (présentateur -Radio Gambie) Alhaji Ousman Secka (co-présentateur -Radio Gambie) Station Radio: Radio Gambie (« Radio Gambia ») Orateurs : 1. -

Wolof and Wolofisation: Statehood, Colonial Rule, and Identification in Senegal
chapter 3 Wolof and Wolofisation: Statehood, Colonial Rule, and Identification in Senegal Unwelcome Identifications: Colonial Conquest, Independence, and the Uneasiness with Ethnic Sentiment in Contemporary Senegal The ethnic friction which characterises classic interpretations of African states is remarkably absent in Senegalese society. Senegal is often presented as a soci- ety dominated by Wolof-speakers, particularly in the urban agglomeration of Dakar, which has assimilated large groups of immigrants both socially and lin- guistically.1 This has increasingly led scholars to define Senegal as a predomi- nantly ‘Wolof society’, whose language is spreading widely (which is sometimes seen as being linked to Murid Islam as well). The Wolof language has migrated from the region of the capital and other urban communities, such as Saint- Louis, Tivaouane, Thiès, Diourbel, and Kaolack, into the southern coastal belt towards the Gambian border. This has strongly influenced the interpretation of the history of what is present-day Senegal. Pre-colonial states are therefore often described as ‘Wolof states’; their ruling dynasties – if there were any – are defined as ‘Wolof’. The Wolof nature of Senegal’s political structures is not seri- ously in question.2 As Senegambia is located on the early modern sea routes to India and the slave ports of the so-called Guinea Coast, information on its inhabitants was available to Europeans from an early period. Such information was also pro- vided by Eurafricans, who were most strongly present in Casamance and the Cacheu-Bissau area.3 Moreover, European officials managed commercial fac- tories on Senegalese land for centuries, starting as early as the sixteenth cen- tury, although their interest was often focused more on the acquisition of slaves and less on the concrete political realities in the hinterland. -

IA Fatick Collège Moyen Secondaire
ELECTIONS DE REPRESENTATIVITE SYNDICALE DANS LE SECTEUR DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION COLLEGE MOYEN SECONDAIRE IA FATICK MATRICULE PRENOMS ENSEIGNANT NOM ENSEIGNANTDATE NAISS ENSEIGNANTLIEU NAISSANCE ENSEIGNANTSEXE CNI NOM ETABLISSEMENT IEF DEPT REGION 201103001/Z ALIOUNE AW 1978-11-19 00:00:00Dakar M 1756197803543 CEM BOUCAR DIOUF DE SENGHOR IEF Diofior Fatick Fatick 201207009/C ABDOUL HOUDOUSSE BA 1984-11-25 00:00:00Dakar M 1755200101003 CEM BOUCAR DIOUF DE SENGHOR IEF Diofior Fatick Fatick 200602077/F BINETA BAKHOUM 1981-12-20 00:00:00SIMAL F 2570199205058 CEM BOUCAR DIOUF DE SENGHOR IEF Diofior Fatick Fatick 200903023/I AWA DATTE 1986-10-30 00:00:00FATICK F 2425198600878 CEM BOUCAR DIOUF DE SENGHOR IEF Diofior Fatick Fatick 646853/B MAMADOU YACINE DIALLO 1980-06-10 00:00:00Marsassoum M 1170199201812 CEM BOUCAR DIOUF DE SENGHOR IEF Diofior Fatick Fatick 201014040/D ISSA COLY DIAM 1989-03-24 00:00:00Joal Fadiouth M 1595198900242 CEM BOUCAR DIOUF DE SENGHOR IEF Diofior Fatick Fatick 201003049/E Mouhamadou Moustapha DIAW 1986-01-21 00:00:00Tattaguine M 1589199700832 CEM BOUCAR DIOUF DE SENGHOR IEF Diofior Fatick Fatick 200609308/B JEAN DIOME 1981-03-03 00:00:00Ndiaganiao M 1598199209375 CEM BOUCAR DIOUF DE SENGHOR IEF Diofior Fatick Fatick 200903054/K Assane DIONGUE 1973-10-17 00:00:00Darou Gueye M 15931985001972 CEM BOUCAR DIOUF DE SENGHOR IEF Diofior Fatick Fatick 200803206/A ALIOUNE BADARA DIOP 1981-10-11 00:00:00FATICK M 1425198101045 CEM BOUCAR DIOUF DE SENGHOR IEF Diofior Fatick Fatick 200803167/G GORA NDIAYE DIOP 1983-04-07 -

Bodenrechtswandel Bei Den Sereer Ndut Im Westlichen Senegal Institut
Institut für Ethnologie und Afrikastudien Department of Anthropology and African Studies Arbeitspapiere / Working Papers Nr. 99 Bernhard Martin Wer ist der rechtmässige Erbe? Bodenrechtswandel bei den Sereer Ndut im westlichen Senegal 2009 The Working Papers are edited by Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Johannes Gutenberg-Universität, Forum 6, D-55099 Mainz, Germany. Tel. +49-6131-3923720; Email: [email protected]; http://www.ifeas.uni-mainz.de http://www.ifeas.uni-mainz.de/workingpapers/Arbeitspapiere.html Geschäftsführende Herausgeberin/ Managing Editor: Eva Spies ([email protected]) Vorwort Der vorliegende Text stellt die überarbeitete Version meiner im Oktober 2006 am Institut für Ethnologie und Afrikastudien der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vorgelegten Magis- terarbeit dar. Ich danke Herrn Prof. Dr. Thomas Bierschenk und Frau Prof. Dr. Carola Lentz für seine Aufnahme in die Reihe der „Arbeitspapiere“ des Instituts. Grundlage der Arbeit ist eine langjährige Beschäftigung mit den Sereer Ndut, einer kleinen Volksgruppe im westlichen Senegal. Die ersten Kontakte zu ihnen konnte ich während eines deutsch-österreichisch-senegalesischen Jugendaustausches im Jahre 1999 knüpfen. Zwei Jahre später folgte ein einmonatiger Aufenthalt in der Region zwecks Vorbereitung der Feld- forschung. 2003 begannen dann die eigentlichen Forschungsarbeiten zu den Themen Agrar- und Bodenrechtswandel, die sich mit Unterbrechungen über insgesamt dreizehn Monate bis zum Frühjahr 2006 erstreckten. Die Ergebnisse dieser Forschung werden zu einem Teil in dieser Magisterarbeit, zu einem anderen Teil in der derzeit in der Abfassung begriffenen Di- plomarbeit am Geographischen Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz unter dem Titel „Zeit der Hirse – Zeit des Reises. Agrarwandel und Agrarkrise bei den Sereer Ndut im westlichen Senegal“ dargestellt, die von Frau Prof.