Raoul GRESSIER
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sentier-Des-Briqueteries.Pdf
Boucle 13:Boucle 13.qxd 26/05/11 11:26 Page 1 Cafés - Restaurants Hôtellerie - Hébergement 1 3 Les autres boucles de la communauté de communes : Producteurs locaux D 11 N 1 3 SENTIER DES WIDEHEM Saint-Josse Cafés, restaurant. 940 D Hôtel, gîte et chambres d’hôtes . BRIQUETERIES STE-CSTE- ÉCILE CAMIERS D 148 6 Saint-Aubin Café en centre-ville. FRENCQ CORMONT Auberge. Au pays de Saint-Josse-sur-Mer, il y Produits du terroir. ONGVILLIERS LEFAUXL a des églises, des saints et de nombreuses légendes. C’est une MARESVILLEE E tradition culturelle que le Pélerinage de la marine à St-Josse 3 LEE TOUQUETTTOOUQUET 1 pèlerinage de Pentecôte D 1 TUTUUBBERSENTB T 1 PARARIS-PLAS-PLAGE ÉTAPLES N 6 1 pendant lequel les marins A in Depuis des décennies, les populations maritimes d’Etaples p e N 39 d’Etaples viennent consacrer le Witr et de Berck participent le mardi de Pentecôte à la la Can BRÉXENT-ENOCQ che leurs bateaux et portent à procession de Bavémont et le dimanche de la Sainte Trinité l travers champs la châsse 0 N 39 à la Croix Coupée. 94 D du Saint. Car la mer est D 144 passée à Saint-Josse, Durant leur pélerinage, les marins vont graver dans la craie VILLIERS taillée du mur nord du choeur de l’église Saint-Josse, STESTELLA-PLAGGEG au Moyen-âge, avant C l’ensablement de l’es- des dizaines de numéros d’immatriculation de bateaux ST-JOSST-JOSSE de pêche, de noms propres et d’initiales. Tous ces graffiti tuaire de la Canche et MERLIMORLIMONTNNT MONTREUIL PLAGEGEE sa trace est restée sont en réalité des ex-voto marins par lesquels les hommes 14 D 918 vivante dans les implorent la protection divine du Saint, eux qui côtoient M LIIMM ST-AUBIN traditions. -

Au Service De La Ressource En Eau Et Des Milieux Aquatiques Du Bassin
Au service de la ressource en eau et des milieux aquatiques du bassin versant de la Canche AIRON-NOTRE-DAME B 1 BERLENCOURT-LE-CAUROY D 5 CAMPAGNE-LES-HESDIN C 2 ENQUIN-SUR-BAILLONS A 2 COURSET AIRON-SAINT-VAAST B 1 BERMICOURT C 4 CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES B 1 EPS B 4 AIX-EN-ISSART B 2 BERNIEULLES A 2 CAMPIGNEULLES-LES-PETITES B 2 EQUIRRE B 4 ALETTE B 2 BEUSSENT A 2 CANETTEMONT D 5 ERIN B 4 AMBRICOURT B 4 BEUTIN B 2 CAVRON-SAINT-MARTIN B 3 ESTREE B 2 DOUDEAUVILLE AMBRINES C 5 BEZINGHEM A 2 CLENLEU B 2 ESTREELLES B 2 ANVIN B 4 BIMONT A 2 CONCHY-SUR-CANCHE C 4 ESTREE-WAMIN D 5 ATTIN B 2 BLANGERVAL-BLANGERMONT C 4 CONTES B 3 ETAPLES B 1 ourse AUBIN-SAINT-VAAST C 3 BLANGY-SUR-TERNOISE B 4 CONTEVILLE-EN-TERNOIS B 5 FIEFS B 5 HALINGHEN LACRES AUBROMETZ C 4 BLINGEL C 4 CORMONT A 2 FILLIEVRES C 4 La C BEZINGHEM AUCHY-LES-HESDIN C 3 BOISJEAN C 2 COURSET A 2 FLERS C 4 PARENTY AVERDOINGT C 5 BONNIERES D 4 CREPY B 4 FLEURY B 4 AVONDANCE B 3 BOUBERS-LES-HESMOND B 3 CREQUY B 3 FONTAINE-LES-BOULANS B 4 A WIDEHEM HUBERSENT PREURES AZINCOURT B 4 BOUBERS-SUR-CANCHE C 4 CROISETTE C 4 FOUFFLIN-RICAMETZ C 5 ENQUIN- BAILLEUL-AUX-CORNAILLES C 5 BOURET-SUR-CANCHE D 5 CROIX-EN-TERNOIS C 4 FRAMECOURT C 5 SUR-BAILLONS CORMONT BEALENCOURT B 4 BOYAVAL B 5 CUCQ B 1 FRENCQ A 1 HUCQUELIERS Les Baillons BEAUDRICOURT D 5 BREXENT-ENOCQ B 2 DENIER C 5 FRESNOY C 4 BEAUFORT-BLAVINCOURT D 5 BRIMEUX B 2 DOUDEAUVILLE A 2 FRESSIN B 3 FRENCQ BEUSSENT in BERNIEULLES BEAUMERIE-SAINT-MARTIN B 2 BRIAS C 5 ECLIMEUX C 4 FREVENT D 4 p BEAURAINVILLE B 2 BUIRE-LE-SEC C 2 ECOIVRES C 4 GALAMETZ -

Calendrier HIVER 2021
CIRCUIT N° 1 CIRCUIT N° 2 CIRCUIT N°3 CIRCUIT N° 4 Groupe 1 56 km groupe 2 50 KM Groupe 1 73 KM Groupe 2 60km Groupe 1 68 km Groupe 2 55km Groupe 1 72 km Groupe 2 60km BERCK BERCK BERCK BERCK RANG ETAPLES VERTON COLLINE VILLERS/A VERTON BEUTIN CONCHIL COLLINE B. QUEND VRON LE BAHOT EBRUYERES VALENCENDRE ST JOSSE COLLINE FESNES RUE ARGOULES BOIS JEAN ROUSSENT SORRUS MERLIMONT FRESNES NAMPONT VILLERS NAMPONT ROUSSENT NEMPONT ST JOSSE RANG NAMPONT ARGOULES VRON FRESNES NEMPONT TIGNY MERLIMONT VERTON ARGOULES VALLOIRES REGNIERES COLLINE NAMPONT RANG WABEN DOMPIERRE MAINTENAY MACHY FRESNES VERTON COLLINE RAPECHY VIRONCHAUX COLLINE EBRUYERES EMOFER ROUSSENT LA CAPELETTE TIGNY PUITS BERAULT WABEN PUITS BERAULT NAMPONT NOYELLES LEPINE EBRUYERES CONCHIL A GAUCHE D 940 COLLINE LE BAHOT VERTON CONCHIL VERTON VERTON BERCK EMOFER GROFFLIERS BERCK VERTON BERCK BERCK CIRCUIT N° 5 CIRCUIT N° 6 CIRCUIT N° 7 CIRCUIT N° 8 Groupe1 67 km groupe 2 50 km Groupe 1 68 km Groupe 2 55km Groupe 1 72 km Groupe 2 55km Groupe 1 65 km Groupe 2 60 km GROFFLIERS MERLIMONT BERCK BERCK LA MADELON CAPELLE LA MADELON VERTON RANG WABEN CUCQ WABEN RANG AIRRON ND ST AUBIN RUE ETAPLES D 940 VERTON AIRON ST V, SORRUS SORRUS ST FIRMIN CAMIERS CAMIERS BAVEMONT SORRUS VALENCENDRE VALENCENDRE LE CROTOY RUE DANNES ETAPLES AIRON ST VAST LA CALOTTERIE ATTIN BEUTIN MORLAY VILLERS/A NEUFCHATEL ENOCQ ST AUBIN BEUTIN MONTREUIL ATTIN PONTHOILE NESLES SORRUS VALENCENDRE ECUIRES ECUIRES NEUVILLE FRENQ LA CALOTTERIE SORRUS BOIS JEAN BOISJEAN RUE LE MOTTE BEUTIN ST AUBIN ROUSSENT WAILLY B. -

Liste Des Communes Situées Sur Une Zone À Enjeu Eau Potable
Liste des communes situées sur une zone à enjeu eau potable Enjeu eau Nom commune Code INSEE potable ABANCOURT 59001 Oui ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Oui ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Oui ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Oui ACHICOURT 62004 Oui ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Oui ADINFER 62009 Oui AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Oui AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Oui AIBES 59003 Oui AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Oui AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Oui AIRON-NOTRE-DAME 62015 Oui AIRON-SAINT-VAAST 62016 Oui AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Oui AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Oui ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Oui ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non Page 1/59 Liste des communes situées sur une zone à enjeu eau potable Enjeu eau Nom commune Code INSEE potable ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Oui ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Oui ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Oui AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Oui AMY 60011 Oui ANDAINVILLE 80022 Non ANDECHY 80023 Oui ANDRES 62031 Oui ANGRES 62032 Oui ANHIERS 59007 Non ANICHE 59008 Oui ANNAY 62033 -

CORMONT Le Relais De Poste
BEUTIN L' Eglise Eglise dédiée à Saint-Léger ou Leodegar, évêque d'Autun au VII e siècle. Elle fut paroisse jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Le titre curial fut ensuite transféré à Attin. Elle se compose d’une nef sans grand intérêt (payé par les villageois) et d’un chœur datant du commencement du XVIe siècle (payé par le seigneur). Un campenard à une ouïe surmonte un arc triomphal très épais. Il y avait un autre portail latéral au nord de la nef, aujourd’hui muré. Le chœur, très exigu (un peu + de 7 m de long sur 3,75m de large) est bâti en craie taillée. Il forme deux travées et se termine par un chevet à trois pans. Le tout est voûté de deux croisées d’ogive. Les deux clefs de voûte sont aux armes des Halluin, seigneurs d’Attin et de Beutin au XVIe siècle. Ils permettent de situer la construction de l’édifice avant 1542. Les cinq fenêtres sont en tiers-point, dépourvues d’archivoltes mais trilobées dans le haut. Celles de la 1 ère travée ont été percées après coup. Elles sont taillées à même le mur, tandis que les trois autres ont un cintre appareillé. Un petit portail en anse de panier s’ouvrait dans la 1 ère travée nord et l’on voit que la première fenêtre empiète sur son arcade. Les soubassements en grès et silex sont très irréguliers. La statue de la Vierge-mère (?) est un bois du XVIe siècle. Le village est référencé depuis 1042. On disait que les quais de l’ancien port de Montreuil allaient jusqu’à Beutin (1 lieue). -

Service Assainissement Des Eaux Usées
Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois– Pôle opérationnel- Service de l’eau-assainissement 11-13 place Gambetta 62170 MONTREUIL-SUR-MER Téléphone : 03-21-06-66-66 RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT. EXERCICE 2017 A- Présentation du service : Le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois (CA2BM) a pris la compétence assainissement en lieu et place des services de la Communauté de Communes Opale Sud (CCOS), du SIVOM de la région d’ETAPLES et de la Communauté de Communes du Montreuillois (CCM). Le service est composé de deux entités : Service public d’assainissement collectif sur 24 communes Service public d’assainissement non collectif sur 22 communes. Il est géré par 14 personnes réparties comme suit : - Un directeur de service - Une responsable administrative et financière avec 2 agents administratifs - Un responsable technique avec 9 agents techniques. B- Zonage collectif : 1 – Caractéristiques techniques : Le service gère 4 stations d’épuration situées : BERCK-SUR-MER : 63 équivalent/habitants pour 11 260 abonnés. Les communes de BERCK-SUR-MER, RANG-DU-FLIERS, GROFFLIERS et VERTON possèdent un réseau de collecte des eaux usées de 100 kms raccordé à cette usine épuratoire. La gestion des réseaux et de la station a été confié à VEOLIA EAU par l’intermédiaire de 2 contrats de délégation : Un contrat pour la Commune de Verton concernant uniquement la gestion des réseaux. Ce dernier a été renégocié en 2013 et arrive à échéance le 30 Novembre 2021. Un contrat général pour les Communes de Groffliers, Rang-du-Fliers et Berck- sur-mer concernant la gestion des réseaux et de l’usine épuratoire. -

Saveurs Savoir-Faire
Saveurs & savoir-faire en Côte d’Opale GUIDE 2020 des producteurs locaux Edito En cette année particulière, le confinement nous a fait redécouvrir nos producteurs locaux et combien nous avons besoin d’eux. Parce qu’ils sont gage de proximité, de qualité mais aussi de convivialité et de partage. Avec ce nouveau rapport au temps pendant cette longue parenthèse, petits et grands, parents et enfants se sont réappropriés les plaisirs simples d’une recette partagée, réalisée avec de bons produits. Retrouvez tous les producteurs agricoles et artisanaux dans ce guide, pour faciliter l’approvisionnement de chacun, touriste ou habitant. Fromages, fruits et légumes, yaourts et autres produits laitiers, boissons, gourmandises, viandes et poissons, la gamme est large pour se faire plaisir, bien manger et soutenir notre économie locale. Même avec distanciation, les producteurs sauront vous accueillir pour vous faire découvrir et déguster leurs produits. Daniel Fasquelle Président de l’Agence d’Attractivité Opale&CO Les produits locaux font partie de la richesse et de l’identité des territoires. Pendant cette période inédite, les agriculteurs ont montré leur capacité d’adaptation pour continuer de produire et vous approvisionner en produits locaux de qualité. Nous sommes heureux de leur mise en lumière à travers ce guide «Saveurs et Savoir Faire» réalisé par Opale&Co. A nous citoyens, d’être consomm’acteurs afin de faire vivre nos producteurs et artisans. Sur les marchés, dans les magasins, en direct à la ferme, via des distributeurs automatiques ou encore avec le Drive fermier du Montreuillois, les agriculteurs vous donnent rendez-vous tout au long de l’année pour vous proposer leurs produits pleins de saveurs. -

AAP SNEE « Socle Numérique Dans Les Écoles Élémentaires Par Commune » Mai 2021 Liste Des Écoles Sélectionnées
AAP SNEE « socle numérique dans les écoles élémentaires par commune » mai 2021 Liste des écoles sélectionnées Région académique ou Identifiant unqiue Académie Département Raison sociale du déposant Commune COM de l'école (UAI) Auvergne‐Rhône‐Alpes Clermont‐Ferrand 03 ‐ Allier COMMUNE DE NEUILLY LE REAL Neuilly‐le‐Réal(03197) 0030342F Auvergne‐Rhône‐Alpes Clermont‐Ferrand 03 ‐ Allier COMMUNE DE QUINSSAINES Quinssaines(03212) 0030267Z Auvergne‐Rhône‐Alpes Clermont‐Ferrand 03 ‐ Allier COMMUNE DE MONTAIGU LE BLIN Montaigu‐le‐Blin(03179) 0030356W Auvergne‐Rhône‐Alpes Clermont‐Ferrand 03 ‐ Allier COMMUNE DE PREMILHAT Prémilhat(03211) 0030989J Auvergne‐Rhône‐Alpes Clermont‐Ferrand 03 ‐ Allier COMMUNE DE DIOU Diou(03100) 0030928T Auvergne‐Rhône‐Alpes Clermont‐Ferrand 03 ‐ Allier COMMUNE DE LIGNEROLLES Lignerolles(03145) 0030403X Auvergne‐Rhône‐Alpes Clermont‐Ferrand 03 ‐ Allier COMMUNE DE CHAMBERAT Chambérat(03051) 0030664F Saint‐Rémy‐en‐ Auvergne‐Rhône‐Alpes Clermont‐Ferrand 03 ‐ Allier COMMUNE DE ST REMY EN ROLLAT 0030158F Rollat(03258) Auvergne‐Rhône‐Alpes Clermont‐Ferrand 03 ‐ Allier COMMUNE DE ARRONNES Arronnes(03008) 0030716M SI REGR PEDAG SAUVIER ARCHIGNAT Auvergne‐Rhône‐Alpes Clermont‐Ferrand 03 ‐ Allier Archignat(03005) 0030709E TREIGNAT SI REGR PEDAG SAUVIER ARCHIGNAT Auvergne‐Rhône‐Alpes Clermont‐Ferrand 03 ‐ Allier Saint‐Sauvier(03259) 0030160H TREIGNAT SI REGR PEDAG SAUVIER ARCHIGNAT Auvergne‐Rhône‐Alpes Clermont‐Ferrand 03 ‐ Allier Treignat(03288) 0030233M TREIGNAT SIRP DE DEUX CHAISES LE MONTET Auvergne‐Rhône‐Alpes Clermont‐Ferrand -

La Gestion De L'eau Milieux Aquatiques Bassin Versant De La Canche
LaLa gestiongestion dede l’eaul’eau etet desdes milieuxmilieux aquatiquesaquatiques dudu bassinbassin versantversant dede lala CancheCanche Syndicat Mixte Canche et Affluents 19 Place d’Armes 62 140 Hesdin 03 21 06 24 89 - [email protected] www.symcea.fr Edito a gestion de l’eau est un domaine vaste et complexe qui concerne et implique de nombreux acteurs. Au lendemain d’un récent renouvellement au niveau communal, retracer les grandes lignes de ce schéma me semblait important et c’est pourquoi, je vous propose de parcourir ce livret qui vous fera découvrir ou re-découvrir le cheminement de l’eau au sein d’un bassin versant. LEn effet, c’est bien le bassin versant qui régit la gestion de l’eau en Europe et en France et qui se décline jusqu’aux bassins plus modestes comme celui de la Canche. Ce territoire est le lieu d’une démarche au long cours initiée par la Commission Locale de l’Eau (CLE) depuis 2000 et portée par le Syndicat Mixte Canche et Affluents (Symcéa). Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) ayant permis d’identifier les enjeux et les objectifs à atteindre en cohérence avec les obligations européennes et nationales. Des opérations et actions sont mises en oeuvre pour préserver l’eau, cette ressource essentielle, ainsi que les milieux aquatiques. L’enjeu est surtout de connecter l’ensemble des acteurs de ce territoire de l’eau et de les fédérer pour optimiser l’atteinte des objectifs. La solidarité à l’échelle du bassin versant de la Canche est un des piliers de l’action de la CLE et du Symcéa mais ne peut fonctionner que si chaque partie s’engage et contribue à ce projet. -

Liste Montreuil 2010
ELECTIONS DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX LISTE ELECTORALE PROVISOIRE DES PRENEURS N° DATE DE COMMUNE NOM OU SOCIETE NOM DE NAISSANCE PRENOM ADRESSE CPOST ORDRE NAISSANCE D'INSCRIPTION 2 LACHERE Guillaume 30/09/1975 26 Rue Principale 62180 AIRON NOTRE DAME 4 LEBLOND Guy 08/02/1951 34 Rue du Bas 62180 AIRON NOTRE DAME 1 DUPONT Dominique 16/09/1952 2 Rue du Marais 62180 AIRON NOTRE DAME 3 LAMADON Yves 01/11/1949 2 Rue de la Petite Tringue 62180 AIRON NOTRE DAME 0 ELECTIONS DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX LISTE ELECTORALE PROVISOIRE DES PRENEURS N° DATE DE COMMUNE NOM OU SOCIETE NOM DE NAISSANCE PRENOM ADRESSE CPOST ORDRE NAISSANCE D'INSCRIPTION 5 LECLERCQ Stephane 29/10/1963 58 Impasse St Georges 62180 AIRON SAINT VAAST 2 BETHOUART Luc 06/04/1950 327 Henri Béthouart 62180 AIRON SAINT VAAST 1 BETHOUART Bernard 04/03/1950 1 Rue de Bavemont 62180 AIRON SAINT VAAST 6 MERLOT Thierry 16/02/1973 218 Henri Béthouart 62180 AIRON SAINT VAAST 4 DELATTRE Rémi 22/05/1980 769 Henri Béthouart 62180 AIRON SAINT VAAST 3 DELATTRE BOITEL Marie-José 04/11/1954 769 Henri Béthouart 62180 AIRON SAINT VAAST 0 ELECTIONS DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX LISTE ELECTORALE PROVISOIRE DES PRENEURS N° DATE DE COMMUNE NOM OU SOCIETE NOM DE NAISSANCE PRENOM ADRESSE CPOST ORDRE NAISSANCE D'INSCRIPTION 1 GILLET David 02/10/1973 120 Rue de l'Eglise 62650 AIX EN ERGNY 4 ROUSSEL Hervé 09/05/1961 269 Rue du Tronquoy 62650 AIX EN ERGNY 3 GILLIOT Bernard 04/06/1955 15 Rue du Haut Pays 62650 AIX EN ERGNY 2 GILLIOT Antoine 11/05/1949 207 Rue du Haut Pays -
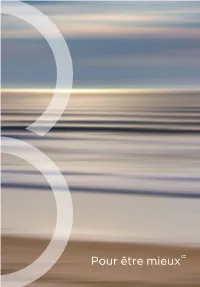
Pour Être Mieux Dir
Pour être mieux Dir. Boulogne-sur-Mer Calais - Bruxelles - Londres BECOURT CAMPAGNE LES-BOULONNAIS 27 ZOTEUX D131 Boulonnais D131 BOURTHES D127E D125 BEZINGHEM A D343 a D156 WIDEHEM HUBERSENT D150 D148E PARENTY D128 D132 D127 ERGNY AIX D940 D148 D156E EN -ERGNY RUMILLY D146E WICQUINGHEM D113 PREURES CAMIERS ENQUIN D148 SUR-BAILLONS CAMIERS D129E D147E se D127 ur VERCHOCQ SAINTE-CECILE D147 Co HUCQUELIERS FRENCQ D131E CORMONT MENCAS D92 BERNIEULLES D150 VINCLY D128 D146 D146E D147 D133 D152 HERLY AVESNES D104 BEUSSENT BIMONT MATRINGHEM MANINGHEM D928 D940 RADINGHEM LEFAUX D129E D133 LONGVILLIERS D151 D126 D148 INXENT D152E D133E M D148 D156 D343 D152 D126 D129 D155E HEZECQUES SENLIS D145 MARESVILLE QUILEN ETAPLES D150 D104 SUR-MER D343 TUBERSENT ois Bim e D149 D113 CLENLEU D901 MONTCAVREL D151E SAINT-MICHEL COUPELLE RECQUES D129E D343 LUGY SOUS-BOIS VIEILLE D130 SUR-COURSE D108 ne ALETTE L D149 e n Trax y D127 LE TOUQUET s M 26 D155 PARIS-PLAGE D149 D93 C BREXENT e RIMBOVAL FRUGES an D146E n ch ENOCQ on e Br D130 ESTREELLES e d HUMBERT D104 D146 D129s Bra D153 D143 ESTREE COUPELLE NEUVE D343 D113 EMBRY CREQUY ne VERCHIN BEUTIN D126 n STELLA D139 e ATTIN D150 ri LA MANCHE LA b PLAGE D144 D155 D144 m E TORCY D154 CANLERS D144 D104 CUCQ LA CALOTERIE RUISSEAUVILLE TREPIED-STELLA NEUVILLE ROYON D71E SOUS-MONTREUIL D130 AVONDANCE LA MADELAINE 7 Vallées SOUS-MONTREUIL CREPY D343 D154 D940 e is SAINS AMBRICOURT SAINT-JOSSE équo LEBIEZ Ternois r LES-FRESSIN D144E C PLANQUES MERLIMONT SORRUS D144 M D144E MERLIMONT SAINT-AUBIN D108 MONTREUIL BEAUMERIED138 -

[Mémoires De La Société Académique De L'arrondissement De Boulogne
MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DEL'ARRONDISSEMENTDEBOULOGNE-SUR-MER MEMOIRES DE LA SOCIETE ACADÉMIQUE DE L'ARRONDISSEMENT DE BOULOGNE-SUR-MER TOMEXI BOULOGNE-SUR-MER IMPRIMERIE VEUVE CHARLES AIGRE 4, EUEDESVIEILLARDS — r 1881 ITIMITMMPHII DE LA FRANCE / COMPEENANT LES NOMS DE LIEUX ANCIENS ET MODERNES ARRONDISSEMENT DE BOULOGNE-SUR-MER Par M. l'Abbé D. HAIGNERÉ EX-ARCHIVISTEDELAVILLEDEBOULOGNE SECRÉTAIREPERPÉTUELDELASOCIETEACADÉMIQUE ' Ouvragequi a obtenule SecondPrix au Concoursdes SociétésSavantes,le 25novembre1861 BOULOGNE-SUR-MER IMPRIMERIE VEUVE CHARLES AIGRE 4, BUEDESVIEILLARDS 1881. iH. 3/Lonsieur . ALEXANDRE A.DÀM Commandeur de la Légion d'honneur Ancien maire de Boulogne Président honoraire.de la Société d'Agriculture ^Monsieur, C'est à vous qu'appartient la dédicace de cet ouvrage, dont vous ave\ provoqué Vexécution et dont nous avons tous deux partagé l'honneur, le 25 no- vembre 1861, dans le grand amphithéâtre de 'la Sorbonne. Je ne puis donc aujourd'hui le publier sans que votre nom y soit inscrit à la première page, pour témoigner de ma gratitude envers le Magistrat êminent, l'Administrateur aux vues larges et pro- fondément libérales, dont je n'oublierai jamais la haute bienveillance à mon égard. Daigne^ agréer, Monsieur, le respectueux hommage des sentiments dévoués avec lesquelsje suis, Votre très humble et très reconnaissant serviteur, D. HAIGNERÉ Ex-archivistedelavilledeBoulogne, Curé-desservantdeMenneville, Ofiieierd'Académie. LETTEE DE FÉLICITATIONS Adressée à VAuteur Par Mgr PARI SI S cMon cher abbé Haigneré, Les ornements des églises matérielles sont divers et c'est leur ensemble harmonieux qui en fait la beauté. Ainsi en est-il de la fcloire d'un diocèse, et il est hors de doute que les distinctions qui y sont dé- cernées à des hommes d'études sérieuses et d'érudition profonde lui donnent un lustre utile même à la Religion dans ce siècle superficiel.