Plan Local D'urbanisme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE ET LES VALLÉES CONSÉQUENTES DE PONT-AUDEMER À LA SEINE (Identifiant National : 230009161)
Date d'édition : 27/10/2020 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009161 LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE ET LES VALLÉES CONSÉQUENTES DE PONT-AUDEMER À LA SEINE (Identifiant national : 230009161) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 8704) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 230009161, LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE ET LES VALLÉES CONSÉQUENTES DE PONT-AUDEMER À LA SEINE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 44P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009161.pdf Région en charge de la zone : Haute-Normandie Rédacteur(s) :SAVINI J-R Centroïde calculé : 460908°-2489651° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 01/09/2016 Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020 Date de première diffusion INPN : 23/10/2020 Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 8 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 8 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 8 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 9 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

Aclou Condé-Sur-Risle Malleville-Sur-Le-Bec Aizier
Communes du ressort du tribunal d'instance de BERNAY Aclou Condé-sur-Risle Malleville-sur-le-Bec Aizier Conteville Malouy Appeville-Annebault Cormeilles Manneville-la-Raoult Asnières Corneville-la-Fouquetière Manneville-sur-Risle Authou Corneville-sur-Risle Marais-Vernier Bailleul-la-Vallée Courbépine Martainville Barc Drucourt Mélicourt Barneville-sur-Seine Duranville Menneval Barquet Écaquelon Mesnil-en-Ouche Barville Écardenville-la-Campagne Mesnil-Rousset Bazoques Épaignes Montfort-sur-Risle Beaumontel Épreville-en-Lieuvin Montreuil-l'Argillé Beaumont-le-Roger Étréville Monts du Roumois Bec-Hellouin Éturqueraye Morainville-Jouveaux Bernay Fatouville-Grestain Morsan Berthouville Favril Nassandres sur Risle Berville-la-Campagne Ferrières-Saint-Hilaire Neuville-du-Bosc Berville-sur-Mer Fiquefleur-Équainville Neuville-sur-Authou Beuzeville Flancourt-Crescy-en-Roumois Noards Bois-Hellain Folleville Noë-Poulain Boisney Fontaine-l'Abbé Notre-Dame-d'Épine Boissey-le-Châtel Fontaine-la-Louvet Notre-Dame-du-Hamel Boissy-Lamberville Fort-Moville Noyer-en-Ouche Bonneville-Aptot Foulbec Piencourt Bosgouet Fourmetot Places Bosrobert Franqueville Plainville Bosroumois Freneuse-sur-Risle Planquay Boulleville Fresne-Cauverville Plasnes Bouquelon Giverville Plessis-Sainte-Opportune Bouquetot Glos-sur-Risle Pont-Audemer Bourg-Achard Goulafrière Pont-Authou Bournainville-Faverolles Goupillières Poterie-Mathieu Bourneville-Sainte-Croix Grand Bourgtheroulde Préaux Bray Grand-Camp Quillebeuf-sur-Seine Brestot Grosley-sur-Risle Romilly-la-Puthenaye Brétigny -

Liste Communes 3Eme Circo 19062020
Aizier Appeville-Annebault Asnières Authou Bailleul-la-Vallée Barneville-sur-Seine Barville Bazoques Bernay Berville-sur-Mer Beuzeville Boissy-Lamberville Bonneville-Aptot Bosgouet Boulleville Bouquelon Bouquetot Bourg-Achard Bournainville-Faverolles Bourneville-Sainte-Croix Brestot Broglie Campigny Caorches-Saint-Nicolas Capelle-les-Grands Caumont Cauverville-en-Roumois Chamblac Chapelle-Bayvel Chapelle-Gauthier Chapelle-Hareng Colletot Condé-sur-Risle Conteville Cormeilles Corneville-la-Fouquetière Corneville-sur-Risle Courbépine Drucourt Duranville Écaquelon Épaignnes Épreville-en-Lieuvin Étreville Éturqueraye Fatouville-Grestain Ferrières-Saint-Hilaire Fiquefleur-Équainville Folleville Fontaine-l'Abbé Fontaine-la-Louvet Fort-Moville Foulbec Freneuse-sur-Risle Fresne-Cauverville Giverville Glos-sur-Risle Goulafrière Grand-Camp Hauville Heudreville-en-Lieuvin Honguemare-Guénouville Illeville-sur-Montfort La Haye-Aubrée La Haye-de-Routot La Lande-Saint-Léger La Noé-Poulain La Poterie-Mathieu La Trinité-de-Réville La Trinité-de-Thouberville Le Bois-Hellain Le Favril Le Landin Le Mesnil-Saint-Jean Le Noyer-en-Ouche Le Perrey Le Planquay Le Thiel-Nolent Le Torpt Les Places Les Préaux Lieurey Malouy Manneville-la-Raoult Manneville-sur-Risle Marais-Vernier Martainville Mélicourt Menneval Mesnil-en-Ouche Mesnil-Rousset Montfort-sur-Risle Montreuil-l'Argillé Morainville-Jouveaux Nassandres-sur-Risle Noards Notre-Dame-du-Hamel Piencourt Plainville Plasnes Pont-Audemer Pont-Authou Quillebeuf-sur-Seine Rougemontiers Routot Saint-Agnan-de-Cernières -

Télécharger La Carte De Randonnées
Crédits photos : Grégory Wait / Calvados Attractivité / Calvados Crédits photos : Grégory Wait / / by feet by pied à 2h00 / / by feet by pied à / / 96m by feet by pied à / / / by feet by pied à feet by pied à 53% 3h00 2h15 40m 1h45 3h00 90m 70% 60m 117m 47% 47% 38% circuits Inglemare. press. house of Carbec, Christian cross and pond of of pond and cross Christian Carbec, of house plain and the valley. the and plain on the estuary, and the Risle Valley, authentic cider cider authentic Valley, Risle the and estuary, the on - wash and source chapel,miraculous Pommeraye, thatched cottages, landscapes alternating the the alternating landscapes cottages, thatched fontaine du Pré, paths in balcony with panoramas panoramas with balcony in paths Pré, du fontaine 27 the of castle estuary, the on views Panoramic the town. the alluvium of the Seine. Educational panels. Educational Seine. the of alluvium stream, springs and wash-house, many many wash-house, and springs stream, trees and poplars with a special cut, edges of Risle, Risle, of edges cut, special a with poplars and trees Crédits photos : Grégory Wait / Calvados Attractivité / Calvados Crédits photos : Grégory Wait Seine. river the on navigation guided century 19th the forest walk, beautiful thatched cottages near near cottages thatched beautiful walk, forest environments, preserved site. Walk on the on Walk site. preserved environments, Panoramas on the Val Durand, fording on the the on fording Durand, Val the on Panoramas Marsh of the maritime Risle with many willows, ash ash willows, many with Risle maritime the of Marsh Classified historical monument, the old lighthouse of of lighthouse old the monument, historical Classified Panoramic views along the hillside la Brûlette, Brûlette, la hillside the along views Panoramic Panoramas on the Seine, mosaic of natural of mosaic Seine, the on Panoramas authentique pressoir. -

Liste Des Communes Dans Les Bassins Versants
NOM DES COMMUNES N° INSEE Bassins-Zones d'alerte ACLOU 27001 Risle aval ACON 27002 Avre moyen ACQUIGNY 27003 Iton aval AIGLEVILLE 27004 Eure moyenne AILLY 27005 Eure moyenne AIZIER 27006 Risle aval AJOU 27007 Risle amont ALIZAY 27008 Andelle AMBENAY 27009 Risle amont AMECOURT 27010 Epte AMFREVILLE-LA-CAMPAGNE 27011 Risle aval AMFREVILLE-LES-CHAMPS 27012 Andelle AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS 27013 Epte AMFREVILLE-SUR-ITON 27014 Iton aval ANDE 27015 Epte ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE 27017 Eure moyenne APPEVILLE-ANNEBAULT 27018 Risle aval ARMENTIERES-SUR-AVRE 27019 Avre amont ARNIERES-SUR-ITON 27020 Iton aval ASNIERES 27021 Calonne AUBEVOYE 27022 Eure moyenne AULNAY-SUR-ITON 27023 Iton aval AUTHEUIL-AUTHOUILLET 27025 Eure moyenne AUTHEVERNES 27026 Epte AUTHOU 27028 Risle aval AVIRON 27031 Iton aval AVRILLY 27032 Iton aval BACQUEPUIS 27033 Iton aval BACQUEVILLE 27034 Andelle BAILLEUL-LA-VALLEE 27035 Calonne BALINES 27036 Avre amont BARC 27037 Risle amont BARNEVILLE-SUR-SEINE 27039 Risle aval BARQUET 27040 Risle amont BARVILLE 27042 Calonne BAZINCOURT-SUR-EPTE 27045 Epte BAZOQUES 27046 Risle aval BEAUBRAY 27047 Iton amont BEAUFICEL-EN-LYONS 27048 Andelle BEAUMESNIL 27049 Risle amont BEAUMONTEL 27050 Risle amont BEAUMONT-LE-ROGER 27051 Risle amont BEMECOURT 27054 Iton amont BERENGEVILLE-LA-CAMPAGNE 27055 Iton aval BERNAY 27056 Charentonne NOM DES COMMUNES N° INSEE Bassins-Zones d'alerte BERNIENVILLE 27057 Risle aval BERNIERES-SUR-SEINE 27058 Eure moyenne BERNOUVILLE 27059 Epte BERTHENONVILLE 27060 Epte BERTHOUVILLE 27061 Risle aval BERVILLE-EN-ROUMOIS -

Lettre Reliquats Zone Vulnérable Mars 2019
8 mars 2019 Plan prévisionnel de fertilisation Pluviométrie du 1 er octobre 2018 au 31 janvier 2019 Source : Météo France et Arvalis Institut du Végétal Reliquats d'azote Références 2019 Pour assurer le calcul de la dose bilan d’azote dans votre Plan de Fumure Prévisionnel (PPF), il est nécessaire de disposer d’une estimation du stock d’azote minéral disponible dans le sol à la sortie de l’hiver : le reliquat azoté. Pour les parcelles n’ayant pas fait l’objet d’une mesure spécifique, ou pour les parcelles présentant des valeurs aberrantes (valeur du NH4 élevée supérieure à 20 kg N/ha), on se référera à des valeurs moyennes en fonction de la culture, voire du précédent et de la zone pluviométrique. Vous trouverez ci-dessous les valeurs moyennes 2019. Voir carte des communes (27) au verso Reliquat utilisable en kg N/ha selon la zone pluviométrique Zone 1 < 250 mm Zone 2 : 250 à 300 mm CULTURE Précèdent Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur 0-60 cm 0-90 cm 0-60 cm 0-90 cm Betteraves 34 (35) 45 (131) 27* 41 (52) Pomme de Terre 37* 66 (45) 29 (11) 36 (42) Céréale paille enfouie 29 (127) 43 (144) 24* 37 (19) Céréale Paille exportée 30 (66) 48 (89) Colza 34 (306) 57 (315) 28 (13) 44 (74) BLE Lin 27 (105) 49 (224) 28 (23) 35 (112) Féverole 33* 51* 27* 40* Pois 28 (42) 57 (48) 27* 44* Maïs Fourrage 34 (25) 60 (16) 25 (34) 40 (92) Maïs Grain 34 (24) 53 (13) 25* 37* Autres 32* 52* 27* 39* COLZA 23 (129) 29 (125) 22 (15) 25 (42) ESCOURGEON 24 (146) 43 (139) 24* 37 (45) AUTRES CULTURES D’HIVER 30* 50* 25* 35* Avec culture intermédiaire 40 (188) -
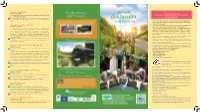
Un Ensemble Unique Un Beau Lavoir En Briques
Lavoir de Saint-Maclou N:49.350681° et E:0.415184° Un ensemble unique Un beau lavoir en briques. La source naît dans un superbe ouvrage d’art situé Unité architecturale. Implantation répondant à des règles communes. sous la ligne de chemin de fer. Visite originale et instructive. Revenir vers Toutainville sur 2,5 km. Tourner à droite vers « la fosse ». Prendre à droite après la voie ferrée. Au carrefour suivant, à droite. Rouler sur 1 km, à droite vers la vallée , à 100 m à droite (pis- ciculture). Ne pas jeter sur la voie publique. Édition 2014. Le canton de Beuzeville se situe sur un plateau crayeux, creusé par des vallées. Il est limité au Nord par la Seine, à l’Est par la Risle et la Morelle à l’Ouest. Au fond des vallées naissent de nombreuses sources. C’est là que l’on trouve les lavoirs. Lavoir de la pisciculture - Le Torpt Presque tous les villages du canton sont situés assez loin des lavoirs, à cause de l’humidité. Sur les 20 N:49.34458° et E:0.40500° lavoirs recensés, un seul est en plein village, au pied de l’église de Fique eur-Équainville. Ce lavoir est situé face à l’entrée de la pisciculture. Il est composé d’un Les lavoirs du canton ont presque tous un toit à double pentes (comme à Manneville-la-Raoult) ou bassin cimenté bien dégagé et sans couverture. Le lavoir a été la première à quatre pentes (comme à Beuzeville). Cela permettait de se protéger de la pluie tout en récupérant forme de l’utilisation de l’eau de la source par l’homme. -

DIPER I LISTE DES ECOLES 2 ET 3 CLASSES COMPOSANT LES SUPPORTS DE TITULAIRE REMPLACANT DE SECTEURS (TS) - Mouvement 2017
DIPER I LISTE DES ECOLES 2 ET 3 CLASSES COMPOSANT LES SUPPORTS DE TITULAIRE REMPLACANT DE SECTEURS (TS) - Mouvement 2017 - L'an dernier, des postes de titulaires remplaçants de secteurs (T.S.) ont été créés pour assurer le remplacement des décharges de direction des écoles de 2 et 3 classes. Ils sont publiés dans SIAM, sous l'appellation "TS". Ils constituent une fraction d'un poste fractionné. Ils sont classées par circonscription et par numéro de poste. Ils sont complétés par des décharges de direction, des compléments de temps partiel, ... Pour connaître la composition complète du poste, consulter la liste des postes fractionnés sur le portail métier. BERNAY 0271811X EEPU Franqueville Principal 0270064Y EMPU Les Fontaines Bernay 0,25 0271272L EMPU Bourg Lecomte Bernay 0270271Y EEPU Berthouville 0271146Z EEPU Goupillières /Goupil Othon Principal 0271340K EEPU Tilleul Othon 0,25 0271803N EMPU Le Plessis ste Opportune 0271843G EMPU Ecardenville 0270287R EEPU Neuville sur Authou Principal 0,12 0270333R EEPU st Aubin de Scellon 0271646T EMPU Bosrobert Principal 0271542E EEPU St Paul de Fourques 0,25 0271145Y EMPU Giverville 0271265D EEPU Boissy Lamberville 0270308N EEPUSt Aubin du Thenney Principal 0270295Z EMPU Broglie 0,25 0270251B EEPU Fontaine l'Abbé 0271349V EMPU Thiberville 0270246W EEPU Caorches St Nicolas Principal 0270265S EMPU St Victor de Chrétienville 0,25 0271244F EEPU Capelle les Grands 0270302G EEPU Grand Camp EVREUX II 0270960X EEPU Ecardenville Sur Eure Clef Vallée d'Eure Principal 0270140F EEPU Jouy sur Eure 0,25 0271281W -

MEMBRES DU COMITE SYNDICAL MAJ : Juin 2019
Syndicat de Destruction des Ordures Ménagères de l’Ouest du Département de l’Eure MEMBRES DU COMITE SYNDICAL MAJ : Juin 2019 TITULAIRES Titre Nom Prénom Titre Ville Délégué de la Communauté Monsieur AUBER Jacques de Communes Lieuvin Pays Maire de Lieurey LIEUREY d’Auge Délégué de l’Intercom Bernay MALLEVILLE SUR LE Monsieur AUGER Michel Maire de Malleville sur le Bec Terres de Normandie BEC Délégué de la Communauté Monsieur BARRIERE Jean LE THUIT DE L’OISON de Communes Roumois Seine Vice-Président de la Vice-Président en charge de Maire de Jean- BARNEVILLE LA Monsieur BERNARD Communauté de Communes l’Environnement et de la gestion des Barneville La François BERTRAN du Pays de Honfleur Beuzeville déchets Bertran Délégué de l’Interco Monsieur BESNEHARD Daniel Maire de la Neuve-Lyre LA NEUVE LYRE Normandie Sud Vice-Président de l’Intercom Vice-Président des Ordures Monsieur BEURIOT Valéry Maire de Brionne BRIONNE Bernay Terres de Normandie Ménagères et du Plan Local Habitat 9 Impasse de la Délégué de la Communauté de Adjoint au Maire d’Epaignes Monsieur BLAIS Francis Communes Lieuvin Pays Libération EPAIGNES d’Auge Délégué de la Communauté Monsieur BOUCHER Dominique de Communes de Pont- Maire de Bouquelon Le Village BOUQUELON Audemer Val de Risle Vice-Président de la Monsieur BUSSY Daniel Communauté de Communes Maire de Fourmetot FOURMETOT de Pont-Audemer Val de Risle Vice-Président de la Vice-Président en charge de Monsieur CAILLOUEL Hervé Communauté de Communes l’assainissement et des Ordures Maire de Valletot VALLETOT Roumois Seine Ménagères -

Communes, Anciennes Communes Et Paroisses De L'état Civil : Liste Alphabétique Avec Le Rattachement À La Nouvelle Commune
Communes, anciennes communes et paroisses de l'état civil : liste alphabétique avec le rattachement à la nouvelle commune. (Cette liste ne prend pas en compte les récentes fusions de communes, intervenues principalement depuis 2016.) Aclou Acon Acquigny Aigleville Ailly Aizier Ajou Alaincourt (Tillières-sur-Avre) Alizay Ambenay Amécourt Amfreville-la-Campagne Amfreville-les-Champs Amfreville-sous-les-Monts Amfreville-sur-Iton Andé Angerville-la-Campagne Angoville (Berville-en-Roumois) Appetot (Bonneville-Aptot) Appeville-Annebault Armentières-sur-Avre Arnières-sur-Iton Asnières (Asnières) Aubevoye Aulnay-sur-Iton Authenay (Le Roncenay-Authenay) Autheuil (Autheuil-Authouillet) Autheuil-Authouillet Authevernes Authou Authouillet (Autheuil-Authouillet) Auvergny (Neaufles-Auvergny) Aveny (Dampsmesnil) Aviron Avrilly Bacquepuis Bacqueville Bailleul-la-Vallée Bailleul-près-Saint-André (Chavigny-Bailleul) Bâlines Barc Barneville-sur-Seine Barquet Barville Bastigny (Saint-André-de-l'Eure) Basville (Berville-en-Roumois) Baudemont (Bus-Saint-Rémy) Bazincourt-sur-Epte Bazoques Beaubray Beauficel-en-Lyons Beaumesnil Beaumontel Beaumont-le-Roger Bémécourt Bérengeville-la-Campagne Bérengeville-la-Rivière (Arnières-sur-Iton) Bernay Berniencourt (Le Val-David) Bernienville Bernières-sur-Seine Bernouville Bérou (Guichainville) Berthenonville Berthouville Berville-en-Roumois Berville-la-Campagne Berville-sur-Mer Beuzeville Bézu-la-Forêt Bézu-le-Long (Bézu-Saint-Éloi) Bézu-Saint-Éloi Bionval (Écos) Bizy et Gamilly (Vernon) Blacarville (Saint-Mards-de-Blacarville) -

Communes 27 ET 76 PREVENTION H5N8
Listes des communes en zone à risque particulier dans lesquelles s’appliquent les restrictions liées à la prévention H5N8. le 25 Octobre 2020 • EURE • SEINE-MARITIME EURE Communes du département de l’Eure en Zone à risque particulier dans lesquelles s’appliquent les restrictions liées à la prévention H5N8. URE ESTUAIRE ET VALLEE DE 27006 AIZIER SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27064 BERVILLE-SUR-MER SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27065 BEUZEVILLE SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27071 LE BOIS-HELLAIN SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27100 BOULLEVILLE SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27101 BOUQUELON SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27107 BOURNEVILLE SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27126 CAMPIGNY SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27134 CAUVERVILLE-EN-ROUMOIS SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27146 LA CHAPELLE-BAYVEL SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27163 COLLETOT SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27169 CONTEVILLE SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27170 CORMEILLES SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27174 CORNEVILLE-SUR-RISLE SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27218 EPAIGNES SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27227 ETREVILLE SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27233 FATOUVILLE-GRESTAIN SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27243 FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27258 FORT-MOVILLE SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27260 FOULBEC SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27263 FOURMETOT SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27317 LA HAYE-AUBREE SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27319 LA HAYE-DE-ROUTOT SEINE ESTUAIRE ET VALLEE DE EURE 27361 LA LANDE-SAINT-LEGER -

Annuaire Annuaire
ANNUAIRE ANNUAIRE Pont-Audemer Pont-Audemer Val-de-Reuil Val-de-Reuil Les Andelys Les Andelys Le Neubourg Louviers Le Neubourg Louviers Vernon Vernon Bernay Evreux Bernay Evreux Saint-André-de-l’Eure Saint-André-de-l’Eure Verneuil-d’Avre-et-d’Iton Verneuil-d’Avre-et-d’Iton www.dsden27.ac-normandie.fr 2019-2020 www.dsden27.ac-normandie.fr 2019-2020 Sommaire Organigramme de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Eure - DSDEN ..................................................................................... 3 Service de promotion de la santé en faveur des élèves et les services sociaux personnels et élèves ......................... 27 Trois Bassins d’Éducation et de Formation - BEF ........................................................................... 39 + Réseaux de l’Éducation prioritaire - REP- REP ............................................................................. 43 Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés - A.S.H ............................ 47 Dispositifs Unités Localisées pour l’inclusion Scolaire - ULIS et unité pédagogique pour élèves allophones arrivants - UPE2A ................................. 51 Premier degré : public > les inspections de l’Éducation nationale - I.E.N. .................................................................... 56 > les écoles publiques .............................................................................................................................. 63 Second degré : public > les collèges publics ..............................................................................................................................