Evaluation Finale Du « Projet De Création D'un Marché Pour Le
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Omvg Energy Project Countries
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP PROJECT : OMVG ENERGY PROJECT COUNTRIES : MULTINATIONAL GAMBIA - GUINEA- GUINEA BISSAU - SENEGAL SUMMARY OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Team Members: Mr. A.B. DIALLO, Chief Energy Engineer, ONEC.1 Mr. P. DJAIGBE, Principal Financial Analyst, ONEC.1/SNFO Mr. K. HASSAMAL, Economist, ONEC.1 Mrs. S.MAHIEU, Socio-Economist, ONEC.1 Mrs. S.MAIGA, Procurement Officer, ORPF.1/SNFO Mr. O. OUATTARA, Financial Management Expert, ORPF.2/SNFO Mr. A.AYASI SALAWOU, Legal Consultant, GECL.1 Project Team Mr. M.L. KINANE, Principal Environmentalist ONEC.3 Mr. S. BAIOD, Environmentalist, ONEC.3 Mr. H.P. SANON, Socio-Economist, ONEC.3 Sector Director: Mr. A.RUGUMBA, Director, ONEC Regional Director: Mr. J.K. LITSE, Acting Director, ORWA Division Manager: Mr. A.ZAKOU, Division Manager, ONEC.1, 1 OMVG ENERGY PROJECT Summary of ESIA Project Name : OMVG ENERGY PROJECT Country : MULTINATIONAL GAMBIA - GUINEA- GUINEA BISSAU - SENEGAL Project Ref. Number : PZ1-FAO-018 Department : ONEC Division: ONEC 1 1. INTRODUCTION This paper is the summary of the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) of the OMVG Project, which was prepared in July 2014. This summary was drafted in accordance with the environmental requirements of the four OMVG countries and the African Development Bank’s Integrated Safeguards System for Category 1 projects. It starts with a presentation of the project description and rationale, followed by the legal and institutional frameworks of the four countries. Next, a description of the main environmental conditions of the project is presented along with project options which are compared in terms of technical, economic and social feasibility. -

Surveillance System Assessment in Guinea: Training Needed to Strengthen Data Quality and Analysis, 2016
PLOS ONE RESEARCH ARTICLE Surveillance system assessment in Guinea: Training needed to strengthen data quality and analysis, 2016 1 1 1,2 1,2 Doreen Collins , Sarah RheaID *, Boubacar Ibrahima Diallo , Mariama Boubacar Bah , Facinet Yattara3, Rachelle Goman Keleba4, Pia D. M. MacDonald1,5 1 RTI International, Research Triangle Park, North Carolina, United States of America, 2 RTI International, Conakry, Guinea, 3 Guinea Ministry of Health, Conakry, Guinea, 4 International Organization for Migration, Boffa, Guinea, 5 Department of Epidemiology, Gillings School of Global Public Health, University of North a1111111111 Carolina, Chapel Hill, North Carolina, United States of America a1111111111 a1111111111 * [email protected] a1111111111 a1111111111 Abstract The 2014±2016 Ebola virus disease outbreak revealed the fragility of the Guinean public health infrastructure. As a result, the Guinean Ministry of Health is collaborating with interna- OPEN ACCESS tional partners to improve compliance with the International Health Regulations and work Citation: Collins D, Rhea S, Diallo BI, Bah MB, Yattara F, Keleba RG, et al. (2020) Surveillance toward the Global Health Security Agenda goals, including enhanced case- and community- system assessment in Guinea: Training needed to based disease surveillance. We assessed the case-based disease surveillance system strengthen data quality and analysis, 2016. PLoS during October 1, 2015±March 31, 2016, in the Boffa prefecture of Guinea. We conducted ONE 15(6): e0234796. https://doi.org/10.1371/ onsite interviews -

Climate Change Analysis for Guinea Conakry with Homogenized Daily Dataset
CLIMATE CHANGE ANALYSIS FOR GUINEA CONAKRY WITH HOMOGENIZED DAILY DATASET. Abdoul Aziz Barry Dipòsit Legal: T 262-2015 ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. -
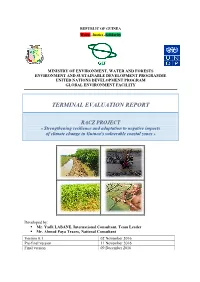
RAZC Project Final Evaluation Report VF 2016.Pdf
REPUBLIC OF GUINEA Work –Justice -Solidarity MINISTRY OF ENVIRONMENT, WATER AND FORESTS ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAMME UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY TERMINAL EVALUATION REPORT RACZ PROJECT « Strengthening resilience and adaptation to negative impacts of climate change in Guinea's vulnerable coastal zones » Developed by: . Mr. Yadh LABANE, International Consultant, Team Leader . Mr. Ahmed Faya Traore, National Consultant Version 0.1 02 November 2016 Pre-final version 11 November 2016 Final version 09 December 2016 CONTENTS i. OPENING PAGE ................................................................................................................................................... i ii. EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................................................... ii 1. PROJECT SUMMARY TABLE ........................................................................................................................ ii 2. PROJECT DESCRIPTION ................................................................................................................................ ii 3. EVALUATION RATING TABLE ................................................................................................................... iii 4. SUMMARY OF CONCLUSIONS, RECOMMENDATIONS AND LESSONS ............................................. iii iii. ACRONYMS AND ABBREVIATIONS ........................................................................................................... -

NEW KAPORO FISH LANDING FACILITY DEVELOPMENT PROJECT 5-5 New Kaporo Fish Landing Facility Development Project
NEW KAPORO FISH LANDING FACILITY DEVELOPMENT PROJECT 5-5 New Kaporo Fish Landing Facility Development Project 5-5-1 Outline Both Kaporo and the adjacent Nongo fish landing beaches are located on the northern shore of the central part of the Conakry Peninsula and they are the farthest east of all coastal fishery bases on this peninsula. This area is located at the mouth of Kaporo River, known as the place where Lusitanian people first visited the Conakry Peninsula and where a fishing settlement was established very early. Comparison of fishery statistics of 1992 and 1998 shows a temporary decrease in the number of fishing boats operating at Kaporo and Nongo fish landing beaches toward the latter part of the 1990s. This is considered to be attributable to the advance of general city residents into this region at around the same time due to development of urbanization and to a (temporary) shift of fishing boats from Kaporo and Nongo regions to other fish landing beaches on the Conakry Peninsula due to active development of fishery bases under ODEPAG (Guinea Artisanal Fishery Development Plan). On the contrary, in recent years the number of fishing boats operating in Kaporo and Nongo regions drastically increased (by 57 boats – about 65% in the 4 years since 1998) and the current number of boats operating is 170. This is considered to have resulted from the geographical superiority of this region as an urban fish landing spot in view of increased needs for fishery products in this region and proximity to consumer markets under situations where the population of Conakry has increased and sprawled to the central as well as eastern parts of the Conakry Peninsula. -

The Bel Air Bauxite Mining Project Environmental & Social Impact
NON-TECHNICAL SUMMARY – ESIA – BEL AIR MINING PROJECT The Bel Air Bauxite Mining Project Environmental & Social Impact Assessment (ESIA) Non-Technical Summary April 2016 1 NON-TECHNICAL SUMMARY – ESIA – BEL AIR MINING PROJECT This document is a Non-Technical Summary (NTS) of the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the Bel Air Mining Project. It provides a summary of the Project and its related ESIA process and provides information on the systems developed to manage the predicted environmental and social impacts of the Project’s activities during all phases from construction to closure. This document and the complete ESIA report are publicly available on the Bel Air Mining Project. websites at: Alufer Mining Limited – in English: http://www.alufermining.com/sustainability. Local stakeholders can access more detailed information in a variety of different ways, including through the Bel Air Information Centre (BAIC) located in the Bel Air Hotel (Boffa Prefecture, Guinea). A printed copy of the ESIA in English and French is available for reference in the BAIC and at the Alufer-Bel Air Mining office in Conakry. Digital copies are also available at these locations. The Bel Air Mining's Stakeholder Engagement Plan (SEP), which outlines the company's approach to involving interested parties as the Project proceeds, is also available. For more information on the issues outlined in this report, to ask questions or provide feedback, please contact [email protected] in English or French. 2 NON-TECHNICAL SUMMARY – ESIA – BEL AIR MINING PROJECT Table of Contents 1 Overview of the Bel Air Mining Project ................................................... 4 2 ESIA Report ............................................................................................. -

Deciphering the Origin of the 2012 Cholera Epidemic in Guinea by Integrating Epidemiological and Molecular Analyses
Deciphering the Origin of the 2012 Cholera Epidemic in Guinea by Integrating Epidemiological and Molecular Analyses Stanislas Rebaudet1*, Martin A. Mengel2, Lamine Koivogui3, Sandra Moore1, Ankur Mutreja4, Yacouba Kande5, Ousmane Yattara5,Ve´ronique Sarr Keita5, Berthe-Marie Njanpop-Lafourcade2, Pierre-Edouard Fournier6, Eric Garnotel7, Sakoba Keita5, Renaud Piarroux1 1 Aix-Marseille Universite´, UMD 3, Marseille, France, 2 Agence de Medecine Preventive (AMP), Paris, France, 3 Institut National de Sante´ Publique (INSP), Conakry, Republic of Guinea, 4 Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton, Cambridge, United Kingdom, 5 Division Pre´vention et Lutte contre la Maladie (DPLM), Ministe`re de la Sante´ Publique et de l’Hygie`ne Publique, Conakry, Republic of Guinea, 6 Aix-Marseille Universite´, Faculte´ de Me´decine, Marseille, France, 7 Hoˆpital d’Instruction des Arme´es (HIA) Alphonse Laveran, Marseille, France Abstract Cholera is typically considered endemic in West Africa, especially in the Republic of Guinea. However, a three-year lull period was observed from 2009 to 2011, before a new epidemic struck the country in 2012, which was officially responsible for 7,350 suspected cases and 133 deaths. To determine whether cholera re-emerged from the aquatic environment or was rather imported due to human migration, a comprehensive epidemiological and molecular survey was conducted. A spatiotemporal analysis of the national case databases established Kaback Island, located off the southern coast of Guinea, as the initial focus of the epidemic in early February. According to the field investigations, the index case was found to be a fisherman who had recently arrived from a coastal district of neighboring Sierra Leone, where a cholera outbreak had recently occurred. -

Analyses of Socio-Economic Status and Livelihood Patterns of Coastal Communities Dependent on Mangrove Forest Resources in Guinea
Analyses of Socio-economic Status and Livelihood Patterns of Coastal Communities Dependent on Mangrove Forest Resources in Guinea ギニアにおけるマングローブ林資源に依存した海岸コミュニティの社会経済的 地位や生活パターンの分析 A Dissertation By BALDE BOUBACAR SIDDIGHI Submitted to the United Graduate School of Agricultural Sciences, Tottori University In partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY March 2015 Major Subject: Managerial Economics I Analyses of Socio-economic Status and Livelihood Patterns of Coastal Communities Dependent on Mangrove Forest Resources in Guinea ギニアにおけるマングローブ林資源に依存した海岸コミュニティの社会経済的 地位や生活パターンの分析 A Dissertation By BALDE BOUBACAR SIDDIGHI Supervisory Committee: 1. Professor Hajime Kobayashi, Faculty of Agriculture, Tottori University 2. Professor Makoto Nohmi, Faculty of Agriculture, Tottori University 3. Associate professor Akira Ishida, Kobe University 4. Associate professor Norikazu Inoue, Shimane University II Dedication This thesis is dedicated to my wife and daughter for their endless encouragement, support, and love. III Acknowledgments Praise be to Almighty God, the Lord of the Universe for His infinite bounty without which this humble work could not be what it is. In His name, I would like to sincerely thank all those who contributed to the realization of this study. I am deeply grateful to my main academic supervisor, Professor Kobayashi Hajime, Faculty of Agriculture, Tottori University for his both kindness and efficient supervision in the process of designing and writing this thesis. I am also indebted to the other members of the supervisory committee: Professor Nohmi Makoto, Faculty of Agriculture, Tottori University and Associate professor Ishida Akira, Kobe University, who provided significant comments and suggestions. I am grateful to all those who helped in collecting the data as well. -

Study on Artisanal (Small-Scale) Fisheries Development Final Report
No. Japan International Cooperation Agency (JICA) Ministry of Fisheries and Aquaculture, the Republic of Guinea STUDY ON ARTISANAL (SMALL-SCALE) FISHERIES DEVELOPMENT FINAL REPORT (MAIN REPORT) AUGUST, 2003 OVERSEAS AGRO-FISHERIES CONSULTANTS CO., LTD. IC NET LIMITED AFF JR 03-49 Japan International Cooperation Agency (JICA) Ministry of Fisheries and Aquaculture, the Republic of Guinea STUDY ON ARTISANAL (SMALL-SCALE) FISHERIES DEVELOPMENT FINAL REPORT (MAIN REPORT) AUGUST, 2003 OVERSEAS AGRO-FISHERIES CONSULTANTS CO., LTD. IC NET LIMITED PREFACE In response to a request from the Government of the Republic of Guinea, the Government of Japan decided to conduct a development study on artisanal fisheries development and entrusted the study to the Japan International Cooperation Agency (JICA). In the 2-year period from March 2000 to June 2003, JICA sent to Guinea three times, a study team lead by Mr. Yasuo Ishimoto from Overseas Agro-Fisheries Consultants Co. Ltd.. The team held discussions with concerned officials from the Government of Guinea, and conducted a field study at the study area. After the team returned to Japan, further studies were made, and as a result, the present report was finalized. I hope that this report will contribute to the promotion of the project and to the enhancement of the friendly relationship between our two countries. I wish to express my sincere appreciation to the concerned officials of the Government of the Republic of Guinea for their close cooperation extended to the teams. August, 2003 Takao Kawakami President Japan International Cooperation Agency August, 2003 LETTER OF TRANSMITTAL Mr. Takao Kawakami President Japan International Cooperation Agency Dear Mr. -

RESTRICTED WT/TPR/S/370 24 April 2018
RESTRICTED WT/TPR/S/370 24 April 2018 (18-2575) Page: 1/97 Trade Policy Review Body TRADE POLICY REVIEW REPORT BY THE SECRETARIAT GUINEA This report, prepared for the fourth Trade Policy Review of Guinea, has been drawn up by the WTO Secretariat on its own responsibility. The Secretariat has, as required by the Agreement establishing the Trade Policy Review Mechanism (Annex 3 of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization), sought clarification from Guinea on its trade policies and practices. Any technical questions arising from this report may be addressed to Jacques Degbelo (tel.: 022 739 5583), Catherine Hennis-Pierre (tel.: 022 739 5640), Michael Kolie (022 739 5931) and Alya Belkhodja (tel.: 022 739 5162). Document WT/TPR/G/370 contains the policy statement submitted by Guinea. Note: This report is subject to restricted circulation and press embargo until the end of the first session of the meeting of the Trade Policy Review Body on Guinea. This report was drafted in French. WT/TPR/S/370 • Guinea - 2 - CONTENTS SUMMARY ........................................................................................................................ 6 1 ECONOMIC ENVIRONMENT .......................................................................................... 8 1.1 Main features of the economy ....................................................................................... 8 1.2 Recent economic developments ....................................................................................10 1.3 Trade and investment -

Ebola Outbreak Fact Sheet #24, Fiscal Year (Fy) 2015 March 11, 2015
WEST AFRICA – EBOLA OUTBREAK FACT SHEET #24, FISCAL YEAR (FY) 2015 MARCH 11, 2015 NUMBERS AT HIGHLIGHTS USG HUMANITARIAN ASSISTANCE A GLANCE TO EVD OUTBREAK RESPONSE CDC Director Dr. Tom Frieden visited TO DATE IN FY 2014 & FY 2015 Guinea from March 4 to 10 to assess 24,247 ongoing efforts to curb the spread of USAID/OFDA1 $500,268,291 EVD. Dr. Frieden met with senior USG USAID/FFP2 $57,479,546 Number of Suspected, and Government of Guinea (GoG) Probable, and Confirmed USAID/GH3 $20,076,000 Ebola Virus Disease (EVD) officials and traveled to Forécariah and Cases in Acutely Affected Coyah prefectures, both of which have USAID/Liberia $16,100,000 Countries* reported confirmed EVD cases in recent USAID/Guinea $3,482,000 UN World Health Organization days. (WHO) – DoD4 $354,115,000 March 11, 2015 WHO reports 116 new confirmed cases of EVD in Guinea and Sierra Leone in the CDC5 $136,685,7856 week ending on March 8. 9,961 The Government of Liberia (GoL) has not $1,088,206,622 Number of EVD-Related documented a new confirmed EVD case USG ASSISTANCE TO THE WEST AFRICA 7 Deaths* since February 19. EVD OUTBREAK RESPONSE WHO – March 11, 2015 11,619 KEY DEVELOPMENTS Number of EVD Cases in On March 5, health care workers discharged the final confirmed EVD patient from an EVD Sierra Leone* treatment unit (ETU) in Liberia, and no confirmed EVD patients are currently receiving WHO – March 11, 2015 treatment. WHO emphasized the need to maintain a high level of EVD surveillance in Liberia to ensure rapid detection of new EVD transmission chains. -

West Africa Ebola Outbreak Fact Sheet
WEST AFRICA – EBOLA OUTBREAK FACT SHEET #24, FISCAL YEAR (FY) 2015 MARCH 11, 2015 NUMBERS AT HIGHLIGHTS USG HUMANITARIAN ASSISTANCE A GLANCE TO EVD OUTBREAK RESPONSE CDC Director Dr. Tom Frieden visited TO DATE IN FY 2014 & FY 2015 Guinea from March 4 to 10 to assess 24,247 ongoing efforts to curb the spread of USAID/OFDA1 $500,268,291 EVD. Dr. Frieden met with senior USG USAID/FFP2 $57,479,546 Number of Suspected, and Government of Guinea (GoG) Probable, and Confirmed USAID/GH3 $20,076,000 Ebola Virus Disease (EVD) officials and traveled to Forécariah and Cases in Acutely Affected Coyah prefectures, both of which have USAID/Liberia $16,100,000 Countries* reported confirmed EVD cases in recent USAID/Guinea $3,482,000 UN World Health Organization days. (WHO) – DoD4 $354,115,000 March 11, 2015 WHO reports 116 new confirmed cases of EVD in Guinea and Sierra Leone in the CDC5 $136,685,7856 week ending on March 8. 9,961 The Government of Liberia (GoL) has not $1,088,206,622 Number of EVD-Related documented a new confirmed EVD case USG ASSISTANCE TO THE WEST AFRICA 7 Deaths* since February 19. EVD OUTBREAK RESPONSE WHO – March 11, 2015 11,619 KEY DEVELOPMENTS Number of EVD Cases in On March 5, health care workers discharged the final confirmed EVD patient from an EVD Sierra Leone* treatment unit (ETU) in Liberia, and no confirmed EVD patients are currently receiving WHO – March 11, 2015 treatment. WHO emphasized the need to maintain a high level of EVD surveillance in Liberia to ensure rapid detection of new EVD transmission chains.