Lavallee Hugo 2009 Memoire.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
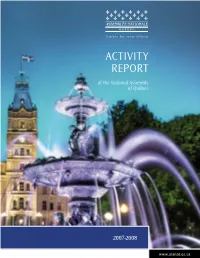
ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec
ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec 2007-2008 www.assnat.qc.ca On the cover: The Tourny Fountain: a gift from the Simons family to commemorate Québec City’s 400th anniversary. ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec This publication was accomplished with the collaboration of the executive personnel and staff from all administrative branches of the National Assembly. Unless otherwise indicated, the data provided in this report concerns the activities of the National Assembly from 1 April 2007 to 31 March 2008. Director: Johanne Whittom Coordinator and editor: Noémie Cimon-Mattar Supervisory committee: Geneviève Barry Patrik Gilbert Suzanne Hébert Robert Jolicoeur Marc Painchaud Jacques Paquet Georges Rousseau Revision: Francine Boivin Lamarche Nancy Ford Éliane de Nicolini Translation: Sylvia Ford Graphic design: Marie-Michelle Gagné Special collaboration: Éliane de Nicolini Photographs: Christian Chevalier pages 43-50-51 Patrick Gilbert page 31 Daniel Lessard pages 12-35-36-38-39-40-41-42 45-46-47-48-58-59-60-64 Fernande Savard page 47 Roch Théroux page 64 Printing: Cover Imprimerie Le Renouveau Interior pages Photocopying and Printing Services of the National Assembly This publication is available on the Internet site of the National Assembly at the following address www.assnat.qc.ca Legal Deposit: 2008 Bibliothèque et Archives nationales du Québec National Library of Canada ISBN 978-2-550-53143-2 ISSN 1492-9023 2 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2007-2008 TABLE OF CONTENTS Highlights 2007-2008 A word from the President A -

Ex LIBRIS UNIVERSITATIS ALBERTENSIS I ¿ T O F Pe, P*J P7l 1777- 7^ Gouvernement Du Québec Public Accounts for the Fiscal Year Ended March 31, 1978
Ex LIBRIS UNIVERSITATIS ALBERTENSIS I ¿ t o f Pe, P*J P7l 1777- 7^ gouvernement du Québec public accounts for the fiscal year ended March 31, 1978 volume 2 details of expenditure Published in accordance with the provisions of section 71 of the Loi de l’administration financière (Financial Administration Act) (1970 Statutes, Chapter 17) Received MAÏ 2? 1575 RECTOR 4 Gouvernement ELLOR du Québec Ministère des Finances ISSN 0706-2850 ISBN 0-7754-3205-9 Legal deposit, 1s' quarter, 1979 Bibliothèque nationale du Québec UNIVERSITY LIERARY UNIVERSITY OF Al BFRTA TABLE OF CONTENTS SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES 1 LIST OF CAPITAL ASSETS 2 1-1 SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES For each category of expenditure, except for "Transfer expen With regard to the category "Transfer expenses", the list of ses", the list of suppliers or beneficiaries is issued by department beneficiaries is published, in certain cases, grouped by program according to the following publishing limits and criteria: or by element of program and, in other cases, grouped by department, and this, according to the following limits and crite a) Salaries, wages, allowances and other remuneration: ria: — Ministers, Deputy Ministers and Public Officers of equiva — By electoral district: complete listing; lent rank: complete listing; — By electoral district and beneficiary: complete listing; — Managerial Staff (managers, assistant managers and civil servants of equivalent rank): complete listing; — By beneficiary only: $8 000 and over. — Any allowance: $8 000 -

C:\Documents and Settings\Eporlier\Bureau\TRANSIT
C A N D I D A T E S E T C A N D I D A T S P R O C L A M É S É L U S +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | CIRCONSCRIPTION | NOM | APPARTENANCE | PROFESSION | DOMICILE | | | | | | | | ÉLECTORALE | | POLITIQUE | | | | | | | | | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Abitibi-Est Alexis Wawanoloath P.Q. Val-d'Or Abitibi-Ouest François Gendron * P.Q. La Sarre Acadie Christine St-Pierre P.L.Q./Q.L.P. Outremont Anjou Lise Thériault * P.L.Q./Q.L.P. Anjou Argenteuil David Whissell * P.L.Q./Q.L.P. Brownsburg-Chatham Arthabaska Jean-François Roux A.D.Q./É.M.D. Victoriaville Beauce-Nord Janvier Grondin * A.D.Q./É.M.D. Saint-Jules Beauce-Sud Claude Morin A.D.Q./É.M.D. Québec Beauharnois Serge Deslières * P.Q. Salaberry-de-Valleyfield Bellechasse Jean Domingue A.D.Q./É.M.D. Saint-Romuald Berthier François Benjamin A.D.Q./É.M.D. Mandeville Bertrand Claude Cousineau * P.Q. Ste-Lucie-des-Laurentides Blainville Pierre Gingras A.D.Q./É.M.D. Blainville Bonaventure Nathalie Normandeau * P.L.Q./Q.L.P. Maria Borduas Pierre Curzi P.Q. Saint-Jean-Baptiste Bourassa-Sauvé Line Beauchamp * P.L.Q./Q.L.P. Montréal-Nord Bourget Diane Lemieux * P.Q. Montréal Brome-Missisquoi Pierre Paradis * P.L.Q./Q.L.P. Bedford Chambly Richard Merlini A.D.Q./É.M.D. La Prairie Champlain Pierre Michel Auger A.D.Q./É.M.D. Trois-Rivières Chapleau Benoît Pelletier * P.L.Q./Q.L.P. Gatineau Charlesbourg Catherine Morissette A.D.Q./É.M.D. -
La Vie À Québec
LE VENDREDI 11 AVRIL 2008 VOL. 1, NUMÉRO 235 ] 44 11 Québec ATIN M ÉDIA COMME www.mediamatinquebec.com COMME M [ EENN SSAAIISSOONN!! PHOTO STEVENS LEBLANC Pages 22 et 23 LE PREMIER QUOTIDIEN [ FAMILLE EXPULSÉE ][ARCHIVES DES VOLTIGEURS ] GRATUIT À QUÉBEC Sauvées de la poussière et... du feu PHOTO MÉDIAMATINQUÉBEC MAXIMUM 7° Merci, MINIMUM -3° me M Lacasse! Page 2 PHOTO MÉDIAMATINQUÉBEC Page 6 Page 8 [ ACTUALITÉ ] MAIN TENDUE À LA FAMILLE CÔTÉ C’est le cas de Mme Thérèse Faguy, 88 ans, qui habite son logement de cinq pièces et demie depuis 23 ans. «J’ai toujours bien payé mon loyer en faisant des chèques à l’avance. Il a tenté de reprendre mon logement en prétendant que c’était pour son père. C’est parce qu’il Céline Côté et sa famille ont trouvé une bonne veut augmenter les loyers», croit Mme Faguy, qui occupe Samaritaine pour les héberger jusqu’à ce qu’ils puissent son logement avec son petit-fils. intégrer leur nouveau logement, à la fin mai. Le logement au-dessus s’était pourtant libéré au cours de Après avoir pris connaissance de l’article décrivant la l’année. Le propriétaire a loué à une jeune mère de deux situation de Mme Côté, paru dans notre livraison d’hier, Valérie enfants. Le loyer a bondi d’un seul coup de 500 $ à 695 $ par Lacasse a immédiatement communiqué avec le conseiller mois; le bail signé par la nouvelle locataire n’indiquait pas le municipal Gérald Poirier et l’a informé de son intention loyer que le locataire précédent payait. -

151544722.Pdf
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Université de Montréal Université de Montréal Analyse de la couverture médiatique d’un leader émergent : le cas d’André Boisclair par Hugo Lavallée Département de science politique Faculté des arts et des sciences Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Maîtrise ès sciences (M.Sc) en science politique Décembre 2009 © Hugo Lavallée, 2009 ii Université de Montréal Faculté des études supérieures Ce mémoire intitulé : Analyse de la couverture médiatique d’un leader émergent : le cas d’André Boisclair présenté par : Hugo Lavallée a été évalué par un jury composé des personnes suivantes : Patrick Fournier président-rapporteur Richard Nadeau directeur de recherche Denis Monière membre du jury iii SOMMAIRE Ce mémoire porte sur le rôle que jouent les médias de masse dans la construction de la personnalité publique des nouveaux chefs de partis politiques. Lorsqu’un individu est nommé à la tête d’un parti politique, il est la plupart du temps peu connu du grand public. Or, comme une écrasante majorité de citoyens n’a jamais l’occasion d’entrer en contact directement avec les hommes et les femmes politiques, c’est exclusivement par le biais des médias que la plupart des gens apprennent à connaître leurs représentants politiques – ou ceux qui aspirent à jouer ce rôle. Or les médias ne se contentent pas de répéter ce que les politiciens disent. Les informations qu’ils décident d’inclure dans leurs reportages, les mots qu’ils utilisent et les cadrages qu’ils retiennent contribuent à définir la personnalité des leaders émergents dont ils parlent. -

Analyse Du Parti Politique L'action Démocratique Du Québec 1994-2009
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL ANALYSE DU PARTI POLITIQUE L'ACTION DÉMOCRATIQUE DU QUÉBEC 1994-2009 MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MÂITRISE EN SCIENCE POLITIQUE PAR LUC BRIÈRE JUIN 2010 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs (SDU-522 - Rév.01-2006). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf ententè contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» REMERCIEMENTS Je tiens à remercier personnellement mon directeur de mémoire Pierre Drouilly pour le temps qu'il m'a consacré et son expertise dans l'analyse des comportements électoraux. Je profite de l'occasion pour remercier ma copine des huit dernières années Virginie Boudreau pour son soutien moral tout au long de ce processus. -

The Activity Report of the National Assembly of Québec for 2008-2009
ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec 2008-2009 www.assnat.qc.ca Cover illustration: Crown of fleurs de lys and acanthus leaves supporting a ring of lights informing the public when the National Assembly is sitting. ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec 2008-2009 This publication was Supervision Jean Dumas prepared in collaboration Coordination and editing with the senior Noémie Cimon-Mattar management and Drafting committee the personnel of all Noémie Cimon-Mattar Yves Girouard the administrative units Robert Jolicoeur Lucie Laliberté of the National Assembly. Anne-Marie Larochelle Unless otherwise specified, Georges Rousseau the information in this Revision Francine Boivin Lamarche activity report covers Éliane de Nicolini the National Assembly’s Michelle Lavoie activities from April 1, Translation Anglocom 2008 to March 31, 2009. Sylvia Ford Art direction Manon Paré Graphic design Catherine Houle Manon Paré Photography Christian Chevalier, cover and pages 12, 14, 40, 42, 44 to 47, 49 to 52, 54 to 56, 60, 61, 68, 76, 77, and highlights François Asselin, page 76 Noémie Cimon-Mattar, page 76 Daniel Lessard, pages 43 and 68 Debates Broadcasting and Publishing Directorate, page 47 Stéphane Lévesque, page 46 Samuel Pignedoli, page 43 Kevin Thériault, page 43 Roch Théroux, page 48 Marie-Ève Vézina, “ From the 38th to 39th ” highlights Société du 400e anniversaire de Québec, page 50 Cover printing : Imprimerie LithoChic This publication is available on the National Assembly website at www.assnat.qc.ca Legal Deposit -

ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec
ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec 2008-2009 www.assnat.qc.ca Cover illustration: Crown of fleurs de lys and acanthus leaves supporting a ring of lights informing the public when the National Assembly is sitting. ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec 2008-2009 This publication was Supervision Jean Dumas prepared in collaboration Coordination and editing with the senior Noémie Cimon-Mattar management and Drafting committee the personnel of all Noémie Cimon-Mattar Yves Girouard the administrative units Robert Jolicoeur Lucie Laliberté of the National Assembly. Anne-Marie Larochelle Unless otherwise specified, Georges Rousseau the information in this Revision Francine Boivin Lamarche activity report covers Éliane de Nicolini the National Assembly’s Michelle Lavoie activities from April 1, Translation Anglocom 2008 to March 31, 2009. Sylvia Ford Art direction Manon Paré Graphic design Catherine Houle Manon Paré Photography Christian Chevalier, cover and pages 12, 14, 40, 42, 44 to 47, 49 to 52, 54 to 56, 60, 61, 68, 76, 77, and highlights François Asselin, page 76 Noémie Cimon-Mattar, page 76 Daniel Lessard, pages 43 and 68 Debates Broadcasting and Publishing Directorate, page 47 Stéphane Lévesque, page 46 Samuel Pignedoli, page 43 Kevin Thériault, page 43 Roch Théroux, page 48 Marie-Ève Vézina, “ From the 38th to 39th ” highlights Société du 400e anniversaire de Québec, page 50 Cover printing : Imprimerie LithoChic This publication is available on the National Assembly website at www.assnat.qc.ca Legal Deposit -

Gouvernement Du Québec Public Accounts for the Year Ended March 31, 1987
Ex LIBRIS UNIVERSITATIS ALBERTENSIS gouvernement du Québec public accounts for the year ended March 31, 1987 volume 2 details of expenditure • suppliers and beneficiaries • capital assets Published under section 71 of the Financial Administration Act (R.S.Q., c. A-6) Gouvernement du Québec Ministère des Finances UNIVERSITY LIBRARY Legal Deposit — 1a Quarter 1988 UNIVERSITYOF A' ' ta Bibliothèque nationale du Québec TABLE OF CONTENTS SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES 1 LIST OF CAPITAL ASSETS 2 ■ 1-1 SECTION 1 LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES The list of suppliers and beneficiaries for each category of expen NOTES diture except “ Transfer Payments” is issued by department ac cording to the following publishing limits and criteria: Amounts paid to “Various persons" have not been detailed by supplier or a) Salaries, wages, advances and other remuneration: beneficiary in the following cases: — Ministers, deputy ministers and senior officials of equivalent Allowances to private forest owners in regard to interest on their borrowings rank: complete listing; from forestry assistance (Office du crédit agricole du Québec) and to farmers — Managerial staff (managers, executive assistants and offi in regard to interest on their borrowings from the Office du crédit agricole cials of equivalent rank): complete listing; du Québec, farm credit provided by private institutions, farm improvement, — Any allowance: $11 000 or more; production assistance, special assistance, farm loans (Farm Credit Corpora tion of Canada), development of farming operations, land redevelopment — Employer contributions: $22 000 or more. and start-up assistance to young farmers; manne insurance premium as b) Other categories: $22 000 or more, with the exception of Debt sistance to fishing vessel owners; public servants’ or employees' group life Service, details for which are not published. -

Gazette Est Interditesansl’Autorisation Écritedel’Éditeurofficiel Duquébec
Partie QuébecDU 1 Index Janvier Décembre 2007 officielle Avis juridiques 139e année Gazette Dépôt légal – 1er trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 2007 Tous droits de traduction et d’adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays. Toute reproduction par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l’autorisation écrite de l’Éditeur officiel du Québec. Partie 1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Index Janvier – Décembre 2007 3 SOMMAIRE ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, LOI SUR L’... 5 AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME, LOI SUR L’... 5 AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS . 9 ASSURANCES, LOI SUR LES… . 9 SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE, LOI SUR LES… . 10 AVIS DIVERS . 12 COMMISSION DE TOPONYMIE . 15 RÉPERTOIRE TOPONYMIQUE DU QUÉBEC . 15 COMMISSION MUNICIPALE, LOI SUR LA... 15 COMPAGNIES (PARTIE I), LOI SUR LES… . 15 CURATEUR PUBLIC, LOI SUR LE... 15 AVIS DE QUALITÉ . 15 AVIS DE CORRECTION . 15 BIENS DÉLAISSÉS PAR LES PERSONNES MORALES DISSOUTES . 15 BIENS SITUÉS AU QUÉBEC DONT LES PROPRIÉTAIRES OU LEURS HÉRITIERS SONT INCONNUS OU INTROUVABLES OU AUXQUELS ILS ONT RENONCÉ . 16 CLÔTURE D’INVENTAIRE . 16 FIN DE LIQUIDATION. 16 PRODUITS FINANCIERS NON RÉCLAMÉS ET BIENS NON RÉCLAMÉS REMIS AU MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC . 16 SUCCESSIONS NON RÉCLAMÉES. 16 DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL . 16 CHANGEMENTS DE NOM — ACCORDÉS . 16 CHANGEMENTS DE NOM — DEMANDES . 16 DÉCLARATIONS TARDIVES DE FILIATION . 41 LOI ÉLECTORALE . 44 CANDIDATES ET CANDIDATS PROCLAMÉS ÉLUS . 44 DIRECTEURS DU SCRUTIN . 46 FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS . -

Public Acoount for the Fiscal Year Ended March 31 1982
CFF FSA 1 r; / I9SI gouvernement du Québec public accounts for the year ended March 31, 1982 1981 -1982 volume 2 details of expenditure Québec gouvernement du Québec public accounts for the year ended March 31, 1982 volume 2 details of expenditure Published in accordance with the provisions of Section 71 of the Financial Administration Act (R.S.Q., c. A-6 and amendments) Gouvernement du Québec Ministère des Finances ISSN 0706-2869 OFF ISBN 2-551-05223-8 (Complété Edition) ISBN 2-551-05225-4 (Volume 2) F5/I I Legal Deposit — 4th Quarter 1982 cfo/iqsi Bibliothèque nationale du Québec A TABLE OF CONTENTS SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES 1 LIST OF CAPITAL ASSETS 2 1-1 SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES For each category of expenditure, except for "Transfer ex- With regard to the category "Transfer expenses", the list of benefi- penses", the list of suppliers or beneficiaries is issued by depart- ciaries is published, in certain cases, grouped by program or by ment according to the following publishing limits and criteria. element of program and, in other cases, grouped by department, and this, according to the following limits and criteria. (a) Salaries, wages, allowances and other rémunération: — By électoral district: complété listing — Mmisters, deputy ministers and public officers of équiva¬ lent rank: complété listing. — By électoral district and beneficiary complété listing — Managerial staff (managers, assistant managers and civil — By beneficiary only: 8 000 $ and over servants of équivalent rank): complété listing NOTES — Any allowance: 8 000 $ and over — Employées contributions: 16 000 $ and over. -

L'histoire DU QUÉBEC Pour Ne Pas Oublier NOTRE PASSÉ
L©HISTOIRE DU QUÉBEC pour ne pas oublier NOTRE PASSÉ © 2012 Tout Droits Réservés ± Francois GOULET auteur/éditeur. Publication permise, avec la permission de Mr. Claude Routhier auteur de: La Chronologie de l©Histoire du Québec Édition Révisé en date du mois de Septembre 2012 ± V1.16 *** Le titre que j©avais choisis au début était « L©Histoire du Québec pour les NULS » mais le titre a dû subir un changement le 6 Avril 2012 Hey Oui.. J©ai dû changer le titre de cet ouvrage pour plaire à l©éditeur de la série « POUR LES NULS » Apparemment que mon titre original leurs portait (voici.. selon leurs dirent) : “Cette reproduction non autorisée porte atteinte à la marque « Pour les nuls ». Elle constitue en outre un acte de concurrence déloyale et parasitaire et est de nature à porter atteinte à notre réputation, risquant ainsi d’induire le lecteur en erreur quant à la sortie d’un nouveau livre de notre collection”. Hey bien.. Ils sont plus NULS que je ne le pensais.. Je leurs répondrai simplement: « Hey bande de NULS.. Ceci n©est pas une reproduction, car vous ne l©avez pas sortis. Vous êtes vraiment dans les patates et même, à côté de la track.. Qui a-t-il de déloyale en donnant en PDF gratuit à qui veux bien le recevoir?? Avez-vous peur de perdre quelques minable petits EURO?? N©ayez crainte.. les petits poissons ne mangent pas les GROS» Donc.. pour ne pas créé un incident diplomatique international, et ne nuire nullement à « leurs réputations ».. J©ai donc décidé de changer le titre de ce petit ouvrage.