Nappe Alluviale Du Gave De Pau
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liste Des Services D'aide À Domicile
14/04/2015 LISTE DES SERVICES D'AIDE À DOMICILE pouvant intervenir auprès des personnes âgées bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A.), des adultes handicapées bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) et pour certains, auprès des bénéficiaires de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale légale départementale A Habilitation à l'aide sociale départementale www.cg64.fr TI = Type d'interventions réalisables u AS = Service prestataire d'aide à domicile pouvant intervenir auprès des P = Prestataire -- M = Mandataire t bénéficiaires de l'aide sociale départementale Pour plus d'information, voir : Choisir un mode d'intervention . C Code AS Nom du service Adresse Ville Téléphone TI Territoire d'intervention G Postal CCAS Hôtel de ville P Ville d’ANGLET A AS 64600 ANGLET 05 59 58 35 23 Centre Communal d'Action Sociale Place Charles de Gaulle M Département des Pyrénées-Atlantiques Uniquement en garde de nuit itinérante Association 12, rue Jean Hausseguy A AS 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 P Communauté d’agglomération du BAB (BIARRITZ, Les Lucioles BP 441 BAYONNE, ANGLET) et périphérie proche Association P 95, avenue de Biarritz 64600 ANGLET 05 59 41 22 98 Département des Pyrénées-Atlantiques Côte Basque Interservices (ACBI) M Association P 3, rue du pont de l'aveugle 64600 ANGLET 05 59 03 53 31 Département des Pyrénées-Atlantiques Services aux Particuliers (ASAP) M Association 12, rue Jean Hausseguy P 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 Département des Pyrénées-Atlantiques Garde à Domicile BP 441 M Centre -

A 65 Km Av Copernic
Av Copernic - Rp Total - Rte de Sendets - Andoins - Limendous - Soumoulou - Gomer - A 65 km Lucgarier - Lagos - Bénéjacq - Nay - Pardies-Piétat - Côte de Piétat - D209 - Crêtes de 02-janv Sam 13h30 Rontignon - Gelos - Pau Av Copernic - Rp Total - Rte de Sendets - Andoins - Limendous - Soumoulou - Gomer - B 40 km Lucgarier - Angaïs - Ousse - Sendets - Idron – Pau Hippodrome - Perlic - Poey-de-Lescar - Bas de Beyrie - Bougarber - Viellenave - X A 60 km D945 - D201 - Bas de Momas - D32 - D206 - Lonçon - Bournos - X D834 - Navailles- 07-janv Jeu 13h30 Angos - St Castin - Maucor - Bas de Buros - Pau Hippodrome - Perlic - Poey-de-Lescar - Bas de Beyrie - Bougarber - D945 - D201 - Bas B 40 km de Momas - D216 - Caubios - Sauvagnon - D289 - ZI Serres-Castet - Pau Jardiland - Trespoey - Bizanos - Assat - Baliros - Nay - Bénéjacq - Lagos - Espoey - Haut A 65 km d'Espoey - Lourenties - Limendous - Andoins - Sendets - Haut d'Idron - Pau 09-janv Sam 13h30 Jardiland - Trespoey - Bizanos - Assat - Baliros - Nay -Mirepeix - Angaïs - Ousse - Idron - B 40 km Pau Avenue et bas de Buros - Morlaàs - St Jammes - Souye - Escoubes - St Laurent- A 60 km Bretagne - Sedzère - Arrien - Lourenties - Limendous - Nousty - Ousse - Pau 14-janv Jeu 13h30 Hippodrome - Rocade nord - D289 - Uzein - Caubios - Ste Quitterie - D40 - D206 - B 40 km Navailles-Angos - Maucor - Bas de Buros - Pau Av Copernic - Rp Total - Rte de Sendets - Ousse - Hameau de Ousse - Assat - Baliros - A 65 km Nay - Asson - D35/CV - Lestelle-Bétharram - Montaut - Coarraze - Bénéjacq - Angaïs - 16-janv -

Habitats Humides Naturels D'intérêt Communautaire
Etude de faisabilité de gestion des grands corridors alluviaux des Pyrénées-Atlantiques Analyse bibliographique et propositions d’outils d’amélioration des connaissances LAPORTE Thierry (chargé de secteur sud), HAHN Wendy (stagiaire Master 2 Professionnel, UST Lille 1) & FUMEY Emilie (Sigiste), 2006, CREN Aquitaine, 80 pages + 7 annexes Résumé Les corridors alluviaux recèlent un patrimoine naturel exceptionnel et assurent de très nombreuses fonctions écologiques indispensables à la survie d’espèces animales et végétales mais aussi hydrologiques, sociales et économiques très utiles à l’ensemble de la collectivité publique. Une méthodologie élaborée s’appuyant sur la Base de Données Carthage des Agences de l’Eau a permis de faire ressortir 15 « grands sites » appelés « métasites » regroupant 44 sites sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques. L’analyse bibliographique conclue au manque d’informations sur les indicateurs écologiques et socio-économiques à l’échelle des métasites et des sites. Les niveaux de connaissance et les indicateurs retenus par les producteurs de données sont par ailleurs très hétérogènes entre métasites et entre sites. On observe même un important déficit de connaissance sur le métasite de la Bidassoa et sur la plupart des métasites du nord-est du département : Luy de France, Gros et Petit Lées, Grand Lées et Larcis. Dans le cadre de cette étude le CREN Aquitaine propose donc des critères à retenir pour réaliser à court ou moyen terme une hiérarchisation des sites en fonction des enjeux de conservation. Pour évaluer ces enjeux, le CREN Aquitaine suggère également d’utiliser une seule et même base d’indicateurs qui pourraient être repris dans les cahiers des charges des futures études. -

(EU) 2021/335 of 23 February 2021 Amending the Annex To
25.2.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Uni on L 66/5 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/335 of 23 February 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2020/1809 concerning certain protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2021) 1386) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary checks applicable in intra-Union trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Having regard to Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC (3), and in particular Article 63(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2020/1809 (4) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in holdings where poultry or other captive birds were kept in certain Member States and the establishment of protection and surveillance zones by those Member States in accordance with Council Directive 2005/94/EC. (2) Implementing Decision (EU) 2020/1809 provides that the protection and surveillance zones established by the Member States listed in the Annex to that Implementing Decision, in accordance with Directive 2005/94/EC, are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in that Annex. -

1 RP Partie 1.3 Etat Amenagement 1Erepartie
1.3 L'état de l'aménagement L'armature d'un territoire rural • Une division en trois secteurs identitaires Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Nay est caractérisé par de vastes espaces dissociant des modes d'occupation ou d'activités historiques : • le nord est marqué par la vaste plaine agricole, entourée par les coteaux à l'est ou à l'ouest, et est qualifié de « secteur de la plaine ». Ce secteur comprend les communes d'Angaïs, Arros-de-Nay, Assat, Baliros, Baudreix, Beuste, Boeil-Bezing, Bordères, Bordes, Lagos, Narcastet, Pardies-Piétat et Saint-Abit. • le cœur du territoire est constitué par le pôle urbain de Nay, avec un ensemble de communes agglomérées et est qualifié de « pôle urbain du Pays de Nay ». Ce secteur comprend les communes de Bénéjacq, Bourdettes, Coarraze, Igon, Mirepeix et Nay. • enfin, le sud, territoire le plus vaste, est marqué par le relief des coteaux et de la montagne pyrénéenne et le régime de la loi Montagne pour plusieurs communes. Qualifié de « secteur des coteaux et de la montagne », cet espace comprend les communes d'Arbéost, Arthez d'Asson, Asson, Bruges-Capbis-Mifaget, Ferrières, Haut-de-Bosdarros, Labatmale Lestelle-Bétharram, Montaut et Saint-Vincent. Ces trois espaces, proches et imbriqués, marquent l'identité rurale du Pays de Nay. Ils sont à l'origine d'une organisation de l'espace et d'urbanisme sur les 29 communes du SCoT que le Projet d'Aménagement et de Développement Durables prend en considération et entend pérenniser. D'un point de vue quantitatif : • le secteur de la plaine comprend 13 communes, pour une superficie de 81,51 km² et une population de 12 173 habitants en 2015. -

Recueil Des Actes Administratifs N°64-2017-031 Publié Le 18 Mai 2017
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°64-2017-031 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES PUBLIÉ LE 18 MAI 2017 1 Sommaire ARS 64-2017-05-12-015 - Arrêté de nomination d'un médecin agréé (1 page) Page 8 DDCS 64-2017-05-12-004 - Arrêté approuvant le plan de signalisation de l'ouvrage "Radier du pont de Lescar" sur le Gave de Pau permettant la sécurisation de la circulation des engins nautiques non motorisés (3 pages) Page 10 64-2017-05-12-013 - Arrêté approuvant le plan de signalisation de l'ouvrage "Seuil d'Asson" sur l'Ouzom permettant la sécurisation de la circulation des engins nautiques non motorisés (3 pages) Page 14 64-2017-05-12-014 - Arrêté approuvant le plan de signalisation de l'ouvrage "seuil d'Asson" sur l'Ouzom permettant la sécurisation de la circulation des engins nautiques non motorisés (3 pages) Page 18 64-2017-05-12-005 - Arrêté approuvant le plan de signalisation de l'ouvrage "Seuil de stabilisation d'Artiguelouve" sur le Gave de Pau permettant la sécurisation de la circulation des engins nautiques non motorisés (3 pages) Page 22 64-2017-05-12-006 - Arrêté approuvant le plan de signalisation de l'ouvrage "Seuil de stabilisation d'Assat" sur le Gave de Pau permettant la sécurisation des engins nautiques non motorisés (3 pages) Page 26 64-2017-05-12-007 - Arrêté approuvant le plan de signalisation de l'ouvrage "Seuil de stabilisation de Baudreix" sur le Gave de Pau permettant la sécurisation de la circulation des engins nautiques non motorisés (3 pages) Page 30 64-2017-05-12-012 - Arrêté approuvant le plan de signalisation de l'ouvrage "Seuil -

Mardi 26 Mai 2015 Page 1 Sur 18 Département Des Pyrénées-Atlantiques Liste Alphabétique Des Maires Commune Nom Du Maire Aast MORLANNE Romain
mardi 26 mai 2015 Page 1 sur 18 Département des Pyrénées-Atlantiques Liste alphabétique des maires Commune Nom du maire Aast MORLANNE Romain Abère CUILLET Myriam Abidos MIRASSOU Jean-Claude Abitain SEGUIN Marc Abos CAZALERE Jean-Pierre Accous BERGÉS Paule Agnos BERNOS André Ahaxe-Alciette-Bascassan BIDART Jean-Paul Ahetze ELISSALDE Philippe Aïcirits-Camou-Suhast ERGUY Chantal Aincille OÇAFRAIN Gilbert Ainharp ARHANCHIAGUE Jean-Pierre Ainhice-Mongelos IRIGOIN Jean-Pierre Ainhoa IBARLUCIA Michel Alçay-Alçabéhéty-Sunharette ERRECARRET Anicet Aldudes DENDARIETA Jean-Michel Alos-Sibas-Abense IRIART Jean-Pierre Amendeuix-Oneix MANDAGARAN Arnaud Amorots-Succos ABBADIE Arnaud Ance JARGOYHEN Corinne Andoins ROCHE Christian Andrein MARTIN Alain Angaïs ARRABIE Bernard Anglet OLIVE Claude Angous LANSALOT-MATRAS Francis Anhaux CHANGALA André Anos DESCLAUX Christelle Anoye LAVOYE Alain Aramits SERNA Etienne Arancou BORDES Alexandre Araujuzon LARCO Jean-Claude mardi 26 mai 2015 Page 2 sur 18 Département des Pyrénées-Atlantiques Liste alphabétique des maires Commune Nom du maire Araux LAMBERT Nadine Arbérats-Sillègue BACHO Sauveur Arbonne MIALOCQ Marie-Josèphe Arbouet-Sussaute NARBAIS JAUREGUY Eric Arbus LARRIEU Didier Arcangues ECHEVERRIA Philippe Aren MIRANDE David Aressy FERRATO Claude Arette CASABONNE Pierre Argagnon CASSOU André Argelos BORNY Marcel Arget SOUSTRA Thierry Arhansus ERDOZAINCY-ETCHART Christine Armendarits DELGUE Lucien Arnéguy BÈGUE Catherine Arnos PEDEGERT Alain Aroue-Ithorots-Olhaïby BARNEIX Jean-Pierre Arrast-Larrebieu DAVANT Allande -

MEMOIRE DE REPONSE AUX OBSERVATIONS DE LA Mrae 21 FEVRIER 2019 Communes De BAUDREIX, MIREPEIX Et BOURDETTES
MEMOIRE DE REPONSE AUX OBSERVATIONS DE LA MRAe 21 FEVRIER 2019 Communes de BAUDREIX, MIREPEIX et BOURDETTES DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION RENOUVELLEMENT ET EXTENSION GRAVIERE DE BAUDREIX 27 MARS 2019 Sas DRAGAGES DU PONT DE LESCAR Demande d’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert de graves alluvionnaires Commune de CARRESSE-CASSABER Réponses aux observations MRAe 1 Sas DRAGAGES DU PONT DE LESCAR Demande d’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert de graves alluvionnaires Commune de CARRESSE-CASSABER SOMMAIRE OBSERVATIONS DE LA MRAe 1/ OBSERVATIONS RELATIVES A LA BIODIVERSITE : .................................................................. 5 2/ OBSERVATIONS RELATIVES AU MILIEU HUMAIN ET AU BRUIT : ....................................... 7 3/ OBSERVATIONS RELATIVES A LA REMISE EN ETAT DES LIEUX : ..................................... 11 4/ DIVERS : ................................................................................................................................................. 14 ANNEXES Réponses aux observations MRAe 2 Sas DRAGAGES DU PONT DE LESCAR Demande d’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert de graves alluvionnaires Commune de CARRESSE-CASSABER PREAMBULE Le projet de renouvellement et d’extension pour l’exploitation de graves alluvionnaires situé sur les communes de Baudreix, Mirepeix et Bourdettes, porté par la Sté Dragages du Pont de Lescar, actuel exploitant de la gravière de Baudreix, a été déposé le 12 Juillet 2018 auprès des services de la Préfecture. Dans le cadre de -

Résultats Des Affectations D'office Des 2 Et 5 Juillet 2018
Résultats des affectations d’office des 2 et 5 juillet 2018 Page 1/6 ABIDOS DIRECTION LARTIGAU LISA ANCE FEAS 0,50 ECEL ABADIE LUCILLE ANGLET FERRY 0,25 DCOM MAT DAMESTOY MAIDER ANGLET HERRIOT 0,25 DCOM MAT DAMESTOY MAIDER ANGLET JAURES 0,25 DCOM MAT DAMESTOY MAIDER ANGLET LARREBAT 0,25 DCOM MAT DAMESTOY MAIDER ANGLET LARREBAT TRBD PREDY GUILLAUME ARAMITS 0,50 TRBD ABADIE LUCILLE ARBERATS 0,50 MSUP INCAGARAY KATTALIN ARBUS 0,25 DCOM LECOMTE SANDRINE ARBUS 0,25 ECMA LECOMTE SANDRINE ARCANGUES 0,36 TRBD GRILLON YOANNA ARGAGNON 0,50 ITIN Occitan HOU VALERIE ARGAGNON 0,25 ECMA MARIE NATACHA ARMENDARITS ECEL DE CAUNES ISABELLE ARMENDARITS DIRECTION OLIVE LAURENT ARTIGUELOUVE 0,25 DCOM ESTRABOLS PAULINE ARTIGUELOUVE 0,25 ECMA SARAGNET EMILIE ARTIGUELOUVE ECEL VIEU EMMA ARZACQ 0,50 MSUP ERRAMOUSPE MARITCHU ARZACQ 0,25 DCOM ELE ERRAMOUSPE MARITCHU AUBERTIN 0,50 ECEL TOURNIER FABIOLA BAUDREIX 0,50 ECEL GRATIA LAURE BAYONNE ARENES ECMA DUFOURG ELODIE BAYONNE BRANA TR SURNOMBRE ELE SAMAGAIO MELANIE BAYONNE BRANA ECEL GUILLAUME SANDRINE BAYONNE BRIAND 0,50 ULIS TOURNADRE SANDRINE BAYONNE CAVAILLES 0,25 ECEL TOURNADRE SANDRINE BAYONNE FERRY 0,50 ECMA Basque AHAMENDABURU ISABELLE BAYONNE FERRY 0,50 ECEL Basque MAITIA GRACIE BAYONNE IDEKIA ITEP MARTIN FREDERIQUE BAYONNE LAHUBIAGUE 0,25 ECMA DECLINCHAMP LAURA BAYONNE MALEGARIE ECEL Basque HIRIGOYEN AMAIA BAYONNE COLLEGE MARRACQ DIR ADJOINT SEGPA LOUSTAUNAU LIONEL BAYONNE PRISON MOUTEL-GROS DAVID BAYONNE TR SURNOMBRE BLACHIER MICHEL Résultats des affectations d’office des 2 et 5 juillet 2018 Page 2/6 -

COMMUNES HAD OLORON À Compter Du 01/02/2016
REPARTITION DES COMMUNES/HAD AQUITAINE COMMUNES HAD ORTHEZ COMMUNES HAD OLORON COMMUNES HAD PAU COMMUNES HAD BAYONNE à compter du 01/02/2016 à compter du 18/12/2015 AAST ABIDOS ACCOUS AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN ABERE ABITAIN AGNOS AHETZE ANDOINS ABOS AINHARP AICIRITS-CAMOU-SUHAST ANOS ANDREIN ALCAY-ALCABEHETY-SUNHARETTE AINCILLE ARBUS ANOYE ALOS-SIBAS-ABENSE AINHICE-MONGELOS ARESSY ARGAGNON ANCE AINHOA ARRIEN ARGELOS ANGAIS ALDUDES ARTIGUELOUTAN ARGET ANGOUS AMENDEUIX-ONEIX ARTIGUELOUVE ARNOS ARAMITS AMOROTS-SUCCOS ASSAT ARRICAU-BORDES ARAUJUZON ANGLET AUSSEVIELLE ARROSES ARAUX ANHAUX BALEIX ARTHEZ-DE-BEARN AREN ARANCOU BARINQUE ARTIX ARETTE ARBERATS-SILLEGUE BEDEILLE ARZACQ-ARRAZIGUET ARRAST-LARREBIEU ARBONNE BENTAYOU-SEREE ASTIS ARROS-DE-NAY ARBOUET-SUSSAUTE BERNADETS ATHOS-ASPIS ARTHEZ-D'ASSON ARCANGUES BILLERE AUBIN ARUDY ARHANSUS BIZANOS AUBOUS ASASP-ARROS ARMENDARITS BUROS AUDAUX ASSON ARNEGUY CASTEIDE-DOAT AUGA ASTE-BEON AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY CASTERA-LOUBIX AURIAC AUBERTIN ARRAUTE-CHARRITTE ESCOUBES AURIONS-IDERNES AUSSURUCQ ASCAIN ESLOURENTIES-DABAN AUTERRIVE AYDIUS ASCARAT ESPECHEDE AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN BALIROS AYHERRE GABASTON AYDIE BARCUS BANCA GELOS BAIGTS-DE-BEARN BARZUN BARDOS HIGUERES-SOUYE BALANSUN BAUDREIX BASSUSSARRY IDRON BALIRACQ-MAUMUSSON BEDOUS BAYONNE LABATUT BARRAUTE-CAMU BENEJACQ BEGUIOS LAMAYOU BASSILLON-VAUZE BEOST BEHASQUE-LAPISTE LAROIN BASTANES BERROGAIN-LARUNS BEHORLEGUY LEE BELLOCQ BESCAT BERGOUEY-VIELLENAVE LESCAR BERENX BEUSTE BEYRIE-SUR-JOYEUSE LESPOURCY BESINGRAND BIDOS BIARRITZ LOMBIA BETRACQ -
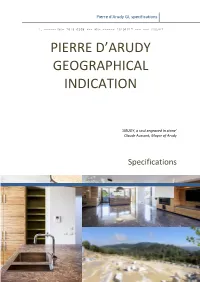
Hier Des Charges IG Pierre D'arudy
Pierre d'Arudy GI, specifications hier des charges IG Pierre d’Arudy 1. ------IND- 2019 0568 F-- EN- ------ 20191217 --- --- PROJET PIERRE D’ARUDY GEOGRAPHICAL INDICATION ‘ARUDY, a soul engraved in stone’ Claude Aussant, Mayor of Arudy Specifications p. 1 Pierre d'Arudy GI, specifications hier des charges IG Pierre d’Arudy Table of contents INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 4 I. Name .................................................................................................................................................... 6 II. Product concerned .............................................................................................................................. 6 A. Product description ..................................................................................................................... 6 B. Products covered ......................................................................................................................... 8 III. Demarcation of the geographical area or associated specific place .................................................. 8 IV. The quality, reputation, traditional knowledge or other characteristics possessed by the product in question is essentially attributable to its geographical area or specific place ...................................... 15 A. Specificity of the geographical area ......................................................................................... -

N°49 Trait D'union Pâques, Avril 2009
N° 49 Gratuit Printemps 2009 PAROISSE SAINTE MARIE DE BATBIELLE TRAIT D’UNION Éditorial - « Qu’est ce que Pâques ? » Dans nos mémoires d’enfant, Pâques, tout comme Noël, sont associés à des idées de cadeaux. La nuit pascale, les cloches passent dans les jardins pour déposer de précieux œufs en chocolat. Quel bonheur de découvrir au petit matin ces « trésors promis » au pied d’un arbre ou sous quelques fleurs ! Bien sûr, un adulte bienveillant participe à la découverte. Il se joint volontiers à la récolte. Mais rien ne doit être oublié. Pâques, la résurrection. Pâques, c’est la joie et l’émerveillement, une fête qui nous dynamise. Un dynamisme qui permet de s’émerveiller, qui fait vivre. Le Soleil s’est levé, CHRIST EST RESSUSCITÉ. « En sa personne, il a tué la haine ». Béance de son Amour blessé, Béance de son côté transpercé d’où jaillit l’eau et l’Esprit, D’où jaillit la vie que nul ne peut définitivement stopper. « J’ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer ». Qui nous roulera la pierre… Qui ? « Car la pierre était fort grande… » Le 1er jour de la semaine, de grand matin, trois femmes : Marie, Marie-Madeleine et Salomé vont au tombeau. Alors que le soleil se lève, elles regardent : la pierre a été roulée… Alors, qui nous roulera la pierre, pour avancer dans l’espérance? Lettre de nos missionnaires Au cours d’une rencontre du Conseil Pastoral Paroissial, Sœur Thérèse nous a fait part des besoins de sa communauté, les Servantes de Marie, un peu loin de chez nous, en Inde.