Diagnosticdiagnostic–Scenario–Scenarios Tendancetendances
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liste Des Elus Du Departement De Seine-Maritime
LISTE DES ELUS DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME CANTON QUALITE COLLEGE NOM PRENOM MANDATAIRE CP VILLE 01 ARGUEIL TITULAIRE 1 BELLET MARC 76780 LA HALLOTIERE 01 ARGUEIL TITULAIRE 1 BULEUX FRANCOISE 76780 NOLLEVAL 01 ARGUEIL SUPPLEANT 1 CAGNIARD PHILIPPE 76780 SIGY EN BRAY 01 ARGUEIL SUPPLEANT 1 DOMONT LYDIE 76780 SIGY EN BRAY 01 ARGUEIL TITULAIRE 1 GRISEL JEROME 76780 LE MESNIL LIEUBRAY 01 ARGUEIL SUPPLEANT 1 LANCEA PHILIPPE 76220 LA FEUILLIE 01 ARGUEIL SUPPLEANT 1 LETELLIER JEAN-PIERRE 76780 SIGY EN BRAY 01 ARGUEIL TITULAIRE 1 ROHAUT ARMELLE 76780 LA CHAPELLE ST OUEN 02 AUMALE TITULAIRE 1 AVYN SANDRINE 76390 RICHEMONT 02 AUMALE TITULAIRE 1 CHAIDRON GERARD 76390 ELLECOURT 02 AUMALE SUPPLEANT 1 CHOQUART CHRISTOPHE 76390 VIEUX ROUEN SUR BRESLE 02 AUMALE SUPPLEANT 1 COOLS CHRISTOPHE 76390 CONTEVILLE 02 AUMALE TITULAIRE 1 FERON YOLAINE 76390 CONTEVILLE 02 AUMALE SUPPLEANT 1 PINGUET JEAN-JACQUES 76390 CONTEVILLE 02 AUMALE TITULAIRE 1 POULET NICOLAS 76390 CONTEVILLE 02 AUMALE SUPPLEANT 1 VATTIER JACQUES 76390 RICHEMONT 03 BACQUEVILLE EN CAUX TITULAIRE 1 AUBLE CHRISTINE 76730 AVREMESNIL 03 BACQUEVILLE EN CAUX SUPPLEANT 1 LEVASSEUR BRIGITTE 76730 AVREMESNIL 03 BACQUEVILLE EN CAUX TITULAIRE 1 MASSE STEPHANE 76730 BACQUEVILLE EN CAUX 03 BACQUEVILLE EN CAUX TITULAIRE 1 VAILLANT GERALDINE 76730 AUPPEGARD 03 BACQUEVILLE EN CAUX SUPPLEANT 1 VASSEUR JEAN-BAPTISTE 76730 BACQUEVILLE EN CAUX 03 BACQUEVILLE EN CAUX SUPPLEANT 1 VIARD MARIE-PAULE 76730 AUPPEGARD 04 BELLENCOMBRE SUPPLEANT 1 BARRE GILLES 76680 BELLENCOMBRE 04 BELLENCOMBRE SUPPLEANT 1 DEHONDT -

Tronçon Et Cours D'eau Hydrographiques En Seine-Maritime
Tronçon et cours d'eau hydrographiques en Seine-Maritime LE TREPORT EU ETALONDES CRIEL-SUR-MER SAINT-REMY-BOSCROCOURT INCHEVILLE TOCQUEVILLE-SUR-EU Légende de la carte MONCHY-SUR-EU BAROMESNIL ASSIGNY LONGROY Tronçon hydrographique PENLY CANEHAN BRUNVILLE LE MESNIL-REAUME AUQUEMESNIL MELLEVILLE BELLEVILLE-SUR-MER Cours d'eau GRENY SEPT-MEULES BAZINVAL DERCHIGNY SAINT-QUENTIN-AU-BOSC DIEPPE GREGES GOUCHAUPRE ANCOURT AVESNES-EN-VAL GRANDCOURT BLANGY-SUR-BRESLE Limite de commune HAUTOT-SUR-MER BAILLY-EN-RIVIERE QUIBERVILLE ENVERMEU DANCOURT FRESNOY-FOLNY LONGUEIL PIERRECOURT ARQUES-LA-BATAILLE PREUSEVILLE LE BOURG-DUN OFFRANVILLE DOUVREND HODENG-AU-BOSC FALLENCOURT SAINT-VALERY-EN-CAUX AMBRUMESNIL BLOSSEVILLE MARTIGNY WANCHY-CAPVAL SMERMESNIL CAMPNEUSEVILLE PALUEL INGOUVILLE AUBERMESNIL-BEAUMAIS GUEURES FOUCARMONT CAILLEVILLE LA GAILLARDE ANNEVILLE-SUR-SCIE MEULERS AUBERVILLE-LA-MANUEL ANGIENS LONDINIERES NEVILLE SAINT-MARTIN-AU-BOSC PLEINE-SEVE FREAUVILLE CALLENGEVILLE BUTOT-VENESVILLE BRACHY FONTAINE-LE-DUN BERTREVILLE-SAINT-OUEN FREULLEVILLE VILLERS-SOUS-FOUCARMONT SASSETOT-LE-MAUCONDUIT CRASVILLE-LA-MALLET BAILLEUL-NEUVILLE AUBERMESNIL-AUX-ERABLES AUBEGUIMONT ANCRETTEVILLE-SUR-MER CLASVILLE DROSAY AUTIGNY SAINTE-FOY BACQUEVILLE-EN-CAUX OSMOY-SAINT-VALERY ELLECOURT CANY-BARVILLE BAILLOLET FESQUES ANGLESQUEVILLE-LA-BRAS-LONG CRIQUETOT-SUR-LONGUEVILLE BIVILLE-LA-RIVIERE LANDES-VIEILLES-ET-NEUVES ANGERVILLE-LA-MARTEL BURES-EN-BRAY HAUTOT-L'AUVRAY BELMESNIL LES CENT-ACRES LUCY LE CAULE-SAINTE-BEUVE AUMALE COLLEVILLE BERTHEAUVILLE BOSVILLE -
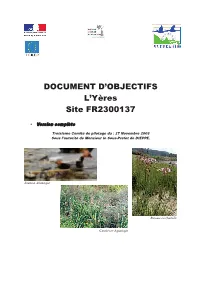
DOCUMENT D'objectifs L'yères Site FR2300137
DOCUMENT D’OBJECTIFS L’Yères Site FR2300137 Version complète Troisième Comité de pilotage du : 27 Novembre 2003 Sous l’autorité de Monsieur le Sous-Préfet de DIEPPE. Saumon Atlantique Butome en Ombelle Catabrose Aquatique Réalisation en 2001-2003 : Séverine DUMONT Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles de la Seine-Maritime Immeuble U.S.A. B.P. 500 – Cité de l’Agriculture 76 235 BOIS-GUILLAUME Cedex Préambule.............................................................................................................................................................. 2 CHAPITRE 1 : Description et analyse de l'existant........................................................................................... 4 1.1. Présentation du site...................................................................................................................................... 4 1.1.1. Situation de l'Yères ............................................................................................................................... 4 1.1.2. Justification scientifique du zonage ...................................................................................................... 5 1.1.3. Zonage................................................................................................................................................... 6 1.2. Exigences écologiques des habitats et espèces ............................................................................................ 7 1.2.1. Fiches -

Carte Des Vélorouteset Voies Vertes
les Offices de Tourisme. de ces d’hébergements, contactez possibilités la liste Pour connaître communes dans les traversées. différentes Vélo », existent « Accueil de la démarche D’autres hébergements, non référencés dans le cadre ou vitrines ont sur leurs devantures les prestataires Sur le terrain, • et dans les documents touristiques Sur Internet estle logo « accolé • Vélo ? Accueil un prestataire Comment repérer de De bénéficier : transfert de services aux cyclistes adaptés • et conseils : informations De bénéficier attentionné d’un accueil • sécurisé, kit de : abri à vélos De disposer d’équipements adaptés • : cyclotouriste pour le Vélo » c’est la garantit « Accueil Choisir un établissement ou en séjour. qu’ils soient itinérants à vélo, touristes aux besoins leurs conditions d’accueil des sensibilisés et ont adapté touristiques labellisés ont été Tourisme, tous les prestataires ou personnels des gestionnaires de visites Offices de sites de de vélo, Maritime, qu’ils soient hébergeurs, loueurs/réparateurs de Seine- vertes et voies Situés à moins de 5 km des véloroutes cyclables. le long des itinéraires auprès des cyclistes et des un accueil services Vélo » qui garantit de qualité « Accueil nationale de Seine-Maritime déploie la marque Le Département Linking quaint fishing villages to seaside resorts along the Alabaster Coast, this Vélo. le logo Accueil le panneau ou la vitrophanie représentant des équipements labellisés. » à côté AV des vélos,... lavage et accessoires, de vélos et séchage du linge, location bagages, lavage ...) utiles météo, (circuits, réparation… 180-km-long (111 miles) challenging cycle route consists of small sign-posted roads La Véloroute du Littoral / Alabaster Coast Cycle Route that wind through the impressive chalk cliffs and greens valleys. -

Avis D''enquête Publique
PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME DCPPAT - BPP --- AVIS D’'ENQUÊTE PUBLIQUE --- Ouverture d’une enquête publique relative au projet du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Vallée de l’Yères présenté par le Syndicat mixte du bassin versant de l’Yères et de la Côte. --- Syndicat Mixte du bassin versant de l’Yères et de la Côte --- Il sera procédé du mercredi 12 juin 2019 au mardi 16 juillet 2019 inclus, soit pour une durée de trente-cinq jours, à une enquête publique préalable à l’approbation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la vallée de l’Yères, présentée par le Syndicat du bassin versant de l’Yères et de la Côte (SMBVYC). Cette enquête se déroule sur le territoire des communes de : Aubermesnil-aux-Erables, Auvilliers, Avesnes-en-Val, Bailly-en- Rivière, Baromesnil, Callengeville, Canehan, Clais, Criel-sur-Mer, Cuverville-sur-Yères, Dancourt, Etalondes, Fallencourt, Flocques, Foucarmont, Fresnoy-Folny, Grandcourt, le Caule-Sainte-Beuve, Les Landes-Vieilles-et-Neuves, Le Mesnil- Réaume, Le Tréport, Melleville, Petit-Caux, Preuseville, Puisenval, Réalcamp, Rétonval, Saint-Germain-sur-Eaulne, Saint- Léger-au-Bois, Saint-Martin-le-Gaillard, Saint-Pierre-des-Jonquières, Saint-Rémy-Boscrocourt, Saint-Riquier-en-Rivière, Sept- Meules, Smermesnil, Touffreville-sur-Eu, Vatierville, Villers-sous-Foucarmont, Villy-sur-Yères, incluses pour tout ou partie dans le périmètre du SAGE. L'autorité compétente pour prendre les décisions relatives à la déclaration d’utilité publique est le préfet du département de la Seine -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°76-2020-69
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°76-2020-69 SEINE-MARITIME PUBLIÉ LE 15 AVRIL 2020 1 Sommaire Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET 76-2020-04-15-034 - 2020-03-30 - arrêté portant interdiction d'accès au littoral de la Seine-Maritime jusqu'au 15-04-2020 (3 pages) Page 3 76-2020-04-15-002 - Arrêté du 15 avril 2020 portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public dans le département de la Seine-Maritime jusqu'au 11 mai 2020 (4 pages) Page 7 76-2020-04-15-001 - Arrêté du 15 avril 2020 réglementant l'ouverture des jardins familiaux et ouvriers dans le département de la Seine-Maritime (2 pages) Page 12 76-2020-04-15-025 - arrêté préfectoral Arques la Bataille (2 pages) Page 15 76-2020-04-15-026 - arrêté préfectoral Bacqueville en Caux (2 pages) Page 18 76-2020-04-15-024 - arrêté préfectoral de Ambrumesnil (2 pages) Page 21 76-2020-04-15-020 - arrêté préfectoral de Anneville Ambourville (2 pages) Page 24 76-2020-04-15-021 - arrêté préfectoral de la Bouille (2 pages) Page 27 76-2020-04-15-023 - arrêté préfectoral de Neuville lès Dieppe (2 pages) Page 30 76-2020-04-15-017 - arrêté préfectoral de Sotteville sur mer (2 pages) Page 33 76-2020-04-15-018 - arrêté préfectoral de Tourville sur Arques (2 pages) Page 36 76-2020-04-15-022 - arrêté préfectoral Longueville sur Scie (2 pages) Page 39 76-2020-04-15-031 - arrêté préfectoral marché Berneval le grand (2 pages) Page 42 76-2020-04-15-032 - arrêté préfectoral marché Duclair (2 pages) Page 45 76-2020-04-15-033 - arrêté préfectoral marché Ecrainville -

Contrat De Territoire 2017-2022
CONTRAT DE TERRITOIRE 2017 -2022 36 SOMMAIRE Convention d’engagement 2 Présentation du territoire 9 Plan d’actions 14 Fiches actions Action n°1 : Création d’une Voie Douce de la Haute Vallée de la Bresle en connexion avec les territoires voisins : Phase 1 : Etudes et tronçon Monchaux-Soreng 15 Action n°2 : Création d’une ruche industrielle et artisanale communautaire au sein de l’ancienne verrerie Denin à Nesle-Normandeuse Phase 1 : Etudes 22 Action n°3 : Création d’hébergements dans l’ancienne maison du meunier (Aumale) à destination des jeunes salariés, apprentis et stagiaires pour les entreprises du secteur verrier 30 Action n°4 : Réhabilitation de la friche Pochet du Courval 37 Action n°5 : Rénovation énergétique du gymnase Flechelle 43 Action n°6 : Création d’une boucle pédestre « Agrion de Mercure » 49 1 CONVENTION D’ENGAGEMENT CONTRAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERREGIONALE AUMALE-BLANGY-SUR-BRESLE Entre La Région Normandie, représentée par Monsieur Hervé MORIN, Président du Conseil Régional, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 18/01/2021, Et Le Département de la Seine-Maritime, représenté par Monsieur Bertrand BELLANGER, Président du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 25/01/2021, Et La Communauté de Communes Interrégionale Aumale-Blangy-sur-Bresle, représentée par Monsieur Christian ROUSSEL, Président, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du 10/12/2020, Vu La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action -

Mai | Octobre 2021
Mai | Octobre 2021 ÉDITO Chaque année le Département de Normandie en terme de vous propose plus de 150 visites biodiversité et a été aménagé pour découvrir notre patrimoine pour vous en faire découvrir ses naturel sur les Espaces Naturels particularités. Son caractère Sensibles et le littoral de la Seine- sauvage vous invite rapidement Maritime. au voyage vers une reconnexion Cette année, c’est avec un plaisir à la nature. N’hésitez pas à vous particulier et une grande joie y rendre en accès libre ou lors que nous pouvons rouvrir nos d’une animation ! sites aux animations nature, en Je vous invite à rester toujours compagnie de nos partenaires prudent et à respecter les locaux. Visites naturalistes, conditions sanitaires pour votre artistiques, sensorielles ou encore sécurité, et j’espère que cette ludiques sur les plus beaux sites belle programmation de sorties naturels de notre territoire vous nature gratuites vous comblera et permettront de renouer avec la vous permettra de retrouver des nature. instants de partage et de bien- Cette année est également être qui sont tant essentiels. marquée par l’ouverture d’un Bel été à tous ! nouveau site en libre accès, qui a bénéficié d’aménagements exceptionnels : il s’agit de la Le Président du Département tourbière d’Heurteauville. Espace de la Seine-Maritime naturel de la vallée de Seine, il est l’un des sites les plus riches 2 LES ESPACES NATURELS LE LITTORAL Cas quasi-unique en France, le Département de la Seine- SENSIBLES ET LES FORÊTS Maritime a géré pendant près d’un siècle la grande majorité des digues et les épis du littoral de DÉPARTEMENTALES la côte d’Albâtre. -

Nos Bonnes Adresses" Dédié Aux Hébergements À Également Été Édité
N O S B O N N E S A D R E S S E S R E S T A U R A N T S / R E S T A U R A N T S 2021 Bienvenue Welcome to Bresle and Yères DANS LES VALLEES ENTRE BRESLE ET YÈRES Ce guide est édité par l’Office de Tourisme Communautaire et propose un choix de restauration, labellisés, qualifiés ou non sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes Aumale - Blangy-sur-Bresle (CCIABB). Ce document d’information ne peut engager la responsabilité de l’Office de Tourisme sur les prestations proposées. Le descriptif des installations et les textes fournis par les établissements n’engagent que leur seule responsabilité. Un deuxième guide "nos bonnes adresses" dédié aux hébergements à également été édité. Il est disponible sur demande à l’accueil des 2 bureaux d’information touristique du territoire Aumale - Blangy-sur-Bresle. This guide is published by the Community Tourism Office and offers a choice of catering, labeled, qualified or not on all the communes of the Community of Communes Aumale - Blangy-sur-Bresle (CCIABB). This information document does not involve the responsibility of the Tourist Office for the services offered. The description of the facilities and the texts provided by the establishments are their sole responsibility. A second guide "our good addresses" dedicated to accommodation has also been published. It is available on request at the reception of the 2 tourist information offices of the territory Aumale - Blangy-sur-Bresle. SOMMAIRE SOMMUARY Restaurants 4 Restaurants Restaurations rapides 9 Fast food Bars / Cafés 12 Coffee -

Seine-Maritime Et Intercommunalités
Eu Le Tréport Étalondes Ponts-et-Marais Flocques CC Villes Sœurs Criel-sur-Mer Saint-Rémy-Boscrocourt Saint-Pierre-en-Val Incheville Touffreville-sur-Eu Monchy-sur-Eu Baromesnil Canehan Millebosc Longroy Le Mesnil-Réaume Saint-Martin-le-Gaillard Guerville Petit-Caux Cuverville-sur-Yères Melleville Bazinval Seine-Maritime et intercommunalités Sept-Meules Monchaux-Soreng Villy-sur-Yères CC Falaises du Talou Rieux Grèges Dieppe Sauchay Avesnes-en-Val Blangy-sur-Bresle Varengeville-sur-Mer Grandcourt Hautot-sur-Mer Martin-Église Ancourt Bailly-en-Rivière Sainte-Marguerite-sur-Mer Bellengreville Quiberville Rouxmesnil-Bouteilles Saint-Ouen-sous-Bailly Dancourt Nesle-Normandeuse Envermeu Saint-Aubin-sur-Mer Fresnoy-Folny Longueil CA Région Dieppoise Les Ifs Saint-Riquier-en-Rivière Pierrecourt Arques-la-Bataille Sotteville-sur-Mer Le Bourg-Dun Ouville-la-Rivière Saint-Aubin-sur-Scie Puisenval Veules-les-Roses Saint-Aubin-le-Cauf Douvrend Preuseville Saint-Valery-en-Caux Offranville Saint-Nicolas-d'Aliermont CC Interrégionale Saint-Denis-d'Aclon Wanchy-Capval Manneville-ès-Plains La Chapelle-sur-Dun Paluel Martigny Ingouville Ambrumesnil Tourville-sur-Arques Blosseville Dampierre-Saint-Nicolas Aumale-Blangy-sur-Bresle Avremesnil Sauqueville Fallencourt Hodeng-au-Bosc Veulettes-sur-Mer Colmesnil-Manneville Saint-Sylvain Cailleville Saint-Pierre-le-Vieux Aubermesnil-Beaumais Réalcamp Malleville-les-Grès Gueures Saint-Jacques-d'Aliermont CC Londinières Gueutteville-les-Grès Foucarmont Campneuseville Auberville-la-Manuel La Gaillarde Thil-Manneville -

Carte En Vigueur Jusqu'au 10 Mai 2021
Carte en vigueur jusqu’au 10 mai 2021 Prises de rdv organisées par la CPTS en lien avec les médecins traitants Maison de santé et les pharmaciens. 16c Avenue de la Gare Guerville 76340 Blangy-sur-Bresle Monchaux-Soreng Bazinval 02 35 17 48 60 Blangy-sur-Bresle Rieux Maison de santé : 02 35 94 91 98 Grandcourt Nesle-Normandeuse Mairie : 02 35 93 80 08 Dancourt Maison de santé 3bisPierrecourt rue Charles Desjonquières Mairie de Londinières Saint-Riquier- Fresnoy- En-Rivière 76340 Foucarmont Folny Preuseville 2 rue Général de Gaulle Puisenval 76660 Londinières Hodeng-au-Bosc 02 35 94 13 30 Wanchy-Capval Fallencourt Smermesnil Réalcamp Campneuseville Saint-Pierre- Foucarmont Londinières des-Jonquières Saint-Léger-Aux-Bois Saint-Martin-Au-Bosc Sainte-Agathe- Villers-Sous-Foucarmont d'Aliermont Fréauville Callengeville Vieux-Rouen-Sur-Bresle 02 49 49 28 09 Aubermesnil-Aux-Erables Richemont Osmoy- Clais Retonval Aubeguimont Maison de santé 02 35 93 02 29 Saint-Valery Croixdalle Bailleul- Neuville Ellecourt1 rue du Jeu de paume Salle des fêtes Vatierville Landes-Vielles-et-Neuves Baillolet Fesques 76390 Aumale Marques rue du BaronBures-en-Bray d’Haussez Le Caule-Sainte-Beuve Morienne Lucy 76270 Neufchâtel-en-Bray Saint-Germain- sur-Eaulne Aumale Nullemont Mesnières-en-Bray Ménonval Sainte-Beuve- en-Rivière Auvilliers 02 35 32 23 92 Fresles Illois Saint-Martin-l'Hortier Mortemer Maison de santé Neufchâtel-en-Bray 57 bis rue Dillard Quièvrecourt Graval Haudricourt 76270 Saint-SaënsBellencombre Bully Bouelles Ronchois Ventes- Flamets-Frétils Saint-Rémy -

N° 51 Du 1Er Mars 2014
1er mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 100 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2014-266 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Seine-Maritime NOR : INTA1403657D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ; Vu le décret no 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble le I de l’article 71 du décret no 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu la délibération du conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er.−Le département de la Seine-Maritime comprend trente-cinq cantons : – canton no 1 (Barentin) ; – canton no 2 (Bois-Guillaume) ; – canton no 3 (Bolbec) ; – canton no 4 (Canteleu) ; – canton no 5 (Caudebec-lès-Elbeuf) ; – canton no 6 (Darnétal) ; – canton no 7 (Dieppe-1) ; – canton no 8 (Dieppe-2) ; – canton no 9 (Elbeuf) ; – canton no 10 (Eu) ; – canton no 11 (Fécamp) ; – canton no 12 (Gournay-en-Bray) ; – canton no 13 (Le Grand-Quevilly) ; – canton no 14 (Le Havre-1) ; – canton no 15 (Le Havre-2) ; – canton no 16 (Le Havre-3) ; – canton no 17 (Le Havre-4) ; – canton no 18 (Le Havre-5) ; – canton no 19 (Le Havre-6) ; – canton no 20 (Luneray) ; – canton no 21 (Le Mesnil-Esnard) ; – canton no 22 (Mont-Saint-Aignan) ; – canton no 23 (Neufchâtel-en-Bray) ; – canton no 24 (Notre-Dame-de-Bondeville) ; .