What Defines Qiang-Ness? Towards a Phylogenetic Assessment of the Southern Qiangic Languages of Muli Agence Nationale De La Rech
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
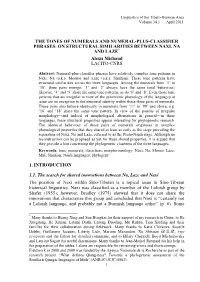
THE TONES of NUMERALS and NUMERAL-PLUS-CLASSIFIER PHRASES: on STRUCTURAL SIMILARITIES BETWEEN NAXI, NA and LAZE* Alexis Michaud LACITO-CNRS
Linguistics of the Tibeto-Burman Area Volume 34.1 — April 2011 THE TONES OF NUMERALS AND NUMERAL-PLUS-CLASSIFIER PHRASES: ON STRUCTURAL SIMILARITIES BETWEEN NAXI, NA AND LAZE* Alexis Michaud LACITO-CNRS Abstract: Numeral-plus-classifier phrases have relatively complex tone patterns in Naxi, Na (a.k.a. Mosuo) and Laze (a.k.a. Shuitian). These tone patterns have structural similarities across the three languages. Among the numerals from ‘1’ to ‘10’, three pairs emerge: ‘1’ and ‘2’ always have the same tonal behaviour; likewise, ‘4’ and ‘5’ share the same tone patterns, as do ‘6’ and ‘8’. Even those tone patterns that are irregular in view of the synchronic phonology of the languages at issue are no exception to the structural identity within these three pairs of numerals. These pairs also behave identically in numerals from ‘11’ to ‘99’ and above, e.g. ‘16’ and ‘18’ share the same tone pattern. In view of the paucity of irregular morphology—and indeed of morphological alternations in general—in these languages, these structural properties appear interesting for phylogenetic research. The identical behaviour of these pairs of numerals originates in morpho- phonological properties that they shared at least as early as the stage preceding the separation of Naxi, Na and Laze, referred to as the Proto-Naish stage. Although no reconstruction can be proposed as yet for these shared properties, it is argued that they provide a hint concerning the phylogenetic closeness of the three languages. Keywords: tone; numerals; classifiers; morpho-tonology; Naxi; Na; Mosuo; Laze; Muli Shuitian; Naish languages; phylogeny. 1. -

Curriculum Vitae
Curriculum vitae Alexis Michaud Born 16.08.1975. Married since 1999. 1 child born in 2010. Researcher (Chargé de Recherche) at Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, France), Langues et Civilisations à Tradition Orale research centre (LACITO) E-mail: [email protected] Web page: http://lacito.vjf.cnrs.fr/membres/michaud_en.htm Scripts: https://github.com/alexis-michaud Adjunct member of Laboratoire de Phonétique et Phonologie research centre (LPP-CNRS, France) International Research Institute MICA (Hanoi, Vietnam) Dongba Culture Research Institute (丽江市东巴文化研究院, Yunnan, China) Degrees 2017 Habilitation to supervise Ph.D. students (Habilitation à diriger des recherches) 2005 Ph.D. in Phonetics, summa cum laude, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle 2002 Master’s degree (“Diplôme d’Etudes Approfondies”) in Phonetics, “mention Très bien”, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle 1998 Master’s degree (“Diplôme d’Etudes Approfondies”) in Linguistics, “mention Très bien”, Université Paris 4-Sorbonne 1997 Passed (1st nationwide) the “Agrégation”, a competitive examination taken in the 5th year of University studies. Major: English language, literature and linguistics 1996 1st year of Master’s degree in Modern languages at Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle. Classes in linguistics at Oxford University 1995 Bachelor’s degree in English language, literature and linguistics 1994 Passed (2nd nationwide) the entrance examination to the Foreign Languages department of “École Normale Supérieure de Lyon” (one of the “Grandes Écoles”; formerly “ENS Fontenay-St Cloud”) Professional experiences Since 2006: tenured researcher (“Chargé de recherche”) in Linguistics at Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Affiliation: Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO): Oct. 2006-Dec. -

Tone in Yongning Na: Lexical Tones and Morphotonology Alexis Michaud
Tone in Yongning Na: lexical tones and morphotonology Alexis Michaud To cite this version: Alexis Michaud. Tone in Yongning Na: lexical tones and morphotonology. Language Science Press, 13, 2017, Studies in Diversity Linguistics, Haspelmath, Martin, 978-3-946234-86-9. 10.5281/zen- odo.439004. halshs-01094049v6 HAL Id: halshs-01094049 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01094049v6 Submitted on 26 Apr 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution| 4.0 International License Tone in Yongning Na Lexical tones and morphotonology Alexis Michaud language Studies in Diversity Linguistics 13 science press Studies in Diversity Linguistics Chief Editor: Martin Haspelmath Consulting Editors: Fernando Zúñiga, Peter Arkadiev, Ruth Singer, Pilar Valen zuela In this series: 1. Handschuh, Corinna. A typology of marked-S languages. 2. Rießler, Michael. Adjective attribution. 3. Klamer, Marian (ed.). The Alor-Pantar languages: History and typology. 4. Berghäll, Liisa. A grammar of Mauwake (Papua New Guinea). 5. Wilbur, Joshua. A grammar of Pite Saami. 6. Dahl, Östen. Grammaticalization in the North: Noun phrase morphosyntax in Scandinavian vernaculars. 7. Schackow, Diana. A grammar of Yakkha. 8. -

The Origin of Vowel Alternations in the Tangut Verb Guillaume Jacques
The origin of vowel alternations in the Tangut verb Guillaume Jacques To cite this version: Guillaume Jacques. The origin of vowel alternations in the Tangut verb. Language and Linguistics, Sage publishing, Association with Academia Sinica, Taiwan, 2009, 10 (1), pp.17-27. halshs-00351738 HAL Id: halshs-00351738 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00351738 Submitted on 11 Jan 2009 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. The origin of vowel alternations in the Tangut verb1 Jacques Guillaume, Université Paris Descartes Language and Linguistics 10.1:17-27,2009 Abstract: Like other Qiangic languages, Tangut has a complex verbal morphology. Based on comparative data from Qiangic languages, this article attempts at reconstructing the origin of the Tangut Ablaut system. In Tangut, some verbs have two stems, whose distribution is determined by the person of the agent and the patient. Stem 2 appears when the agent is first of second person singular and the patient is third person, and stem 1 in other verbal forms. We show that there was third person patient *-w suffix in Tangut cognate with Northern Qiang, and that stem 2 are the result of the coalescence of this suffix with the verb root vowel. -

The Structure of the Tangut Verb Guillaume Jacques
The Structure of the Tangut verb Guillaume Jacques To cite this version: Guillaume Jacques. The Structure of the Tangut verb. Journal of Chinese Linguistics, 2011, 39 (2), pp.419-443. halshs-00610385 HAL Id: halshs-00610385 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00610385 Submitted on 21 Jul 2011 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. THE STRUCTURE OF THE TANGUT VERB1 Guillaume Jacques CNRS (CRLAO), Paris ABSTRACT Abstract: The present paper is an attempt at analyzing the verbal morphology of Tangut from the point of view of both Tangut texts and modern Qiangic languages, its closest living relatives. Modern Qiangic languages, especially Rgyalrong, have a very strict verbal template. In this article, we propose that Tangut also had a verbal template, which was probably the result of independent grammaticalization rather than a shared inheritance with Rgyalrong. Then, we discuss apparent counterexamples to the proposed template and argue that other explanations are possible to account for them. Finally, we demonstrate the (previously unnoticed) existence of verbal incorporation in Tangut. SUBJECT KEYWORDS Tangut, Rgyalrong, Japhug, incorporation, directional prefixes, templatic morphology 1 As in Middle and Modern Chinese, in the Tangut script, there is a one-to-one relation between syllables and characters. -

Sir Gerard Clauson and His Skeleton Tangut Dictionary Imre Galambos
Sir Gerard Clauson and his Skeleton Tangut Dictionary Imre Galambos Sir Gerard Leslie Makins Clauson (1891–1974) worked most of his life as a civil servant and conducted academic research in his spare time.1 Only after retiring in 1951 at the age of 60 was he able to devote his full attention to scholarly endeavours, which were primarily focussed on Turkish languages. Thus as a scholar, today he is primarily remembered for his contribution to Turkish studies, and his Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish is still an essential reference tool in the field.2 Yet in addition to his study of Turkish and Mongolian linguistics, he also worked on a number of other Asian languages, including Tangut. Even though his extensive list of publications includes a small number of items related to Tangut studies,3 he devoted an incredible amount of time and effort to studying the language and to compiling a dictionary. He never finished the dictionary but deposited a draft version along with his notes in seven large volumes at the Library of the School of Oriental and African Studies (SOAS), so that they would be available to anyone who wished to study Tangut and perhaps continue his research. Eric Grinstead, who used the dictionary when working on the Tangut manuscripts at the British Museum, called it “a paragon of excellence” in comparison with high level of errors in dictionaries available at the time.4 Indeed, the erudition of Clauson’s dictionary is obvious even upon a cursory look at the manuscript version and had it ever been published, it would have undoubtedly made a major impact on scholarship. -

Language Ecology in Tibetan Areas of Western Sichuan: Problems, Causes and Strategies Xiao-Qiong WANG1,A
2021 International Conference on Education, Humanity and Language, Art (EHLA 2021) ISBN: 978-1-60595-137-9 Language Ecology in Tibetan Areas of Western Sichuan: Problems, Causes and Strategies Xiao-qiong WANG1,a 1Chongqing University of Technology, Chongqing, China [email protected] Keywords: Language ecology, Tibetan areas, Western Sichuan. Abstract. The language ecology in western Sichuan is diverse and complex, and there are nearly 20 ethnic groups and 20 languages intermingled with each other. However, their unique linguistic individuality is often covered by the universal language and become "disadvantaged languages" in their own habitat. Many reasons, of which are mixed ethnic distribution, deficient education resource and economic transformation etc., have led to the loss of linguistic vitality of the ancient languages. Ethnic, bilingual and vocational education are necessary strategies to improve the ethnic language ecology. 1. Introduction Sichuan Tibetan area located at the South-eastern fringe of Qinghai-Tibet plateau, stands at the transitional and intersection zone between Qinghai-Tibet plateau and Sichuan Basin from which Yun’nan-Guizhou Plateau is accessible. It consists of Garze Tibetan Autonomous Prefecture, Ngapa Tibetan and Qiang Prefecture and Muli Tibetan Autonomous County, which covers a vast area of 249,700 square kilometres and is approximately 51.49% of the total Sichuan territory. Diversity and complexity is the feature of Qinghai-Tibet plateau in terms of landform. Hengduan Mountains are characterized by deep alpine valleys from south to north which are steep and dangerous. And yet it bears the characteristics of both Qinghai-Tibet plateau and Hengduan Mountains. Its remote geographical location and closed geographical environment make the ancient national language and culture preserved sporadically. -

Ersu) Katia Chirkova
Lizu (Ersu) Katia Chirkova To cite this version: Katia Chirkova. Lizu (Ersu). Thurgood, Graham and Randy J. LaPolla. The Sino-Tibetan Languages (Second Edition), Routledge, pp.823-839, 2016, 9781138783324. hal-01485386 HAL Id: hal-01485386 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01485386 Submitted on 8 Mar 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Lizu (Ersu) Katia Chirkova (CNRS-CRLAO) 1. Introduction Lizu is one of three closely related Tibeto-Burman languages spoken in Sìchuān 四川 省 Province in the People’s Republic of China: Ersu, Lizu, and Duoxu (see Map 1). The three languages are currently classified as dialects of one Ersu language (ISO-639 code ers). The Ersu language itself is classified as a member of the Qiangic subgroup of the Tibeto-Burman language family (e.g. Bradley 1997:36-37; Sun 2001). Map 1: Distribution of Ersu, Lizu, and Duoxu (Map by Franz Huber) The Lizu people refer to themselves as /lî-zû/ or /lŷ-zû/ ‘white people’. In Chinese, the group is variously known as Lǐrǔ 里汝, Lǚsū 吕苏, or Lìsū 傈苏 (Sun 1982; Huang and Renzeng 1991; Wang 2010; Wang 2012); in English, as Lizu or Lyuzu (Chirkova 2008; Ikeda 2009; Yu 2012). -

19-Handel-Chirkova-Stls-2016-Handout
Duoxu tonal developments in Tibeto-Burman context Zev Handel and Katia Chirkova Presentation at STLS-2016, Seattle, September 8-10, 2016 This is a draft that likely contains errors in both data and analysis. Please cite with care. Introduction Is the “ELD” cluster (Ersu, Lizu, Duoxu) a member of, or closely connected to, Lolo-Burmese? In other words, is it descended from Proto-Lolo-Burmese [PLB] or perhaps a sister of PLB? Let us term the affirmative response the ELD-LB Hypothesis. One way to test this hypothesis is to identify lexical items that are exclusive or nearly exclusive to Lolo-Burmese (i.e. seldom seen in other TB branches) and then determine if they are present in ELD. Another is to see if there are phonemic correspondences that are most easily explained (applying Occam’s Razor) by the ELD-LB Hypothesis, i.e. by the presumption of shared innovation. A preliminary argument along these lines was made in Chirkova and Handel (2013a), focusing in particular on nasal, voiceless nasal, and fricative-initial words. In this paper we examine tonal correspondences. Chirkova (2014b) was a preliminary presentation of intriguing evidence for an affinity between the ELD tone system and the PLB tone system. We here present a more detailed and better supported analysis. One hypothesis that could account for the evidence is the ELD-LB Hypothesis. However, at this stage of our analysis there are also alternative explanations that are plausible. We will present both the positive and negative evidence for the ELD-LB Hypothesis. PTB tones and PLB tones: an overview Attempts like that of Benedict (1972) to reconstruct a tone system for Proto-Tibeto-Burman [PTB] in unchecked (i.e. -

ILLUSTRATIONS of the IPA Ersu
ILLUSTRATIONS OF THE IPA Ersu Katia Chirkova Centre de Recherches Linguistiques sur l’Asie Orientale, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France [email protected] Dehe Wang Xichang College, Xichang, China [email protected] Yiya Chen Leiden University Centre for Linguistics, Leiden Institute for Brain and Cognition, Leiden, The Netherlands [email protected] Angelique´ Amelot Laboratory of Phonology and Phonetics, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France [email protected] Tanja Kocjanciˇ cAntolˇ ´ık Laboratory of Phonology and Phonetics, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France [email protected] The Ersu language (/ə́˞-sv5 ̩́xo/,̀ ersˇ uy¯ uˇ, ISO-639 code ers) is spoken by approximately 16,800 people who reside in five counties in Sichuan Province () in the People’s Republic of China: (i) Ganluo (), and (ii) Yuexi () counties of Liangshan Yi Autonomous Prefecture (), (iii) Shimian () and (iv) Hanyuan () counties of Ya’anMunicipality (), and (iv) Jiulong (, Written Tibetan, hereafter WT brgyad zur) county of Ganzi (,WTdkar mdzes) Tibetan Autonomous Prefecture.1 Ersu has two closely related sister languages: Lizu (/li55-zu55-hũ55/or/ly55- zu55-hũ55/, lˇıruyˇ uˇ or l`ısuy¯ uˇ)andDuoxu(/do33-ɕu33-na31/, duox¯ uy` uˇ 1 In transcriptions of Ersu words ‘-’ stands for morpheme boundary and ‘ = ’ stands for clitic boundary. In transcriptions, the Low tone is marked as ‘a’,̀ and the High tone is marked as ‘a’́ (for more detail, see section ‘Prosodic organisation’ below). Journal of the International Phonetic Association (2015) 45/2 C International Phonetic Association doi:10.1017/S0025100314000437 Downloaded from https://www.cambridge.org/core. -

Section 18.1, Han
The Unicode® Standard Version 13.0 – Core Specification To learn about the latest version of the Unicode Standard, see http://www.unicode.org/versions/latest/. Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book, and the publisher was aware of a trade- mark claim, the designations have been printed with initial capital letters or in all capitals. Unicode and the Unicode Logo are registered trademarks of Unicode, Inc., in the United States and other countries. The authors and publisher have taken care in the preparation of this specification, but make no expressed or implied warranty of any kind and assume no responsibility for errors or omissions. No liability is assumed for incidental or consequential damages in connection with or arising out of the use of the information or programs contained herein. The Unicode Character Database and other files are provided as-is by Unicode, Inc. No claims are made as to fitness for any particular purpose. No warranties of any kind are expressed or implied. The recipient agrees to determine applicability of information provided. © 2020 Unicode, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright, and permission must be obtained from the publisher prior to any prohibited reproduction. For information regarding permissions, inquire at http://www.unicode.org/reporting.html. For information about the Unicode terms of use, please see http://www.unicode.org/copyright.html. The Unicode Standard / the Unicode Consortium; edited by the Unicode Consortium. — Version 13.0. Includes index. ISBN 978-1-936213-26-9 (http://www.unicode.org/versions/Unicode13.0.0/) 1. -

Languages of Southeast Asia
Jiarong Horpa Zhaba Amdo Tibetan Guiqiong Queyu Horpa Wu Chinese Central Tibetan Khams Tibetan Muya Huizhou Chinese Eastern Xiangxi Miao Yidu LuobaLanguages of Southeast Asia Northern Tujia Bogaer Luoba Ersu Yidu Luoba Tibetan Mandarin Chinese Digaro-Mishmi Northern Pumi Yidu LuobaDarang Deng Namuyi Bogaer Luoba Geman Deng Shixing Hmong Njua Eastern Xiangxi Miao Tibetan Idu-Mishmi Idu-Mishmi Nuosu Tibetan Tshangla Hmong Njua Miju-Mishmi Drung Tawan Monba Wunai Bunu Adi Khamti Southern Pumi Large Flowery Miao Dzongkha Kurtokha Dzalakha Phake Wunai Bunu Ta w an g M o np a Gelao Wunai Bunu Gan Chinese Bumthangkha Lama Nung Wusa Nasu Wunai Bunu Norra Wusa Nasu Xiang Chinese Chug Nung Wunai Bunu Chocangacakha Dakpakha Khamti Min Bei Chinese Nupbikha Lish Kachari Ta se N a ga Naxi Hmong Njua Brokpake Nisi Khamti Nung Large Flowery Miao Nyenkha Chalikha Sartang Lisu Nung Lisu Southern Pumi Kalaktang Monpa Apatani Khamti Ta se N a ga Wusa Nasu Adap Tshangla Nocte Naga Ayi Nung Khengkha Rawang Gongduk Tshangla Sherdukpen Nocte Naga Lisu Large Flowery Miao Northern Dong Khamti Lipo Wusa NasuWhite Miao Nepali Nepali Lhao Vo Deori Luopohe Miao Ge Southern Pumi White Miao Nepali Konyak Naga Nusu Gelao GelaoNorthern Guiyang MiaoLuopohe Miao Bodo Kachari White Miao Khamti Lipo Lipo Northern Qiandong Miao White Miao Gelao Hmong Njua Eastern Qiandong Miao Phom Naga Khamti Zauzou Lipo Large Flowery Miao Ge Northern Rengma Naga Chang Naga Wusa Nasu Wunai Bunu Assamese Southern Guiyang Miao Southern Rengma Naga Khamti Ta i N u a Wusa Nasu Northern Huishui