Pprm Lovagny- Note De Présentation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bulletin Municipal N°38 - Décembre 2019 Sommaire Le Mot Du Maire
Bulletin municipal N°38 - Décembre 2019 Sommaire Le mot du Maire SOMMAIRSOMMAI E En matière de travaux de sécurité routière, les premiers aménagements de voirie de la Vy de la Verdelle ont été réalisés, avec l’espoir qu’ils engendreront une diminution des flux de circulation et un ralentissement des véhicules. L1 le motM du Maire En ce qui concerne notre personnel communal, notre équipe a enregistré, après plus de dix années de bons et loyaux services, le départ à la retraite de nfos ommunale s notre secrétaire de mairie Madame Brigitte Greillet, et l’arrivée de Madame Florence Vincent pour assurer IIC2 C Le Conseil Municipal en séances, déc 2018 - nov 2019 4 Les finances de la commune son remplacement et la poursuite du service. Nous 6 La révision du Plan Local d’Urbanisme souhaitons à Brigitte le meilleur pour la suite et à 7 L’urbanisme Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Florence tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles 8 Les grands projets fonctions. 9 Les travaux réalisés en 2019 11 Les projets de travaux pour 2020 Tous les membres de la commission communication et 12 L’environnement l’ensemble de nos collègues du Conseil Municipal se Par ailleurs, nos actions de mutualisation des ème 14 La jeunesse et le scolaire joignent à moi pour vous présenter la 38 édition du services se poursuivent afin de limiter l’inflation 15 Etat Civil bulletin municipal annuel de Lovagny et la dernière de de nos dépenses de fonctionnement. la mandature. Au niveau intercommunal, la création d’une police En le parcourant, vous pourrez retrouver les différentes pluri-communale sur tout le territoire de la CCFU vénements actions réalisées par vos élus afin d’accompagner le a permis de répondre à une partie des demandes en développement de la commune et répondre aux besoins E16 Dossier : les maires de Lovagny matière de sécurité. -

Légende Communale LES TERREAUX
885635,341144 886135,341144 886635,341144 887135,341144 887635,341144 888135,341144 LE PLAN N s te di o t C MONTAGNE D'AGE 4 VERS LA VILLE e s de nal LE SOMMET DES VAGES omm u c it V d o 7 ie N l r a ru LE SOMMET DES VAGES e comm unal n Voie mi e Voie h C 11 N e NONGLARD t de Vaulx u comm unale o R co LES EPIEUTAIRES mm MONTHOUX una le s r ie b r o ES COURBES S ) rural º 5 N de .C.n (V 1 u a e t o C e 108861,403216 n 108861,403216 g s ta e n d o M on s i Voi s Fruitiere e e dit de la s s LES VAGES Po la u d 1 N la l e a s r Chemin s ru a p Im VERS LE CHATEAU comm unale e d . h C LES n i m a l e AU JUILIARD h LA POSSESSION C Voie ru in r em al Ch dit e d r ntie Se l e a N 2 s n s i y h e C ale S comm un COMMUNAUX Voie d i t de C. LES CHAMPS RUES R LES CHAMPS BEUFAN des air es d Epieut it de L 'E c r ole a P Combassiere la Voie ta r rd a e gl S n o N comm una le Voi e eyss el S R.N N 201 de s n e lb A FLANCS u V 203 a VERS L'EGLISE l DE LA a r a Pa rur al a de MOIRY s e u l LA ns c ulbe E V ' l comm Ch em in COMBASSIERE t un di LAVANCHE ale rural de dit MONTAGNE LE PRE DE MONCLAIR Guil lar d t rur al e h c u d o i B t 3 0 2 . -

Revue M 2019
Programme des sorties club 019 Les diff1rents parcours sont consultables sur les sites : P calculitineraires Q r1f1rence : C chiffres ou P Openrunner Q 7 chiffres. https://www.calculitineraires.fr/index.php https://www.openrunner.com/ SA8EDI 9 8ARS – Sortie commune - 13h45 – Marquisats (50 kms DA 230 m nB256696C iste I Faverges I Mercier I /1sonne I piste I Doussard I Lathuile I piste - Annecy DI8ANCDE 10 MARS V.. – Départ Chavanod 2h30 SA8EDI 16 8ARS Départ commun – 13h45 – stade Randonneurs (55 km , DA 950m nB256692C pt de Brogny-Argonay clinique I Col de la Fr1tallaF I /illy le I AllonFier I Cercier I Bonlieu I Salenoves -M1signy I Nonglard I Lovagny I (orges du Fier I oisy I Cran -Annecy .ouristes (46 km, DA 440 m OR 8351551C Annecy le /ieux I Sur les bois I Col de Bluffy I Bluffy - Talloires I Doussard I iste I Annecy DI8ANCDE 19 MARS V.. – Départ Viuz la Chiesaz Parking église 8h30 SA8EDI 23 8ARS Départ commun – 13h45 – Marquisats Randonneurs nB256232 63 km dA1 00 Sevrier - col de Leschaux - la Chapelle st Maurice - st Eustache - st JorioF piste Doussard I Angon I Talloires I Menthon - col de Bluffy - Annecy le vx - Marquisats .ouristes 35 km dA 7 0 mt Sevrier-col de Leschaux-la Chapelle st Maurice-st Eustache-st JorioF-piste -retours Annecy DI8ANCDE 4 MARS V.. – Départ 8ermoz Parking ASP.. 8h30 SA8EDI 30 8ARS Départ commun – 13h30 – Mermoz Randonneurs (60 km, DA 1076 m OR 8351631C EI du Levray I Maclamod I Chavanod Corbier - Montagny les Lanches I Chapeiry I Dir Alby puis Le issieu I Boussy I eignat I MarcellaF I D25, I FaramaF - 0auteville ID14 puis D244 I Orbessy I St Eusebe I eFay I Sallongy I Frenes I /aulx - Nonglard I oisy I Brassily I Annecy 9 .ouristes (4 km DA 5 5 nB256952C oisy I Lovagny I Nonglard I 0auteville I /aux I Sallongy - La combe de Sillingy - La Balme I Sillingy I Nonglard - Lovagny- oisy S: Lovagny possibilit1 de rentrer par les gorges du Fier) 8ERCREDI 3 AVRIL – Reprise Ecole Cyclo RendeF vous parking (ymnase AS TT 13h45. -

Horaires Ligne 32 2017.Indd
Transports Horaires 32 La situation évolue RUMILLY / LOVAGNY / ANNECY La loi du 8 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, confi e aux PÉRIODE Régions la qualité d’autorité organisatrice des transports jusqu’alors exercée par les Départements. du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018 Ce transfert est échelonné dans le temps. Le Département a transféré à la Région à la date du 1er janvier 2017 la compétence liée aux lignes régulières et au transport à la demande, et à la date du 1er septembre 2017 la compétence liée aux transports scolaires. Afi n de garantir la cohérence du dispositif, le Département a assuré, par délégation de la Région, la gestion des transports interurbains jusqu’au 31 août 2017. Depuis le 1er septembre 2017, vous pouvez continuer à circuler à bord des cars du réseau des lignes interurbaines de Haute-Savoie (LIHSA) et utiliser les transports scolaires. Pour la ligne interurbaine 32, la valeur est de 54 g CO2/passager.kilomètre* *Formule n°5 – Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport. CONTACTS BUSTOURS SAS SIEGE ZA de Penaye 01300 CHAZEY BONS 161 T / 04 79 81 21 09 CENTRE DE RUMILLY F / 04 79 81 02 20 Route d’Aix-les-Bains [email protected] 74150 RUMILLY T / 04 50 01 23 63 VOYAGES GRILLET [email protected] 07/2017 Route d’Aix-les-Bains [email protected] 74150 RUMILLY T / 04 50 01 23 63 [email protected] auvergnerhonealpes.fr/interurbainhautesavoie -

RUMILLY COUV DCC.Indd
Ma Ville Rumilly l Guide Pratique l 2017 1 Le mot du maire ..................................................................................... 03 MA VILLE ................................................................. 05 Découvrir la ville .............................................................................. 06 Vie pratique Cadre de vie Plan de ville ..................................................................................... 11 L’équipe municipale ......................................................................... 18 La mairie .......................................................................................... 20 Vos démarches administratives ........................................................ 22 Vous informer .................................................................................. 26 A vos agendas .................................................................................. 28 VIE PRATIQUE ........................................................... 33 Numéros utiles ................................................................................. 34 Information sur les risques majeurs ................................................. 39 Social et Famille Santé - Professionnels de santé ....................................................... 58 CADRE DE VIE ........................................................... 63 Les déplacements............................................................................. 64 Le stationnement ............................................................................. -
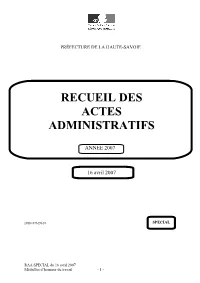
S O M M a I R E
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ANNEE 2007 16 avril 2007 ISSN 07619618 SPECIAL RAA SPECIAL du 16 avril 2007 Médailles d’honneur du travail - 1 - S O M M A I R E CABINET • Arrêté n° 2007.779 du 14 mars 2007 portant attribution de la Médaille d'Honneur du Travail – Promotion du 1er janvier 2007............................................................................ p 3 RAA SPECIAL du 16 avril 2007 Médailles d’honneur du travail - 2 - CABINET Arrêté n° 2007.779 du 14 mars 2007 portant attribution de la Médaille d'Honneur du Travail – Promotion du 1er janvier 2007 Article 1 : La médaille d’honneur du travail ARGENT est décernée à : - Madame ABATE Martine née VIARD-CRETAT Opérateur Montage, TEFAL SAS, RUMILLY. demeurant 4, rue Marcoz D'Ecle à RUMILLY - Monsieur ACHOUIANTZ Denis Perceur, SNR ROULEMENTS, ANNECY. demeurant 5 avenue de vert bois à CRAN-GEVRIER - Monsieur ADAMCZYK Laurent Employé de banque , BANQUE DE FRANCE , MARNE LA VALLEE . demeurant 92, chemin de la Tournette à SEVRIER - Monsieur ALLARD François Vendeur , REXEL FRANCE SAS, VILLEURBANNE . demeurant 1125, route de Lady Les Granges à MEGEVE - Madame ALLEMAND Jocelyne née FOURNIER-BIDOZ Employée de banque , BANQUE LAYDERNIER , ANNECY. demeurant La vacherie à THONES - Madame AMIR Anne-Marie née CLARET-TOURNIER Agent de fabrication , AUTOCAM / BOUVERAT INDUSTRIES, MARNAZ. demeurant Le Clos des Charmes à SCIEZ - Madame AMRI Soufia née SAIDI Opératrice, G. CARTIER TECHNOLOGIES, CLUSES. demeurant 308, rue des Iles à BONNEVILLE - Madame ANOTHAI Christine née LOUARD Opératrice, G. CARTIER TECHNOLOGIES, CLUSES. demeurant Chez M.et Mme RIN Christophe - 76, impasse des Ederlweiss à SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY - Monsieur ANSELME Georges Chauffeur-livreur, BRAKE FRANCE SERVICE , PRINGY. -

Inventaire Départemental Des Cavités Souterraines Hors Mines —R De La Haute-Savoie ' Rapport Final Convention MEDD N° CV04000065
•••, «> i, Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines —r de la Haute-Savoie ' Rapport final Convention MEDD n° CV04000065 ^ BRGM/RP-54130-FR V..,L , Septembre 2006 \ \ ' - - • :'11 ' "".. /^/ " -•/•..•'' F.9 3740/c-.t -615 5 l* íiwlii. RÉriJSLIQUt F brgGéosciencesm pour une Terre durable JÖ» Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie Rapport final Convention MEDD n° CV04000065 BRGM/RP-54130-FR Septembre 2006 Étude réalisée dans le cadre des projets de Service public du BRGM 2005 PSP04RHA06 O. Renault Avec la collaboration de D. Clairet Vérificateur : Approbateur : Nom : C. Lembezat Nom : F. Deverly Date : 12/10/06 Date : 14/11/06 Signature : Signature : Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2000. BRGM Geosciences pour une lene durable 2 0 DEC. 2006 BIBLIOTHEQUE brgm Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie Mots clés : base de données, inventaire, département de la Haute-Savoie, cavités souterraines, cavités naturelles, carrières souterraines abandonnées, ouvrages civils et militaires En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : O. Renault avec la collaboration de D. Clairet (2006) - Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie. Rapport final. BRGM/RP-54130-FR, 47 p., 27 ill., 3 ann., 1 carte hors texte ® BRGM, 2006, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l'autorisation expresse du BRGM. BRGM/RP-54130-FR - Rapport final Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie Synthèse Dans le cadre de la constitution d'une base de données nationale des cavités souterraines, le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (MEDD), a chargé le BRGM de réaliser l'inventaire des cavités souterraines abandonnées hors mines dans le département de la Haute-Savoie (Convention MEDD n° CV04000065). -

Haute Savoie Sites Inscrits
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT RHÔNE-ALPES liste des sites inscrits département de la Haute-Savoie • 125 sites inscrits Date de protection, nom du site, communes concernées • 24/08/1937 Lac d’Annecy, Annecy / Annecy-le-Vieux / Veyrier-du-Lac / Menthon-Saint-Bernard / Talloires / Doussard / Duingt / Saint-Jorioz / Sévrier • 19/05/1939 Abords du Pont de la Caille, Allonzier-la-Caille / Cruseilles, • 20/04/1942 Ruines du château de Faucigny et leurs abords, Faucigny, • 15/09/1942 Le Bonnant et les deux ponts du Diable, Saint-Gervais-les-Bains, • 15/09/1942 Vues panoramiques de la RN 202, Saint-Gervais-les-Bains, • 23/09/1942 Col du Bonhomme et ses abords, Les Contamines-Montjoie, • 17/02/1943 Rives du Lac d’Annecy à Albigny, Annecy-le-Vieux • 17/03/1943 Abords de la RD 909 au lieu-dit “ la Tour ”, Annecy-le-Vieux, • 22/03/1943 Place du Bourg et ses abords, Alby-sur-Chéran, • 30/06/1943 Château de la Palud, Moye • 01/06/1943 Carrefour du Faubourg Saint-Martin, La Roche-sur-Foron, • 01/06/1943 Gorges de Mieussy, Mieussy, • 01/06/1943 Maisons anciennes rue Carnot et Place Saint-Jean, La Roche-sur-Foron, • 01/06/1943 Place Grenette et Hôtel de Ville, La Roche-sur-Foron, • 09/06/1943 Église Saint-Jean et rue des Fours, La Roche-sur-Foron, • 09/06/1943 Quartier du Plain-Château, La Roche-sur-Foron, • 09/06/1943 Rampe du Crétet, La Roche-sur-Foron, • 30/06/1943 Colline de Chappay, Le Val-de-Fier, • 30/06/1943 Pont de Lornay et ses abords, Le Val-de-Fier, • 05/11/1943 Place de la Mairie, Rumilly, • 16/11/1943 Château de Monthoux et son parc, Pringy • 02/12/1943 Gorges du Fier, Lovagny, • 14/01/1944 Étroit d’Enté et ses abords, Mieussy, • 28/01/1944 Hameau de Trélechamps et ses abords, Chamonix-Mont-Blanc, • 02/02/1944Montagne d’Anterne, Passy, • 10/02/1944 Alpe des Chavannes, Les Gets, • 10/02/1944 Côteau en bordure sud de la RN 202, Les Gets, Direction régionale de l'environnement - RHONE-ALPES 208bis, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cédex 03 tél. -
Horaires Lignes Régulières
Horaires Lignes régulières Rumilly Vallières-sur-Fier 32 Hauteville-sur-Fier Vaulx Annecy Rumilly Sales 33 Marcellaz-Albanais Etercy Annecy Horaires valables du 7 juillet 2021 au 31 août 2022 32 Rumilly>Hauteville-sur-Fier>Annecy JOURS DE FONCTIONNEMENT L M Me J V L M Me J V RUMILLY Gare SNCF 6:30 7:00* RUMILLY Pont Neuf 6:34 7:04* VALLIÈRES-SUR-FIER Vers Coppet 6:39 7:09* VALLIÈRES-SUR-FIER Église 6:41 7:11* VALLIÈRES-SUR-FIER Les Quatre Chemins 6:45 7:15* HAUTEVILLE-SUR-FIER La Croix 6:47 7:17* HAUTEVILLE-SUR-FIER Chef-Lieu 6:49 7:19* HAUTEVILLE-SUR-FIER Les Onges 6:52 7:22* HAUTEVILLE-SUR-FIER Les Grands Prés 6:53 7:23* VAULX La Croix 6:56 7:26* NONGLARD Chez Pochat 7:00 7:30* LOVAGNY Mairie 7:05 7:35* LOVAGNY Ancien Lavoir 7:06 7:36* POISY Collège Simone Veil - 7:40* POISY Chef-Lieu 7:11 7:44* ANNECY Le Rabelais - 7:55* ANNECY Lycée Baudelaire 7:20 8:05* ANNECY Église des Bressis 7:21 8:09* ANNECY Lycée Gabriel Fauré 7:29 - ANNECY Gare Routière 7:34 8:15* JOURS DE FONCTIONNEMENT Me L M Me J V L M Me J V ANNECY Lycée Gabriel Fauré 12:06* - - ANNECY Gare Routière 12:12* 16:50* 18:05 ANNECY Lycée Baudelaire 12:19* 16:58* 18:13 ANNECY Le Rabelais 12:27* 17:10* - POISY Chef-Lieu 12:36* 17:20* 18:25 LOVAGNY Ancien Lavoir 12:41* 17:25* 18:30 LOVAGNY Mairie 12:42* 17:27* 18:32 NONGLARD Chez Pochat 12:47* 17:32* 18:37 VAULX La Croix 12:50* 17:35* 18:40 HAUTEVILLE-SUR-FIER Les Grands Prés 12:51* 17:37* 18:42 HAUTEVILLE-SUR-FIER Les Onges 12:52* 17:38* 18:43 HAUTEVILLE-SUR-FIER Chef-Lieu 12:54* 17:40* 18:45 HAUTEVILLE-SUR-FIER La Croix 12:56* -

Sommaire Le Mot Du Président
n ° 9 février 2013 - Entr E Fier & Usses BULLETIN COMMUNAUTAIRE D’INFORMATION - PoRTAGE LE MOT DU PRÉSIDENT DES REPAS petiTE EnfAncE Depuis 2008, de nouvelles compétences ont été transférées de nos communes à la CCFU de façon à optimiser et développer les miSSion locAlE services à notre population. jEunES La dernière compétence transférée est celle du service de livraison hAbitat de repas à domicile à l’échelle de la communauté de communes en collaboration avec l’ADMR. Ce service est effectif depuis février dévEloPPEmEnT SOMMAIRE 2012. Les repas sont confectionnés par l’EPHAD de Sillingy. DuRAblE Par ailleurs les élus ont décidé, pour optimiser les frais de AccessibiliTé fonctionnement, d’entamer une réflexion sur la mutualisation entre Au hAnDicap nos sept communes de la CCFU. gestion L’année 2012 a vu la mise en service totale de notre nouveau site internet (www.fieretusses.fr), avec EnviRonnEmEntalE le paiement en ligne des prestations de services. - AmbassadeuR DE TRi Nous vous invitons vivement à l’utiliser pour le paiement en ligne de vos factures - pannEAux d’eau. Au niveau des équipements communautaires, nous avons procédé cet été à la rénovation SERvicE DE l’EAu du gymnase suite au diagnostic réalisé. Nous avons obtenu beaucoup de subventions agenDA - mAnifestationS pour ce chantier (DETR, conseil général et député) représentant un montant cumulé de 378 840 euros pour un budget global de 753 760 euros. parc DES jARDinS Par ailleurs, la Maison de la solidarité, située à La Balme de Sillingy sera aménagée au DE hAuTE-SAvoiE cours de l’année 2013 pour accueillir certains services à la personne ainsi que les associations qui œuvrent dans ce domaine. -

Blason Lovagny
LLLeLeee blason de Lovagny Répondant à divers souhaits et recherches, le Conseil Municipal de Lovagny a décidé de doter la commune d’un blason lors de sa séance du 25 janvier 1985. Le 21 juin 1985, après avis de la Commission Nationale d’Héraldique, le blason de Lovagny, dessiné par Pierre Caddet, enfant de la commune, a été définitivement adopté. Définition héraldique Ecartelé : Les armoiries de Lovagny se composent de six parties : 1 - au chef de sable chargé de cinq tours d’argent 2 - au premier de gueules à une croix d'argent ; 3 - au second d'azur à clocher d'argent ; 4 - au troisième d'azur à trois ponts d'argent posés deux et un ; 5 - au quatrième de gueules au loup passant d'argent. 6 - l’écu est surmonté d’un listel « Lovagny » 1 - Le haut du blason, « au chef de sable chargé de cinq tours d’argent » Les 5 tours rappellent les cinq châteaux disparus, en ruines ou subsistant encore dans la commune : - le château de Saillon (disparu), - la tour du Petit Grézy (en ruines), - le château de Pontverre (en ruines), - le château de Chavaroche, - et le château de Montrottier. - le château de Saillon Le château de Saillon a aujourd’hui disparu, tout du moins de la surface de la commune. Il n’en reste que ses soubassements, avec des murs de plus de 1.50 m d’épaisseur, sur lesquels cette maison a été bâtie et a pris son emplacement même. La seigneurie de Saillon était située dans le Bas-Valais suisse. Les Pontverre avaient des droits féodaux à Saillon, droits partagés avec une famille noble de Saillon. -

Recueil Des Actes Administratifs N°74-2017-034
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°74-2017-034 HAUTE-SAVOIE PUBLIÉ LE 22 MARS 2017 1 Sommaire 74_DDARS_Délégation départementale de l'Agence régionale de santé de Haute-Savoie 74-2017-02-02-010 - arrété A.R.S 2017- 0056 fixant la programmation prévisionnelle pour la période de 2017 à2021 des contrats pluriannuels d' objectifs et de moyens des établissements et services médico- sociaux accueillant des personnes handicapées relevant de la compétence conjointe de l' Agence Régionale de Santé Auvergne - Rhone- Alpes et du Conseil Départemental de la Haute - Savoie. (3 pages) Page 4 74-2017-03-16-002 - Arrêté n°2017-0630 du 6 mars 2017 confiant l'intérim des fonctions de directeur de l'Ehpad La Provenche à St-Jorioz (Haute-Savoie) et des Ehpad Alfred Blanc Faverges Chevaline à Faverges (Haute-Savoie) à M. Christian TRIQUARD, Directeur du Centre Hospitalier Gabriel Déplante à RUMILLY (Haute-Savoie) (2 pages) Page 8 74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie 74-2017-03-09-004 - Arrêté DDCS/PL/2017-0027 fixant pour l'année 2017 la valeur du seuil de ressources des demandeurs de logement social du 1er quartile prévu par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (2 pages) Page 11 74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie 74-2017-03-15-003 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources / arrêté 2017-0015 du 15 mars 2017 portant délégation de signature en matière de gracieux fiscal donnée par Ludovic PEYTIER responsable de la trésorerie