Annales Du Gâtinais, Volume 4
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PROGRAMME DES VISITES ET DECOUVERTES Sauf Mention Spéciale, Le Tarif Des Visites Est De 4 € Par Personne À Partir De 14 Ans
Tarif PROGRAMME DES VISITES ET DECOUVERTES Sauf mention spéciale, le tarif des visites est de 4 € par personne à partir de 14 ans Réservation indispensable • à l’accueil de l’Office de Tourisme • par téléphone • sur www.grandpithiverais.fr Durée moyenne des visites : 1h30 Renseignements à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais 02 38 30 50 02 [email protected] Ce programme de visites n’est pas exhaustif d’autres visites peuvent être programmées en complément (fermes, exploitations agricoles..), n’hésitez pas à nous consulter. Avril à Novembre 2018 Office de Tourisme du Grand Pithiverais Nous vous emmenons découvrir le Grand Pithiverais ! Bureau de Pithiviers - Maison des Remparts - 1 mail ouest - 45300 PITHIVIERS Bureau de Malesherbes - 19 place du Martroi - Malesherbes 45330 LE MALESHERBOIS Bureau de Nibelle - 42 rue Saint Sauveur - 45300 NIBELLE 06/01/18 RC REV 0 Programme d’Avril à Novembre 2018 MERCREDI 18 AVRIL MERCREDI 13 JUIN MERCREDI 25 JUILLET SAMEDI 1er SEPTEMBRE Visite de ville : Puiseaux Visite de ville : Puiseaux Visite de l’huilerie Laluque Atelier tri de la laine à la ferme Feularde 14h00 devant la mairie 14h00 devant la mairie 10h30 à l’huilerie, Bazoches-les-Gallerandes 14h30 à la ferme Feularde, Les Hauts de Feularde, Estouy SAMEDI 28 AVRIL SAMEDI 16 JUIN SAMEDI 28 JUILLET Visite de ville : Pithiviers Le Jardin privé d’André Eve à Pithiviers Le Jardin d’André Eve à Pithiviers SAMEDI 8 SEPTEMBRE 10h00 à l’Office de Tourisme 10h00 au 28 faubourg d’Orléans 10h00 au 28 faubourg d’Orléans Le jardin privé d’André -

Publicité Pour Les Demandes D'autorisation D'exploiter
PRÉFET DU LOIRET Direction Départementale des Territoires Contact DDT 45 du Loiret Mme RIVIERRE Christine Service Agriculture et Développement Rural Tél : 02.38.52.47.95 181, Rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Fax : 02.38.52.47.51 Courriel : [email protected] Bureaux : Cité Administrative Coligny Boite fonctionnelle : [email protected] 131, Rue du Faubourg Bannier – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Publicité pour les demandes d’autorisation d’exploiter (décret n° 2015-713 du 22 JUIN 2015) N° Publicité Demandeur Biens demandés Propriétaires Date Date limite de dépôt de Communes d’enregistrement demande d’autorisation du dossier complet d’exploiter 2018-45-120 EARL « D’ENTRAYGUES » (61ha 98a 34ca) à • Mme DURAND Madeleine (usufruitière) à OUZOUER SOUS 13/07/2018 16/10/2018 (M. LUTTON Michaël) à BARVILLE EN GATINAIS, BELLEGARDE et M. CRAPEAU André (nu propriétaire) à BARVILLE EN GATINAIS BOESSES, BROMEILLES, BEAUNE LA ROLANDE ECHILLEUSES, EGRY et • M. DION André à AUXY GAUBERTIN • M. GUILLOT Denis à VILLENEUVE SUR LOT 47300 • Succession LAURIN Mathieu et LAURIN Emilie chez Maître ROYER à BEAUNE LA ROLANDE • Succession NOUE née LAURET Marie chez Maître ROYER à BEAUNE LA ROLANDE • Mme BECHU née LOUBIERE Madeleine à TULLINS 38210 • Succession NOUE Alfred et NOUE née LAURET Marie chez Maître ROYER à BEAUNE LA ROLANDE • Succession NOUE Alfred chez Maître ROYER à BEAUNE LA ROLANDE • M. NOUE Daniel à MONTBARROIS • M. NOUE Pierre et Mme NOUE-LENOBLE Solange (usufruitiers) à BARVILLE EN GATINAIS, M. NOUE Daniel (nu propriétaire) à MONTBARROIS • M. NOUE Pierre et Mme NOUE-LENOBLE Solange (usufruitiers) à BARVILLE EN GATINAIS, M. -

Publicité Pour Les Demandes D'autorisation D'exploiter (Décret N
PRÉFET DU LOIRET Direction Départementale des Territoires Contact DDT 45 du Loiret Mme RIVIERRE Christine Service Agriculture et Développement Rural Tél : 02.38.52.47.95 181, Rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Fax : 02.38.52.47.51 Courriel : [email protected] Bureaux : Cité Administrative Coligny Boite fonctionnelle : [email protected] 131, Rue du Faubourg Bannier – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Publicité pour les demandes d’autorisation d’exploiter (décret n° 2015-713 du 22 JUIN 2015) N° Publicité Demandeur Biens demandés Propriétaires Date d’enregistrement du Date limite de dépôt de Communes dossier complet demande d’autorisation d’exploiter 2017-45-199 M. DURAND Aurélien à (188,33 ha) à BARVILLE • Indivision GIRARD : Mme RIGAULT Mireille à 22/09/2017 22/12/2017 BATILLY EN GATINAIS EN GATINAIS, BATILLY PANNES, M. GIRARD Claude à LUTHENAY- EN GATINAIS, BEAUNE UXELOUP 58240 et M. GIRARD Gilbert à LA ROLANDE, VILLEMOUTIERS, BOISCOMMUN, • M. BERGER Marc à SAINT GEORGES SUR MOULON BOYNES, 18110 MONTBARROIS, • Mme ROCHER Josiane à DEUIL LA BARRE 95170 NANCRAY SUR • M. DURAND Jérémy à SAINT MARTIN D’ABBAT RIMARDE et SAINT • M. BERTHION Jean-Marie à COULAINES 72190 MICHEL • M. ROUSSEAU Pierre à BOISCOMMUN • M. et Mme BERARD Jean-Claude à BATILLY EN GATINAIS • M. DURAND Didier à BATILLY EN GATINAIS • Mme VALLEE Mauricette à BELLEGARDE • Mme GOURDON Madeleine, tutrice Mme BEAUDOIN Anne-Marie (MJPM) à ORLEANS • Mme DURAND Ginette à BEAUNE LA ROLANDE • M. AGULHON Marc à SAINT JEAN DE BRAYE • M. BEAUDICHON Claude à MONTBARROIS • Mme GUINET-FAUVIN Monique à BEAUNE LA ROLANDE • M. -

Les Teneurs Maximales En Pesticides Dans Les Eaux Distribuées
LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES ! ! DANS LES EAUX DISTRIBUÉES ! Rouvres dans le Loiret en 2016 ! Saint-Jean Pannecières Sermaises 0,13 Pannecières ! Autruy ! ! Audeville ! Andonville sur-Juine Thignonville Malesherbois ! Césarville Atrazine ! ! ! Intville-la Dossainville ! Boisseaux Morville-en Guétard Augerville Beauce la-Rivière Orville ! ! Erceville Charmont-en ! ! Dimancheville Atrazine dés!éthyl ! Beauce Engenville Desmonts ! Ramoulu Briarres Léouville sur-Essonne Outarville Guigneville Marsainvilliers ! Aulnay-la Puiseaux La représentation Atrazine dé!séthyl déisopropyl Rivière Ondreville ! Bondaroy sur-Essonne Estouy cartographique est ! Greneville Pithiviers Grangermont # en-Beauce Neuville 2,6 Dichlorobenzamide ! Pithiviers sur-Essonne Bromeilles le-Vieil basée sur les unités de Châtillon Échilleuses Chaussy Bazoches-les le-Roi Tivernon Givraines Dordives Bignon Gallerandes Jouy-en Dadonville Chevry # Pithiverais Yèvre-la Boësses sous-le Mirabeau distribution (UDI). Une Ville Bignon Lion-en Oison Escrennes Bazoches Beauce Ascoux Chevannes sur-le UDI correspond à un ! Attray Sceaux-du Laas Bouilly-en Gaubertin Pers-en Rozoy-le Betz ! Crottes-en Gâtinais Ferrières Vieil Aschères Gâtinais Boynes Nargis Gâtinais Ruan le-Marché Pithiverais Montigny Bouzonville Auxy Préfontaines en-Gâtinais secteur où l’eau est de Mareau Barville-en Bordeaux-en Santeau aux-Bois Ervauville ! aux-Bois Courcelles Gâtinais Égry Gâtinais Courtempierre Mérinville ! Batilly-en Foucherolles qualité homogène, géré Trinay 0,44 Selle Artenay Vrigny Gâtinais -

Archives Départementales Du Loiret
Archives départementales du Loiret Guide des sources sur la Première Guerre mondiale dans le Loiret Version mise à jour en novembre 2018 1 Introduction Département compris dans la zone de l’arrière, le Loiret n’a pas été le théâtre d’opérations militaires pendant le conflit. Il a pourtant pleinement participé à l’effort de guerre, par exemple par l’envoi de soldats au front, par la réquisition de denrées agricoles ou encore par l'accueil de soldats blessés. La guerre a également eu des répercussions fortes sur le quotidien des Loirétains : réorganisation de l'administration publique, bouleversements sociaux, encadrement des libertés démocratiques, présence marquée de l'autorité militaire, difficultés économiques et cherté de la vie, prise en charge des anciens combattants, des mutilés, des veuves et des orphelins... Dans le cadre de la commémoration du centenaire, des recherches nouvelles voient le jour, initiées par des collectivités, des associations patrimoniales, des étudiants, des enseignants, des membres de l'université d'Orléans. Mais sans épuiser le sujet. En interrogeant de manière renouvelée des sources connues ou en exploitant des documents passés inaperçus, l’histoire du Loiret durant la Grande Guerre peut toujours s’écrire et se ré-écrire. Les archives, qu’elles soient d’origine publique ou privée, sont la matière première pour toute étude du conflit. Néanmoins le repérage des documents est parfois difficile. Le présent guide a l'ambition de donner quelques clés d’accès, en répertoriant, sans prétendre bien sûr à l'exhaustivité, les sources disponibles, à destination d'un public large, allant des initiés aux amateurs de la période historique ou de l'histoire locale. -
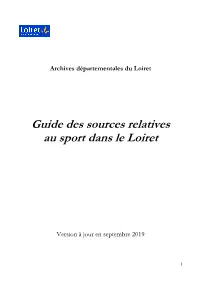
Guide Des Sources Relatives Au Sport Dans Le Loiret
Archives départementales du Loiret Guide des sources relatives au sport dans le Loiret Version à jour en septembre 2019 1 Introduction Si la pratique sportive remonte au moins à l’Antiquité, le terme « sport » n’apparaît dans les dictionnaires français qu’à partir du milieu du XIXe siècle. Deux phénomènes concomitants se manifestent à cette période : la démocratisation de la pratique sportive, via notamment la création des premières sociétés ou associations sportives, et l’apparition du sport comme spectacle de masse. La puissance publique encourage et organise une pratique sportive étendue. On peut citer ainsi la loi Falloux de 1850 qui rend obligatoire la pratique de la gymnastique scolaire ou bien le soutien aux sociétés de gymnastique patriotiques créées après la guerre de 1870. Néanmoins, il faut attendre le gouvernement du Front Populaire pour qu’une vraie politique publique de développement du sport se mette en place, avec la nomination de Léo Lagrange comme sous-secrétaire d’Etat aux Sports et à l’organisation des loisirs sous l’autorité, à partir de 1937, de Jean Zay ministre de l’Education nationale et des Beaux-Arts. Le Gouvernement de Vichy poursuivra cette politique d’encouragement du sport de masse et organisera également une première administration dédiée au sport. Après la Libération, la jeunesse et le sport vont être confiés au ministère de l’Education nationale, avant la création du ministère de la Jeunesse et des Sports par le décret du 8 janvier 1966 portant nomination du gouvernement Pompidou et le décret du 21 janvier 1966 n°66-64 fixant les attributions du ministère. -

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIER SERVICE GEOLOGIQUE REGIONAL-CENT Avenue Dé Concyr BP 60 45060 ORLEANS CEE Tel: 38.64.37 TABLE DES MATIERES
RECHERCHE DE SITES DE CARRIERES POUR GRANULATS CARTOGRAPHIE DE ZONES SUSCEPTIBLES DE RECELER BRGM DES CALCAIRES DURS AU NORD-EST DU LOIRET Par F. MENILLET 89 SGN 365 GEO/CEN AVRIL 1989 BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIER SERVICE GEOLOGIQUE REGIONAL-CENT Avenue dé Concyr_ BP 60 45060 ORLEANS CEE Tel: 38.64.37 TABLE DES MATIERES RESUME 1. INTRODUCTION 1 2. CARACTERES GEOLOGIQUES GENERAUX ET CRITERES DE SELECTION... 2 2.1. VUE D'ENSEMBLE SUR LES CALCAIRES DE BEAUCE AU NORD- EST DU LOIRET 2 2.2. CRITERES DE SELECTION DES ZONES FAVORABLES 5 3. SELECTION DES ZONES FAVORABLES 8 t 3.1. LOCALISATION DES ZONES FAVORABLES 8 3.2. COMMENTAIRE SUR LES DIFFERENTES ZONES SELECTIONNEES. 9 3.3. PROCEDURE DE RECHERCHE 11 4. CONCLUSIONS 12 RECHERCHE DE SITES DE CARRIERES POUR GRANULATS CARTOGRAPHIE DES ZONES SUSCEPTIBLES DE RECELER DES CALCAIRES DURS AU NORD-EST DU LOIRET RESUME Société CRAMBES Auteur : F. MENILLET 89 SGN 365 GEO/CEN Pour localiser des sites favorables à la recherche de gisements de calcaires durs au Nord-Est du département du Loiret, une étude documen- taire et une prospection sur le terrain ont été effectuées. Elles ont permis de préciser la connaissance de la lithologie des Calcaires de Beauce dans cette région et de sélectionner le Calcaire de Pithiviers comme seule subdivision géologique favorable. Ce calcaire n'ayant cependant pas partout une dureté et une épaisseur suffisantes, 6 zones, implantées sur des cartes topographiques à 1/25.000 ème ont été retenues pour une recherche de gisement en sondages. Outre ce résumé, ce rapport contient 12 pages et 2 cartes hors texte - 1 - 1. -

DDRM 2012 8,83 Mo
PRÉFET DU LOIRET DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de Protection Civile JANVIER 2012 Le Dossier Départemental des Risques Majeurs, édition janvier 2012, a été conçu et réalisé par le SIRACED-PC de la Préfecture de la Région Centre et du Loiret. Équipe de rédaction : Préfecture : Mme BRUCHET, Mme HAUTIN, Mme NIETO-LAVENTURE, M. BARSEGHIAN ; Direction Départementale des Territoires : M. NGUYEN, M. PIEL ; Direction Départementale de la Protection des Populations : Mme LEDOUBLE ; Unité territoriale de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement : M. DELHOMELLE ; Météo France : M. RAYNAUD ; Conseil Général : M. ROCH ; Bureau de Recherches Géologiques et Minières : M. GOURDIER, M. COCHERY ; SNCF Établissement Infrastructure Circulation Centre : M. CHARPENTIER ; Établissement Infrastructure Circulation Paris Sud Est : M. DA CONCEICAO. Illustrations, mise en page, impression : Le Mot DU PRÉfet Source : Préfecture du Loiret Chaque année, le monde déplore des sinistres d’origine météorologique (inondations, ouragans...) et des accidents d’origine technologique (explosion d’un établissement, pollution chimique...) aux conséquences dramatiques. Chaque événement est l’occasion de rappeler que le risque zéro n’existe pas. Le département du Loiret n’y échappe pas. Ce constat nous oblige à agir. Agir pour connaître, pour prévoir, pour se préparer. Avec cette nouvelle édition du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), le département se dote d’un outil actualisé qui décrit les risques majeurs affectant le département, dresse le portrait succinct de l’organisation des secours et prodigue les consignes de sécurité. Le risque majeur se définit comme un aléa d’origine naturelle ou technologique dont les effets impliqueraient un grand nombre d’individus et dont les conséquences seraient graves pour les personnes, les biens et l’environnement. -

Guide Des Parents Du Pithiverais
1 des parents du Pithiverais 2012 maquette Caf du Loiret - décembre 2011 guide pour les parents du Pithiverais 2012 2 3 Préambule Avant la naissance En tant que parent, il n’est pas Santé ........................................................ page 4 toujours facile de savoir ce qui existe Structures de garde ...................................... page 5 sur l’arrondissement de PITHIVIERS Services à la personne ................................... page 8 (Cantons de BEAUNE LA ROLANDE, de 0 à 4 ans MALESHERBES, OUTARVILLE, PITHIVIERS Santé ........................................................ page 9 et PUISEAUX). Structures de garde ...................................... page 11 Services à la personne ................................... page 16 Éducation .................................................. page 17 Conscient de ce constat, un groupe Lieux d’accueil parents enfants ........................ page 18 de professionnels et de parents * ont Ludothèques ............................................... page 19 réalisé ce guide pour vous aider dans SOMMAIRE vos démarches liées à l’éducation de de 4 à 12 ans Santé ........................................................ page 20 vos enfants. Le Pôle développement Structures de garde ...................................... page 21 territorial de la caisse d’Allocations Services à la personne ................................... page 27 familiales a accompagné ce travail. Éducation .................................................. page 28 Accueil de loisirs pour les moins de 14 ans .......... -

Chantiers Sur Les Routes.Pdf
ESSONNE De Rouvres-Saint-Jean à Sermaises - RD921 Chantiers sur les routes Réfection de la couche de roulement SemaineSemaine 32,32, 99 auau 1515 aoûtaoût 20212021 N SEINE-ET-MARNE De Yèvre-la-Ville EURE-ET-LOIR à Boynes - RD950 Dadonville - RD623 Aiguillage et tirage De La Selle-sur-le-Bied De Aschères-le Création d'un de fibre optique à Chantecoq - RD32 Marché à Crottes-en giratoire Intervention sur Pithiverais - RD133 Jouy-en-Pithiverais le réseau de Aiguillage et tirage - RD845 télécommunication de fibre optique Transport de boue souterrain Escrennes - RD845 Transport de boue Jouy-en Pithiverais - RD845 De Thorailles à Louzouer - RD115 Aschères-le-Marché - RD11 Transport de boue Intervention sur le réseau de télécommunication souterrain Aiguillage et tirage de fibre optique Chailly-en Gâtinais - RD963 De Louzouer à La Chapelle De Saint-Hilaire-les De Courcy aux Loges à Ingrannes RD921 Réfection de la couche de roulemnt. De Chevilly à Ingrn. RD921 Ingrannes - RD921 Intervention sur Saint-Sépulcre - RD128 Cercottes - RD2020 Trtmn. de sol Implantation des sondes Andrésis à La Selle Maintenance radar tronçon SM100 pour le traitement de sol le réseau de Intervention sur le réseau de en-Hermoy - RD2060 télécommunication télécommunication souterrain Interventions sur Rbréch. RD8 Réfctn. souterrain Ingrnn. RD343 le réseau de passgà. niveau Agllg. fibre optiq. De Sully la Chapelle Loiret Fibre à Ingrannes RD143 télécommunication Aiguillag. fibre optique Loiret Fibre souterrain De Saint-Firmin-des Saran RD557 Protection des accôtements pour Saran - RD557 De Vitry aux De Chailly-en-Gâtinais à réalisatin. d'un forage sous chaussée Remplacement et renforcement des bordures béton et Loges à Cmbr. -

Carte-Touristique-2018.Pdf
BIENVENUE DANS LE GRAND PITHIVERAIS BUREAUX DE L’OFFICE DE TOURISME / TOURIST INFORMATION CENTER GRAND 1 2 Vers 3 4 5 6 ETAMPES PITHIVERAIS PLUS BEAUX VILLAGE DE FRANCE PARIS Vers MELUN LABEL : "MOST BEAUTIFUL VILLAGES OF FRANCE" OFFICE DE TOURISME FONTAINEBLEAU Vers Rouvres- MÉRÉVILLE PARCS & JARDINS Saint-Jean Nangeville / PARKS & GARDENS A Vers Mainvilliers ANGERVILLE MALESHERBES ÉTAMPES SERMAISES VILLES & VILLAGES FLEURIS ACTIVITÉSDE LOISIRS PARIS Pannecières / FLOWERED TOWNS AND VILLAGES / LEISURE ACTIVITIES Orveau- Bellesauve B6 Base de loisirs de Buthiers / Leisure center Thignonville Audeville SAFRANIÈRES A1 Europaint - Paintball à Rouvres Saint Jean Andonville Autruy- Coudray / SAFFRON FIELDS A1 Karting RKO (entre Andonville et Angerville) / Kart racing sur-Juine Intville- Intville- Césarville- A6 Spa du château d’Augerville Morville- la-Guétard Boisseaux Dossainville Vers SITES NATURELS REMARQUABLES en-Beauce Augerville- / REMARKABLE NATURAL SITES D5 Cabaret le Diamant Bleu à Barville / Cabaret - Music Hall B URY la-Rivière FONTAINEBLEAU C4 ULM “les drôles d’oiseaux” à Marsainvilliers / Aircraft activities Labrosse Orville EcrevilleErceville Manchecourt C4 Laser Game à Pithiviers / Laser Game Charmont- Engenville Dimancheville ÉTANGS en-Beauce / LAKES D3 Aérodrome de Pithiviers le Vieil / Aircraft strip en-Beauce Ramoulu Briarres- Desmonts D4 Centre équestre à Pithiviers le Vieil / Equestrian center Léouville Marsainvilliers sur-Essonnes F4 Centre équestre à Nibelle / Equestrian center OUTARVILLE PATRIMOINE REMARQUABLE / REMARKABLE -

SESS14-XX-PV-AC RESTRICTION Beauce
PRÉFECTURE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE Arrêté n° 2014-000-0000 définissant les mesures coordonnées de restriction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours d’eau tributaires LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ILE DE FRANCE PRÉFET DE PARIS PRÉFET COORDONNATEUR DU BASSIN SEINE-NORMANDIE COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 214-7, R. 211-66 à R. 211-70, R. 212-1 et R. 213-14 à R. 213-16, VU l’arrêté modifié du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l’élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine- Normandie approuvé le 20 novembre 2009, VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés approuvé par arrêté inter-préfectoral en date du 11 juin 2013, VU la circulaire du 18 mai 2011 du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse, VU les arrêtés préfectoraux modifiés des départements : - d’Eure-et-Loir, du 3 juin 1999, - de Loir-et-Cher, du 31 mars 1999, - du Loiret, du 30 avril 1999, - de Seine-et-Marne, du 9 juin 1999, - des Yvelines, du 28 juillet 1999, - de l’Essonne, du 25 mars 1999, portant prescriptions complémentaires