Retrait Effectif Ou Pluralisation Contrôlée?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ethereum Based Domain Name System Using Smart Contracts
ETHEREUM BASED DOMAIN NAME SYSTEM USING SMART CONTRACTS (BC-DNS) A Project Presented to the faculty of the Department of Computer Science California State University, Sacramento Submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of MASTER OF SCIENCE in Computer Science by Rodney Pinto SPRING 2019 © 2019 Rodney Pinto ALL RIGHTS RESERVED ii ETHEREUM BASED DOMAIN NAME SYSTEM USING SMART CONTRACTS (BC-DNS) A Project by Rodney Pinto Approved by: __________________________________, Committee Chair Dr. Jun Dai. __________________________________, Second Reader Dr. Xuyu Wang. ____________________________ Date iii Student: Rodney Pinto I certify that this student has met the requirements for format contained in the university format manual, and that this project is suitable for shelving in the library and credit is to be awarded for the project. __________________________, Graduate Coordinator ____________________ Dr. Jinsong Ouyang, Ph.D. Date Department of Computer Science iv Abstract of ETHEREUM BASED DOMAIN NAME SYSTEM USING SMART CONTRACTS (BC-DNS) by Rodney Pinto One of the most critical resources that ensure the current working of the internet is the domain name system (DNS). It is a decentralized, hierarchical naming system that is responsible for translating the human-readable domain name to its associated IP address. The use of DNS thus eliminates the need for humans to remember the IP address of all their favorite websites (such as 172.217.6.68 an IPV4 address for google.com). Despite its widespread use, DNS is vulnerable to various security issues. This project focuses on replicating the basic functionality of the existing DNS on the blockchain and deploying it on a peer to peer network making it completely decentralized and, in the process, make it a bit more secure and reliable by addressing few of the security vulnerabilities of the existing system. -

Identifier System Attack Mitigation Methodology DATE: 13 February 2017 Identifier System Attack Mitigation Methodology
Identifier System Attack Mitigation Methodology DATE: 13 February 2017 Identifier System Attack Mitigation Methodology Introduction This document is part of ICANN’s effort to contribute to enhancing the Stability, Security, and Resiliency (SSR) of the Internet’s system of unique identifiers (“Internet Identifiers”) by working with the Community to identify and increase awareness of related attacks and to promote broader adoption of attack mitigation practices. This effort also addresses Recommendation #12 of the Security, Stability & Resiliency (SSR) Review Team (SSR-RT) by creating an Identifier System Attack Mitigation Methodology. Specifically, this document identifies and prioritizes types of attacks against the Identifier System, providing a stepping-off point for ICANN to coordinate with the Community to develop a series of short technical documents (“Tech Notes”) on actual high-impact attacks and emerging high-risk vulnerabilities. This document will be periodically updated to reflect evolution of both the Identifier System and the cybercrime landscape, supporting on-going efforts within both ICANN and the Community to mitigate attacks that pose the greatest risk to Identifier System SSR. Authors: Lisa Phifer and David Piscitello Page 1 Identifier System Attack Mitigation Methodology DATE: 13 February 2017 Attack Mitigation Methodology ICANN is proposing a new Identifier System Attack Mitigation Methodology to: • Identify, prioritize, and periodically refresh a list of top Identifier System attacks; • Develop guidance on actual high-impact attacks and emerging high-risk vulnerabilities; • Describe corresponding attack mitigation practices that are commonly considered useful; and • Encourage broader adoption of those practices via contracts, agreements, incentives, etc. This document represents the first component of this methodology. -

Thesis That TW-OR Forwards All DNS Queries to a Resolver in China
The Impact of DNSSEC on the Internet Landscape Von der Fakult¨atf¨urIngenieurwissenschaften, Abteilung Informatik und Angewandte Kognitionswissenschaft der Universit¨atDuisburg-Essen zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Ingenieurwissenschaften genehmigte Dissertation von Matth¨ausWander aus Lubin (L¨uben) Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Torben Weis Prof. Dr.-Ing. Felix Freiling Tag der m¨undlichen Pr¨ufung:19. Juni 2015 Abstract In this dissertation we investigate the security deficiencies of the Domain Name System (DNS) and assess the impact of the DNSSEC security extensions. DNS spoofing attacks divert an application to the wrong server, but are also used routinely for blocking access to websites. We provide evidence for systematic DNS spoofing in China and Iran with measurement-based analyses, which allow us to examine the DNS spoofing filters from van- tage points outside of the affected networks. Third-parties in other countries can be affected inadvertently by spoofing-based domain filtering, which could be averted with DNSSEC. The security goals of DNSSEC are data integrity and authenticity. A point solution called NSEC3 adds a privacy assertion to DNSSEC, which is supposed to prevent disclosure of the domain namespace as a whole. We present GPU-based attacks on the NSEC3 privacy assertion, which allow efficient recovery of the namespace contents. We demonstrate with active measurements that DNSSEC has found wide adoption after initial hesitation. At server-side, there are more than five million domains signed with DNSSEC. A portion of them is insecure due to insufficient cryptographic key lengths or broken due to maintenance failures. At client-side, we have observed a worldwide increase of DNSSEC validation over the last three years, though not necessarily on the last mile. -

CS4700/CS5700 Fundamentals of Computer Networks
CS4700/CS5700 Fundamentals of Computer Networks Lecture 17: Domain Name System Slides used with permissions from Edward W. Knightly, T. S. Eugene Ng, Ion Stoica, Hui Zhang Alan Mislove amislove at ccs.neu.edu Northeastern1 University Human Involvement • Just like your friend needs to tell you his phone number for you to call him • Somehow, an application needs to know the IP address of the communication peer • There is no magic, some out-of-band mechanism is needed – Word of mouth – Read it in the advertisement in the paper – Etc. • But IP addresses are bad for humans to remember and tell each other • So need names that makes some sense to humans Alan Mislove amislove at ccs.neu.edu Northeastern2 University Internet Names & Addresses • Names: e.g. www.rice.edu – human-usable labels for machines – conforms to “organizational” structure • Addresses: e.g. 128.42.247.150 – router-usable labels for machines – conforms to “network” structure • How do you map from one to another? – Domain Name System (DNS) Alan Mislove amislove at ccs.neu.edu Northeastern3 University DNS: History • Initially all host-addess mappings were in a file called hosts.txt (in /etc/hosts) – Changes were submitted to SRI by email – New versions of hosts.txt ftp’d periodically from SRI – An administrator could pick names at their discretion – Any name is allowed: eugenesdesktopatrice • As the Internet grew this system broke down because: – SRI couldn’t handled the load – Hard to enforce uniqueness of names – Many hosts had inaccurate copies of hosts.txt • Domain Name System (DNS) was born Alan Mislove amislove at ccs.neu.edu Northeastern4 University Basic DNS Features • Hierarchical namespace – as opposed to original flat namespace • Distributed storage architecture – as opposed to centralized storage (plus replication) • Client--server interaction on UDP Port 53 – but can use TCP if desired Alan Mislove amislove at ccs.neu.edu Northeastern5 University Naming Hierarchy root edu com gov mil org net uk fr etc. -
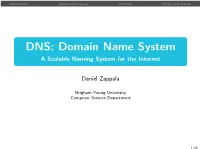
DNS: Domain Name System a Scalable Naming System for the Internet
Introduction Queries and Caching Protocol History and Growth DNS: Domain Name System A Scalable Naming System for the Internet Daniel Zappala Brigham Young University Computer Science Department 1/26 Introduction Introduction Queries and Caching Protocol History and Growth Domain Name System • people like to use names for computers (www.byu.edu), but computers need to use numbers (128.187.22.132) • the Domain Name System (DNS) is a distributed database providing this service • a program send a query a local name server • the local name server contacts other servers as needed • many DNS services • host name to IP address translation • host aliasing (canonical name versus alias names) • lookup mail server for a host • load distribution - can provide a set of IP addresses for one canonical name Demonstration: dig 3/26 Introduction Queries and Caching Protocol History and Growth Names • domain name: top-level domain (TLD) + one or more subdomains • example: cs.byu.edu • host name: a domain name with one or more IP addresses associated with it • TLDs • ccTLD: country codes (.us, .uk, .tv) • gTLD: generic (.com, .edu, .org, .net, .gov, .mil) { see full list at Wikipedia • iTLD: infrastructure (.arpa) • may be 127 levels deep, 63 characters per label, 255 characters per name 4/26 Introduction Queries and Caching Protocol History and Growth DNS Hierarchy • root, top-level domain (TLD), and local name servers • each level represents a zone • what zone is BYU in charge of? 5/26 Introduction Queries and Caching Protocol History and Growth Root Name -
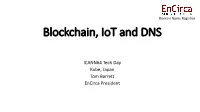
Blockchain, Iot and DNS
Domain Name Registrar Blockchain, IoT and DNS ICANN64 Tech Day Kobe, Japan Tom Barrett EnCirca President About EnCirca Domain Name Registrar • Formed in 2001 in Boston, USA • ICANN Accredited Registrar • Specialty: Partnering with TLD Registries • Restricted and regulated TLDs • White-labelled Storefronts for DotBrand and regulated registries • Validation Provider for .BANK and six other TLDs • Blockchain integration with .LUXE, XYZ Why Do We Care? Domain Name Registrar The blockchain and the Internet of Things (IoT) are two of the most transformative technologies in the world today. “Blockchain technology is probably the best invention since the internet itself” IoT Investments Domain Name Registrar Blockchain Investments Domain Name Registrar Blockchain and IoT Domain Name Registrar • Both need DNS to work. • Both need features not present in today’s DNS • Alternative frameworks and protocols are emerging to address the limitations of the DNS • Will DNS advance to meet this challenge? • What role will ICANN play in this space? A World Exploding with Devices Domain Name Registrar IoT Defined Domain Name Registrar Connect physical things to communication networks with a special focus on: • Existing infrastructure (buildings, roads, vehicles, factory equipment, etc.) and • Constrained devices with extremely limited computing resources (switches, valves, sensors, actuators, thermostats, etc.) Blockchain Defined Domain Name Registrar • An open, distributed ledger that can record transactions between two parties efficiently and in a verifiable and permanent way • A growing list of records, called blocks, are linked using cryptography • Typically managed by a peer-to-peer network • Data in any block cannot be altered retroactively without alteration of all subsequent blocks Blockchain Benefits Domain Name Registrar • You have complete control of the value you own; there is no third party that holds your value or can limit your access to it. -

Exploring the Threats of Decentalised DNS
Unravelling Ariadne's Thread: Exploring the Threats of Decentalised DNS Constantinos Patsakis1,2, Fran Casino1, Nikolaos Lykousas1, and Vasilios Katos3 1University of Piraeus 2Athena Research Center 3Bournemouth University Abstract The current landscape of the core Internet technologies shows con- siderable centralisation with the big tech companies controlling the vast majority of traffic and services. This has sparked a wide range of de- centralisation initiatives with perhaps the most profound and successful being the blockchain technology. In the past years, a core Internet in- frastructure, domain name system (DNS), is being revised mainly due to its inherent security and privacy issues. One of the proposed panaceas is Blockchain-based DNS, which claims to solve many issues of traditional DNS. However, this does not come without security concerns and issues, as any introduction and adoption of a new technology does - let alone a disruptive one such as blockchain. In this work, we discuss a num- ber of associated threats, including emerging ones, and we validate many of them with real-world data. In this regard, we explore a part of the blockchain DNS ecosystem in terms of the browser extensions using such technologies, the chain itself (Namecoin and Emercoin), the domains, and users which have been registered in both platforms. Finally, we provide some countermeasures to address the identified threats, and we propose a fertile common ground for further research. arXiv:1912.03552v1 [cs.CR] 7 Dec 2019 Keywords: Malware, DNS, Blockchain, Blockchain Forensics, Cybercrime 1 Introduction One could argue that there is a periodic paradigm shift between centralisation and decentralisation in computer science. -
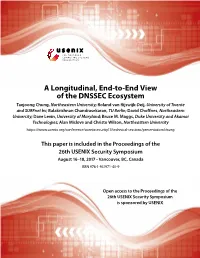
A Longitudinal, End-To-End View of the DNSSEC Ecosystem
A Longitudinal, End-to-End View of the DNSSEC Ecosystem Taejoong Chung, Northeastern University; Roland van Rijswijk-Deij, University of Twente and SURFnet bv; Balakrishnan Chandrasekaran, TU Berlin; David Choffnes, Northeastern University; Dave Levin, University of Maryland; Bruce M. Maggs, Duke University and Akamai Technologies; Alan Mislove and Christo Wilson, Northeastern University https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity17/technical-sessions/presentation/chung This paper is included in the Proceedings of the 26th USENIX Security Symposium August 16–18, 2017 • Vancouver, BC, Canada ISBN 978-1-931971-40-9 Open access to the Proceedings of the 26th USENIX Security Symposium is sponsored by USENIX A Longitudinal, End-to-End View of the DNSSEC Ecosystem Taejoong Chung Roland van Rijswijk-Deij Northeastern University University of Twente and SURFnet Balakrishnan Chandrasekaran David Choffnes Dave Levin TU Berlin Northeastern University University of Maryland Bruce M. Maggs Alan Mislove Duke University and Akamai Technologies Northeastern University Christo Wilson Northeastern University Abstract To address these problems, DNS Security Extensions (DNSSEC) [20] were introduced nearly two decades ago. The Domain Name System’s Security Extensions At its core, DNSSEC is a hierarchical public key infras- (DNSSEC) allow clients and resolvers to verify that tructure (PKI) that largely mirrors the DNS hierarchy and DNS responses have not been forged or modified in- is rooted at the root DNS zone. To enable DNSSEC, the flight. DNSSEC uses a public key infrastructure (PKI) owner of a domain signs its DNS records and publishes to achieve this integrity, without which users can be sub- the signatures along with its public key; this public key is ject to a wide range of attacks. -

Governança Global Da Internet
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Programa de Pós-Graduação em Ciência Política Doutorado em Ciência Política Diego Rafael Canabarro GOVERNANÇA GLOBAL DA INTERNET: TECNOLOGIA, PODER E DESENVOLVIMENTO (Volume 2) Porto Alegre 2014 Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. 192 Diego Rafael Canabarro GOVERNANÇA GLOBAL DA INTERNET: TECNOLOGIA, PODER E DESENVOLVIMENTO Tese de Doutorado apresentada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial à obtenção do título de Doutor. Orientador: Dr. Marco Aurélio Chaves Cepik Porto Alegre 2014 Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. 193 CIP - Catalogação na Publicação Canabarro, Diego Rafael Governança Global da Internet: Tecnologia, Poder e Desenvolvimento / Diego Rafael Canabarro. -- 2014. 433 f. Orientador: Marco Cepik. Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Porto Alegre, BR-RS, 2014. 1. Governança da Internet. 2. Desenvolvimento Institucional. 3. Poder Político. 4. Desenvolvimento. I. Cepik, Marco, orient. II. Título. Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os dados fornecidos pelo(a) autor(a). Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. 194 RESUMO A criação e a popularização da Internet pelo mundo levaram à institucionalização de uma realidade de governança descentralizada e multifacetada, que toca diversos regimes internacionais vigentes, arregimenta uma pluralidade quase infinita de stakeholders e conta com grande protagonismo de atores privados. A governança global da Internet diz respeito ao endereçamento dos dispositivos computacionais terminais e nucleares que integram a Internet e às tarefas de transmissão, roteamento e comutação de pacotes de dados de uma ponta à outra da Rede. -

An Empirical Study of Namecoin and Lessons for Decentralized Namespace Design
An empirical study of Namecoin and lessons for decentralized namespace design Harry Kalodner*, Miles Carlsten*, Paul Ellenbogen*, Joseph Bonneau†, Arvind Narayanan* {kalodner, carlsten, pe5, arvindn} @cs.princeton.edu* [email protected]† Princeton University Abstract 1 Introduction Decentralized namespaces. We initiate the study of decentralized namespaces from an eco- Secure decentralized namespaces have recently nomic perspective. A namespace, as we define become possible due to cryptocurrency technol- it, is an online system that maps names to val- ogy. They enable a censorship-resistant domain- ues. The Domain Name System (DNS) is the name system outside the control of any single most prominent example. A web service such entity, among other applications. Namecoin, a as Twitter that allows users to claim usernames fork of Bitcoin, is the most prominent example. and create profiles can be thought of as imple- menting a namespace. To be memorable by hu- We initiate the study of decentralized names- mans, namespaces must support arbitrary user- paces and the market for names in such sys- chosen strings as names. To be secure, names- tems. Our extensive empirical analysis of paces must map each name to the same value Namecoin reveals a system in disrepair. Indeed, for all users and adversaries shouldn’t be able to our methodology for detecting “squatted” and convince a user that any other value is correct. otherwise inactive domains reveals that among The problem of decentralized namespaces has Namecoin’s roughly 120,000 registered domain long been recognized as an important one. The names, a mere 28 are not squatted and have non- DNS is a critical yet centralized component of trivial content. -

Promotion of the Arabic Domain Name System
Distr. LIMITED E/ESCWA/ICTD/2009/Technical Paper.2 31 December 2009 ORIGINAL: ENGLISH ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN ASIA (ESCWA) PROMOTION OF THE ARABIC DOMAIN NAME SYSTEM Preliminary Feasibility Study for the ESTABLISHMENT OF THE DOMAIN NAME REGISTRY FOR THE ”.ﻋﺭﺒﻲ“ arab” and “ GENERIC TOP LEVEL DOMAINS ________________________ Note: This document has been reproduced in the form in which it was received, without formal editing. 09-0590 Disclaimers: This document has been reproduced without formal editing. The views expressed in this paper are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the United Nations Secretariat. Bibliographical and other references have, wherever possible, been verified. Mention of firm names and commercial products does not imply the endorsement of the Untied Nations. The material contained in this report may not be reproduced in whole or in part without the prior written permission of UN-ESCWA. iii Preface This Preliminary Feasibility study on Establishment of the Domain Name Registry for the “.arab” and Generic Top Level Domains was developed by ESCWA through a team comprising specialized ”.ﻋﺮﺑﻲ“ experts in the field combining technical, business, and legal backgrounds1. It constitutes a core component of ESCWA’s project on “Promotion of the Arabic Domain Names System” which is part of the Strategic Framework for 2007-2008; namely, expected accomplishments (a) Increased implementation of the Regional Plan of Action for building the Information Society, particularly in relation to the ICT sector and (b) Enhanced capacity of ESCWA member countries to provide e-services in Arabic targeting socio-economic development. The objective of this study is to provide an initial assessment of the feasibility of establishing a domain gTLDs through studying relevant technical and operational " .ﻋﺮﺑﻲ" name registry for the ".arab" and requirement and over viewing business, marketing, legal, financial and capital funding aspects related to establishing such registry. -

Domain Name Disputes and Unfair Trade Practices: an Analytical Legal Study
Domain Name Disputes and Unfair Trade Practices: An Analytical Legal Study A Dissertation submitted To Sikkim University In Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Philosophy By: Tshering Choden Bhutia Department of Law School of Social Sciences, Sikkim University January, 2018. 1 2 3 ACKNOWLEDGEMENT I am highly indebted to my research supervisor Dr. Nidhi Saxena, for her continuous support, supervision, motivation and guidance throughout the tenure of my research work in spite of her hectic schedule who truly remained driving spirit in my work and her experience gave me the light in handling research work and helped me clarifying the abstruse concepts, requiring knowledge and perception, handling critical situations and in understanding the objectives of my work. I would like to thank Prof. I.G Ahmed, HoD, who let me experience the research of “Domain Name Disputes & Unfair Trade Practices: An Analytical Legal Study” .I am very much grateful to the former Vice Chancellor Prof.T.B.Subba and present Vice Chancellor Prof. Jyoti Prakash Tamang for the opportunities and facilities that were provided at every step of my research. I would also like to acknowledge all the faculty members of law department Dr. Pravin Mishra, Mr. Veer Mayank, Miss Denkila Bhutia, Mr. Vijoy.V and Dr. Sonam Yangchen Bhutia for their support and encouragement. I acknowledge with pleasure for infrastructural support that I have received from Sikkim University. I find this opportunity to thank Minu Ma’am and library staff of the Sikkim University for providing their support to me. It would never have been possible to complete this study without a valuable support from my family and my friends.