Le Concordat
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Alsace Lorraine Champagne Free
FREE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE PDF Michelin Travel & Lifestyle | 490 pages | 07 Aug 2015 | Michelin Editions Des Voyages | 9782067203372 | English | Paris, France Grand Est - Wikipedia Belgium and Luxembourg lie to the north, Germany to the east and north, Alsace Lorraine Champagne Switzerland to the south. The capital is Strasbourg. In June French Pres. The reorganization was designed to address redundancies in regional bureaucracies and to reduce costs. In November the National Assembly approved the measure, and it took effect on January 1, Area 22, square miles 57, square km. Print Cite. Facebook Twitter. Give Feedback External Websites. Let us know if you have suggestions to improve this article requires login. External Websites. The Editors of Encyclopaedia Britannica Encyclopaedia Britannica's Alsace Lorraine Champagne oversee subject areas in which they have extensive knowledge, whether from years of experience gained by working on that content Alsace Lorraine Champagne via study for an advanced degree See Article History. Learn More in these related Britannica articles:. Francecountry of northwestern Europe. Historically and culturally among the most important nations in the Western world, France has also played a highly significant role Alsace Lorraine Champagne international affairs, with former colonies in every corner of the globe. Bounded by the Atlantic Ocean…. History at your fingertips. Sign up here to see what happened On This Dayevery day in your inbox! Email address. By signing up, you agree to our Privacy Notice. Be on the lookout for your Britannica newsletter to get trusted stories delivered right to your inbox. The Northeast: Champagne, Lorraine, Alsace – France Revisited - Life in Paris, Travel in France Three areas with strong identities comprise the region officially called Grand Est: Champagne, Lorraine and Alsace. -

COMMUNIQUE DE PRESSE 11Ème Édition Du
COMMUNIQUE DE PRESSE 4 mai 2018 11ème édition du « Rendez-vous avec les Religions » Conférences, spectacles, sport… au programme jusqu’au 5 juillet La Région Grand Est œuvre régulièrement avec les représentants des différentes familles religieuses et spirituelles présentes sur le territoire. Ces groupes sont réunis au sein d’une instance unique en France tournée vers le dialogue, l’information et la formation, sous l’autorité de Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, avec à ses côtés Catherine Zuber, conseillère régionale déléguée : le « Comité interreligieux auprès de la Région Grand Est ». Il vise à promouvoir toute action interreligieuse et interculturelle pour une meilleure compréhension de l’autre, de ses croyances et de sa culture. Il soutient et participe à différents événements, ponctuels ou permanents, notamment le « Rendez-vous avec les Religions » et le « Mois de l’Autre ». « La question des cultes fait partie intégrante de l’identité de notre Région, de par la spécificité du concordat en vigueur dans les départements d’Alsace-Moselle. Le dialogue interreligieux est un élément essentiel du bien-vivre ensemble, c’est pourquoi je souhaite que l’on puisse continuer à entretenir avec les représentants des cultes un travail régulier, notamment au travers de l’animation d’un réseau des acteurs œuvrant dans ce domaine. Je rencontrerai le « Comité interreligieux auprès de la Région Grand Est » le 4 juin prochain pour évoquer ces différentes questions. La Région Grand Est est pleinement investie sur ce sujet de société. Cette nouvelle édition du « rendez-vous avec les Religions » en est une parfaite illustration. » a souhaité réagir Jean Rottner, Président de la Région Grand Est. -

Social and Solidarity Economy: Challenges and Opportunities for Today’S Entrepreneurs
Social and Solidarity Economy: Challenges and Opportunities for Today’s Entrepreneurs UNITEE Strasbourg, 21st March 2014 The European-Turkish Business Confederation (UNITEE) represents, at the European level, entrepreneurs and business professionals with a migrant background (New Europeans). Their dual cultural background and their entrepreneurial spirit present a central asset which can facilitate Europe’s economic growth. FEDIF Grand Est is the Federation of French-Turkish Entrepreneurs of the French Great East region. It represents trade and industry entrepreneurs of the East of France. The first objective of FEDIF Grand Est is to contribute to the economic development of the region by promoting entrepreneurship and supporting the regional enterprises. CONFERENCE REPORT On Friday, 21st March 2014, UNITEE and FEDIF Grand Est organised the panel discussion “Social and Solidarity Economy: Challenges and Opportunities for Today’s Entrepreneurs” in UNITEE’s Strasbourg Office. Catherine Trautmann, MEP, and Pierre Roth, Managing Director of the Regional Chamber of the Social and Solidarity Economy of Alsace, were invited to this event to discuss the topic of social and solidarity economy (SSE), a major issue in the context of economic crisis. SPEAKERS Moderator: Mme Camille Serres, Project Manager Catherine Trautmann, MEP, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Pierre Roth, Managing Director of the Regional Chamber of the Social and Solidarity Economy of Alsace (CRESS Alsace) 2 CONFERENCE REPORT Aburahman Atli, Secretary General of FEDIF Grand Est and head of UNITEE’s Strasbourg Office, opened the conference with a welcome speech in which he underlined the challenges and opportunities of this new form of economy in our worrying economic climate. -

CALENDRIER 2021 (17 Novembre 2020)
Ligue Grand Est du Sport Automobile CALENDRIER 2021 (17 novembre 2020) 2020 2021 Date repli Catég. ASA Reçu le (covid-19) Nom de l'Epreuve JANVIER FÉVRIER 13 et 14 février 20 et 21 9ème Rallye Régional de Bourbonne-les-Bains + PEA / 4ème Rallye VHC / NON Régional ASA Langres le 29 sept. février 4ème Rallye VHRS 27 et 28 février MARS 6 et 7 mars 13 et 14 NON 30ème Rallye de Meuse + PEA / Rallye VHC Régional ASA 55 le 10 sept. mars 20 et 21 mars 26, 27 et 28 25, 26 et 27 24ème Rallye Epernay - Vins de Champagne + PEA / 13ème Rallye VHC National ASAC Champagne le 11 sept. mars mars (CFR 2ème division) AVRIL 4 et 5 avril 9 et 10 avril NON 1er Slalom KIMMEL Régional ASAC Moselle le 25 sept. 9 et 10 avril NON 36ème Rallye Régional du Florival + PEA / Rallye VHC / Rallye VHRS Régional ASA Plaine de l'ILL le 24 sept. 16, 17 et 18 ASA Reims NON 1er Classic Rallye National Saint-Dizier-Lacs de Champagne National le 10 sept. avril Chaumont Vintage 17 et 18 10 et 11 17ème Rallye Régional Mouzon-Frézelle Régional ASA Nancy le 11 août avril avril 17 et 18 24 et 25 1er Slalom de l'ASAPI Régional ASA Plaine de l'ILL le 24 sept. avril avril 23, 24 et 25 modif du 28 50ème Course de Côte d'Abreschviller-Saint Quirin, mémorial C. HENRY + Nationale ASAC Moselle le 24 août avril oct. PEA / 15ème Course de Côte VHC 30 avril et NON 26ème Course de Côte de l'Ormont / 2ème Course de Côte VHC Régional ASA Mirecourt le 10 août 1er mai MAI 1er et 2 mai 8 et 9 mai NON 9ème Slalom de Chambley Planet'Air Régional ASA Chambley le 1er sept. -

Carte Mentale
A remettre dans l’ordre pour constituer votre carte mentale : Réseau de Espaces en crise transport + Ardennes , Moselle, important en industrie ancienne Alsace et 5 aires urbaines, (mines, acier, Moselle Diagonale du dont Strasbourg métallurgie, textile, vide Ardennes, métropole Désindustrialisation) Meuse Germanique à Solde européenne, l’EST / migratoire institutions Peu de connections Parisienne à positif européennes en Champagne- FEDER (aide l’Ouest (parlement euro + Ardenne européenne aux Arte Frontalier régions les plus aves 4 Etats pauvres) Aménagement de européens Agriculture forte, réseaux de transport à industrie l’échelle de L’UE 2 euro-régions :Grande agroalimentaire (LGV, tramway, bassin Région ( Lorraine, (céréaliculture et Rhin Meuse) Wallonie, Luxembourg, vignoble) Sarre, RP …) et Région Champagne, trinationale du Rhin Alsace supérieur (Alsace, Bade ERASMUS W, Bâle…) Polyculture et Espace élevage en Shengen Forts flux de Région difficulté travailleurs exportatrice Ardennes, transfrontaliers Meuse Solde migratoire Régime du négatif concordat en Alsace Ardennes, et Moselle / Loi de INTERREG, Meuse séparation de soutien européen Aéroport l’Eglise et de l’Etat aux projets trinational depuis 1905 dans le transfrontaliers Mulhouse- reste du Grand Est Bâle-Fribourg Des influences différents Faiblesses Un territoire hétérogène et inégal Le Grand Est, un espace transfrontalier Atouts Des politique pour construire Au sein de la un territoire dorsale commun européenne (Londres à Milan) Diagonale du Espaces en crise Régime du Germanique -

Supplementary Information for Ancient Genomes from Present-Day France
Supplementary Information for Ancient genomes from present-day France unveil 7,000 years of its demographic history. Samantha Brunel, E. Andrew Bennett, Laurent Cardin, Damien Garraud, Hélène Barrand Emam, Alexandre Beylier, Bruno Boulestin, Fanny Chenal, Elsa Cieselski, Fabien Convertini, Bernard Dedet, Sophie Desenne, Jerôme Dubouloz, Henri Duday, Véronique Fabre, Eric Gailledrat, Muriel Gandelin, Yves Gleize, Sébastien Goepfert, Jean Guilaine, Lamys Hachem, Michael Ilett, François Lambach, Florent Maziere, Bertrand Perrin, Susanne Plouin, Estelle Pinard, Ivan Praud, Isabelle Richard, Vincent Riquier, Réjane Roure, Benoit Sendra, Corinne Thevenet, Sandrine Thiol, Elisabeth Vauquelin, Luc Vergnaud, Thierry Grange, Eva-Maria Geigl, Melanie Pruvost Email: [email protected], [email protected], [email protected], Contents SI.1 Archaeological context ................................................................................................................. 4 SI.2 Ancient DNA laboratory work ................................................................................................... 20 SI.2.1 Cutting and grinding ............................................................................................................ 20 SI.2.2 DNA extraction .................................................................................................................... 21 SI.2.3 DNA purification ................................................................................................................. 22 SI.2.4 -

La Collectivité Européenne D'alsace » Et De L'identité Alsacienne
Chronique 159. A propos de « la collectivité européenne d’Alsace » et de l’identité alsacienne Introduction. 1.À compter du 1er janvier 2021, l’Alsace, composante de la région Grand Est avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne, pourra également affirmer son identité propre au sein « d’une collectivité européenne d’Alsace » (I). Au-delà de ce cadre institutionnel qui a vocation à promouvoir notamment le bilinguisme, l’identité alsacienne repose sur deux autres piliers que sont les statuts des religions organisées par le concordat et le droit local (II). 2.Au-delà de cette actualité juridique et institutionnelle le confinement du printemps 2020 m’a donné l’occasion de mettre entre parenthèses mon centre d’intérêt privilégié qui est le droit de la formation professionnelle, pour m’intéresser, avec mon épouse, aux racines alsaciennes de notre famille, afin de les faire découvrir à nos petits-enfants, devenus comme nous d’ailleurs « des français de l’intérieur »1. Ce témoignage, personnel et familial, donne de la chair au débat institutionnel sur « la collectivité européenne d’Alsace », qui tente d’exprimer l’identité alsacienne2. (III). I. La collectivité européenne d’Alsace 3. Le débat sur la reconnaissance de l’identité alsacienne au sein de la République française « une et indivisible », vient de connaître en 2018 un nouvel épisode à travers un projet de création d’une « collectivité européenne d’Alsace » (accord conclu le 28 octobre 2018 à Matignon entre les présidents des Conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le Président de la région Grand Est et le Premier Ministre).3. -

Alsace – Home of Bugatti for 110 Years — Bugatti Newsroom
Alsace – home of Bugatti for 110 years MOLSHEIM 16 01 2020 THE FRENCH REGION OF ALSACE HAS A MOVING HISTORY – JUST LIKE BUGATTI Flammkuchen, white wine and cars. Alsace in the north of France has a lot to offer – and a lively history. The region between the Vosges and the Rhine switched its political affiliation several times from the 17th century onwards, between the Holy Roman Empire, the German Reich and France. France ceded Alsace to the German Reich in 1871, after which its affiliation switched three more times. The Paris Peace Conference ended on this day 100 years ago. The conference took place at the Palace of Versailles between 18 January 1919 and 21 January 1920. About 100 years ago, on 10 January 1920, the Treaty of Versailles came into force after being painstakingly agreed over many months. The signing of this treaty brought the First World War to an end under international law. Despite the frequent changes, Alsace developed culturally and industrially. The self-confident people of Alsace are proud of their regional identity. French luxury manufacturer Bugatti also made a modest contribution. The region is closely interlinked with the long history of Bugatti. About 110 years ago, company founder Ettore Bugatti moved to Molsheim in Alsace, which at that time was part of the German Reich. Bugatti himself, born in Italy, felt himself to be French even from a young age and thus perfectly epitomised the multinational nature of the people of Alsace. Ettore Bugatti moved to Alsace 110 years ago In late 1909, Ettore Bugatti and his family moved from Cologne to Molsheim near Strasbourg, where he had secured funding to produce cars and aircraft engines. -

Les Services De L'etat En Region Grand
LES SERVICES DE L’ETAT EN REGION GRAND EST 5 PREFECTURE DE LA REGION GRAND EST ET PREFECTURES DES DEPARTEMENTS LORRAINS PREFET DE LA REGION GRAND EST PREFET DU BAS-RHIN 5, place de la République - 67073 STRASBOURG CEDEX )03.88.21.67.68 - fax : 03.88.21.60.07 Mel : [email protected] Préfète : Josiane CHEVALIER ZONE DE DEFENSE EST Espace Riberpray - 12, rue Belle Isle - BP 51064 - 57036 METZ CEDEX 01 ) 03.87.16.12.00 Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la région Grand Est : Michel VILBOIS . Etat-Major Interministériel de Zone (EMIZ) . Centre Régional d’Information et de Coordination Routières (CRICR) . Secrétariat Général de l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI) SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES ET EUROPEENNES (SGARE) 5, place de la République - 67076 STRASBOURG CEDEX ) 03.87.34.87.34 - fax : 03.87.37.92.84 Secrétaire général : Blaise GOURTAY PREFECTURE DE LA MOSELLE 9, place de la Préfecture - BP 71014 - 57034 METZ CEDEX 01 ) 03 87.34.87.34 Préfet : Laurent TOUVET PREFECTURE DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE 1, rue Préfet Claude-Erignac - CO 60031 - 54038 NANCY CEDEX ) 03.83.34.26.26 - fax : 03.83.30.52.34 Préfet : Arnaud COCHET 6 PREFECTURE DE LA MEUSE 40, rue du Bourg - CS 30512 - 55012 BAR-LE-DUC CEDEX ) 03.29.77.55.55 - fax : 03.29.79.64.49 Préfète : Pascale TRIMBACH PREFECTURE DES VOSGES Place Foch - 88026 EPINAL CEDEX ) 03.29.69.88.88 - fax : 03.29.82.42.15 Préfet : Yves SEGUY 7 ARS ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE AGENCE REGIONALE DE SANTE GRAND EST (ARS) 3, boulevard Joffre - 54000 NANCY ) 03.83.39.30.30 (standard régional) Internet : www.ars.grand-est.sante.fr Mel : [email protected] DIRECTION REGIONALE Directrice générale : Virginie CAYRE Directeur général adjoint : Frédéric REMAY Conseillère médicale : Docteur Arielle BRUNNER . -

Is the River Network in the Grand Est and Neighbouring Regions a Source of Economic Potential to Be Developed?
PROCEEDINGS FROM THE SEMINAR ON 7 NOVEMBER 2016 ON TRANSBORDER QUESTIONS AND REGIONAL DEVELOPMENT THE GRAND EST REGION AND ITS NEIGHBOURS NEW DIMENSIONS, NEW OPPORTUNITIES? WHERETHE GRAND ARE ESTWE GOING?REGION AND ITS NEIGHBOURS: NEW DIMENSIONS, NEW OPPORTUNITIES? Agenda PROCEEDINGS FROM THE SEMINAR ON 7 NOVEMBER 2016 ON TRANSBORDER QUESTIONS AND REGIONAL DEVELOPMENT Introduction Roland RIES, Mayor of Strasbourg, President of the Eurodistrict Strasbourg-Ortenau Robert HERRMANN, President of the Eurometropolis of Strasbourg, President of the Strasbourg- Mulhouse-Colmar metropolitan hub Round table n° 1 - What are the best development models for the transborder regions? Catherine TRAUTMANN, former Minister, Vice-President of the Eurometropolis of Strasbourg Dr. Katharina ERDMENGER, Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, Germany Didier HERBILLON, Mayor of Sedan Jean-Paul DETAILLE, Advisor to the Minister of Agriculture and Tourism, in charge of the representation of the Greater Region of Wallonia Contributor: Frédéric BIERRY, President of the Bas-Rhin Departmental Council Round table n° 2 - What are the tools for developing our transborder regions? Stephan TOSCANI, Minister of Finances and European Affairs for the Sarre region André ROSSINOT, President of the Greater Nancy Metropolitan area, President of the Sillon Lorrain Metropolitan hub, Vice-President of MOT (Transborder Operational Mission) Dr. Manuel FRIESECKE, Director of Regio Basiliensis, Swiss partner for cooperation in Upper Rhine Jean-Claude SINNER, Director -
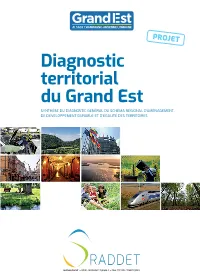
Synthese-Du-Diagnostic-Territorial-Sraddet.Pdf
PROJET Diagnostic territorial du Grand Est SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC GÉNÉRAL DU SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES Sommaire LE PORTRAIT DU GRAND EST ET SES DYNAMIQUES 4 CHAPITRE 1 : CARTE D’IDENTITÉ DU GRAND EST 4 1.1 ◾ Une région au cœur de l’Europe 4 1.2 ◾ Les héritages d’un passé commun 5 1.3 ◾ L’organisation administrative et territoriale 6 CHAPITRE 2 : UN ENVIRONNEMENT DIVERSIFIE, UNE RICHESSE FRAGILE 8 2.1 ◾ Une grande diversité de paysages menacée 8 2.2 ◾ Une région château d’eau à forte responsabilité 9 2.3 ◾ Une riche biodiversité sans frontières 10 CHAPITRE 3 : VIVRE DANS LE GRAND EST EN INTERACTION AVEC LES TERRITOIRES VOISINS 12 3.1 ◾ Des situations socio-économiques inégales et marquées par le transfrontalier 12 3.2 ◾ Un parc de logements peu adapté aux besoins des ménages 13 3.3 ◾ Une offre de services assez cohérente avec la densité de population 14 3.4 ◾ Des systèmes territoriaux sous influences extérieures 17 CHAPITRE 4 : DES ÉCONOMIES TERRITORIALES PLURIELLES 18 4.1 ◾ Un secteur agricole et vinicole puissant et des filières diversifiées 18 4.2 ◾ Un secteur forêt bois à fort potentiel 18 4.3 ◾ Une industrie en conversion 19 4.4 ◾ Un potentiel touristique en développement 20 4.5 ◾ Une économie de proximité en progression 21 4.6 ◾ Recherche et innovation, des relais de croissance 22 CHAPITRE 5 : SE DÉPLACER DANS LE GRAND EST ET AU-DELÀ 23 5.1 ◾ Une région ferroviaire et frontalière, souffrant de flux de transit routier déséquilibrés 23 5.2 ◾ Un maillage dense d’infrastructures -

Le Concordat, Une Chance Pour Les Religions Et L’
Publié le 5 août 2021(Mise à jour le 2/08) Par Laure Salamon Documentaire : L’Alsace, de la plaine d’Alsace au massif des Vosges Dans la collection les 100 lieux qu’il faut voir, France 5 diffuse un épisode sur l’Alsace, le 15 août à 20h50. De Strasbourg au Château fort de Fleckenstein, en passant par les vestiges de la guerre du Linge dans la forêt près de Colmar, ce documentaire montre divers aspects de l’Alsace. La collection des 100 lieux qu’il faut voir utilise le même procédé de faire connaître une région par ses habitants. Trois femmes emmènent les curieux. Adeline Beck, administratrice duMusée Vodou de Strasbourg fait visiter la capitale alsacienne : sa cathédrale, les canaux et le parc naturel de l’Île- du-Rohrschollen. Vous apprendrez par exemple pourquoi le quartier de la Petite France s’appelle ainsi ! Puis, Margaux Jung, experte en oenotourisme, emmène les téléspectateurs et téléspectatrices, entre autre, se balader dans les tranchées du Mémorial de la bataille du Linge, participer à la fabrication de spécialités culinaires et admirer les cigognes ! Enfin la professeure d’histoire Maryvonne Leonhard termine la visite en Alsace du Nord dans les entrailles de la Ligne Maginot et sur les hauteurs du Château de Fleckenstein, après avoir oeuvré à l’élaboration d’un moule à kougloff. Nature, gastronomie, patrimoine et récits historiques, tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment devant votre télévision à la découverte des trésors de cette région. Laure Salamon À voir “L’Alsace, de la plaine d’Alsace au massif des Vosges” réalisé par Sam Caro, dans la collection “Les 100 lieux qu’il faut voir”, diffusion le 15 août à 20h50 sur France 5 et en replay sur France.tv Publié le 3 août 2021(Mise à jour le 3/08) Par Laure Salamon Alsace : le Liebfrauenberg lance un appel à projet Le centre d’accueil du Liebfrauenberg en Alsace lance un appel à projets pour diversifier ses activités.