Arnica Montana En Région Centre-Val De Loire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

38 Plant Species at Risk Accounts in Prince George Timber Supply Area
38 PLANT SPECIES AT RISK ACCOUNTS IN PRINCE GEORGE TIMBER SUPPLY AREA FIA PROJECT 2668067 Prepared for: Canadian Forest Products Ltd. 5162 Northwood Pulpmill Road Prince George, B.C. V2L 4W2 Attn: Bruce Bradley Prepared by: Timberline Natural Resource Group Ltd. 1512 97 th Avenue Dawson Creek, BC V1G 1N7 March 2008 1 Acknowlegements The authors of these accounts, Mecah Klem, Jen Atkins, Korey Green and Dan Bernier would like to thank Bruce Bradley and the PG FIA licensee group for funding this project. We would also like to acknowledge the work by Timberline staff on related projects – their research and previous related technical reports were useful for completing these accounts in an efficient and comprehensive manner. Gilbert Proulx of Alpha Wildlife Research and Management is also thanked for his contribution to other components of this collaborative project. 2 Table of Contents: Introduction ................................................................................................... 5 Alpine cliff fern .............................................................................................. 6 American sweet-flag ...................................................................................... 8 Arctic rush ................................................................................................... 10 Austrian draba ............................................................................................ 12 Back’s sedge ................................................................................................ -

Aconitum Napellus, Arnica Montana, Belladonna, Eupatorium
FEBRIPLEX- aconitum napellus, arnica montana, belladonna, eupatorium perfoliatum, gelsemium sempervirens, mercurius solubilis, rhus toxicodendron tablet Seroyal USA Disclaimer: This homeopathic product has not been evaluated by the Food and Drug Administration for safety or efficacy. FDA is not aware of scientific evidence to support homeopathy as effective. ---------- FEBRIPLEX Active ingredients Each tablet contains: Aconitum napellus (Aconite) Whole Plant 6X Arnica montana (Mountain arnica) Underground Parts 8X Belladonna (Deadly nightshade) Whole Plant 8X (<1.43 x 10-10% alkaloids, calculated) Eupatorium perfoliatum (Boneset) Aerial Parts 10X Gelsemium sempervirens (Yellow jessamine) Underground Parts 12X Mercurius solubilis (Hahnemann's soluble mercury) 10X Rhus toxicodendron (Poison Ivy) Leafy Unwoody Twigs 8X Uses For the temporary relief of flu-like symptoms accompanied by mild fever and fatigue. Warnings Stop use and ask a doctor if symptoms continue to persist after three days of use or are accompanied by a fever. Do not use if you have ever had an allergic reaction to this product or any of its ingredients. If pregnant or breastfeeding, ask a health professional before use. Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away. Keep out of reach of children. If pregnant or breastfeeding, ask a health professional before use. Other information Do not use if the blister pack has been tampered with. Store in a cool, dry place. Inactive ingredients Lactose monohydrate (milk), magnesium stearate, sodium carboxymethylcellulose, xylitol Directions Adults and adolescents (12 years and older): At the first sign of symptoms, take one tablet allowing it to dissolve under the tongue. -

Conservation of Eastern European Medicinal Plants Arnica Montana in Romania Management Plan
Conservation of Eastern European Medicinal Plants Arnica montana in Romania Case Study Gârda de Sus Management Plan Barbara Michler 2007 Projekt Leader: Dr. Susanne Schmitt, Dr. Wolfgang Kathe (maternity cover) WWF-UK Panda House, Weyside Park, Godalming, Surrey GU7 1XR, United Kingdom Administration: Michael Balzer and team WWF-DCP Mariahilfer-Str. 88a/3/9 A-1070 Wien Austria Projekt Manager: Maria Mihul WWF-DCP 61, Marastu Bdv. 3rd floor, 326/327/328 Sector 1, Bucharest, RO-71331 Romania With financial support of the Darwin Initiative Area 3D, Third Floor, Nobel House 17 Smith Square, London SW1P 3JR United Kingdom Project Officer: Dr. Barbara Michler Dr. Fischer, ifanos-Landschaftsökologie Forchheimer Weg 46 D-91341 Röttenbach Germany Local Coordinator: Dr. Florin Pacurar University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine (USAMV) Department of Fodder Production & Conservation Cluj-Napoca, Romania Major of the community Gârda de Sus Alba Iulia Romania Acknowledgements I am very grateful to a number of people who were involved in the process of the project over the last 6 years (including 3 previous years under Project Apuseni). Thanks to all of them (alphabetic order): Apuseni Nature Park: Alin Mos Arnica project team: Mona Cosma, Valentin Dumitrescu, Dr. Wolfgang Kathe, Adriana Morea, Maria Mihul, Michael Klemens, Dr. Florin Pacurar, Horatiu Popa, Razvan Popa, Bobby Pelger, Gârda Nicoleta, Dr. Susanne Schmitt, Luminita Tanasie Architects for Humanity: Chris Medland Babes-Bolyai University Cluj-Napoca (UBB) represented by Prof. Dr. Laszlo Rakosy Community Gârda de Sus, represented by the major Marin Virciu Darwin Initiative, London Drying (data collection): Bîte Daniela, Broscăţan Călin, Câmpean Sorin, Cosma Ramona, Dumitrescu Valentin, Feneşan Iulia, Gârda Nicoleta, Klemens Michael, Morea Adriana, Neag Cristina, Păcurar Adriana, Paşca Aniela, Pelger Bogdan, Rotar Bogdan, Spătăceanu Lucia, Tudose Sorina Ethnography: Dr. -

Plant Trait Responses to Grassland Management and Succession
PLANT TRAIT RESPONSES TO GRASSLAND MANAGEMENT AND SUCCESSION DISSERTATION ZUR ERLANGUNG DES DOKTORGRADES DER NATURWISSENSCHAFTEN (DR. RER. NAT.) DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT III – BIOLOGIE UND VORKLINISCHE MEDIZIN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG VORGELEGT VON STEFANIE KAHMEN REGENSBURG JUNI 2003 Veröffentlichung: Kahmen, S. (2004) Plant trait responses to grassland management and succession. Dissertationes Botanicae 382, pp. 123. Promotionsgesuch eingereicht am 18. Juni 2003 Mündliche Prüfung am 10. Oktober 2003 Prüfungsausschuss: Prof. Günter Hauska Prof. Peter Poschlod Prof. Michael Kleyer Prof. Jürgen Heinze Die Arbeit wurde angeleitet von Prof. Peter Poschlod Contents CHAPTER 1 GENERAL INTRODUCTION...................................................................1 CHAPTER 2 PLANT FUNCTIONAL TRAIT RESPONSES TO GRASSLAND SUCCESSION OVER 25 YEARS ..............................................................7 CHAPTER 3 CONSERVATION MANAGEMENT OF CALCAREOUS GRASSLANDS. CHANGES IN PLANT SPECIES COMPOSITION AND RESPONSE OF PLANT FUNCTIONAL TRAITS DURING 25 YEARS.................................23 CHAPTER 4 EFFECTS OF GRASSLAND MANAGEMENT ON PLANT FUNCTIONAL TRAIT COMPOSITION .........................................................................35 CHAPTER 5 COMPARISON OF UNIVARIATE AND MULTIVARIATE ANALYSIS OF PLANT TRAIT RESPONSES TO MANAGEMENT TREATMENTS................49 CHAPTER 6 DOES GERMINATION SUCCESS DIFFER WITH RESPECT TO SEED MASS AND GERMINATION SEASON? EXPERIMENTAL TESTING OF PLANT FUNCTIONAL TRAIT RESPONSES TO MANAGEMENT.................59 -

THE USE of BIOTECHNOLOGY for SUPPLYING of PLANT MATERIAL for TRADITIONAL CULTURE of MEDICINAL, RARE SPECIES Arnica Montana L
Lucrări Ştiinţifice – vol. 57 (1) 2014, seria Agronomie THE USE OF BIOTECHNOLOGY FOR SUPPLYING OF PLANT MATERIAL FOR TRADITIONAL CULTURE OF MEDICINAL, RARE SPECIES Arnica montana L. Iuliana PANCIU1, Irina HOLOBIUC2, Rodica CĂTANĂ2 e-mail: [email protected] Abstract Taking into account the importance of Arnica montana, the attempts to improve the culture technologies are justified. Our study had the aim to optimize in vitro plant multiplication and growth as a source of plants for traditional culture in this species. Aseptic germinated seedlings were used as explants, apical meristem being the origin of the direct morphogenesis process. For induction of regeneration, to promote plant growth and rooting, we used some combination of growth factors and supplements as ascorbic acid, glutamine, PVP and active charcoal added in culture media based on MS formula. We improved the efficiency of micropropagation, the best values were recorded on variant supplemented with PVP –.7 regenerants/explant in the first 4 weeks and increasing at 17/ initial explant ( mean 14.62) after 8 weeks. Concerning the germination capacity of the seeds scored after 2 weeks in sterile condition, the rate was 47.76 and in non-sterile conditions, the rate varied depending of the substrate used. Comparing to the plants obtained through traditional seeds germination, in vitro plants grew faster and were more vigourously. The micropropagation protocol in Arnica montana L. allowed us to regenerate healthy, developed and rooted plants in the second subculture cycle. This in vitro methodology can provide plant material for initiation of a conventional culture after acclimatization of the obtained vitroplants. -

Download The
SYSTEMATICA OF ARNICA, SUBGENUS AUSTROMONTANA AND A NEW SUBGENUS, CALARNICA (ASTERACEAE:SENECIONEAE) by GERALD BANE STRALEY B.Sc, Virginia Polytechnic Institute, 1968 M.Sc, Ohio University, 1974 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (Department of Botany) We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA March 1980 © Gerald Bane Straley, 1980 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the Head of my Department or by his representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department nf Botany The University of British Columbia 2075 Wesbrook Place Vancouver, Canada V6T 1W5 26 March 1980 ABSTRACT Seven species are recognized in Arnica subgenus Austromontana and two species in a new subgenus Calarnica based on a critical review and conserva• tive revision of the species. Chromosome numbers are given for 91 populations representing all species, including the first reports for Arnica nevadensis. Results of apomixis, vegetative reproduction, breeding studies, and artifi• cial hybridizations are given. Interrelationships of insect pollinators, leaf miners, achene feeders, and floret feeders are presented. Arnica cordifolia, the ancestral species consists largely of tetraploid populations, which are either autonomous or pseudogamous apomicts, and to a lesser degree diploid, triploid, pentaploid, and hexaploid populations. -

Erik Van Nieukerken & Sjaak Koster
DE VALKRUIDMINEERVLINDER DIGITIVALVA ARNICELLA IN NEDERLAND: HERONTDEKKING EN BEHOUD (LEPIDOPTERA: PLUTELLIDAE: ACROLEPIINAE) Erik van Nieukerken & Sjaak Koster De valkruidmineervlinder Digitivalva arnicella leek al sinds het begin van de eeuw uit Nederland verdwenen. Niemand had echter speciaal op deze soort gelet, en toen de auteurs in Drenthe de laatste grote groeiplaatsen van valkruid bezochten, bleek dat het vlindertje er waarschijnlijk nooit is weggeweest. In totaal werden acht populaties van de vlinder vastgesteld, waarvan er in de laatste zes jaar twee verdwenen zijn. Vroeger moet de vlinder overal waar valkruid groeide gevlogen hebben. Dat kon op een bijzondere wijze worden vastgesteld: niet in insectencollecties, maar door rupsen- mijnen in historisch herbariummateriaal van Arnica te onderzoeken. Met de voed- selplant is D. arnicella enorm achteruitgegaan en momenteel zeer ernstig bedreigd in zijn voortbestaan in ons land. Bij het beheer van de groeiplaatsen van valkruid zal daarom speciaal gelet moeten worden op deze soort. Het wegmaaien van de hele vegetatie in augustus, zoals dat nu op sommige vindplaatsen gebeurt, is in elk geval funest voor de rupsen, die dan in de bladeren zitten. Valkruid of wolverlei (Arnica montana L.) (plaat In 1991 kon de eerste auteur tot zijn verrassing op 3: 3) is een in Nederland sterk in aantal groei- twee Drentse groeiplaatsen rupsen van D. arnicel- plaatsen achteruitgaande plant (Bokeloh & van la vinden. Van 1992 tot 1994 werden door beide Zanten 1992), die vanwege zijn opvallende uiter- auteurs nog meer groeiplaatsen bezocht om het lijk en belang als homeopathisch geneesmiddel huidige verspreidingsbeeld vast te leggen, en kon sinds 1973 beschermd is op grond van de de rups op acht plaatsen in Drenthe vastgesteld Natuurbeschermingswet. -

A Study of the Effect of a Homoeopathic Complex (Aconitum
The efficacy of a Homoeopathic complex (Aconitum napellus 30CH, Arnica montana 30CH and China officinalis 30CH) on the transport of broiler chickens to the abattoir, in terms of mortality rate, damage and weight loss. By ALAN ROWAN EATWELL Dissertation submitted in partial compliance with the requirements for the Master’s Degree in Technology: Homoeopathy, in the Faculty of Health Sciences at the Durban Institute of Technology. I, Alan Rowan Eatwell, declare that this dissertation represents my own work, both in conception and execution ___________________ _________________ Signature of candidate Date APPROVED FOR FINAL SUBMISSION ___________________ _________________ Signature of supervisor: Date Dr C.M Hall B.Sc (PU for CHE) M. Tech. Hom(TN) ___________________ _________________ Signature of Joint-Supervisor: Date D. Thomson B Sc (Microbiology) Brunel University U.K. DEDICATION This dissertation is dedicated to my father and Barbara for all their patience and support. I ACKNOWLEDGEMENTS My father and Barbara for their incredible patience and support, both financial and moral. Don Thomson, my supervisor at Rainbow Chickens, thank you very much for all you’ve done. You really went out of your way to assist me, without which I could never have completed this thesis. Dr. C. Hall my supervisor at the Durban Institute of Technology, for all her advice and input. Dr G. Mc David, my previous supervisor especially for his guidance during preparing my G186. To my colleagues and friends I made during my studies, especially Dr. J. van Loggerenberg for friendship and support. To all my lecturers for their dedication and invaluable knowledge passed on during my studies. -

Heathlands a Lost World?
Heathlands A Lost World? Mattias Lindholm Institutionen för biologi och miljövetenskap Naturvetenskapliga fakulteten Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i naturvetenskap med inriktning biologi, som med tillstånd från Naturvetenskapliga fakulteten kommer att offentligt försvaras fredag den 24 maj 2019, kl. 10.00 i Hörsalen, Botanhuset, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Carl Skottsbergs gata 22B, Göteborg. Fakultetsopponent är Docent Erik Öckinger, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Heathlands – A Lost World? Mattias Lindholm Department of Biological and Environmental Sciences University of Gothenburg Box 461 SE405 30 Göteborg Sweden E-mail: [email protected] © Mattias Lindholm 2019 Cover: Heathland. Illustration by Per Axell ISBN 978-91-7833-446-9 (Printed) ISBN 978-91-7833-447-6 (PDF) http://hdl.handle.net/2077/59796 Printed by BrandFactory Group AB 2019 Till Valle och Arvid Figure 1. Arnica montana. Illustration by Kerstin Hagstrand-Velicu. Lindholm M. (2019) Heathlands – A Lost World? Mattias Lindholm, Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg, Box 461, SE405 30 Göteborg, Sweden E-mail: [email protected] Keywords Heathland, Calluna, Conservation, Coleoptera, Carabidae, Lycosidae, Management, Restoration, Conservation strategy Abstract Heathland is a familiar landscape type in southwest Sweden. It is open with few trees, and the vegetation is dominated by dwarf-shrubs growing on nutrient-poor soils. Dry heaths with Heather Calluna vulgaris and wet heaths with Bell Heather Erica tetralix are common vegetation communities in the heathland, and they often form mosaics. The heathland landscape is highly threatened, with large substantial areal losses of 95% in Sweden since the 1800s. Heathland supports around 200 red-listed species, including plants, insects, birds and reptiles. -

Phylogenies and Secondary Chemistry in Arnica (Asteraceae)
Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 392 Phylogenies and Secondary Chemistry in Arnica (Asteraceae) CATARINA EKENÄS ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS ISSN 1651-6214 UPPSALA ISBN 978-91-554-7092-0 2008 urn:nbn:se:uu:diva-8459 ! " # $ %&& &'&& ( ( ( ) * + , * - * %&& * ) . /!0* ! * 12%* 34 * * 5. 24 62633$64&2%6&* + /!0 , ( 7 /.+0 , ( , ! 7 * ( ( / ! " 0 / 0 ,6 ! ( ( 8! 55 /#$%&0 , 4 %1* ) , ,6 ' - * 9 : ( , ( (( ! * ( ( ( * .7 ( , ! ( ( 11 ( ; * .+ ! 7 ( ( /** ( 0 , ( * . ( ( ( ( ( , ( * " ( .+ ( # ! * ! 6 ( ( ( ( ( ( "6< ! , ( ( % * ( ( , (( * = , .+ * )* + ! ! 5+. +. 8)% 7 )! "6< ,-.' , ' / ' 0 ( 1 ' ' ,234&5 ' * > - %&& 5.. ;36;%$ 5. 24 62633$64&2%6& ' ''' 6 $32 / '99 *-*9 ? @ ' ''' 6 $320 List of Papers This thesis is based on the following papers, which are referred to in the text by their Roman numerals: I Ekenäs, C., B. G. Baldwin, and K. Andreasen. 2007. A molecular phylogenetic study of Arnica (Asteraceae): Low chloroplast DNA variation and problematic subgeneric classification. Sys- tematic Botany -

Phylogenies and Secondary Chemistry in Arnica (Asteraceae)
Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 392 Phylogenies and Secondary Chemistry in Arnica (Asteraceae) CATARINA EKENÄS ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS ISSN 1651-6214 UPPSALA ISBN 978-91-554-7092-0 2008 urn:nbn:se:uu:diva-8459 !"# $ % !& '((" !()(( * * * + , - . , / , '((", + 0 1# 2, # , 34', 56 , , 70 46"84!855&86(4'8(, - 1# 2 . * 9 10-2 . * . # 9 , * * 1 ! " #! !$ 2 1 2 .8 # * * :# 77 1%&'(2 . !6 '3, + . .8 ) / , ; < * . * ** # , * * * , 09 * . # * * 33 * != , 0- # 9 * * 1, , * 2 . * , 0 * * * * * . * , $ * 0- * % # , # 8 * * * * * * $8> # . * * !' , * * . ** , ? . 0- , +,- # # 7-0 -0 :+' 9 +# $8> ./0) . ) 1 ) 2 * 3) ) .456(7 ) , @ / '((" 700 !=5!8='!& 70 46"84!855&86(4'8( ) ))) 8"&54 1 );; ,/,; A B ) ))) 8"&542 List of Papers This thesis is based on the following papers, which are referred to in the text by their Roman numerals: I Ekenäs, C., B. G. Baldwin, and K. Andreasen. 2007. A molecular phylogenetic -
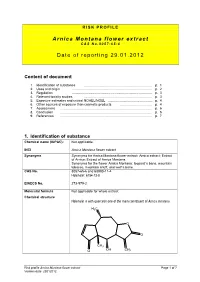
RISK PROFILE of Acetanilide
RISK PROFILE Arnica Montana flower extract C A S N o . 8057- 65- 6 Date of reporting 29.01.201 2 Content of document 1. Identification of substance ......................................................................... p. 1 2. Uses and origin ...................................................................................... p. 2 3. Regulation ...................................................................................... p. 3 4. Relevant toxicity studies ......................................................................... p. 3 5. Exposure estimates and critical NOAEL/NOEL ................................................ p. 4 6. Other sources of exposure than cosmetic products ................................... p. 4 7. Assessment .................................................................................................. p. 6 8. Conclusion .................................................................................................. p. 6 9. References .................................................................................................. p. 7 1. Identification of substance Chemical name (IUPAC): Not applicable. INCI Arnica Montana flower extract Synonyms Synonyms for Arnica Montana flower extract: Arnica extract; Extract of Arnica; Extract of Arnica Montana. Synonyms for the flower Arnica Montana: leopard`s bane, mountain tobacco, mountain snuff, and wolf`s bane. CAS No. 8057-65-6 and 68990-11-4 Helenalin: 6754-13-8 EINECS No. 273-579-2 Molecular formula Not applicable for whole extract Chemical