GRAAT Issue # 2 – June 2007 Queering the Prisoner : Tirer Le Bon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Available to Download
A Desert Between Us & Them INTRODUCTION The activities and projects in this guide have been developed to compliment the themes of the A Desert Between Us & Them documentary series. These ideas are meant to be an inspiration for teachers and students to become engaged with the material, exercise their creative instincts, and empower their critical thinking. You will be able to adapt the activities and projects based on the grade level and readiness of your students. The International Society for Technology in Education (http://www.iste.org) sets out standards for students to “learn effectively and live productively in an increasingly global and digital world.” These standards, as described in the following pages, were used to develop the activities and projects in this guide. The Ontario Visual Heritage Project offers robust resources on the A Desert Between Us & Them website http://1812.visualheritage.ca. There is a link to additional A Desert Between Us & Them stories posted on our YouTube Channel, plus the new APP for the iPad, iPhone and iPod. A Desert Between Us & Them is one in a series of documentaries produced by the Ontario Visual Heritage Project about Ontario’s history. Find out more at www.visualheritage.ca. HOW TO NAVIGATE THIS GUIDE In this guide, you will find a complete transcript of each episode of A Desert Between Us & Them. The transcripts are broken down into chapters, which correspond with the chapters menus on the DVD. Notable details are highlighted in orange, which may dovetail with some of the projects and activities that you have already planned for your course unit. -

A Journey Through Relationship Into Wonder
A JOURNEY THROUGH RELATIONSHIP INTO WONDER Sharon Anne Nehring-Willson Bachelor of Arts, University of Victoria, 1994 Bachelor of Education, University of British Columbia, 1997 PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION In the Faculty of Education O Sharon Anne Nehring-Willson 2003 SIMON FRASER UNIVERSITY December 2003 All rights reserved. This work may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without permission of the author. APPROVAL NAME Sharon Anne Nehring-Willson DEGREE Master of Education TITLE A Journey Through Relationship Into Wonder EXAMINING COMMITTEE: Allan MacKinnon, Associate Professor Senior Su~ervisor liet, Assistant Professor PARTIAL COPYRIGHT LICENCE I hereby grant to Simon Fraser University the right to lend my thesis, project or extended essay (the title of which is shown below) to users of the Simon Fraser University Library. and to make partial or single copies only for such users or in response to a request from the library of any other university, or other educational institution, on its own behalf or for one of its users. I further agree that permission for multiple copying of this work for scholarly purposes may be granted by me or the Dean of Graduate Studies. It is understood that copying or publication of this work for financial gain shall not be allowed without my written permission. Title of ThesislProjectlExtended Essay: A Journey Through Relationship into Wonder (Date) Abstract This project is a philosophical discussion addressing the idea of what is value in education, more specifically, the value of the natural world and its impacts upon humans, and how we should be teaching this in our classes. -

Celebrating 50Years of the Prisoner
THE MAGAZINE BEYOND YOUR IMAGINATION www.infinitymagazine.co.uk THE MAGAZINE BEYOND YOUR IMAGINATION 6 DOUBLE-SIDED POSTER INSIDE! “I AM NOT A NUMBER!” CELEBRATING 50 YEARS PLUS: OF THE PRISONER • CHRISTY MARIE - COSPLAY QUEEN • SPACECRAFT KITS • IAIN M. BANKS • THE VALLEY OF GWANGI • NEWS • SATURDAY MORNING SUPERHEROES • CHILDREN’S FILM FOUNDATION AND MUCH, MUCH MORE… FUTURE SHOCK! THE HISTORY OF 2000 AD AN ARRESTING CONCEPT - TAKE A TRIP IN ROBOCOP THE TIME TUNNEL WRITER INFINITY ISSUE 6 - £3.99 06 THE MAGAZINE BEYOND YOUR IMAGINATION www.infinitymagazine.co.uk 6 THE MAGAZINE BEYOND YOUR IMAGINATION DOUBLE-SIDED POSTER INSIDE! 8 14 “I AM NOT A 38 NUMBER!”50 YEARS CELEBRATING OF THE PRISONER • SPACECRAFT KITS PLUS: • NEWS • CHRISTY MARIE• THE - COSPLAY VALLEY QUEEN OF GWANGI• CHILDREN’S • IAIN M. BANKS • SATURDAY MORNING SUPERHEROES FILM FOUNDATION AND MUCH, MUCH MORE… FUTURE SHOCK! AN ARRESTING THE HISTORY OF CONCEPT - 2000 AD ROBOCOP WRITER TAKE A TRIP IN THE TIME TUNNEL INFINITY ISSUE 6 - £3.99 Prisoner cover art by Mark Maddox (www.maddoxplanet.com) 19 44 08: CONFESSIONS OF A CONVENTION QUEEN Pat Jankiewicz discovers how Star Wars FanGirl Christy Marie became a media phenomenon! 14: SATURDAY MORNING SUPER-HEROES Jon Abbott looks at Hanna-Barbera’s Super TV Heroes line of animated adventurers. 19: UNLOCKING THE PRISONER Don’t miss this amazing 11-page special feature on Patrick McGoohan’s cult favourite from the 1960s. 38: MODEL BEHAVIOUR Sci-fi & Fantasy Modeller’s Andy Pearson indulges his weakness for spacecraft kits… 40 40: FUTURE SHOCK! John Martin talks to Paul Goodwin, director of an acclaimed documentary on the history of 2000 AD. -

"The Harmony Way:" Integrating Indigenous Values Within Native North American Theology and Mission
Digital Commons @ George Fox University Faculty Publications - Portland Seminary Portland Seminary 4-2010 "The aH rmony Way:" Integrating Indigenous Values Within Native North American Theology and Mission Randy Woodley George Fox University, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.georgefox.edu/gfes Part of the American Studies Commons, Christianity Commons, Missions and World Christianity Commons, and the Religious Thought, Theology and Philosophy of Religion Commons Recommended Citation Woodley, Randy, ""The aH rmony Way:" Integrating Indigenous Values Within Native North American Theology and Mission" (2010). Faculty Publications - Portland Seminary. 72. http://digitalcommons.georgefox.edu/gfes/72 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Portland Seminary at Digital Commons @ George Fox University. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications - Portland Seminary by an authorized administrator of Digital Commons @ George Fox University. For more information, please contact [email protected]. ABSTRACT "THE HARMONY WAY:" INTEGRATING INDIGENOUS VALVES WITHIN NATIVE NORTH AMERICAN THEOLOGY AND MISSION by Randy Stephen Woodley Given that Western models of mission have failed among Native Americans and that colonial practices have devastated native communities, this research sought a better way of pursuing Christian mission among Native Americans by asking two questions: (1) Do Native American have a generally shared set of values that could guide the construction -

The Joy Luck Club Study Guide
The Joy Luck Club Study Guide © 2018 eNotes.com, Inc. or its Licensors. ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced or used in any form or by any means graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, Web distribution or information storage retrieval systems without the written permission of the publisher. Summary Summary of the Novel The novel contains four sections, each beginning with a vignette depicting a stage in the life cycle. The four stories in each section explore the relationship between the mothers and the daughters at the same stage. One series of stories focuses on Suyuan Woo, who comes to America in 1947, having lost her family, including twin daughters, during war. She does not know her daughters were rescued. Now remarried, she settles in San Francisco, has a daughter, Jing-mei (June), and starts a Joy Luck Club similar to one in China with three other women. The four form strong friendships. As she grows up, Jing-mei and her mother struggle to understand one another. They never completely resolve their differences, and Suyuan dies unexpectedly. At the next meeting of the Joy Luck Club, her mother’s friends tell Jing-mei that Suyuan’s twin daughters have been found. They give her a check so she can visit them. As the novel ends, she meets her sisters in Shanghai. A second set of stories focuses on An-mei, who lives with her grandmother because her mother has been disowned. When An-mei is nine, her grandmother dies; and An-mei leaves with her mother to live in the home of a wealthy man and his other wives. -

A Prison for Others--A Burden to Oneself
1 A Prison for Others—A Burden to One's Self Anne Collins Smith and Owen M. Smith published in The Dynamics of Interconnections in Popular Culture(s) edited by Ray Browne and Ben Urish, Cambridge Scholars Publishing, January 2014 Women have come a long way since the mid-1960's, both in the real world and in the world of philosophy. Given the advances in society and the developments within feminism that took place between that decade and the first decade of the 21st century, we might reasonably expect the new Prisoner series to present a more contemporary perspective on women than the original. Such is most emphatically not the case. If we compare the original Village to the new one, it looks as if those pennyfarthing wheels are spinning backwards instead of forwards. Where it all began—with Frankenstein's grandmother In the 1960's, the most prominent kind of feminist philosophy was liberal feminism. This kind of feminism has a long history, going back to the British philosopher Mary Wollstonecraft (1759-1797), whose name may seem familiar because her daughter, Mary Wollstonecraft Shelley, wrote the novel Frankenstein. At a time when middle-class women were confined to their household duties and had little opportunity to exercise their minds or develop their moral sense, Wollstonecraft made the devastatingly straightforward argument that women have the same capabilities as men to be rational and self-determined, and therefore deserve the same right to reach their full potential. She argued that if women were permitted to have education and autonomy, they would develop into intelligent people of good character. -

The Badge Not The
I Agreed to Wear the Badge, Not the Gun: (Re)Viewing Ethics of Policing through Stories of the American West Presented at the Western Political Science Association 2016 Annual Meeting Who Will Watch the Watchers? Panel San Diego, 26 March 2016 Tim Delaune Assistant Professor of Political Science SUNY Cortland © 2016, Timothy A. Delaune, all rights reserved. This Text is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License. Introduction In a fantasy sequence styled after the American West, secret agent Number Six, aka “The Prisoner,” is buffaloed by threats against the life and safety of a vulnerable townswoman into becoming the sheriff for the Town of Harmony (presumably so that the entities holding him prisoner can probe his behavior to learn why he resigned from his position as a British spy). He agrees to take on that role (to wear the badge) but not to do so by violent force (but not the gun). Ultimately, when the woman is killed, he removes the badge, takes up his gun, and exacts revenge.1 In the introductory episode of the HBO series Deadwood, we first meet soon-to-be Deadwood sheriff Seth Bullock as he is performing his final duty as Marshal of the Montana territory, fending off a mob in order that a horse thief receive a legal hanging rather than the fruits of mob justice.2 Though he has tired of sheriffing, and is headed to Deadwood to open a hardware store with his friend Sol Star, he ultimately finds himself enmeshed in political situation of his new town, and ultimately consents to serve as sheriff when it is clear that no one else has the requisite skills to do so competently.3 In the novel Warlock, two men, a Marshal hired by a citizens’ committee of the as-yet unincorporated town to keep the peace, and a Deputy who was once affiliated with the very cowboys who have routinely disturbed the peace,4 struggle with the ethical commitments their roles entail, endeavoring to serve the community while effectively having to take the law into their own hands. -
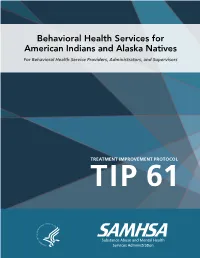
TIP 61 Behavioral Health Services for American Indians and Alaska Natives
Behavioral Health Services for American Indians and Alaska Natives For Behavioral Health Service Providers, Administrators, and Supervisors TREATMENT IMPROVEMENT PROTOCOL TIP 61 Please share your thoughts about this publication by completing a brief online survey at: https://www.surveymonkey.com/r/KAPPFS The survey takes about 7 minutes to complete and is anonymous. Your feedback will help SAMHSA develop future products. BEHAVIORAL HEALTH SERVICES FOR TIP 61 AMERICAN INDIANS AND ALASKA NATIVES Executive Summary For Behavioral Health Service Providers, Program Administrators, Clinical Supervisors, and Researchers The Executive Summary of this Treatment Improvement Protocol summarizes substance use and mental illness among American Indians and Alaska Natives and discusses the importance of delivering culturally responsive, evidence-based services to address these behavioral health challenges. TIP Navigation Executive Summary For behavioral health service providers, program administrators, clinical supervisors, and researchers Part 1: Pr actical Guide to the Provision of Behavioral Health Services for American Indians and Alaska Natives For behavioral health service providers Part 2: Imple mentation Guide for Behavioral Health Program Administrators Serving American Indians and Alaska Natives For behavioral health service providers, program administrators, and clinical supervisors Appendix and Index Part 3: Lit erature Review For behavioral health service providers, program administrators, clinical supervisors, and researchers TIP 61 Behavioral -

Transculturals As Agents of Change by Chris J. Harriss B.A. In
Transculturals as Agents of Change by Chris J. Harriss B.A. in International Business, January 1994, American University of Paris M.B.A. in Management of International Business, June 1996, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Institut d’Administration des Entreprises A Dissertation submitted to The Faculty of The Graduate School of Education and Human Development of The George Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education January 19, 2018 Dissertation directed by Shaista E. Khilji Professor of Human and Organizational Learning The Graduate School of Education and Human Development of the George Washington University certifies that Chris J. Harriss has passed the final examination for the degree of Doctor of Education as of December 7, 2017. This is the final and approved form of the dissertation. Transculturals as Agents of Change Chris J. Harriss Dissertation Research Committee: Shaista E. Khilji, Professor of Human and Organizational Learning, Dissertation Director Katherine Rosenbusch, Assistant Professor of Management, George Mason University, Committee Member Michael Pobát, Adjunct Professor of Human and Organizational Learning, Committee Member ii © Copyright 2018 by Chris J. Harriss All rights reserved iii Dedication To Claudie, representing the Meunier family of the Old World, and Joe, representing the Harriss family of the New World, for having given me a transcultural life and 46 years of dedicated support and love. iv Acknowledgments This dissertation is the accomplishment of a 5-year academic marathon at the heart of GSEHD. Such dedication would have been meaningless without the guidance, support, and encouragement of a number of key individuals, including my chair, Dr. -
The Roddy Desperadoes
The Roddy Desperadoes By Jackie Layne Partin (2017) Note: Italics depict quotes taken directly from sources. Regular type shows my comments for the most part. Bold type is for emphasis, especially dates. Now we are going to put ourselves back into the “good old days” connecting with more of Grundy County, Tennessee’s lost history, becoming flies on the wall if you please. The surname Roddy was connected to wealth. Money doesn’t always buy happiness, for quite often it destroys any possibility of living in harmony with family, friends, neighbors or the law. Andrew Jackson “A. J.” Roddy, son of Daniel and Mary (Fry) Roddy, married Susannah “Susan” Stotts and settled in Warren County where they started their family. Before 1860 their first two children, Thomas Benjamin “T. B. Roddy and Mary Frances Roddy, were running about the house. By 1870 the family had grown with four more children: J. C. “Jay”, John K., Anna B., and Alfred James Law “A. J. L.” Roddy. Later in 1870, the last child, William H. Roddy was born. As usual, I feel a long story coming on but one full of action, not boring, shameful, and possibly an unknown part of the history of Grundy County. From the start, let’s just say that T. B. Roddy, for the most part, exhibited good behavior especially in his older years. He was a family man, merchant, and in civil government positions of the county. Let’s give more attention to the lives of sons, Jay Roddy, John K. Roddy, Alfred James Law Roddy and William H. -
Improving Cultural Competence
A TREATMENT IMPROVEMENT PROTOCOL Improving Cultural Competence TIP 59 A TREATMENT IMPROVEMENT PROTOCOL Improving Cultural Competence TIP 59 U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Substance Abuse and Mental Health Services Administration Center for Substance Abuse Treatment 1 Choke Cherry Road Rockville, MD 20857 Improving Cultural Competence Acknowledgments This publication was produced by The CDM Group, Inc., under the Knowledge Application Program (KAP) contract numbers 270-99-7072, 270-04-7049, and 270-09-0307 with the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Andrea Kopstein, Ph.D., M.P.H., Karl D. White, Ed.D., and Christina Currier served as the Contracting Officer’s Representatives. Disclaimer The views, opinions, and content expressed herein are those of the consensus panel and do not necessarily reflect the views, opinions, or policies of SAMHSA or HHS. No official support of or endorsement by SAMHSA or HHS for these opinions or for particular instruments, software, or resources is intended or should be inferred. Public Domain Notice All materials appearing in this volume except those taken directly from copyrighted sources are in the public domain and may be reproduced or copied without permission from SAMHSA or the authors. Citation of the source is appreciated. However, this publication may not be reproduced or distributed for a fee without the specific, written authorization of the Office of Communications, SAMHSA, HHS. Electronic Access and Copies of Publication This publication may be ordered or downloaded from SAMHSA’s Publications Ordering Web page at http://store.samhsa.gov. -

A Prison for Others—A Burden to One's Self
Stephen F. Austin State University SFA ScholarWorks Faculty Publications Division of Multidisciplinary Programs 1-2014 A Prison for Others—A Burden to One's Self Anne Collins Smith Stephen F Austin State University, [email protected] Owen M. Smith Stephen F Austin State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.sfasu.edu/multidisciplinary_facultypubs Part of the Critical and Cultural Studies Commons, Feminist, Gender, and Sexuality Studies Commons, Film and Media Studies Commons, and the Television Commons Tell us how this article helped you. Repository Citation Smith, Anne Collins and Smith, Owen M., "A Prison for Others—A Burden to One's Self" (2014). Faculty Publications. 5. https://scholarworks.sfasu.edu/multidisciplinary_facultypubs/5 This Book Chapter is brought to you for free and open access by the Division of Multidisciplinary Programs at SFA ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications by an authorized administrator of SFA ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. 1 A Prison for Others—A Burden to One's Self Anne Collins Smith and Owen M. Smith published in The Dynamics of Interconnections in Popular Culture(s) edited by Ray Browne and Ben Urish, Cambridge Scholars Publishing, January 2014 Women have come a long way since the mid-1960's, both in the real world and in the world of philosophy. Given the advances in society and the developments within feminism that took place between that decade and the first decade of the 21st century, we might reasonably expect the new Prisoner series to present a more contemporary perspective on women than the original.