Diagpartie4-La-Vie-Sur-Le-Terr.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Departement De L'herault Commune De Beziers
REGION OCCITANIE - DEPARTEMENT DE L’HERAULT COMMUNE DE BEZIERS ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE RELATIVE : - A, LA REVISON GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME ; - A, L’ACTUALISATION DU PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT. Organisée au titre du : Code de l’Environnement, articles L 123-1 et R 123-5, relatifs à l’enquête publique ; Code de l’Urbanisme, article L 163-41 à L 153-43 relatifs au PLU et à l’enquête ; Code général des Collectivités Territoriales, articles L 2224-10 et R 2224-8, zonage d’assainissement. A) - RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. B) - CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. C) – ANNEXES. (Enquête publique du lundi 12 octobre au vendredi 13 novembre 2020, Arrêté de Monsieur le Maire de BEZIERS N° 2038 du 15 septembre 2020). Rédacteur. Le Commissaire enquêteur : Serge OTTAWY. Le 05 mars 2021. A Mars 2021 Commune de BEZIERS – Enquête unique relative : - à la Révision Générale du Plan local d’Urbanisme, - à l’actualisation du plan de zonage d’assainissement. Arrêté Municipal N° 2038 du 15 / 09 / 2020 - EP du 12/10/2020 au 13/11/2019 – Rapport d’Enquête Publique. Commune de BEZIERS. BEZIERS. B Mars 2021 Commune de BEZIERS – Enquête unique relative : - à la Révision Générale du Plan local d’Urbanisme, - à l’actualisation du plan de zonage d’assainissement. Arrêté Municipal N° 2038 du 15 / 09 / 2020 - EP du 12/10/2020 au 13/11/2020 – Rapport d’Enquête Publique. PRESENTATION DU RAPPORT D’ENQUETE FASCICULE 1 -Chapitre 1, Généralités concernant l’objet et le cadre de l’enquête ; -Chapitre 2, Organisation et déroulement de l’enquête ; -Chapitre 3, Examen et analyse des documents présentés au public ; FASCICULE 2 -Chapitre 4, Examen et analyse des documents et des observations ; FASCICULE 3 -Conclusions et avis du Commissaire-enquêteur : PLU ; FASCICULE 4 -Conclusions et avis du Commissaire-enquêteur : Zone Assainissement ;; FASCICULE 5 ANNEXES. -

Journal Officiel De La République Française
o Quarante-troisième année. – N 8 A ISSN 0298-296X Lundi 12 et mardi 13 janvier 2009 BODACCBULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Standard......................................... 01-40-58-75-00 DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS Annonces....................................... 01-40-58-77-56 Renseignements documentaires 01-40-58-79-79 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 Abonnements................................. 01-40-58-79-20 www.journal-officiel.gouv.fr (8h30à 12h30) Télécopie........................................ 01-40-58-77-57 BODACC “A” Ventes et cessions - Créations d’établissements Procédures collectives Procédures de rétablissement personnel Avis relatifs aux successions Avis aux lecteurs Les autres catégories d’insertions sont publiées dans deux autres éditions séparées selon la répartition suivante Modifications diverses..................................... $ BODACC “B” Radiations ......................................................... # Avis de dépôt des comptes des sociétés .... BODACC “C” Avis aux annonceurs Toute insertion incomplète, non conforme aux textes en vigueur ou bien illisible sera rejetée Banque de données BODACC servie par les sociétés : Altares-D&B, EDD, Experian, Optima on Line, Groupe Sévigné-Payelle, Questel, Tessi Informatique, Jurismedia, Pouey International, Scores et Décisions, Les Echos, Creditsafe, Coface services et Cartegie. Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 17 mai 1984 relatif à la constitution et à la commercialisation d’une banque de données télématique des informations contenues dans le BODACC, le droit d’accès prévu par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de la Direction des Journaux officiels. Le numéro : 2,50 € Abonnement. − Un an (arrêté du 21 novembre 2008 publié au Journal officiel du 27 novembre 2008) : France : 386,20 €. -

Liste Magasins but Participant
Trouver votre magasin BUT participant MAGASIN BUT REGION ADRESSE C.P VILLE BOURG-EN-BRESSE BOURGOGNE SAVOIE Rue des Près de Brou 01000 BOURG EN BRESSE LAON CHAMPAGNE ZAC Descartes Le fond du pré robert 02000 CHAMBRY SAINT QUENTIN NORD Z.A.C. Les marlettes Forum de Picardie 02100 FAYET SOISSONS CHAMPAGNE Centre commercial "Les portes de Soissons" 02200 VAUXBUIN MONTLUCON AUVERGNE Rue Albert Einstein - Espace St Jacques 03100 MONTLUCON VICHY AUVERGNE 76-84 avenue Gilbert ROUX 03300 CUSSET MOULINS / YZEURE BOURGOGNE SAVOIE RD 707 Fromenteau 03400 TOULON SUR ALLIER DIGNE PACA ZA Quartier St Christophe 04000 DIGNE CANNES PACA Avenue des Arlucs - Cannes La Bocca 06150 CANNES ANTIBES PACA 809 Route de Nice RN7 Les Breguieres 06600 ANTIBES NICE PACA 106 Avenue France d'Outre Mer 06700 SAINT LAURENT DU VAR AUBENAS PACA Route nationale 104 07200 LACHAPELLE SOUS AUBENAS CHARLEVILLE MEZIERES CHAMPAGNE Centre commercial des Ayvelles 08000 VILLERS SEMEUSE FOIX PYRENEES Route nationale 20 Peysale 09000 FOIX PAMIERS PYRENEES Centre commercial PERYSUD R.N.20 09100 PAMIERS SAINT GIRONS PYRENEES Route Départementale 117 Route de Toulouse 09190 SAINT LIZIER ROMILLY CHAMPAGNE 6 Boulevard Antoine de St Exupery BAR B 10510 MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE NARBONNE LANGUEDOC 21 Rue Alfred Chauchard - ZAC Bonne source 11100 NARBONNE VILLEFRANCHE ROUERGUE AUVERGNE Route de Montauban 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE RODEZ LANGUEDOC Centre commercial le Comtal -lieudit l'Estreniol 12850 ONET LE CHÂTEAU ARLES LANGUEDOC L'Aurélienne Quartier Fourchon 13200 ARLES AUBAGNE/MARSEILLE -

61 Clubs 2020 ALLIER
61 Clubs 2020 ALLIER AINAY LE CHATEAU T.C AINAY LE CHATEAU (50 03 0089) 38 licenciés (11 J + 27 A) Installations : Stade Guillet - 03360 Ainay Le Chateau Animation : Ecole de Tennis - Mini Tennis Président : Jean Sébastien PLO – 10 rue du Dr Vallet - 18200- St amand de Montrond - Tél. : 06 88 63 53 64 - [email protected] CQP : David CAGNY Tél 07 78 80 11 20 Correspondante FFT et Interlocutrice TENNIS FEMININ : Audrey Augonnet – L’Avignon 03360 Ainay Le Château – Tél : 06 08 46 90 46 [email protected] AVERMES S.C AVERMES (50 03 0071) 120 licenciés (41 J + 79 A) Installations : Stade des Isles - 03000 Avermes - Tél. : 09 66 94 44 30 - sportingclubavermes- [email protected] - www.sca-tennis.fr Animation : Club Junior - Ecole de Tennis - Mini Tennis - Programme Tennis Adulte – TMC D’Moiselles de Bourbon, beach tennis, stages jeunes vacances Toussaint et Pâques Président et Correspondant FFT : Florent HUGUET – Les Grands Vernats – 03000 Avermes - Tél. : 06 77 57 23 58 – [email protected] Autres correspondants : Tournois : Gauthier RODRIGUEZ : 06 15 30 82 40 Equipes : Jean-François SARASQUETA : 06 88 39 11 90 Enseignant : Alexis DETOLLENAERE Tél : 06 67 27 77 24 Interlocutrice TENNIS FEMININ : Pauline BOURLIAUD - Tél 06 83 27 38 96 – [email protected] BAYET S.C BAYET (50 03 0154) 61 licenciés (47 J + 14 A) Installations : Ile des Grottes - 03500 Bayet - Tél. : 04 70 45 32 26 - Mail : [email protected] Animation : Ecole de Tennis Président et Correspondant FFT : Laurent MARION – Les Cassons – 03500 BAYET - Tél. : 06 46 50 03 55 – mail : [email protected] Correspondant : Sébastien SCHMITT : Tél 06 34 56 31 16 mail : [email protected] BELLENAVES T.C BELLENAVES (50 03 0048) 38 licenciés (14 J + 24A) Installations : Mairie - 03330 Bellenaves - Tél. -

Liste Points Distribution OBE Ecotaxe.Pdf
KEYCODE nseq Categorie + Brand/Raison Sociale Ville Adresse CP SECTEUR PARTENAIRE EQUIPEMENT Longitude X Latitude Y Type Reseau 24/24 Horaires PODl Horaires Horaires PO dim AUTOROUT SENS bidirect Atelier de montage AU002 001 RESTAURANT AUTOGRILL HAUT KOENIGSBOURG ORSCHWILLER A35 - Aire du Haut Koenigsbourg 67600 Est AUTOGRILL WS 7.4048355315735 48.23179986010 Autoroute 24h/24 OUI OUI AU003 002 RESTAURANT AUTOGRILL REIMS CHAMPAGNE MOURMELON LE GRAND A4 - Aire de Reims Champagne 51400 Nord AUTOGRILL WS 4.2448750017395 49.11996709275Autoroute 24h/24 OUI OUI AU004 003 RESTAURANT AUTOGRILL TROYES FRESNOY FRESNOY LE CHATEAU A5 - Aire de Troyes Fresnoy 10270 IDF AUTOGRILL WS 4.2399811376952 48.21133670348Autoroute 24h/24 OUI OUI AU005 004 RESTAURANT AUTOGRILL NEMOURS NEMOURS A6 - Aire de Nemours 77140 IDF AUTOGRILL WS 2.7226088256225 48.264143365634Autoroute 24h/24 OUI OUI AU102 005 HOTEL AUTOGRILL BEAUNE MERCEUIL MERCEUIL A6 - Aire de Beaune Merceuil 21190 Rhône-Alpes AUTOGRILL WS 4.8358090251007 46.96211581937Autoroute 24h/24 OUI sens Lyon > Paris OUI AU007 006 RESTAURANT AUTOGRILL MONTELIMAR OUEST ALLAN A7 - Aire de Montélimar Ouest 26780 PACA AUTOGRILL WS 4.7821905330353 44.51462879107 Autoroute 8h/20h 8h/20h 8h/20h OUI OUI AU010 007 RESTAURANT AUTOGRILL NARBONNE - VINASSAN SALLES D'AUDE A9 - Aire de Narbonne - Vinassan 11110 PACA AUTOGRILL WS 3.0933722193908 43.215872412004Autoroute 6h30/22h 6h30/22 6h30/22h OUI sens Espagne > Orange AU100 008 HOTEL AUTOGRILL CHAMPS CHAMPS A71 - Aire des Volcans d’Auvergne 63440 Rhône-Alpes AUTOGRILL WS 3.1123253915161 46.05829532261 Autoroute 24h/24 OUI OUI AU101 009 RESTAURANT AUTOGRILL RELY RELY A26 - Aire de Rely 62120 Nord AUTOGRILL WS 2.3769444 50.5733333 Autoroute 24h/24 OUI sens Calais > Troyes AUT04 010 RESTAURANT AUTOGRILL RIVOLI RIVOLI A32/E70 Tangenziale Nord Torino - Km. -

Répertoire Archives Contemporaines Cazouls-D'hérault
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DES ARCHIVES CONTEMPORAINES DE CAZOULS-D’HERAULT CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’HERAULT 254, rue Michel Teule 34184 Montpellier Cedex 4 04 67 04 38 80 / Fax 04 67 52 43 82 / site internet : http://www.cdg34.fr CONSEIL GENERAL DE L’HERAULT, ARCHIVES DEPARTEMENTALES 2, avenue de Castelnau CS 54495 34093 Montpellier Cedex 5 04 67 14 82 18 / Fax 04 67 02 15 28 / e-mail [email protected] RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DES ARCHIVES CONTEMPORAINES DE CAZOULS-D’HERAULT [Décembre 2001] Par Sylvie MONTES , Attaché de conservation du patrimoine Sous la direction de Annie DENIZART , Attaché de conservation du patrimoine SOMMAIRE Série contemporaine (archives postérieures à 1982) 1 W Secrétariat général…………………………………………………………………..………… p. 2 2 W Administration générale………………………………………….……………………………. p. 3 3 W État civil…………………………………………………………………………………………. p. 5 4 W Élections……………………………………………………………...…………………………. p. 6 5 W Personnel communal…………………………………….……………………………………. p. 7 6 W Finances communales………………………………………………………………………… p. 8 7 W Bâtiments communaux………………………………………………………………………... p. 9 8 W Travaux publics, voirie et réseaux divers……………………..…………………………….. p. 10 9 W Aide sociale………………………………………………………...…………………………... p. 12 10 W Enseignement………………………………………………………….………………………. p. 13 11 W Syndicats dont la commune est membre………………………….………………………… p. 14 12 W Urbanisme…………………………………………………………………………...………….. p. 15 INDEX …………………………………………………………………………………………………… p. 16 Répertoire numérique détaillé des archives communales -

L' Etude Urgente Sur Le Transport Urbain a Bujumbura Republique Du Burundi
No. AGENCE JAPONAISE DE COOPERATION INTERNATIONALE MINISTERE DES TRANSPORTS, POSTES ET TELECOMMUNICATION MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’EQUIPEMENT REPUBLIQUE DU BURUNDI L' ETUDE URGENTE SUR LE TRANSPORT URBAIN A BUJUMBURA REPUBLIQUE DU BURUNDI RAPPORT FINAL FEVRIER 2008 AGENCE JAPONAISE DE COOPERATION INTERNATIONALE JAPAN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. EN ASSOCIATION AVEC YACHIYO ENGINEERING CO., LTD. SD JR 08-038 No. L' ETUDE URGENTE SUR LE TRANSPORT URBAIN A BUJUMBURA RAPPORT FINAL FEVRIER 2008 AGENCE JAPONAISE DE COOPERATION INTERNATIONALE Préparé par le JAPAN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. EN ASSOCIATION AVEC YACHIYO ENGINEERING CO., LTD. SD JR 08-038 TAUX DE CHANGE Aout 2007 1 US$ = 1,100 Burundi Franc 1 US$ = 110.0 Yen 1 Yen = 10 Burundi Franc AVANT-PROPOT En réponse à la requête du Gouvernement de la République du Burundi, le Gouvernement du Japon a décidé de réaliser une "Etude d’urgence du Transport urbain à Bujumbura" et a confié cette étude à l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA). La JICA a sélectionné une mission d'étude conduite par M. Yasushi OHWAKI de Japan Engineering Consultants Co., Ltd. en association avec YACHIYO Engineering Co., Ltd. et l’a déléguée sur place entre janvier 2007 et mars 2008. La mission a eu des échanges de vues avec les ingénieurs du Ministère des Transports, des Postes et des Télécommunications, du Ministère des Travaux publics et de l'Equipement, et de l’ Office des Transports en Commun (OTRACO) ainsi que d’autres autorités concernées du Gouvernement du Burundi, et a effectué des études sur le site, des analyses de données et l’établissement du Plan directeur du projet. -

MODERE DISTRIBUTION Présent Dans Deux Secteurs : En Rive Droite De La Cesse Sur La Commune De Sallèles-D'aude Et En Rive Dr
DISTRIBUTION Présent dans deux secteurs : en rive droite de la Cesse sur la commune de Sallèles-d’Aude et en rive droite de l’Aude au niveau de Moussan. Remplace la ripisylve sur les zones où les berges sont les plus abruptes. MODERE Document d’objectifs du site Natura 2000 « Cours inférieur de l'Aude » Diagnostic, enjeux et mesures de gestion SIC : FR 910436 RéalisationRéalisationRéalisation : Syndicat mixte du delta de l'Aude, Agence des aires marines protégées et Université de Montpellier2 Élaboration : John Holliday (SMDA), Marion Corre, Julien Courtel, Mathilde Labbé, François Flisiak (AAMP) Avec la participation : des membres des groupes de travail et du comité de pilotage du site Cours inférieur de l'Aude. Avec le soutien de : photographie en page de couverture : ©CEN L-R A Informations générales et caractéristiques physiques........................................................17 A.1 Natura 2000.............................................................................17 A.1.1 Le réseau Natura 2000...........................................................................................17 A.1.2 Désignation et gestion du site*.................................................................................20 A.2 Contexte administratif...................................................................22 A.2.1 Localisation...........................................................................................................22 A.2.2 Statut foncier..........................................................................................................22 -

Programme De Recherche Dans Le Champ De L'urbain
Programme de Recherche dans le Champ de l’Urbain Port-au-Prince : entre vulnérabilité et croissances urbaines, construction d’une métropole caribéenne Référence contrat No FED/2014/338-974 Annexe 17 RAPPORT SYNTHETIQUE DE L’AXE 1 Juillet 2017 UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS 1 Le présent document a été élaboré avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité des universités partenaires du PRCU : l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis – LADYSS, l’université d’État d’Haïti (UEH) – UEH-ENS- LADMA, et du CNIGS et ne peut être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne. Rapport final de l’Axe 1 – L’étude des périphéries de Port-au- Prince Equipe : J. Milian (coord.), O. Archambeau, S. Darly, V. Dathus, R. Dolce, E. Konshina, H. Pilkington, A. Rivière, A. Yapi-Diahou La question du défaut de maîtrise de la croissance urbaine de Port-au-Prince par les autorités haïtiennes est ancienne. Les travaux sur l’histoire urbanistique de la capitale et les étapes de cette croissance documentent et expliquent dans une certaine mesure ce problème apparu dès la phase de forte expansion que connaît la ville à partir de l’occupation américaine dans les années 1930 et qui va s’aggravant à partir des années 1950 (Lucien, 2014). Dès cette période s’opère une extension par agrégation, avec de multiples carences et complications dans l’organisation de la trame urbaine et le fonctionnement d’une agglomération de plus en plus peuplée. Port-au-Prince on le sait exerce dès le 19ème s. -

Chambre D'agriculture
Les marchés des producteurs HÉRAULT 1000 et une expériences avec nos producteurs I T I O N D É 2021 N O É D I T I 1000 et une expériences avec nos producteurs www.marches-producteurs.com Venez à la rencontre des producteurs fermiers, vignerons et artisans qui vous régaleront avec les pépites de notre beau terroir. Vous pourrez y faire vos courses ou savourer des assiettes fermières avec des bons produits locaux et de saison en direct du producteur. Gourmands, chaleureux, colorés, animés, nocturnes, sous le soleil... à chacun son marché ! Essayez-les, vous y succomberez ! VENTE DE PRODUITS FERMIERS Bienvenue à la Ferme Hérault ET ACCUEIL À LA FERME Contact : Hélène Jaillant 06 14 78 27 34 [email protected] www.bienvenue-a-la-ferme.com Ganges 85 Montoulieu 43 Saint-Bauzille-de-Putois 25 Le Caylar Claret 102 Lauret Romigièures Saint-Maurice de Navacelles Le Lamalou Saint-Jean-De-Bueges 53 116 113 Valflaunes L'Orb Saint-Martin-de-Londres 106 Réservoir d'Avène 115 Saint-Mathieu-de-Tréviers L'Hérault 108 Saint-Ghuilhem le Désert 105 107 Nous sommes plus de 140 agriculteurs adhérents Saint-Series Lodève 101 Les Matelles Bienvenue à la ferme dans l’Hérault prêts à vous faire 116 Le Bérange 65 117 57 Saint-Vincent-De-Barbeyrargues 60 La Lergue 7 103 Assas Entre-Vignes Vérargues découvrir nos produits et la passion de notre métier. Lunas Argelliers St Jean de la Blaquière Saint-Jean-de-Fos Saint-Gely-Du-Fesc 58 Teyran 75 76 Avec ce guide, vous dénicherez les bonnes adresses et Montpeyroux Aniane Le lez Castries 8 Lunel les bons plans fermiers de notre département. -

Val D'allier 01
AtlAs prAtique des pAysAges d’Auvergne / fichE ensemblE de paysage vAlS et Gdes rivIères de Plaine 8 vAl D’AllIER 01 Le val d’Allier est l’élément naturel 1. SITUATION Allier de Villeneuve / 8.01 J Forêt d’Apremont / structurant du département de l’Allier 8.01 K Allier du Veurdre. À cheval sur les départements du Puy-de- qui porte son nom. Dans la mesure où Dôme et de l’Allier, l’ensemble de paysages du 2. GRANDES COMPOSANTES la rivière est quasiment entièrement Val d’Allier correspond à la partie élargie de la DES PAYSAGES auvergnate (elle traverse la région sur rivière depuis la sortie des défilés du Val d’Al- plus de quatre cents kilomètres du lier (ensemble 9.01) jusqu’à la sortie de la ré- 2.1 Une vallée plate, espace de diva- gion Auvergne. Il traverse la Grande Limagne gation poUr la rivière sud au nord, de Langogne en Lozère, et les plaines des Varennes (6.01), l’ensemble au bord de la Haute-Loire, jusqu’au de paysages de la Forêt et bocage du Val d’Al- Le trait marquant du paysage physique Veurdre dans l’Allier), on peut considé- lier Vichyssois (5.06), celui des Bois Noirs et de de la vallée de l’Allier est sa platitude. Son rer qu’elle est tout autant structurante la Montagne bourbonnaise (2.01), ainsi que orientation correspond à la faille bordière de le Forterre (6.04), la forêt et le bocage bour- la Limagne dans le sens nord-sud. Sa pente pour la région Auvergne dans son bonnais (5.01) et la Sologne bourbonnaise est très faible sur ce tronçon : environ 0,1 %. -
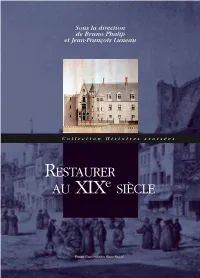
Restaurer Au Xixe Siècle
Sous la direction de Bruno Phalip et Jean-François Luneau Collection Histoires croisées RESTAURER AU XIXe SIÈCLE Presses Universitaires Blaise-Pascal a discipline de l’histoire de l’art peine à intégrer pleinement le mot “production” qui touche Là l’artisanat comme à l’industrie. Les logiques de la production artistique sont envisagées ici par autant de médiévistes que de modernistes et contemporanéistes, tant les décou- pages chronologiques habituels sont des horizons à dépasser. Les axes de recherche du plan quadriennal 2008-2011 du Centre d’Histoire Espaces et Culture de l’université Blaise Pas- cal, de même que ceux du prochain contrat quadriennal, témoignent de cette volonté de franchir les limites conceptuelles et chronologiques imposées par la tradition disciplinaire. La restauration d’œuvres d’art et d’édifices produits à la période médiévale suppose de s’inter- roger à propos de leur authenticité qui ne peut être prédéfinie comme originelle. Les processus de transmission, de conservation et de valorisation n’étant aucunement innocents, il a paru important de réunir des interventions amorçant un dialogue avec des chercheurs privilé- giant, un temps, la “production artistique” à celle de la “création artistique”. Créer suppose la valorisation du fait individuel, la promotion permanente et l’autocélébration habituelle des élites. Produire revient à rééquilibrer, en traitant du collectif, sans oublier le fait indivi- duel, en assurant une place à l’équipe, l’atelier, les qualifications et les intelligences partagées. Restaurer suppose aussi la conscience de la disparition d’un monde, de sa lente des- truction ou défiguration. L’entretien seul n’est plus possible et la production d’œuvres res- taurées doit être assumée.