Messiaen Fiche
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Signumclassics
126booklet 13/5/08 11:28 Page 1 ALSO AVAILABLE ON signumclassics Ragtime & Blue Brahms and Schumann Haydn Piano Sonatas Elena Kats-Chernin - Piano John Lill - Piano John Lill - Piano SIGCD058 SIGCD075 SIGCD097 Elena Kats-Chernin is a composer who Much-loved pianist, John Lill, plays John Lill returns to take the listener on a defies categorisation: a virtuosic pianist touchstones of the 19th-century romantic journey through the many moods of Haydn, and improviser, her compositions flow piano tradition. Lill is at his sparkling in brilliant performances of some from her like a fountain. This CD is best in this wonderful repertoire. composer’s most intriguing works for drawn from the small works she often the keyboard. writes for her own enjoyment - a cornucopia of rags, blues and heart- melting melodies. Available through most record stores and at www.signumrecords.com For more information call +44 (0) 20 8997 4000 126booklet 13/5/08 11:28 Page 3 MESSIAEN: CHAMBER WORKS MESSIAEN: CHAMBER WORKS The general perception of Messiaen is of a always turned up at class with mountains of work 1. Fantaisie [8.59] composer who lived in some rarefied atmosphere (not guaranteed to ensure popularity!) and was of his own, floating far above the mundane, recognised as a young man likely to succeed. But Quatuor pour la fin du Temps material world. Given his preoccupation with any view of Messiaen as vague or indecisive in his 2. Liturgie de cristal [2.37] esoteric rhythms, sound-colours, theology and opinions needs to be set against the truth - for all birdsong, this is perhaps a reasonable judgment his pacific demeanour (and, in later years, 3. -

Birdsong in the Music of Olivier Messiaen a Thesis Submitted To
P Birdsongin the Music of Olivier Messiaen A thesissubmitted to MiddlesexUniversity in partial fulfilment of the requirementsfor the degreeof Doctor of Philosophy David Kraft School of Art, Design and Performing Arts Nfiddlesex University December2000 Abstract 7be intentionof this investigationis to formulatea chronologicalsurvey of Messiaen'streatment of birdsong,taking into accountthe speciesinvolved and the composer'sevolving methods of motivic manipulation,instrumentation, incorporation of intrinsic characteristicsand structure.The approachtaken in this studyis to surveyselected works in turn, developingappropriate tabular formswith regardto Messiaen'suse of 'style oiseau',identified bird vocalisationsand eventhe frequentappearances of musicthat includesfamiliar characteristicsof bird style, althoughnot so labelledin the score.Due to the repetitivenature of so manymotivic fragmentsin birdsong,it has becomenecessary to developnew terminology and incorporatederivations from other research findings.7be 'motivic classification'tables, for instance,present the essentialmotivic featuresin somevery complexbirdsong. The studybegins by establishingthe importanceof the uniquemusical procedures developed by Messiaen:these involve, for example,questions of form, melodyand rhythm.7he problemof is 'authenticity' - that is, the degreeof accuracywith which Messiaenchooses to treat birdsong- then examined.A chronologicalsurvey of Messiaen'suse of birdsongin selectedmajor works follows, demonstratingan evolutionfrom the ge-eralterm 'oiseau' to the preciseattribution -

God, Nature, and Politics in Olivier Messiaen's <I>Des Canyons Aux Étoiles
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Masters Theses Graduate School 8-2014 Sonic Environmentalism: God, Nature, and Politics in Olivier Messiaen's Des canyons aux étoiles . Ryan James Taussig University of Tennessee - Knoxville, [email protected] Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes Part of the Musicology Commons Recommended Citation Taussig, Ryan James, "Sonic Environmentalism: God, Nature, and Politics in Olivier Messiaen's Des canyons aux étoiles . .. " Master's Thesis, University of Tennessee, 2014. https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/2853 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a thesis written by Ryan James Taussig entitled "Sonic Environmentalism: God, Nature, and Politics in Olivier Messiaen's Des canyons aux étoiles . .." I have examined the final electronic copy of this thesis for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree of Master of Music, with a major in Music. Rachel M. Golden, Major Professor We have read this thesis and recommend its acceptance: Leslie C. Gay, Jacqueline A. Avila Accepted for the Council: Carolyn R. Hodges Vice Provost and Dean of the Graduate School (Original signatures are on file with official studentecor r ds.) ! Sonic Environmentalism:! God, Nature, and Politics in Olivier Messiaen’s Des canyons aux étoiles . -

Aspects of Structure in Olivier Messiaen's Vtngt Regards Sur L'enfant-Jesus
ASPECTS OF STRUCTURE IN OLIVIER MESSIAEN'S VTNGT REGARDS SUR L'ENFANT-JESUS by DAVID ROGOSIN B.Mus., l'Universite de Montreal, 1978 M.Mus., l'Universite de Montreal, 1981 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MUSICAL ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES School of Music We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA March 1996 © David Rogosin, 1996 AUTHORIZATION In presenting this thesis in partial fulfillment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of The University of British Columbia, Vancouver, Canada Date DE-6 (2/88) ASPECTS OF STRUCTURE IN OLIVIER MESSIAEN'S "VINGT REGARDS SUR L'ENFANT-JESUS" ABSTRACT The paper explores various structural aspects of the 1944 masterwork for piano, Vingt Regards sur I'Enfant-Jesus, by Olivier Messiaen (1908-1992). Part One examines elements of the composer's style in isolation, focusing prin• cipally on the use of the modes of limited transposition to generate diverse tonal styles, as well as the use of form and "cyclical" or recurring themes and motifs to both unify and diversify the work. -

Messiaen's Influence on Post-War Serialism Thesis
3779 N8! RI. oIo MESSIAEN'S INFLUENCE ON POST-WAR SERIALISM THESIS Presented to the Graduate Council of the North Texas State University in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF MUSIC by Thomas R. Muncy, B.A. Denton, Texas August, 1984 Muncy, Thomas R., Messiaen's Influence on Post-'gar Serialism. Master of Music (Theory), August, 1984, 106 pp., 76 examples, biblio- graphy, 44 titles. The objective of this paper is to show how Olivier Messiaen's Mode de valeurs et d'intensites influenced the development of post- war serialism. Written at Darmstadt in 1949, Mode de valeurs is considered the first European work to organize systematically all the major musical parameters: pitch, duration, dynamics, articulation, and register. This work was a natural step in Messiaen's growth toward complete or nearly complete systemization of musical parameters, which he had begun working towards in earlier works such as Vingt regards sur 1'Enfant-Jesus (1944), Turangalila-symphonie (1946-8), and Cantyodjaya (1949), and which he continued to experiment with in later works such as Ile de Feu II (1951) and Livre d'orgue (1951). The degree of systematic control that Messiaen successfully applied to each of the musical parameters influenced two of the most prominent post-war serial composers, Pierre Boulez and Karlheinz Stockhausen, to further develop systematic procedures in their own works. This paper demonstrates the degree to which both Boulez' Structures Ia (1951) and Stockhausen's Kreuzspiel (1951) used Mode de valeurs as a model for the systematic organization of musical parameters. TABLE OF CONTENTS Page LIST OF EXAMPLES..-.........-... -

A Musical and Theological Discussion of Olivier Messiaen’S Vingt Regards Sur L’Enfant-Jésus
The Theme of God: A Musical and Theological Discussion of Olivier Messiaen’s Vingt regards sur l’Enfant-Jésus By © 2017 Heekyung Choi Submitted to the graduate degree program in Music and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts. ________________________________ Chairperson Dr. Michael Kirkendoll ________________________________ Dr. Richard Reber ________________________________ Dr. Scott Murphy ________________________________ Dr. Scott McBride Smith ________________________________ Dr. Jane Barnette Date Defended: 1 May 2017 The Dissertation Committee for Heekyung Choi certifies that this is the approved version of the following dissertation: The Theme of God: A Musical and Theological Discussion of Olivier Messiaen’s Vingt regards sur l’Enfant-Jésus ________________________________ Chairperson Dr. Michael Kirkendoll Date approved: 1 May 2017 ii Abstract The purpose of this research is to help both performers and liturgical musicians to better understand Messiaen’s musical style and theological inspiration. Olivier Messiaen (1908-1992) is one of the most important composers of French keyboard music in the twentieth century. He composed numerous works in nearly every musical genre, many inspired by his Catholic faith. Vingt regards sur l’Enfant-Jésus (Twenty Contemplations on the Infant Jesus) is a two-hour masterpiece for solo piano written in 1944, and is one of the most significant of his works. The piece is constructed by using three main themes: the Thème de Dieu (Theme of God), Thème de l’étoile et de la Croix (Theme of the Star and of the Cross), and Thème d’accords (Theme of Chords). The “Theme of God” is based on an F-sharp major chord with chromatic passing tones in the inner voice. -

Olivier Messiaen Comes to Visit
Friends of the Kotzschmar Organ Founded in 1981, the Friends of the Kotzschmar of the organ and provides funds to produce and Organ (FOKO), a non-profi t organization, supports promote concerts, maintain, repair, and enhance the the Kotzschmar Organ. Each year the organization organ, sponsor lectures and organ demonstrations presents 16 to 18 concerts, engaging renowned and tours and supports a growing education program organists and guest artists from around the world. to bring awareness and understanding of this musical FOKO is responsible for the care and maintenance gem of Portland. The KotZschmar Organ ... In August, 1912 the City of Portland dedicated its and action component restored to original condition new City Hall, replacing the building destroyed at the shops of Foley-Baker, Incorporated, in Tolland, by fi re in 1908. Th e new building included a large Connecticut. Re-installation of the instrument is public auditorium whose stage was dominated currently underway. by a magnifi cent organ built by the Austin Organ Company of Hartford, Connecticut. Th e instrument Th e renovated Kotzschmar Organ will make its was the gift of Cyrus H.K. Curtis, born in Portland début on Saturday evening, September 27, 2014. in 1850, founder of the Curtis Publishing Company Performers will include Municipal Organist of Philadelphia, renowned for such magazines as Th e Ray Cornils, Peter Richard Conte (Organist of Saturday Evening Post, and Ladies Home Journal. Macy’s Wanamaker Organ, Philadelphia), and the Kotzschmar Festival Brass. Curtis stipulated that his gift should be a memorial to Hermann Kotzschmar, a family friend, his fi rst music teacher, and the leading fi gure in Portland’s musical life from the 1850s until his death in 1908. -
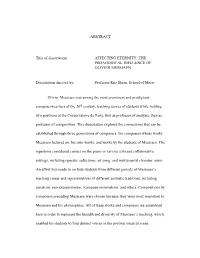
AFFECTING ETERNITY: the PEDAGOGICAL INFLUENCE of OLIVIER MESSIAEN Dissertation Directed By
ABSTRACT Title of dissertation: AFFECTING ETERNITY: THE PEDAGOGICAL INFLUENCE OF OLIVIER MESSIAEN Dissertation directed by: Professor Rita Sloan, School of Music Olivier Messiaen was among the most prominent and prodigious composer-teachers of the 20 th century, teaching scores of students while holding two positions at the Conservatoire de Paris, first as professor of analysis, then as professor of composition. This dissertation explores the connections that can be established through three generations of composers: the composers whose works Messiaen lectured on, his own works, and works by the students of Messiaen. The repertoire considered centers on the piano in various solo and collaborative settings, including operatic reductions, art song, and instrumental chamber music. An effort was made to include students from different periods of Messiaen’s teaching career and representatives of different aesthetic traditions, including serialism, neo-expressionism, European minimalism, and others. Compositions by composers preceding Messiaen were chosen because they were most important to Messiaen and his philosophies. All of these works and composers are assembled here in order to represent the breadth and diversity of Messiaen’s teaching, which enabled his students to find distinct voices in the postwar musical scene. This repertoire was performed over the course of three recitals on November 15 th , 2019, March 8 th and May 6 th , 2020, with the first two recitals held in the Gildenhorn Recital Hall at the University of Maryland, and the third recital streamed live from the living room of the pianist. Recordings of these three recitals can be found in the Digital Repository at the University of Maryland (DRUM). -

Durham E-Theses
Durham E-Theses Oliver Messiaen: Structural aspects of the pianoforte music Macdougall, Ian C. How to cite: Macdougall, Ian C. (1972) Oliver Messiaen: Structural aspects of the pianoforte music, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/10211/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk OLIVIER MESSlAEN : STRUCTURAL ASPECTS OF THE PIANOFORTE MUSIC by IAN C. MACDOUGALL B. Mus. (Hons.) A Thesis presented for the Degree of : Master" of A~rts ! to the ' Faculty of Music at the University, of Durham. Durham, Glasgow & Dunblane 1st September, 1971. V • 1 v Olivier Messiaen .TABLE OF CONTENTS Frontispiece : Olivier Messiaen Summary Declaration of Originality Table of Acknowledgements Preface Chapter 1 Preliminary survey : An introduction to Messiaen's style, creed and musical language. Chapter 2 The 'Preludes' of 1929 and their importance in a continuing line of development. -

COULEURS DE LA CITE CELESTE Presented to the Graduate Council
37V9 /(B THE ROLE OF TEXTURAL DESIGN IN THE MUSIC OF OLIVIER MESSIAEN: A STUDY OF #0 / COULEURS DE LA CITE CELESTE THESIS Presented to the Graduate Council of the North Texas State University in Partial Fullf illment of the Requirements For the Degree of MASTER OF MUSIC by Paulette Sue Wallendorf, B.M. Denton, Texas August, 1981 Wallendorf, Paulette S., The Role of Textural Desin in the Music of Olivier Messiaen: A%Studyof Couleurs de la Cite Celeste. Master of Music (Theory), August, 1981, 76 Pp., 5 graphs, 11 illus trations, bibliography. This study first traces the evolution of a new musical design, one which emphasizes textural elements in the structural foundation. It follows with an account of the life and musical style of Olivier Messiaen, a contemporary composer who has emphasized timbre as a structural parameter in his music--most notably in several works of the sixties. An analysis of his Couleurs de la Cite Celeste (1963) is offered in the final chapter, indicating in particular the impor tant role that timbre, as well as other textural elements, plays in forming the large-scale design. TABLE OF CONTENTS Page LIST OF GRAPHS ........................ .. ..iv . LIST OF ILLUSTRATIONS .. 0.0 . 0 . .0 . 0 V Chapter I. INTRODUCTION . 1 II. TIMBRE AS A STRUCTURAL PARAMETER IN MUSICAL FORMS, PAST AND PRESENT . 12 III. MESSIAEN--HIS BACKGROUND, EDUCATION, INFLUENCES, AND CAREER . , . 25 IV. THE MUSICAL LANGUAGE OF MESSIAEN . 33 Melody Rhythm Harmony The Modes of Limited Transposition V. THE TREATMENT OF TIMBRE IN MESSIAEN'S MUSIC . .. 42 / / VI. COULEURS DE LA CITE CELESTE: A TEXTURALANALYSIS . -

PRESS RELEASE for Immediate Release PHILHARMONIA ORCHESTRA LAUNCHES MESSIAEN CELEBRATIONS a Major Festival to Celebrate the 100 Th Anniversary of the Composer’S Birth
PRESS RELEASE For immediate release PHILHARMONIA ORCHESTRA LAUNCHES MESSIAEN CELEBRATIONS A major festival to celebrate the 100 th Anniversary of the composer’s birth The Philharmonia Orchestra is mounting a significant celebration of the 1 00th Annive rsary of Messiaen’s birth (1908 -1992 ), from 4 February to 23 October . Esa -Pekka Salonen, who becomes Principal Conductor and Artistic Advisor in September , conducts the first part in February with concerts in London, Basingstoke, Cardiff, Southend -on - Sea, Bari, Luxembourg, Parma and Palermo and featuring two iconic works : Messiaen’s Turangalîla -symphonie and Stravinsky’s The Rite of Spring . Both works are iconic pieces in Salonen’s own history; indeed Messiaen’s Turangal îla -symphonie was the piece th at inspired him to take up music. "I was about 11 and couldn't believe there was music like that… if that's what you could produce, I thought it must be the most fascinating thing on earth." The exploration of Messiaen’s work throughout the festival hig hlights the sheer range of the composer’s output from the chamber music ( Quatuor pour la fin du Temps ) to song cycles ( Poèmes pour Mi ), from works for solo piano and small ensemble ( Oiseaux exotiques ) to the two very gigantic but very different masterpiece s: Turangalîla -symphonie and La Transfiguration de Notre -Seigneur Jésus Christ. The Philharmonia is proud to bring together an array of performers who are not only the very finest exponents of Messiaen’s music, but who knew and admired him as a friend, tea cher or mentor : Pierre -Laurent Aimard, George Benjamin, Sylvain Cambreling, Roger Muraro, Cynthia Mill ar and Kent Nagano. -

Messiaen - L’Essentiel De L’Oeuvre Jacques Amblard
Messiaen - l’essentiel de l’oeuvre Jacques Amblard To cite this version: Jacques Amblard. Messiaen - l’essentiel de l’oeuvre. 2019. hal-02293601 HAL Id: hal-02293601 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02293601 Preprint submitted on 20 Sep 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Jacques Amblard (Aix-Marseille Université) Messiaen – L’essentiel de l’œuvre Ce texte est publié dans Brahms (encyclopédie en ligne de l’IRCAM, voit « Messiaen : parcours de l’œuvre »), mais dans une version considérablement réduite, et finalement nettement distincte de celle-ci. La musicographie a souvent dépeint le Messiaen catholique. On a beaucoup évoqué l’ornithologue passionné. Il est parfois question du « rythmicien », du goût pour les modes rythmiques du Moyen Âge, de l’Inde, pour les « rythmes non-rétrogradables », les « modes à transpositions limitées ». Or, tous ces discours reconduisent surtout ceux d’un musicologue célèbre : Messiaen lui- même, discours qu’il semble – de nos jours encore – difficile de contredire, voire simplement de compléter. Peter Hill et Nigel Simeone remarquent à la première page de leur ouvrage que « plus d’une décennie après sa mort, notre connaissance [de Messiaen] est toujours largement conditionnée par ce qu’il a dit de lui-même ».