Dommergues Et Al 2006B.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Phylum MOLLUSCA
285 MOLLUSCA: SOLENOGASTRES-POLYPLACOPHORA Phylum MOLLUSCA Class SOLENOGASTRES Family Lepidomeniidae NEMATOMENIA BANYULENSIS (Pruvot, 1891, p. 715, as Dondersia) Occasionally on Lafoea dumosa (R.A.T., S.P., E.J.A.): at 4 positions S.W. of Eddystone, 42-49 fm., on Lafoea dumosa (Crawshay, 1912, p. 368): Eddystone, 29 fm., 1920 (R.W.): 7, 3, 1 and 1 in 4 hauls N.E. of Eddystone, 1948 (V.F.) Breeding: gonads ripe in Aug. (R.A.T.) Family Neomeniidae NEOMENIA CARINATA Tullberg, 1875, p. 1 One specimen Rame-Eddystone Grounds, 29.12.49 (V.F.) Family Proneomeniidae PRONEOMENIA AGLAOPHENIAE Kovalevsky and Marion [Pruvot, 1891, p. 720] Common on Thecocarpus myriophyllum, generally coiled around the base of the stem of the hydroid (S.P., E.J.A.): at 4 positions S.W. of Eddystone, 43-49 fm. (Crawshay, 1912, p. 367): S. of Rame Head, 27 fm., 1920 (R.W.): N. of Eddystone, 29.3.33 (A.J.S.) Class POLYPLACOPHORA (=LORICATA) Family Lepidopleuridae LEPIDOPLEURUS ASELLUS (Gmelin) [Forbes and Hanley, 1849, II, p. 407, as Chiton; Matthews, 1953, p. 246] Abundant, 15-30 fm., especially on muddy gravel (S.P.): at 9 positions S.W. of Eddystone, 40-43 fm. (Crawshay, 1912, p. 368, as Craspedochilus onyx) SALCOMBE. Common in dredge material (Allen and Todd, 1900, p. 210) LEPIDOPLEURUS, CANCELLATUS (Sowerby) [Forbes and Hanley, 1849, II, p. 410, as Chiton; Matthews. 1953, p. 246] Wembury West Reef, three specimens at E.L.W.S.T. by J. Brady, 28.3.56 (G.M.S.) Family Lepidochitonidae TONICELLA RUBRA (L.) [Forbes and Hanley, 1849, II, p. -
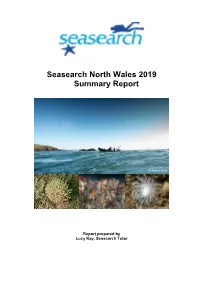
Seasearch North Wales 2019 Summary Report
Seasearch North Wales 2019 Summary Report Report prepared by Lucy Kay, Seasearch Tutor Seasearch Gogledd Cymru 2019 Cynllun gwirfoddol sy’n arolygu rhywogaethau a chynefinoedd morol yw Seasearch ar gyfer deifwyr sy’n deifio yn eu hamser hamdden ym Mhrydain ac Iwerddon. Mae’r cynllun yn cael ei gydlynu yn genedlaethol gan y Gymdeithas Cadwraeth Forol. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi gweithgareddau Seasearch yng Ngogledd Cymru yn ystod 2019. Mae’n cynnwys crynodebau o’r safleoedd a arolygwyd ac yn nodi rhywogaethau a chynefinoedd prin neu anghyffredin a welwyd. Mae’r rhain yn cynnwys nifer o gynefinoedd a rhywogaethau â blaenoriaeth yng Nghymru. Nid yw’r adroddiad hwn yn cynnwys yr holl fanylion data gan fod y rhain wedi eu cofnodi yn y gronfa ddata Marine Recorder a gyflwynwyd i Cyfoeth Naturiol Cymru i’w defnyddio yn ei weithgareddau cadwraeth forol. Mae’r data rhywogaethau hefyd ar gael ar-lein drwy Rwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol Atlas. Yn ystod 2019, roedd Seasearch yng Ngogledd Cymru yn parhau i ganolbwyntio ar rywogaethau a chynefinoedd â blaenoriaeth yn ogystal â chasglu gwybodaeth am wely’r môr a bywyd morol ar gyfer safleoedd nad oeddent wedi cael eu harolygu yn flaenorol. Mae’r data o Ogledd Cymru yn 2019 yn cynnwys 15 o Ffurflenni Arolygu a 34 o Ffurflenni Arsylwi, sef 49 ffurflen i gyd. Yn 2019 cyflawnwyd gwaith Seasearch yng Ngogledd Cymru gan Holly Date, cydlynydd rhanbarthol Seasearch yng Ngogledd Cymru; mae ardal Seasearch Gogledd Cymru yn ymestyn o Aberystwyth i Afon Dyfrdwy. Mae’r cydlynydd yn cael ei gynorthwyo gan nifer o Diwtoriaid gweithredol Seasearch, Tiwtoriaid Cynorthwyol a Threfnwyr Deifio. -

The Genital Systems of Trivia Arctica and Trivia Monacha (Prosobranchia, Mesogastropoda) and Tributyltin Induced Imposex1
Zoo1. Beitr. N. F. 34 (3): 349 - 374 (1992) (Institut für Spezielle Zoologie und Vergleichende Embryologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster) The genital systems of Trivia arctica and Trivia monacha (Prosobranchia, Mesogastropoda) and tributyltin induced imposex1 EBERHARD STROBEN, CHRISTA BROlVlMEL, JORG OEHLMANN and PIO FIORONI Received June 17 , 1992 Summary The mesogastropod prosobranchs Trivia arctica and T. monacha collected along the coast of Brittany and Normandy between 1988 and 1992 exhibit imposex or pseudohermaphroditism (occurrence of male parts in addition to the female genital system) in response to tributyltin (TBT) pollution. Beside some normal females (stage 0) different imposex stages according to the classification of FIORONI et a1. (1991) (3 a, 3 band 4 for T. arctica and 3b and 4 for T. monacha) (Fig. 1) can be distinguished and are documented with scanning electron micrographs for the first time. Additional al terations of the genital tract e.g. excrescences on the vas deferens, a coiled oviduct, a bi- or trifurcated penis or several penes (2 - 5) are described. Neither TBT-induced sterilization nor sex change occur. TBT accumulation in soft parts shows sex-related differences. The VDS (vas deferens sequence) index, uncubed RPS (relative penis size) index and average female penis length of a population are dependent from TBT con centrations in ambient sea water and TBT body burden. A statistical study, based on an analysis of natural populations of T. arctica, T. monacha and Nucella lapillus allows a comparison of the specific TBT sensitivity of the three TBT bioindicators. N. lapillus exhibits a lower threshold for imposex development and a higher TBT sen sitivity, but both Trivia species proved to be suitable TBT bioindicators. -

Rocky Shore Snails As Material for Projects (With a Key for Their Identification)
Field Studies, 10, (2003) 601 - 634 ROCKY SHORE SNAILS AS MATERIAL FOR PROJECTS (WITH A KEY FOR THEIR IDENTIFICATION) J. H. CROTHERS Egypt Cottage, Fair Cross, Washford, Watchet, Somerset TA23 0LY ABSTRACT Rocky sea shores are amongst the best habitats in which to carry out biological field projects. In that habitat, marine snails (prosobranchs) offer the most opportunities for individual investigations, being easy to find, to identify, to count and to measure and beng sufficiently robust to survive the experience. A key is provided for the identification of the larger species and suggestions are made for investigations to exploit selected features of individual species. INTRODUCTION Rocky sea shores offer one of the best habitats for individual or group investigations. Not only is there de facto public access (once you have got there) but also the physical factors that dominate the environment - tides (inundation versus desiccation), waves, heat, cold, light, dark, salinity etc. - change significantly over a few metres in distance. As a bonus, most of the fauna and flora lives out on the open rock surface and patterns of distribution may be clearly visible to the naked eye. Finally, they are amongst the most ‘natural’ of habitats in the British Isles; unless there has been an oil spill, rocky sea shores are unlikely to have been greatly affected by covert human activity. Some 270 species of marine snail (Phylum Mollusca, Class Gastropoda; Sub-Class Prosobranchia) live in the seas around the British Isles (Graham, 1988) and their empty shells may be found on many beaches. Most of these species are small (less than 3 mm long) or live beneath the tidemarks. -

MOLLUSCS Species Names – for Consultation 1
MOLLUSCS species names – for consultation English name ‘Standard’ Gaelic name Gen Scientific name Notes Neologisms in italics der MOLLUSC moileasg m MOLLUSCS moileasgan SEASHELL slige mhara f SEASHELLS sligean mara SHELLFISH (singular) maorach m SHELLFISH (plural) maoraich UNIVALVE SHELLFISH aon-mhogalach m (singular) UNIVALVE SHELLFISH aon-mhogalaich (plural) BIVALVE SHELLFISH dà-mhogalach m (singular) BIVALVE SHELLFISH dà-mhogalaich (plural) LIMPET (general) bàirneach f LIMPETS bàirnich common limpet bàirneach chumanta f Patella vulgata ‘common limpet’ slit limpet bàirneach eagach f Emarginula fissura ‘notched limpet’ keyhole limpet bàirneach thollta f Diodora graeca ‘holed limpet’ china limpet bàirneach dhromanach f Patella ulyssiponensis ‘ridged limpet’ blue-rayed limpet copan Moire m Patella pellucida ‘The Virgin Mary’s cup’ tortoiseshell limpet bàirneach riabhach f Testudinalia ‘brindled limpet’ testudinalis white tortoiseshell bàirneach bhàn f Tectura virginea ‘fair limpet’ limpet TOP SHELL brùiteag f TOP SHELLS brùiteagan f painted top brùiteag dhotamain f Calliostoma ‘spinning top shell’ zizyphinum turban top brùiteag thurbain f Gibbula magus ‘turban top shell’ grey top brùiteag liath f Gibbula cineraria ‘grey top shell’ flat top brùiteag thollta f Gibbula umbilicalis ‘holed top shell’ pheasant shell slige easaig f Tricolia pullus ‘pheasant shell’ WINKLE (general) faochag f WINKLES faochagan f banded chink shell faochag chlaiseach bhannach f Lacuna vincta ‘banded grooved winkle’ common winkle faochag chumanta f Littorina littorea ‘common winkle’ rough winkle (group) faochag gharbh f Littorina spp. ‘rough winkle’ small winkle faochag bheag f Melarhaphe neritoides ‘small winkle’ flat winkle (2 species) faochag rèidh f Littorina mariae & L. ‘flat winkle’ 1 MOLLUSCS species names – for consultation littoralis mudsnail (group) seilcheag làthaich f Fam. -

Marine Ecology Progress Series 555:79
The following supplements accompany the article Spatial and temporal structure of the meroplankton community in a sub- Arctic shelf system Marc J. Silberberger*, Paul E. Renaud, Boris Espinasse, Henning Reiss *Corresponding author: [email protected] Marine Ecology Progress Series 555: 79–93 (2016) SUPPLEMENTS Supplement 1. Compiled list of sampled taxa Crustacea: Decapoda: Galathea sp. Munida sp. Philocheras bispinosus bispinosus Carcinus maenas Cancer pagurus Caridion gordoni Eualus pusiolus Lebbeus sp. Polybiidae Hyas sp. Pandalus montagui Atlantopandalus propinqvus Pagurus bernhardus Pagurus pubescens Anapagurus sp. Anapagurus laevis Cirripedia: Verruca stroemia Balanus balanus Semibalanus balanoides Balanus crenatus Lepadidae Bryozoa: Membranipora membranacea Electra pilosa Polychaeta: Amphinomidae Chaetopteridae Spionidae Phyllodocidae 1 Pectinariidae Nephtyidae Polynoidae Aphroditidae Arenicolidae Trochophora (unknown) Syllidae Mollusca: Bivalvia: Hiatella – Type Mya – Type Mytilidae – Type Cardiidae – Type Anomiidae – Type Gastropoda: Velutina velutina Lamellaria latens Lamellaria perspicua Trivia arctica Littorinimorpha – Type Raphitoma linearis Mangelia attenuata Turritella communis Melanella sp. Nudibranchia Pleurobranchomorpha Cephalaspidea & Sacoglossa Pyramidellidae Echinodermata: Ophiuroidea Echinoidea Asteroidea Holothuroidea Various: Nemertea Enteropneusta Phoronida Sipuncula Platyhelminthes Hydrozoa (Actinula) Anthozoa Planula Ascidiacea Unidentified -

LA MALACOFAUNA DEL YACIMIENTO DE LA PEÑA DE ESTEBANVELA (SEGOVIA) Jesús F
4•La Peña.qxd 18/9/07 09:27 Página 107 LA MALACOFAUNA DEL YACIMIENTO DE LA PEÑA DE ESTEBANVELA (SEGOVIA) Jesús F. Jordá Pardo Universidad Nacional de Educación a Distancia. Departamento de Prehistoria y Arqueología. Senda del Rey, 7. E-28040 Madrid. [email protected] 107 RESUMEN ABSTRACT El yacimiento arqueológico del Pleistoceno superior final de La The archaeological site of La Peña de Estebanvela has pro- Peña de Estebanvela ha proporcionado una interesante colec- vided an interesting malacological collection integrated by 389 ción malacológica integrada por 389 individuos correspondien- individuals corresponding to 11 different taxa. Of these, 5 are tes a 11 taxones diferentes. De estos, 5 son gasterópodos continental gastropods (Theodoxus fluviatilis, Melanopsis sp., continentales (Theodoxus fluviatilis, Melanopsis sp., Helicella Helicella unifasciata, Jaminia quadridens and Gastropoda unifasciata, Jaminia quadridens y Gastropoda indet.), 5 son gas- indet.), 5 are marine gastropods (Littorina obtusata, Trivia arc- terópodos marinos (Littorina obtusata, Trivia arctica, Columbe- tica, Columbella rustica, Nassarius reticulatus and Cyclope ner- lla rustica, Nassarius reticulatus y Cyclope neritea) y 1 es un itea) and 1 is a fragment of marine bivalve (Pecten maximus). fragmento de bivalvo marino (Pecten maximus). Por niveles, los For levels, the three superiors are the richest quantitative and tres superiores son los más ricos tanto cuantitativa como cuali- qualitatively, whereas the three low ones present a scanty pres- tativamente, mientras que los tres inferiores presentan una baja ence of mollusks, basically represented by the continental gas- presencia de moluscos, básicamente representados por los gas- tropods. We could have established four sets: ornamental set, terópodos continentales. -

M13391 Supp.Pdf
Supplement to de Bettignies et al. (2020) – https://doi.org/10.3354/meps13391 Table S1. Complete list of taxa identified during the degradation with their corresponding trophic group: detritus feeders (DF), grazers (G), predators (P) and suspension-feeders (SF). The sum of the abundance of the three replicate cages is reported for each sampling time. Abundance / Trophic Taxons sampling time (weeks) group 2 4 6 11 15 20 24 Annelida Polychaeta Amblyosyllis sp. - Grube, 1857 P 0 0 0 0 0 0 1 Branchiomma bairdi - (McIntosh, 1885) SF 0 0 0 0 0 0 5 Branchiomma bombyx - (Dalyell, 1853) SF 0 0 0 0 1 0 6 Eumida sanguinea - (Örsted, 1843) P 0 1 0 1 0 0 0 Eupolymnia nebulosa - (Montagu, 1819) DF 0 0 0 0 1 0 0 Eupolymnia nesidensis - (Delle Chiaje, 1828) DF 0 0 0 0 0 0 4 Flabelligera affinis - M. Sars, 1829 DF 0 1 0 0 0 0 0 Harmothoe extenuata - (Grube, 1840) P 0 0 0 0 0 0 1 Harmothoe sp. - Kinberg, 1856 P 0 0 0 4 0 0 0 Hydroides norvegica - Gunnerus, 1768 SF 0 0 0 0 0 0 1 Lanice conchilega - (Pallas, 1766) DF 0 0 0 0 1 0 0 Lepidonotus clava - (Montagu, 1808) P 0 0 0 0 2 0 5 Lepidonotus squamatus - (Linnaeus, 1758) P 0 0 0 0 0 0 2 Malmgrenia sp. - McIntosh, 1874 P 0 0 0 0 1 0 0 Micronereis sp. - Claparède, 1863 DF 0 0 0 4 6 0 2 Micronereis variegata - Claparède, 1863 DF 0 0 1 6 6 0 2 Microspio sp. -

Community, Trophic Structure and Functioning in Two Contrasting Laminaria Hyperborea Forests
1 Estuarine, Coastal and Shelf Science Achimer January 2015, Volume 152, Pages 11-22 http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2014.11.005 http://archimer.ifremer.fr http://archimer.ifremer.fr/doc/00226/33747/ © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved. Community, Trophic Structure and Functioning in two contrasting Laminaria hyperborea forests Leclerc Jean-Charles 1, 2, * , Riera Pascal 1, 2, Laurans Martial 3, Leroux Cedric 1, 4, Lévêque Laurent 1, 4, Davoult Dominique 1, 2 1 Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 6, Station Biologique de Roscoff, Place Georges Teissier, 29680 Roscoff, France 2 CNRS, UMR 7144 AD2M, Station Biologique de Roscoff, Place Georges Teissier, 29680 Roscoff, France 3 IFREMER, Laboratoire de Biologie Halieutique, Centre Bretagne, BP 70,29280 Plouzané, France 4 CNRS, FR 2424, Station Biologique de Roscoff, Place Georges Teissier,29680 Roscoff, France * Corresponding author : Jean-Charles Leclerc, email address : [email protected] Abstract : Worldwide kelp forests have been the focus of several studies concerning ecosystems dysfunction in the past decades. Multifactorial kelp threats have been described and include deforestation due to human impact, cascading effects and climate change. Here, we compared community and trophic structure in two contrasting kelp forests off the coasts of Brittany. One has been harvested five years before sampling and shelters abundant omnivorous predators, almost absent from the other, which has been treated as preserved from kelp harvest. δ15N analyses conducted on the overall communities were linked to the tropho-functional structure of different strata featuring these forests (stipe and holdfast of canopy kelp and rock). Our results yielded site-to-site differences of community and tropho-functional structures across kelp strata, particularly contrasting in terms of biomass on the understorey. -

Atlas De La Faune Marine Invertébrée Du Golfe Normano-Breton. Volume
350 0 010 340 020 030 330 Atlas de la faune 040 320 marine invertébrée du golfe Normano-Breton 050 030 310 330 Volume 7 060 300 060 070 290 300 080 280 090 090 270 270 260 100 250 120 110 240 240 120 150 230 210 130 180 220 Bibliographie, glossaire & index 140 210 150 200 160 190 180 170 Collection Philippe Dautzenberg Philippe Dautzenberg (1849- 1935) est un conchyliologiste belge qui a constitué une collection de 4,5 millions de spécimens de mollusques à coquille de plusieurs régions du monde. Cette collection est conservée au Muséum des sciences naturelles à Bruxelles. Le petit meuble à tiroirs illustré ici est une modeste partie de cette très vaste collection ; il appartient au Muséum national d’Histoire naturelle et est conservé à la Station marine de Dinard. Il regroupe des bivalves et gastéropodes du golfe Normano-Breton essentiellement prélevés au début du XXe siècle et soigneusement référencés. Atlas de la faune marine invertébrée du golfe Normano-Breton Volume 7 Bibliographie, Glossaire & Index Patrick Le Mao, Laurent Godet, Jérôme Fournier, Nicolas Desroy, Franck Gentil, Éric Thiébaut Cartographie : Laurent Pourinet Avec la contribution de : Louis Cabioch, Christian Retière, Paul Chambers © Éditions de la Station biologique de Roscoff ISBN : 9782951802995 Mise en page : Nicole Guyard Dépôt légal : 4ème trimestre 2019 Achevé d’imprimé sur les presses de l’Imprimerie de Bretagne 29600 Morlaix L’édition de cet ouvrage a bénéficié du soutien financier des DREAL Bretagne et Normandie Les auteurs Patrick LE MAO Chercheur à l’Ifremer -

Mollusc Iss 18 Visual 1 09/10/2009 13:52 Page 1
Mollusc iss 20 visual 1:Mollusc iss 18 visual 1 09/10/2009 13:52 Page 1 of the river, grid ref. SE 157654. (01483 761210) from 10:00h prompt until approximately 17:00h FIELD - Saturday 24 October Please note Hilbre is a non-smoking property Nottinghamshire, Sherwood Forest area. Slug contents search Those attending should please bring a 2 Leader: Chris du Feu microscope and lamps (a few microscopes are (01427 848400) (home) available if booked in advance), Petri dishes or Society information In spite of the profusion of visitor centres, country other dishes for sorting purposes, a fine water Society website parks, Major Oak and stately homes, the colour paint brush (00), tweezers/forceps, 3 Sherwood Forest and Dukeries area of dissecting tools, if possible an extension lead Letter from your president Nottinghamshire is not well recorded as far as and/or double electric plug, books to help Bas Payne molluscs are concerned. This visit to the identification, and a packed lunch. Coffee, tea and Thoughts from the Sherwood Forest Country Park aims to lighten biscuits are provided. Mollusc new magazine editor this mollusc-recording black spot. We will give As numbers for the workshop are limited, please Peter Topley particular attention to searching for Malacolimax confirm any booking made by 1 November so that 4 tenellus. This species is known only from two it can be checked whether there are any places other sites in the county - both a few kilometres vacant. Those NOT confirming by 1 November Charles Darwin Aydin ö rstan & Robert T Dillon Jr away, in diametrically opposite directions but still will be taken as not wishing to attend and their within the old forest and parkland area of the place will go to someone else. -

The Importance of Larval Mollusca in the Plankton. by Marie V
335 Downloaded from https://academic.oup.com/icesjms/article/8/3/335/730296 by guest on 01 October 2021 The Importance of Larval Mollusca in the Plankton. By Marie V. Lebour, Marine Biological Association, Plymouth. ITTLE was known about the biology of larval marine molluscs until quite recently, although a fair amount of scattered ' information may be found in the works of various authors, L 1 most of whom dealt with the eggs or newly hatched forms ). Their importance in the economy of the sea is very great. During the last few years the present writer has undertaken researches in the Plymouth Marine Laboratory with the object of investigating the planktonic molluscan larvae, the work so far dealing with the gastropods only. The results are astonishingly interesting, for not only have many elaborately formed and beautiful free-swimming larvae, hitherto unknown or undetermined, been identified with their adults, but many of them are found to occur in such numbers that they must influence considerably the general life of the plankton. They may do this in two ways. (1) They are wholly planktonic feeders and, in the veliger stage, with every movement they are taking into their bodies the nanno-plankton, chiefly diatoms, but also other minute organisms both animal and vegetable, thus competing to a large extent with the other plankton feeders. 1) References to these works are not given. The sign X after a name indicates that the observation is new but still unpublished, O indicating that the observation is not new but has been confirmed by the present writer.