Cassen Sous L'ancien Régime
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'élaboration Du Zonage D'assainissement Eaux Usées Et
Région Nouvelle-Aquitaine Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas, sur l’élaboration du zonage d’assainissement eaux usées et eaux pluviales de la communauté de communes Terres de Chalosse (40) n°MRAe 2020DKNA14 dossier KPP-2019-9160 Décision après examen au cas par cas en application de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ; Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, R. 122-17 et suivants ; Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ; Vu le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ; Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, notamment son article 11 ; Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016, du 17 avril 2018 et des 30 avril, 11 juillet et 26 septembre 2019 portant nomination des membres des Missions Régionales d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; Vu la décision du 16 octobre 2019 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation de compétence aux membres permanents pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées au titre des articles R. -

Porter À Connaissance De L'état À L'échelle De
Rapport Porter à connaissance de l’État à l’échelle de la Communauté de communes du canton de Montfort-en-Chalosse Document établi le 16/11/2015 Direction Départementale des Territoires et de la Mer www.landes.gouv.fr PORTER A CONNAISSANCE du PLUi / PLU de la Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Chalosse Communes de Cassen Nousse Clermont Onard Gamarde-les-Bains Ozourt Garrey Poyanne Gibret Poyartin Goos Préchacq-les-Bains Gousse Saint-Geours-d’Auribat Hinx Saint-Jean-de-Lier Louer Sort-en-Chalosse Lourquen Vicq-d’Auribat Montfort-en-Chalosse Communauté de Communes du canton de Montfort en Chalosse… Document établi le 16 novembre 2015 2/130 Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes Porter à connaissance de l’État Document établi le 16 novembre 2015 Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Chalosse SOMMAIRE 1 Les grands principes du PLU/PLUi....................................................................................6 2 Les services de l’État.........................................................................................................12 2.1 L’État associé à l’élaboration / la révision des PLU/PLUi..............................................12 2.2 Le contrôle de la légalité................................................................................................13 2.3 L’évaluation environnementale (article L. 121-10 du code de l’urbanisme)..................13 3 Le PLU/PLUi........................................................................................................................15 3.1 Le déroulement de la procédure d’élaboration / de révision.........................................15 3.1.1 La délibération de prescription (article L. 123-6 du CU)....................................................................15 3.1.2 Le rôle de l’État (article L. 123-7 du CU)...........................................................................................16 3.1.3 Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables – PADD (article L. -

Candidatures Dpt 40 Moins De 1000 Hab-1
Code du départementLibellé du départementCode communeLibellé communeSexe Nom Prénom Date de NaissanceSortant Nationalité 40 LANDES 3 Angoumé F AUDOUY Véronique 14/12/1960 S Française 40 LANDES 3 Angoumé F BORDES Catherine 10/09/1964 S Française 40 LANDES 3 Angoumé F CAYET Laëtitia 24/12/1972 S Française 40 LANDES 3 Angoumé F DE BARROS Catherine 05/03/1968 S Française 40 LANDES 3 Angoumé F DELMAS Isabelle 07/03/1966 S Française 40 LANDES 3 Angoumé M MAUGEAIS Didier 20/07/1957 Française 40 LANDES 3 Angoumé M NAVARRO Thierry 07/06/1971 Française 40 LANDES 3 Angoumé F PAYSAN Hélène 15/06/1956 S Française 40 LANDES 3 Angoumé M PICARD Vincent 06/10/1971 S Française 40 LANDES 3 Angoumé M PIERRE Maurice 27/05/1948 Française 40 LANDES 3 Angoumé M VERGERON Thierry 21/02/1968 S Française 40 LANDES 5 Arboucave M BIDOT Benjamin 02/06/1983 S Française 40 LANDES 5 Arboucave M BIDOT Mathieu 01/12/1987 Française 40 LANDES 5 Arboucave M BOULIN Baptiste 21/09/1988 Française 40 LANDES 5 Arboucave F DARNAUDERYSylvie 26/05/1968 S Française 40 LANDES 5 Arboucave M DARRIEUTORTDidier 21/02/1961 S Française 40 LANDES 5 Arboucave M DEPOMPS Denis 11/11/1969 Française 40 LANDES 5 Arboucave M FALCOU Dominique 02/08/1966 S Française 40 LANDES 5 Arboucave F KOCHER Leila 19/08/1951 Française 40 LANDES 5 Arboucave M LAFFITTE Jean 10/04/1953 S Française 40 LANDES 5 Arboucave F LAFFITTE Nathalie 28/08/1975 Française 40 LANDES 5 Arboucave F TASTET Marie-Claude 25/11/1955 S Française 40 LANDES 6 Arengosse M DARENGOSSEMichel 11/05/1947 S Française 40 LANDES 6 Arengosse M DESTRUHAUT -
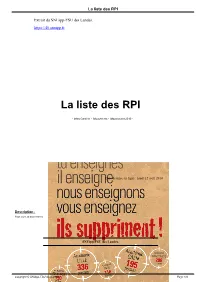
La Liste Des RPI
La liste des RPI Extrait du SNUipp-FSU des Landes. https://40.snuipp.fr La liste des RPI - Infos Carrière - Mouvement - Mouvement 2010 - Date de mise en ligne : lundi 12 avril 2010 Description : Pour aider au mouvement. SNUipp-FSU des Landes. Copyright © SNUipp-FSU des Landes. Page 1/4 La liste des RPI DAX CENTRE LANDES AZUR, MESSANGES, MOLIETS LEVIGNACQ, UZA BEYLONGUE, CARCEN PONSON LESGOR, LALUQUE, TALLER ARENGOSSE,OUSSE SUZAN, ST YAGUEN,VILLENAVE RPC CARCARES, AUDON, GOUTS DAX SUD ADOUR ESTIBEAUX,MOUSCARDES,OSSAGES,TILH MIMBASTE, MISSON ORTHEVIELLE, PORT DE LANNE ORIST, PEY BELUS, ST ETIENNE D'ORTHE ST CRICQ DU GAVE, SORDE L'ABBAYE HASTINGUES, SAMES (64) CANDRESSE, NARROSSE ST VINCENT DE PAUL, TETHIEU HEUGAS, ST PANDELON MONT DE MARSAN HAUTE LANDE BOSTENS,POUYDESSEAUX, STE FOY,GAILLERES BELIS,BROCAS,CANENX,CERE, MAILLERES LUCBARDEZ, SAINT AVIT ARUE, CACHEN, LENCOUACQ BOURRIOT,LOSSE,RETJONS,VIELLE, SOUBIRAN,ST GOR GAREIN,LABRIT,LE SEN,VERT CREON, LABASTIDE LE FRECHE, ST JUSTIN LUXEY, SORE MONT DE MARSAN SUD ARMAGNAC ARTASSENX, BASCONS, BRETAGNE Copyright © SNUipp-FSU des Landes. Page 2/4 La liste des RPI BORDERES, CASTANDET, MAURRIN FARGUES, MONTGAILLARD BOURDALAT,HONTANX,ST GEIN PUJO, SAINT CRICQ VILLENEUVE BOUGUE, LAGLORIEUSE, MAZEROLLES MONT DE MARSAN SUD CHALOSSE AUBAGNAN, BATS, VIELLE TURSAN BRASSEMPOUY, SAINT CRICQ CHALOSSE HORSARRIEU, Ste COLOMBE, SERRES GASTON LACRABE,MANT,MORGANX,PEYRE,MONSEGUR, POUDENX ARSAGUE, BONNEGARDE, CASTEL SARRAZIN CASTAIGNOS, MOMUY, NASSIET BASTENNES,CASTELNAU,DONZACQ,GAUJACQ GAMARDE,GOOS,PRECHACQ GARREY, SORT EN CHALOSSE CASSEN,GOUSSE,LOUER,ONARD,ST GEOURS D'AURIBAT, ST JEAN DE LIER,VICQ D'AURIBAT LAUREDE, POYANNE CAUPENNE,LARBEY,MAYLIS,ST AUBIN HAURIET,MONTAUT,TOULOUZETTE AURICE, CAUNA, LAMOTHE, LE LEUY COUDURES,MONTSOUE,SARRAZIET AUDIGNON,BANOS,DUMES,EYRES MONCUBE MONT DE MARSAN TURSAN ASH PHILONDENX, URGONS PIMBO, SORBETS, MIRAMONT CAZERES, LE VIGNAU LARRIVIERE, RENUNG MIMIZAN PAYS DE BORN BIAS, MEZOS Copyright © SNUipp-FSU des Landes. -

EVS Admin Site
N° CIRCONSCRIPTION ECOLES 1 Mont de Marsan Sud-Chalosse St Pierre du Mont Jules Ferry - Elémentaire 2 Mont de Marsan Sud-Chalosse St Pierre du Mont - Biarnès Maternelle 3 Mont de Marsan Haute Landes Jean Moulin - Mont de Marsan 4 Mimizan Pays de Born Biscarrosse Petit Prince 5 Tyrosse Côte Sud Capbreton 6 Dax Sud-Adour Dax Berre 7 Dax Sud-Adour Dax Les Pins 8 Mimizan Pays de Born Labouheyre (Groupe Scolaire) 9 Mimizan Pays de Born Mimizan Bourg 10 Mont de Marsan Haute Landes Mont de Marsan Argenté 11 Mont de Marsan Haute Landes Mont de Marsan Carboué (Groupe scolaire) 12 Mont de Marsan Haute Landes Mont de Marsan St Jean d'Août (groupe scolaire) 13 Mont de Marsan Sud-Chalosse Montfort Chalosse 14 Mimizan Pays de Born Morcenx Gare 15 Mimizan Pays de Born Parentis Arènes 16 Mont de Marsan Haute Landes Roquefort 17 Tyrosse Côte Sud St Jean de Marsacq 18 Dax Centre Landes St Paul les Dax H. Lavielle 19 Tyrosse Côte Sud Tarnos Poueymidou + Durroty 20 Mont de Marsan Sud-Chalosse Cassen, Gousse,Louer, Onard, St Geours d'Auribat 21 Dax Centre Landes Azur, Messanges, Moliets 22 Dax Centre Landes Laluque, Lesgor, Taller 23 Mont de Marsan Haute-Landes Belis, Brocas, Canenx, Cere, Mailleres 24 Dax Sud-Adour Estibeaux, Mouscardes, Ossages, Tilh 25 Mont de Marsan Haute-Landes Garein, Labrit, Le sen, Vert 26 Mont de Marsan Sud-Chalosse Horsarrieu ,Ste Colombe, Serres Gaston 27 Mont de Marsan Sud-Chalosse Lacrabe, Mant, Monsegur,Morganx, Peyre, Poudenx 28 Tyrosse Cote-Sud Biarrotte, Biaudos, St Laurent de Gosse 29 Dax Sud-Adour Hastingues 30 Mont de Marsan -

Decisión De Ejecución (UE)
7.6.2021 ES Diar io Ofi cial de la Unión Europea L 199 I/1 II (Actos no legislativos) DECISIONES DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/906 DE LA COMISIÓN de 3 de junio de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 4096] (Texto pertinente a efectos del EEE) LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Visto el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (1), y en particular su artículo 259, apartado 1, letra c), Considerando lo siguiente: (1) La gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) es una enfermedad vírica contagiosa de las aves que puede tener consecuencias graves en la rentabilidad de la cría de aves de corral, de manera que el comercio dentro de la Unión y las exportaciones a terceros países se vean perturbados. Los virus de la GAAP pueden infectar a las aves migratorias, que a continuación pueden propagarlos a largas distancias durante sus migraciones de otoño y primavera. Por tanto, la presencia de virus de la GAAP en aves silvestres constituye una amenaza continua de introducción directa e indirecta de estos virus en explotaciones en las que se crían aves de corral u otras aves cautivas. -

LES HÉBERGEMENTS Pour Un Séjour En Immersion Nature Accommodations
LES HÉBERGEMENTS Pour un séjour en immersion nature Accommodations Office de Tourisme 2021 TERRES DE CHALOSSE SOMMAIRE Summary Bienvenue p.2 Welcome Informations p.4 Informations Oui, oui et encore Thermalisme p.6 Thermal cures oui Carte p.7 Map Résidences de tourisme p.8 Tourism residences Hébergement de groupe, hôtels- restaurants p.9 Collective accomodation, hotels and restaurants Camping, aires de camping-car, cabane dans les arbres p.10 Campsite, motorhome areas, tree Bienvenue en Terres de Chalosse house Chambres d'hôtes p.11 Bed and breakfast Welcome in Terres de Chalosse Meublés p.13 Holiday rentals Partenaires p.26 Sponsors OÙ TROUVER TON INFORMATION TOURISTIQUE ? Where to find your tourist information ? Office de Tourisme Bureau d’information touristique L’Office de Tourisme aux thermes Tourism office Tourism office Tourism office at the thermal 55 place Foch 8 rue Vincent Depaul establishment 40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE 40250 MUGRON 1515 avenue des sources 05 58 98 58 50 07 68 06 47 87 40465 PRECHACQ-LES-BAINS D’avril à juin De septembre à De septembre à Juillet-août* octobre** Juillet-août* De mars à novembre*** juin July-August April to june July-August March to november September to june September to october Lundi Fermé 10h-12h30 Fermé Fermé Pot d’accueil à 16h Monday Closed 14h-17h30 Closed Closed (pastis landais et vin) Mardi 10h-12h30 10h-12h30 Point info de 9h à 12h 15h-17h30 14h-17h30 Tuesday 15h-17h30 14h-17h30 (semaine impaire) Mercredi 10h-12h30 10h-12h30 Fermé Fermé * Du 6 juillet au 24 août 2020 Wednesday 15h-17h30 -

Commune 40990 Angoumé 40150 Angresse 40320 Arboucave 40110
Commune 40990 Angoumé 40150 Angresse 40320 Arboucave 40110 Arengosse 40700 Argelos 40430 Argelouse 40110 Arjuzanx 40330 Arsague 40190 Arthez-d'Armagnac 40120 Arue 40700 Aubagnan 40400 Audon 40320 Bahus-Soubiran 40700 Bassercles 40360 Bastennes 40320 Bats 40400 Bégaar 40410 Belhade 40120 Bélis 40300 Bélus 40180 Bénesse-lès-Dax 40230 Bénesse-Maremne 40250 Bergouey 40240 Betbezer-d'Armagnac 40370 Beylongue 40700 Beyries 40390 Biarrotte 40170 Bias 40390 Biaudos 40600 Biscarrosse 40330 Bonnegarde 40370 Boos 40270 Bordères-et-Lamensans 40190 Bourdalat 40330 Brassempouy 40320 Buanes 40120 Cachen 40300 Cagnotte 40430 Callen 40090 Campagne 40090 Canenx-et-Réaut 40400 Carcarès-Sainte-Croix 40400 Carcen-Ponson 40380 Cassen 40330 Castel-Sarrazin 40360 Castelnau-Chalosse 40320 Castelnau-Tursan 40700 Castelner 40500 Cauna 40300 Cauneille 40250 Caupenne 40700 Cazalis 40090 Cère 40320 Classun 40320 Clèdes 40210 Commensacq 40360 Donzacq 40500 Dumes 40210 Escource 40290 Estibeaux 40240 Estigarde 40320 Eugénie-les-Bains 40500 Eyres-Moncube 40500 Fargues 40190 Frêche 40350 Gaas 40090 Gaillères 40420 Garein 40180 Garrey 40110 Garrosse 40160 Gastes 40330 Gaujacq 40320 Geaune 40090 Geloux 40380 Gibret 40180 Goos 40990 Gourbera 40465 Gousse 40400 Gouts 40290 Habas 40700 Hagetmau 40300 Hastingues 40190 Hontanx 40700 Horsarrieu 40230 Josse 40700 Labastide-Chalosse 40300 Labatut 40210 Labouheyre 40320 Lacajunte 40700 Lacrabe 40090 Laglorieuse 40240 Lagrange 40250 Lahosse 40465 Laluque 40250 Lamothe 40270 Larrivière-Saint-Savin 40800 Latrille 40320 Lauret 40550 Léon -

Rythmes Scolaires Des Écoles Du Département Des Landes, Rentrée
Rentrée scolaire 2021/2022 Rythmes scolaires des écoles du Département des Landes Libellé RNE Dénomination Rythmes scolaires Commune AIRE-SUR-L'ADOUR 0400442N ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CLAUDE NOUGARO 4 jours et demi AIRE-SUR-L'ADOUR 0400937B ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE F. GIROUD 4 jours et demi AMOU 0400754C ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours et demi AMOU 0400761K ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi ANGRESSE 0400290Y ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours ARENGOSSE 0400168R ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours ARJUZANX 0400170T ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours ARSAGUE 0400294C ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi ARTASSENX 0401008D ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours ARUE 0400533M ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours et demi AUBAGNAN 0400504F ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi AUDIGNON 0400377T ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours et demi AUREILHAN 0400223A ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours AURICE 0400378U ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours AZUR 0400346J ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours BANOS 0400379V ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi BASCONS 0400491S ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours BASTENNES 0400297F ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi BATS 0400474Y ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MATERNELLE 4 jours et demi BEGAAR 0400735G ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi BELIS 0400523B ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours BELUS 0400328P ECOLE PRIMAIRE 4 jours BENESSE-MAREMNE 0400733E ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE M. GENEVOIX 4 jours BENQUET 0400413G ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours BEYLONGUE 0400232K ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours BIARROTTE -

(EU) 2021/335 of 23 February 2021 Amending the Annex To
25.2.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Uni on L 66/5 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/335 of 23 February 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2020/1809 concerning certain protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2021) 1386) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary checks applicable in intra-Union trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Having regard to Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC (3), and in particular Article 63(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2020/1809 (4) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in holdings where poultry or other captive birds were kept in certain Member States and the establishment of protection and surveillance zones by those Member States in accordance with Council Directive 2005/94/EC. (2) Implementing Decision (EU) 2020/1809 provides that the protection and surveillance zones established by the Member States listed in the Annex to that Implementing Decision, in accordance with Directive 2005/94/EC, are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in that Annex. -

POMMIERS Famille De Métayers, Ayant Habité À Vicq, Laurède Et
POMMIERS Famille de métayers, ayant habité à Vicq, Laurède et Cassen (2 e moitié du XIX e siècle et XX e siècle), originaire de Sames, en pays d’Orthe. A la fin du XVII e siècle, les Pommies sont les maîtres de Lagouarde, à Sames. Plan cadastral de Sames (1817) Au fil du registre paroissial de Sames, nous suivons cinq générations de Pommies à Lagouarde : 1) Jean Pommies et Cécile Dirassen, cités en 1670. 2) Bertrand Pommies (vers 1669-1743) et Marie Petrau (née à Hastingues en 1667), mariés par contrat de mariage du 14 juillet 1689. 1 3) Bernard Pommies (vers 1690-1715) et Jeanne de Pariès (vers 1690-1755), mariés en 1715. 4) Bertrand Pommies (1715-1781) et Marie Dufresne (1718-1785), mariés en 1738. 5) Bertrand Pommies (1740-1813) et Marie Lescastereyres (1758-1783), mariés en 1776. En 1814, Marc Bertrand Pommies (1781-1855) épouse Gracy Dupouy (1787-1835). Le couple occupe successivement plusieurs fermes de Sames avant de s’installer à Bélus à la fin des années 1820. 1 Site Geneanet (source à vérifier). En 1852, leur troisième fils, Marc Pommies (né en 1819) épouse Catherine Fargues, de Vicq. Marc et son fils Pierre Marc dit Henri (1861-1932) vivent à Vicq (1856 à 1861) puis à Audon (1873 à 1892). Henri est métayer à Mant dans le canton d’Hagetmau, en 1895, à Laurède en 1902. Il s’installe à Cassen (Pouyalets) vers 1922-1923. Les alliances Certains de leurs ascendants appartiennent à la bourgeoisie et à la noblesse. A Sames, dans la première moitié du XVIII e siècle, les Pommies se sont alliés aux Pariès . -

Note De Cadrage « Porter a Connaissance » (Contribution Habitat)
Direction départementale des Territoires et de la Mer des Landes Service Aménagement et Habitat Rédacteur : Yann BIVAUD (Adjoint Habitat) SYNDICAT DE LA HAUTE CHALOSSE (COMMUNAUTES DE COMMUNES DES CANTONS DE MUGRON ET DE MONTFORT-EN-CHALOSSE) PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT Élaboration prescrite par délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2015 NOTE DE CADRAGE « PORTER A CONNAISSANCE » (CONTRIBUTION HABITAT) 19/01/2015 Page 1 sur 45 CC du Canton de Mugron : Baigts, Bergouey, Caupenne, Doazit, Hauriet, Lahosse, Larbey, Laurède, Maylis, Mugron, Nerbis, Saint-Aubin, Toulouzette (13 communes). CC du Canton de Montfort-en-Chalosse : Cassen, Clermont, Gamarde-les-Bains, Garrey, Gibret, Goos, Gousse, Hinx, Louer, Lourquen, Montfort-en-Chalose, Nousse, Onard, Ozourt, Poyanne, Poyartin, Préchacq-les-Bains, Saint-Geours-d’Auriabat, Saint-Jean-de-Lier, Sort-en- Chalosse, Vicq-d’Auriabat (21 communes). Page 2 sur 45 1 – Les enjeux en matière d’habitat Situé en Dax et Mont-de-Marsan, le Syndicat de la Haute Chalosse regroupe les intercommunalités de la CC du canton de Mugron et de la CC du canton de Montfort-en-Chalosse. Ces deux intercommunalités, au fort passé historique, patrimonial et économique sont complémentaires. Cette intercommunalité, en outre, bénéficie de l’influence du Grand Dax, dans sa partie ouest du territoire (cette influence se traduit, d’ailleurs, par un accroissement de la démographie et par une dynamique en terme de production de logements). 1.1- Les principaux enjeux de l’État, en matière d’habitat : 1.1.1 – Le parc ancien (la reconquête du (des) centre(s)-ville (s), du (des) bourgs-centre(s)) : lls portent sur le confort du parc existant en le réhabilitant au travers d'opérations visant prioritairement à améliorer la performance énergétique des logements.