Review No. 57
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Policy Notes for the Trump Notes Administration the Washington Institute for Near East Policy ■ 2018 ■ Pn55
TRANSITION 2017 POLICYPOLICY NOTES FOR THE TRUMP NOTES ADMINISTRATION THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY ■ 2018 ■ PN55 TUNISIAN FOREIGN FIGHTERS IN IRAQ AND SYRIA AARON Y. ZELIN Tunisia should really open its embassy in Raqqa, not Damascus. That’s where its people are. —ABU KHALED, AN ISLAMIC STATE SPY1 THE PAST FEW YEARS have seen rising interest in foreign fighting as a general phenomenon and in fighters joining jihadist groups in particular. Tunisians figure disproportionately among the foreign jihadist cohort, yet their ubiquity is somewhat confounding. Why Tunisians? This study aims to bring clarity to this question by examining Tunisia’s foreign fighter networks mobilized to Syria and Iraq since 2011, when insurgencies shook those two countries amid the broader Arab Spring uprisings. ©2018 THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY. ALL RIGHTS RESERVED. THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY ■ NO. 30 ■ JANUARY 2017 AARON Y. ZELIN Along with seeking to determine what motivated Evolution of Tunisian Participation these individuals, it endeavors to reconcile estimated in the Iraq Jihad numbers of Tunisians who actually traveled, who were killed in theater, and who returned home. The find- Although the involvement of Tunisians in foreign jihad ings are based on a wide range of sources in multiple campaigns predates the 2003 Iraq war, that conflict languages as well as data sets created by the author inspired a new generation of recruits whose effects since 2011. Another way of framing the discussion will lasted into the aftermath of the Tunisian revolution. center on Tunisians who participated in the jihad fol- These individuals fought in groups such as Abu Musab lowing the 2003 U.S. -

Stakeholder Report United Nations Human Rights Council Universal
Stakeholder report United Nations Human Rights Council Universal Periodic Review 2019 Libya Freedom of Press- Submitted by the Libyan Center for Freedom of Press Key concerns • Libya’s domestic laws fail to safeguard or guarantee freedom of press in compliance with international human rights laws and standards. • The Libyan state has adopted new laws and regulations that undermine freedom of press and democratic accountability by unjustifiably restricting and criminalising forms of legitimate expression. • State regulation of the press is currently not transparent and lacks any mechanism to ensure its independence or accountability. • Media professionals are actively targeted by militias and armed non-state actors for the nature of their work. The Libyan state has not taken sufficient steps to investigate or prosecute the perpetrators of such offences or better protect the fundamental human rights of media professionals. Introduction 1. The Libyan Center For Freedom Of Press (LCFP) is a Libyan independent organisation established by a group of journalists dedicated to the protection of the freedom of the press and media, the promotion of a free press and the development and capacity building of new young journalists. 2. This report focuses on the most serious concerns and violations related to the right of freedom of expression, as it relates to the press, to be used by the Human Rights Council in its Universal Periodic Review of Libya in 2020. 3. During the last UPR cycle Libya accepted ten recommendations related to freedom of expression and the right of journalists to carry out their work without hindrance.1 However, the Libyan state failed to implement the recommendations and freedom of expression is still hindered and undermined in law and practice. -
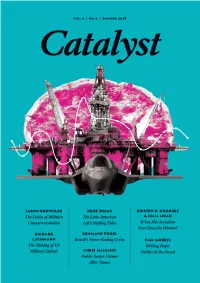
The Limits of Military Counterrevolution
THE LIMITS OF MILITARY COUNTERREVOLUTION jason brownlee merica’s recent wars in South Asia and the Middle East have A inflicted extraordinary physical damage and wreaked seemingly endless havoc. Operations in Afghanistan and Iraq during 2001–2014 totaled $1.6 trillion.1 Once long-term veterans’ care, disability payments, and other economic effects are included, estimates rise to $4–$6 tril- lion.2 Related reports count over one million Americans wounded in Afghanistan and Iraq, in addition to nearly seven thousand killed.3 A conservative tally of local civilian casualties in these countries reaches the hundreds of thousands. Mass destruction has not brought political order to Kabul, Baghdad, or (if one adds the 2011 Libya war) Tripoli. 1 Amy Belasco, The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Opera- tions Since 9/11 (Washington, D.C.: Congressional Research Service, 2014). 2 Neta C Crawford, US Budgetary Costs of Wars through 2016: $4.79 Trillion and Counting (Providence, RI: Watson Institute of International and Public Affairs, Brown University, 2016). 3 Jamie Reno, “VA Stops Releasing Data On Injured Vets as Total Reaches Grim Mile- stone,” International Business Times (2013). http://icasualties.org/ All subsequent data on US casualties in Afghanistan and Iraq come from this source. 151 CATALYST • VOL 2 • №2 Dictatorship has been followed by civil war and interstate conflict among regional powers. These conflagrations present a historic opportunity for correcting US policy, but mainstream critiques have been stunningly myopic. At the peak of government, foreign policy learning remains more self-exculpatory than self-reflective. The cutting-edge diagnosis is that proper “counterinsurgency” requires a more serious political commit- ment than what Washington made in 2001–2016. -

1. the Big Picture Maintained and They Will Continue to Receive Salaries Then Further IS Attack Exposes Gaps in Oil Crescent Security Posture Endorsements Are Likely
THe Government of National Accord (GNA) Has yet to move into Tripoli despite claims by Prime Minister designee, Fayez Seraj, tHeir entry was imminent in a television interview given on Mar 17. Libya Weekly Similar announcements Have been made previously. WHispering Bell is aware of Political Security GNA attempts to negotiate safe entry into tHe capital, and tHat many Tripoli-based Bell Update Whispering Bell militias are gradually supporting tHis, July 30, 2018 albeit not always publicly. If tHe GNA can ensure tHat local militias are consulted prior to entrance, tHeir security role will be 1. The Big Picture maintained and tHey will continue to receive salaries tHen furtHer IS attack exposes gaps in Oil Crescent security posture endorsements are likely. Also, in a positive development for tHe unity THis week was marked by an Islamic Following tHe attack, tHe LNA launched a government leaders claiming to represent State (IS) attack on tHe Al-Aguila police “counter offensive” resulting in tHe deatH various civil groups and local militias from station, located approximately 75 kms of an unknown number of militants in tHe Sabrata, Surman, Ajaylat, Riqdalin and East of Ras Lanuf, in addition to an Wadi Al-Jafr area. Pictures were Al-Jmail reportedly declared tHeir support unidentified drone strike targeting a circulated across social media outlets for tHe GNA. Similarly, Misrata’s farmHouse in Awbari, SoutH of Libya. The purportedly showing tHe bodies of 13 IS Municipality also released a statement latest IS Hit-and-run operation raises attackers. CONTENTS endorsing tHe government. THe UNSMIL concerns over tHe Libyan National Army’s also announced its decisions “to extend (LNA) ability to secure tHe Oil Crescent MeanwHile, multiple veHicles belonging to 1 until 15 June 2016 the mandate...to area after it recently mobilized forces. -

UCLA Law Review Symposium, Entitled Transnational Legal Discourse on Race and Empire
U.C.L.A. Law Review Race and Empire: Legal Theory Within, Through, and Across National Borders E. Tendayi Achiume & Aslı Bâli ABSTRACT In January 2020, we convened the UCLA Law Review Symposium, entitled Transnational Legal Discourse on Race and Empire. In this Article, which also serves as an introduction to the Issue that resulted from the Symposium, we seek to do two things. Our first objective is to situate this Symposium Issue within its broader intellectual context: renewed momentum among Third World Approaches to International Law (TWAIL) scholars to engage Critical Race Theory (CRT) scholars in collaboration aimed at deeper understanding of issues of shared concern. Our second objective, is to offer a concrete example of the insights to be gained from TWAIL-CRT analysis through a brief consideration of the Libyan case, where humanitarian intervention, counterterrorism, and migration control regimes in international law cannot be fully assessed absent engagement with empire and race. Mainstream and official analysis casts the international system and its hegemonic actors in the role of humanitarian responders to a Libyan crisis not of their making. Instead, we draw attention to the ways in which the racial framing of Libya—and its subordination to imperial prerogatives—proved critical to international governance regimes for managing the country—and the bodies and territory within it—from 2011 to the present. AUTHORS E. Tendayi Achiume is Professor of Law at the University of California, Los Angeles School of Law, and a research associate of the African Center for Migration and Society at the University of Witwatersrand in South Africa. -
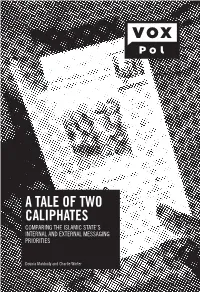
A Tale of Two Caliphates Comparing the Islamic State’S Internal and External Messaging Priorities
A TALE OF TWO CALIPHATES COMPARING THE ISLAMIC STATE’S INTERNAL AND EXTERNAL MESSAGING PRIORITIES Dounia Mahlouly and Charlie Winter A TALE OF TWO CALIPHATES COMPARING THE ISLAMIC STATE’S INTERNAL AND EXTERNAL MESSAGING PRIORITIES About the authors Dr. Dounia Mahlouly is a VOX-Pol postdoctoral Research Fellow at ICSR, King’s College London. She completed her PhD in sociology at the University of Glasgow, where she has been teaching “Introduction to Online Research Methods”. Her thesis investigated the role of social media campaigning in the Tunisian and Egyptian post-revolutionary debates, examining how social media was incorporated into the campaigning strategy of leading political actors competing for power after the 2011 uprisings. She conducted an ethnographic fieldwork in affiliation with the American University in Cairo and contributed to an ESRC cross-country research project co-funded by Google and hosted by the Adam Smith Research Foundation. Dounia is also a part-time research associate for the Open University, where she works as a regional expert for a study commissioned by the British Council and Goethe-Institut in Egypt. Charlie Winter is a Senior Research Fellow at the International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR). He studies terrorism and insurgency with a focus on online and offline strategic communication, and is working on a PhD in War Studies at King’s College London. Alongside his work at ICSR, which is supported by Facebook as part of the Online Civil Courage Initiative, he is an Associate Fellow at the International Centre for Counter-Terrorism in The Hague and an Associate of the Imperial War Museum Institute in London. -
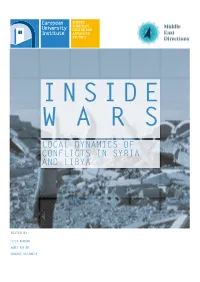
Local Dynamics of Conflicts in Syria and Libya
I N S I D E WARS LOCAL DYNAMICS OF CONFLICTS IN SYRIA AND LIBYA EDITED BY: LUIGI NARBONE AGNÈS FAVIER VIRGINIE COLLOMBIER This work has been published by the European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Middle East Directions. The Middle East Directions Programme encourages and supports multi-disciplinary research on the Middle East region - from Morocco to Iran, Turkey, and the Arabian Peninsula - in collaboration with researchers and research institutions from the region. Via dei Roccettini, 9 – I-50014 San Domenico di Fiesole (FI) – Italy Website: http://middleeastdirections.eu © European University Institute 2016 Editorial matter and selection © editors and responsible principal investigator 2016 Chapters © authors individually 2016 This text may be downloaded only for personal research purposes. Any additional reproduction for other purposes, whether in hard copies or electronically, requires the consent of the author(s), editor(s). If cited or quoted, reference should be made to the full name of the author(s), editor(s), the title, the year and the publisher. INSIDE WARS LOCAL DYNAMICS OF CONFLICTS IN SYRIA AND LIBYA EDITED BY: LUIGI NARBONE AGNÈS FAVIER VIRGINIE COLLOMBIER TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION Luigi Narbone The Local Dynamics of Conflicts in Syria and Libya PART 1. THE SYRIAN CONFLICT Jihad Yazigi Syria’s Implosion: Political and Economic Impacts 1 Agnès Favier Local Governance Dynamics in Opposition-Controlled Areas in Syria 6 Daryous Aldarwish Local Governance under the Democratic Autonomous -

JIHADIST TERRORISM 17 YEARS AFTER 9/11 a Threat Assessment
PETER BERGEN AND DAVID STERMAN JIHADIST TERRORISM 17 YEARS AFTER 9/11 A Threat Assessment SEPTEMBER 2018 About the Author(s) Acknowledgments Peter Bergen is a journalist, documentary producer, The authors would like to thank Wesley Je�eries, John vice president for global studies & fellows at New Luebke, Melissa Salyk-Virk, Daiva Scovil, and Tala Al- America, CNN national security analyst, professor of Shabboot for their research support on this paper. The practice at Arizona State University where he co- authors also thank Alyssa Sims and Albert Ford, who directs the Center on the Future of War, and the co-authored the previous year’s assessment which author or editor of seven books, three of which were forms the basis of much of this report. New York Times bestsellers and four of which were named among the best non-�ction books of the year by The Washington Post. David Sterman is a senior policy analyst at New America and holds a master's degree from Georgetown’s Center for Security Studies. About New America We are dedicated to renewing America by continuing the quest to realize our nation’s highest ideals, honestly confronting the challenges caused by rapid technological and social change, and seizing the opportunities those changes create. About International Security The International Security program aims to provide evidence-based analysis of some of the thorniest questions facing American policymakers and the public. We are focused on South Asia and the Middle East, extremist groups such as ISIS, al Qaeda and allied groups, the proliferation of drones, homeland security, and the activities of U.S. -

Friend and Foe of the Libyan Political Milieu)
Key Social Institutions and Actors of the Libyan Conflict (Friend and Foe of the Libyan Political Milieu) Andrey V. Chuprygin, Senior Lecturer, School of Asian Studies, Faculty of World Economy and International Relations, National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia [email protected] Larisa A. Chuprygina, Senior Lecturer, School of Asian Studies, Faculty of World Economy and International Relations, National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia [email protected] Valeriy A. Matrosov, Lecturer, School of Asian Studies, Faculty of World Economy and International Relations, National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia [email protected] Abstract. Recently, Libyan conflict has become one of the vital elements that determine the development of the geostrategic space in the Middle East and Northern Africa. Meanwhile all the governing mechanisms of this artificial state, the social structure of which still crucially depends on tribes and archaic principles of their interaction, were destroyed. During the Libyan monarchy the social fabric of the country was held together among other factors by the network of Islamic institutions, while in Ghaddafi`s Libya it came down to his personal charisma and the network of his contacts and connections through tribal elders and elites. Since late 2011, there has been an apparent lack of such a factor, on the state level, that could contribute to reunification of the Libyan society or, at least, be used as an impetus for the main actors to compromise. Instead, there are multiple tribes, controlling territories and infrastructure, and numerous militias, controlling the cities, and three governments, each posing as the sole legitimated one. -

How Sirte Became a Hotbed of the Libyan Conflict Sirte: a New Frontline (June 2020) Cover
How Sirte Became a Hotbed of Issue 2021/05 the Libyan Conflict February 2021 Omar Al-Hawari1 Abstract The birthplace and former stronghold of the late Muammar Qadhafi, the coastal city of Sirte, was stigmatised and marginalised following the fall of the regime in October 2011. However, since 2019 it has again become the epicentre of Libya’s domestic and international conflict. How can this sudden change in the strategic importance of the city be explained? Based on numerous interviews with key actors from Sirte and on both warring sides, this paper analyses how the strategic importance of Sirte has evolved since Haftar’s LAAF military offensive on Tripoli in April 2019 and how the city has now become central to the Libyan conflict and its resolution through international diplomatic efforts. Introduction The city of Sirte, located in the middle of the Libyan littoral and at the western edge of the ‘Oil Crescent,’ was the theatre of the final battle of the 2011 civil war, but after being ‘liberated’ by the revolutionary forces in October it faded into the margins of Libya’s transition. The city was military defeated, socially marginalised and politically excluded. However, since 2019 it has again become the epicentre of Libya’s domestic and international conflict. How can this sudden BRIEF change in the strategic importance of the city be explained? The birthplace and former stronghold of the late Muammar Qadhafi, Sirte, and its inhabitants were marginalised and stigmatised following the fall of the regime in October 2011. Left devastated after weeks of shelling and street fighting, the city was still regarded by the new authorities as a stronghold of former regime supporters and the symbol of the ‘defeated’ in the civil war. -
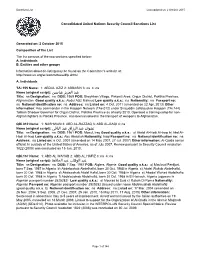
Name (Original Script): ﻦﯿﺳﺎﺒﻋ ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻧﺸﻮان ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﺒﺪ
Sanctions List Last updated on: 2 October 2015 Consolidated United Nations Security Council Sanctions List Generated on: 2 October 2015 Composition of the List The list consists of the two sections specified below: A. Individuals B. Entities and other groups Information about de-listing may be found on the Committee's website at: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml A. Individuals TAi.155 Name: 1: ABDUL AZIZ 2: ABBASIN 3: na 4: na ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺎﺳﯿﻦ :(Name (original script Title: na Designation: na DOB: 1969 POB: Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: Abdul Aziz Mahsud Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 4 Oct. 2011 (amended on 22 Apr. 2013) Other information: Key commander in the Haqqani Network (TAe.012) under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144). Taliban Shadow Governor for Orgun District, Paktika Province as of early 2010. Operated a training camp for non- Afghan fighters in Paktika Province. Has been involved in the transport of weapons to Afghanistan. QDi.012 Name: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: na ﻧﺸﻮان ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ :(Name (original script Title: na Designation: na DOB: 1961 POB: Mosul, Iraq Good quality a.k.a.: a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al- Hadi Al-Iraqi Low quality a.k.a.: Abu Abdallah Nationality: Iraqi Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 6 Oct. 2001 (amended on 14 May 2007, 27 Jul. -

The Wrong Choices of Civilization
The Wrong Choices of Civilization The Wrong Choices of Civilization Carl Denef Acknowledgments This book is dedicated to Maryline who always encouraged me, discussed many aspects of my work and gave me many references. Vincent Denef and Stephen Weeks are acknowledged for critical evaluation of the manuscript. Author: Carl Denef Cover design: Carl Denef (using software of Brave New Books) ISBN: 9789402151640 Second edition © Carl Denef Content Introduction 7 Chapter 1: Climate change sets boundaries to exploitation 11 Chapter 2: A World dominated by capitalism 17 Chapter 3: Social injury from alienation 47 Chapter 4: Social injury from rising inequality 49 Chapter 5: Social injury from violence 65 Chapter 6: Capitalism and war 77 Chapter 7: Demise of capitalism 123 Chapter 8: Towards a social system centred on voluntary human cooperativity, ecosystems and the environment: green anarchism 149 Epilogue 163 5 Even a non-believer should be impressed by the words of Pope Francis in a speech at the World Meeting of Popular Movements in Santa Cruz, Bolivia, in July 2015. “.. the future of humanity does not lie solely in the hands of great leaders, the great powers and the elites. It is fundamentally in the hands of peoples and in their ability to organize. It is in their hands, which can guide with humility and conviction this process of change. … Let us together say from the heart: no family without lodging, no rural worker without land, no laborer without rights, no people without sovereignty, no individual without dignity, no child without childhood, no young person without a future, no elderly person without a venerable old age.” 6 Introduction “The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.