Cahiers D'ethnomusicologie, 14
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Memories of the Origins of Ethnographic Film / Beate Engelbrecht (Ed.)
Contents Preface Beate Engelbrecht IX Introduction 1 The Early Years of Visual Anthropology Paul Hockings 3 The Prehistory of Ethnographic Film Luc de Heusch 15 Precursors in the Documentary Film 23 Robert Flaherty as I Knew Him. R ichard L eacock 2 5 Richard Leacock and the Origins of Direct Cinema: Re-assessing the Idea of an 'Uncontrolled Cinema' Chris tof Decker 31 Grierson Versus Ethnographic Film Brian Winston 49 Research and Record-Making Approaches 57 Recording Social Interaction: Margaret Mead and Gregory Batcson's Contribution to Visual Anthropology in Ethnographic Context Gerald Sullivan 59 From Bushmen to Ju/'Hoansi: A Personal Reflection on the Early Films of John Marshall. Patsy Asch 71 Life By Myth: The Development of Ethnographic Filming in the Work of John Marshall John Bishop 87 Pulling Focus: Timothy Asch Between Filmmaking and Pedagogy Sarah Elder 95 VI Contents Observational and Participatory Approaches 121 Colin Young, Ethnographic Film and the Film Culture of the 1960s David MacDougall 1 23 Colin Young and Running Around With a Camera Judith MacDougall 133 The Origins of Observational Cinema: Conversations with Colin Young Paul Henley 139 Looking for an Indigenous View 163 The Worth/Adair Navajo Experiment - Unanticipated Results and Reactions Richard Chalfen 165 The Legacy of John Collier, Jr. Peter Biella 111 George Stoney: The Johnny Appelseed of Documentary Dorothy Todd Henaut 189 The American Way 205 "Let Me Tell You A Story": Edmund Carpenter as Forerunner in the Anthropology of Visual Media Harald Prins and John Bishop 207 Asen Balikci Films Nanook Paul Hockings 247 Robert Gardner: The Early Years Karl G. -

John Marshall and the Marshall Family Kalahari Project
Beyond Ethnographic Film: John Marshall and the Marshall Family Kalahari Project Carolyn Anderson Professor Emerita, University of Massachusetts American filmmaker John Marshall was a major figure in ethnographic film throughout the second half of the twentieth century; his influence continues into the twentieth-first. Marshall’s career trajectory anticipated and paralleled major shifts in documentary and ethnographic film and challenged notions of the links between the observer and the observed. The mythic narrative style he embraced at the beginning of his career in the early 1950s was soon abandoned for the observational clarity of direct cinema. Recording social interactions in Africa and the United States, Marshall pioneered short “sequence films” in the 1960s, concentrating on long takes, without directorial or editorial modifications. Provoked by the crisis in representation that enveloped anthropology and ethnographic filmmaking, beginning in the late 1970s, his films took a reflexive turn in which the interventions and effects of filming were made explicit. Throughout the last decades of his life, Marshall concentrated on forms of participatory cinema, focusing on collaborative productions driven by the economic and political needs of his subjects. Marshall’s determination to grow as a filmmaker and a world citizen shaped his impact on ethnographic film. When asked the ubiquitous questions of how his filmmaking career began, John Marshall responded, “Well, I started by default” and then told a story that he loved to tell about his father and the family expeditions to Africa.1 It is a remarkable story of the beginnings of what became a remarkable career. John’s father, Laurence Kennedy Marshall, and his mother, Lorna McLean Marshall, both had an interest in anthropology, although neither was a trained anthropologist. -

Liste Représentative Du Patrimoine Culturel Immatériel De L'humanité
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité Date de Date récente proclamation Intitulé officiel Pays d’inscriptio Référence ou première n inscription Al-Ayyala, un art traditionnel du Oman - Émirats spectacle dans le Sultanat d’Oman et 2014 2014 01012 arabes unis aux Émirats arabes unis Al-Zajal, poésie déclamée ou chantée Liban 2014 2014 01000 L’art et le symbolisme traditionnels du kelaghayi, fabrication et port de foulards Azerbaïdjan 2014 2014 00669 en soie pour les femmes L’art traditionnel kazakh du dombra kuï Kazakhstan 2014 2014 00011 L’askiya, l’art de la plaisanterie Ouzbékistan 2014 2014 00011 Le baile chino Chili 2014 2014 00988 Bosnie- La broderie de Zmijanje 2014 2014 00990 Herzégovine Le cante alentejano, chant polyphonique Portugal 2014 2014 01007 de l’Alentejo (sud du Portugal) Le cercle de capoeira Brésil 2014 2014 00892 Le chant traditionnel Arirang dans la République 2014 2014 00914 République populaire démocratique de populaire Date de Date récente proclamation Intitulé officiel Pays d’inscriptio Référence ou première n inscription Corée démocratique de Corée Les chants populaires ví et giặm de Viet Nam 2014 2014 01008 Nghệ Tĩnh Connaissances et savoir-faire traditionnels liés à la fabrication des Kazakhstan - 2014 2014 00998 yourtes kirghizes et kazakhes (habitat Kirghizistan nomade des peuples turciques) La danse rituelle au tambour royal Burundi 2014 2014 00989 Ebru, l’art turc du papier marbré Turquie 2014 2014 00644 La fabrication artisanale traditionnelle d’ustensiles en laiton et en -
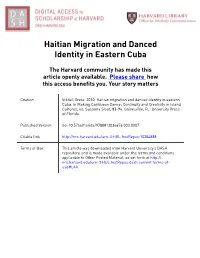
Haitian Migration and Danced Identity in Eastern Cuba
Haitian Migration and Danced Identity in Eastern Cuba The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Viddal, Grete. 2010. Haitian migration and danced identity in eastern Cuba. In Making Caribbean Dance: Continuity and Creativity in Island Cultures, ed. Susanna Sloat, 83-94. Gainesville, FL: University Press of Florida. Published Version doi:10.5744/florida/9780813034676.003.0007 Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:10384888 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA 7 Haitian Migration and Danced Identity in Eastern Cuba Grete Viddal I arrive at Santiago de Cuba’s Teatro Oriente to see a small crowd of locals and tourists waiting outside. We are here to see Ballet Folklórico Cutumba, one of eastern Cuba’s premier folkloric dance troupes. Although the theater is run down and no longer has electricity or running water, its former el- egance is apparent. As we enter, we see that lush but tattered velvet drapes flank the stage and ornate architectural details adorn the walls underneath faded and peeling paint. Light filters in through high windows. As the per- formance starts, women in elaborate ball gowns enter this dusty stage. They must hold up their voluminous skirts to keep yards of fabric from drag- ging on the floor. Men sport white topcoats with tails and matching white cravats. -

An Overview of Russia's Late Mediaeval Musical
Journal of the International Society for Orthodox Church Music Vol. 4 (1), Section II: Conference papers, pp. 183–197 ISSN 2342-1258 https://journal.fi/jisocm An Overview of Russia’s Late Mediaeval Musical Culture, and the “New Repertoires”: Demestvenny, Put and Strochnóe Singing and Notations Nikita Simmons [email protected] Part I. Znamenny Chant and Stolp Notation1 In the primary tradition of Znamenny singing, almost all chant books of the Russian liturgical tradition used Stolp (Znamenny) notation. The Slavonic word stolp (pillar) describes the eight-week cycle of the Octoechos, while the Slavonic term znamya means “mark”, “note”, or “neume”. Slavic Stolp notation (along with early chant repertoire) has been in use since the tenth century (having been derived from Coislin B Palaeobyzantine notation), and in its latest stage of development it is still used by Russian Old Ritualists up to the present time. Beyond the basic level of neume-by-neume notation, Stolp chanting includes three methods of presenting complex melodic features: popévki, litsá and fíty, each of which were traditionally memorized by singers. (Popévki, also called kokízy2, are established sequences of neumes which are the essential “building blocks” of Znamenny chants, while litsa and fity are more lengthy and complex melodic patterns.) These contextual groups of symbols are usually referred to as “múdrye stróki” (“wise lines” or short- hand), indicating the use of “tainozamknénnost” (“secret-closure” or encryption). Stolp chanting, like its Byzantine parent, is organized according to the system of eight Tones, and each Tone (Slavonic: glas) contains a repertoire of popevki, fity and 1 Among the ranks of musicologists who have contributed significantly to the recovery of Russia’s late medieval musical traditions, we are most indebted to М.В. -

From Neumes to Notation: a Thousand Years of Passing on the Music by Charric Van Der Vliet
From Neumes to Notation: A Thousand Years of Passing On the Music by Charric Van der Vliet Classical musicians, in the terminology of the 17th and 18th century musical historians, like to sneer at earlier music as "primitive", "rough", or "uncouth". The fact of the matter is that during the thousand years from 450 AD to about 1450 AD, Western Civilization went from no recording of music at all to a fully formed method of passing on the most intricate polyphony. That is no small achievement. It's attractive, I suppose, to assume the unthinking and barbaric nature of our ancestors, since it implies a certain smugness about "how far we've come." I've always thought that painting your ancestors as stupid was insulting both to them and to yourself. The barest outline of a thousand year journey only hints at the difficulties our medieval ancestors had to face to be musical. This is an attempt at sketching that outline. Each of the sub-headings of this lecture contains material for lifetimes of musical study. It is hoped that outlining this territory may help shape where your own interests will ultimately lie. Neumes: In the beginning, choristers needed reminders as to which way notes went. "That fifth note goes DOWN, George!" This situation was remedied by noting when the movement happened and what direction, above the text, with wavy lines. "Neume" was the adopted term for this. It's a Middle English corruption of the Greek word for breath, "pneuma." Then, to specify note's exact pitch was the next innovation. -

Plainchant Tradition*
Some Observations on the "Germanic" Plainchant Tradition* By Alexander Blachly Anyone examining the various notational systems according to which medieval scribes committed the plainchant repertory to written form must be impressed both by the obvious relatedness of the systems and by their differences. There are three main categories: the neumatic notations from the ninth, tenth, and eleventh centuries (written without a staff and incapable, therefore, of indicating precise pitches);1 the quadratic nota tion in use in Italy, Spain, France, and England-the "Romanic" lands from the twelfth century on (this is the "traditional" plainchant notation, written usually on a four-line staff and found also in most twentieth century printed books, e.g., Liber usualis, Antiphonale monasticum, Graduale Romanum); and the several types of Germanic notation that use a staff but retain many of the features of their neumatic ancestors. The second and third categories descended from the first. The staffless neumatic notations that transmit the Gregorian repertory in ninth-, tenth-, and eleventh-century sources, though unlike one another in some important respects, have long been recognized as transmitting the same corpus of melodies. Indeed, the high degree of concordance between manuscripts that are widely separated by time and place is one of the most remarkable aspects the plainchant tradition. As the oldest method of notating chant we know,2 neumatic notation compels detailed study; and the degree to which the neumatic manuscripts agree not only • I would like to thank Kenneth Levy, Alejandro Plan chart, and Norman Smith for reading this article prior to publication and for making useful suggestions for its improve ment. -

Bulletin of the ICTM Vol
BULLETIN of the INTERNATIONAL COUNCIL for TRADITIONAL MUSIC No. 125, April 2014 ISSN (Online): 2304-4039 Including second notice for the 43rd ICTM World Conference in Astana, Kazakhstan, 2015 CONTENTS From the Secretariat ICTM Study Group on Multipart Music; Calendar of Events Call for Papers: Symposium of the ICTM Message from the Secretary General. Im- Pages 37-38 Study Group on Music and Dance in portant UNESCO Intangible Cultural Heri- Oceania; Preliminary Programme: 4th tage News. Online Membership Directory Recent Publications by ICTM Symposium of the ICTM Study Group on relaunched. An interview with Joseph Han- Members Music and Dance in Southeastern Europe; son Kwabena Nketia. An interview with Call for Papers: 12th Symposium of the Ethnomusicology and Popular Studies; For Trần Văn Khê. ICTM Study Group on Iconography of the the Sake of a Song: Wangga Songmen and Pages 2-8 Performing Arts; News from the British Their Repertories; Music & Mind. 43rd ICTM World Conference in Forum for Ethnomusicology, ICTM UK Page 39 National Committee; Zimbabwean Society Astana, Kazakhstan for Music Research. Appendix: Recent publications by Second Notice and Call for Proposals. Pages 13-22 Cuban scholars Pages 9-12 Announcements — Related Organizations: Catálogo de Instrumentos Musicales: Tomo Call for Papers: 7th International Sympo- Announcements I, Instrumentos Cubanos; Jam Session: la sium on Traditional Polyphony; Taichi Tra- Nueva Generación; Parranda “Los Announcements — ICTM: Programme: 4th ditional Music Award; UNESCO Collection Sánchez”/Parranda de Florencia: Parran- Symposium of the ICTM Study Group on of Traditional Music. deando entre las lomas; Ta makuende yaya: Music of the Turkic-speaking World; Joint Pages 23-25 La fiesta de San Antonio y el Kinfuiti. -

List of the 90 Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage
Albania • Albanian Folk Iso-Polyphony (2005) Algeria • The Ahellil of Gourara (2005) Armenia • The Duduk and its Music (2005) Azerbaijan • Azerbaijani Mugham (2003) List of the 90 Masterpieces Bangladesh • Baul Songs (2005) of the Oral and Belgium • The Carnival of Binche (2003) Intangible Belgium, France Heritage of • Processional Giants and Dragons in Belgium and Humanity France (2005) proclaimed Belize, Guatemala, by UNESCO Honduras, Nicaragua • Language, Dance and Music of the Garifuna (2001) Benin, Nigeria and Tog o • The Oral Heritage of Gelede (2001) Bhutan • The Mask Dance of the Drums from Drametse (2005) Bolivia • The Carnival Oruro (2001) • The Andean Cosmovision of the Kallawaya (2003) Brazil • Oral and Graphic Expressions of the Wajapi (2003) • The Samba de Roda of Recôncavo of Bahia (2005) Bulgaria • The Bistritsa Babi – Archaic Polyphony, Dances and Rituals from the Shoplouk Region (2003) Cambodia • The Royal Ballet of Cambodia (2003) • Sbek Thom, Khmer Shadow Theatre (2005) Central African Republic • The Polyphonic Singing of the Aka Pygmies of Central Africa (2003) China • Kun Qu Opera (2001) • The Guqin and its Music (2003) • The Uyghur Muqam of Xinjiang (2005) Colombia • The Carnival of Barranquilla (2003) • The Cultural Space of Palenque de San Basilio (2005) Costa Rica • Oxherding and Oxcart Traditions in Costa Rica (2005) Côte d’Ivoire • The Gbofe of Afounkaha - the Music of the Transverse Trumps of the Tagbana Community (2001) Cuba • La Tumba Francesa (2003) Czech Republic • Slovácko Verbunk, Recruit Dances (2005) -

Intangible Cultural Heritage 2 EXT COM
Intangible Cultural Heritage 2 EXT COM ITH/08/2.EXT.COM/CONF.201/7 Corr. Paris, 11 February 2008 Distribution limited Original: French UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE Second Extraordinary Session Sofia, Bulgaria, 18 to 22 February 2008 Item 7 of the Provisional Agenda: Formal and procedural conditions concerning the incorporation of items proclaimed “Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity” in the Representative List, notably the Masterpieces present in the territories of States non party to the Convention CORRIGENDUM Paragraph 2 of the annex to Decision 2.EXT.COM 7 should read “This incorporation is enforceable against all States […]” instead of “This incorporation is binding on all States […]”. 1 Intangible Cultural Heritage 2 EXT COM ITH/08/2.EXT.COM/CONF.201/7 Paris, 11 February 2008 Distribution limited Original: French UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE Second Extraordinary Session Sofia, Bulgaria, 18 to 22 February 2008 Item 7 of the Provisional Agenda: Formal and procedural conditions concerning the incorporation of items proclaimed “Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity” in the Representative List, notably the Masterpieces present in the territories of States non party to the Convention Summary In conformity with paragraph 6 of Decision 2.COM 14 taken in Tokyo at the second ordinary session of the Committee, this document presents a proposal relating to formal and procedural conditions concerning the incorporation in the Representative List of items proclaimed “Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity”, notably those present in the territories of States non party to the Convention. -

Editor's Introduction
Studies in Visual Communication Volume 1 Issue 1 Fall 1974 Article 2 1974 Editor's Introduction Sol Worth Recommended Citation Worth, S. (1974). Editor's Introduction. 1 (1), 1-2. Retrieved from https://repository.upenn.edu/svc/vol1/ iss1/2 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/svc/vol1/iss1/2 For more information, please contact [email protected]. Editor's Introduction This contents is available in Studies in Visual Communication: https://repository.upenn.edu/svc/vol1/iss1/2 teachers. It also seemed to be the case that the term "Program in Ethnographic Film" seemed to emphasize r • ~ filmmaking, while both that term and "Visual Anthropol ogy" seemed to exclude people in Sociology, Psychology, Art History, Communication, and other related fields, who were also interested in how man thought of, understood, EDITOR'S INTRODUCTION made, communicated by, and used materials and events that were in the visual mode. Volume One, Number One of a new publication is always The very awkwardness of this new term, The Anthropol . an ambiguous event. On the one hand there is no question ogy of Visual Communication, which we have chosen as the that adding to the unending stream of publications is in itself title of our Society and of our publication, might have one always suspect; on the other hand grown men and women important and salutary effect. It can never be made to roll devote unusual amounts of energy for no economic, and very glibly off the tongue as a description of what one does, or of little social compensation, in order to start, sustain, and whom one is affiliated with. -
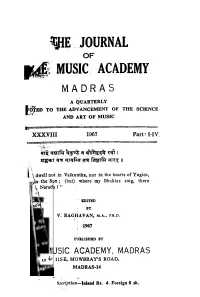
T>HE JOURNAL MUSIC ACADEMY
T>HE JOURNAL OF Y < r f . MUSIC ACADEMY MADRAS A QUARTERLY IrGHTED TO THE ADVANCEMENT OF THE SCIENCE ' AND ART OF MUSIC XXXVIII 1967 Part.' I-IV ir w > \ dwell not in Vaikuntha, nor in the hearts of Yogins, ^n- the Sun; (but) where my Bhaktas sing, there L ^ Narada ! ” ) EDITED BY v. RAGHAVAN, M.A., p h .d . 1967 PUBLISHED BY 1US1C ACADEMY, MADRAS a to to 115-E, MOWBRAY’S ROAD, MADRAS-14 bscription—Inland Rs. 4. Foreign 8 sh. X \ \ !• ADVERTISEMENT CHARGES \ COVER PAGES: Full Page Half Page i BaCk (outside) Rs. 25 Rs. 13 Front (inside) 99 20 .. 11. BaCk (Do.) 30 *# ” J6 INSIDE PAGES: i 1st page (after Cover) 99 18 io Other pages (eaCh) 99 15 .. 9 PreferenCe will be given (o advertisers of musiCal ® instruments and books and other artistic wares. V Special positions and speCial rates on appliCation. t NOTICE All correspondence should be addressed to Dr. V. Ragb Editor, Journal of the MusiC ACademy, Madras-14. Articles on subjects of musiC and dance are accepte publication on the understanding that they are Contributed to the Journal of the MusiC ACademy. f. AIT manuscripts should be legibly written or preferabl; written (double spaced—on one side of the paper only) and be sigoed by the writer (giving his address in full). I The Editor of the Journal is not responsible for tb expressed by individual contributors. AH books, advertisement moneys and cheques du> intended for the Journal should be sent to Dr. V, B Editor. CONTENTS Page T XLth Madras MusiC Conference, 1966 OffiCial Report ..