Mythification Et Démystification De L'histoire Du Pirate La Buse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
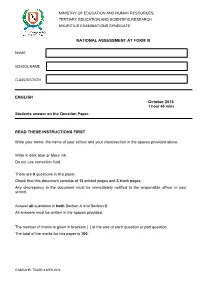
2016 English Form3.Pdf
MINISTRY OF EDUCATION AND HUMAN RESOURCES, TERTIARY EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH MAURITIUS EXAMINATIONS SYNDICATE NATIONAL ASSESSMENT AT FORM III NAME SCHOOL NAME CLASS/SECTION ENGLISH October 2016 1 hour 45 mins Students answer on the Question Paper. READ THESE INSTRUCTIONS FIRST Write your name, the name of your school and your class/section in the spaces provided above. Write in dark blue or black ink. Do not use correction fluid. There are 9 questions in this paper. Check that this document consists of 13 printed pages and 3 blank pages. Any discrepancy in the document must be immediately notified to the responsible officer in your school. Answer all questions in both Section A and Section B. All answers must be written in the spaces provided. The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question. The total of the marks for this paper is 100. © MoE&HR, TE&SR & MES 2016 1 Please turn over this page SECTION A: READING (40 Marks) 1. Read the following text. This is the story of a French pirate who turned to piracy for fun and left behind a mystery – perhaps even a treasure – that lasts to this day. 1 Olivier Levasseur was born in the town of Calais, in northern France, in 1689. His family was wealthy and he was sent to the best schools in France. After receiving an excellent education, he became an officer in the French Navy. During the war of Spanish succession (1701 – 1714), he got his own ship and he became a privateer, someone whose job is to capture enemy ships and keep a percentage of their goods. -
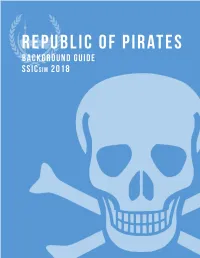
Table of Contents
Table of Contents Welcome from the Dais ……………………………………………………………………… 1 Introduction …………………………………………………………………………………… 2 Background Information ……………………………………………………………………… 3 The Golden Age of Piracy ……………………………………………………………… 3 A Pirate’s Life for Me …………………………………………………………………… 4 The True Pirates ………………………………………………………………………… 4 Pirate Values …………………………………………………………………………… 5 A History of Nassau ……………………………………………………………………… 5 Woodes Rogers ………………………………………………………………………… 8 Outline of Topics ……………………………………………………………………………… 9 Topic One: Fortification of Nassau …………………………………………………… 9 Topic Two: Expulsion of the British Threat …………………………………………… 9 Topic Three: Ensuring the Future of Piracy in the Caribbean ………………………… 10 Character Guides …………………………………………………………………………… 11 Committee Mechanics ……………………………………………………………………… 16 Bibliography ………………………………………………………………………………… 18 1 Welcome from the Dais Dear delegates, My name is Elizabeth Bobbitt, and it is my pleasure to be serving as your director for The Republic of Pirates committee. In this committee, we will be looking at the Golden Age of Piracy, a period of history that has captured the imaginations of writers and filmmakers for decades. People have long been enthralled by the swashbuckling tales of pirates, their fame multiplied by famous books and movies such as Treasure Island, Pirates of the Caribbean, and Peter Pan. But more often than not, these portrayals have been misrepresentations, leading to a multitude of inaccuracies regarding pirates and their lifestyle. This committee seeks to change this. In the late 1710s, nearly all pirates in the Caribbean operated out of the town of Nassau, on the Bahamian island of New Providence. From there, they ravaged shipping lanes and terrorized the Caribbean’s law-abiding citizens, striking fear even into the hearts of the world’s most powerful empires. Eventually, the British had enough, and sent a man to rectify the situation — Woodes Rogers. In just a short while, Rogers was able to oust most of the pirates from Nassau, converting it back into a lawful British colony. -

© 2008 GMT Games, LLC PIRACY, 1660-1720 1
BLACK B EARD : THE GOLDEN AG E OF PIRACY , 1660-1720 1 © 2008 GMT Games, LLC BLACK B EARD : THE GOLDEN AG E OF PIRACY , 1660-1720 2 1 INTRODUCTION Pirate Port Coat Nationality Port Blackbeard is a game for 1–5 players that allows you to recreate the Port Locator # of Arms Color Box Golden Age of Piracy in the 17th-18th centuries. Players maneuver their Pirates around the map, from sea area to sea area and into and out of ports, collecting booty and gaining notoriety in a variety of ways. Players win by having their Pirates become the richest and most notorious of them all, ideally retiring them after long and successful careers at sea. Design Note: Blackbeard is more of a simulation than most Pirate games. However, it is not a detailed, complex simulation like many other games in the hobby. On the other hand, things that happen in Pirate movies and other fictional approaches that rarely—if ever—happened in reality are not included in this game. It is difficult, for example, to find an actual instance of one Pirate attacking another at sea, something that happens in Pirate movies all the time. Note to Players of the original Blackbeard: This new game uses many of the details found in the original Blackbeard (The Avalon Hill Game Company, 1989), but the systems and mechanics for playing those ideas Sea Area Port Merchant At-Sea Sea Area Land are quite different. Do not assume that any rules from the original ver- Separator Ratings Box Box Label Area sion are in this game. -

Black Sails: La Edad De Oro De La Piratería En El Caribe
Facultat de Geografia i Història Treball fi de grau Black Sails: La Edad de Oro de la piratería en el Caribe Sergio López García Carrera de Historia NIUB: 16477646 Tutor: Dr. José Luís Ruíz Peinado Julio, 2017 Sergio López García Black Sails: La Edad de Oro de la piratería en el Caribe Black Sails: La Edad de Oro de la piratería en el Caribe. ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 3-6 2. DEBATE HISTORIOGRÁFICO: LA EDAD DE ORO DE LA PIRATERÍA .......... 6-10 3. CONTEXTO HISTÓRICO: PERIODOS DE LA EDAD DE ORO DE LA PIRATERIA ................................................................................................................................. 10-19 3.1 Periodo de los bucaneros (1650-1688) ................................................... 11-14 3.2 La Ronda del pirata (1690- 1700) ......................................................... 14-16 3.3 El periodo de la Guerra de Sucesión Española y consecuencias (1701-1720) ...... 16-19 4. PERSONAJES HISTÓRICOS ................................................................. 19-32 4.1 Piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros ........................................... 22-28 4.2 Las mujeres piratas ................................................................................. 28-32 5. ISLAS Y REFUGIOS DE LOS PIRATAS .............................................. 32-39 5.1 Saint-Domingue: Isla Tortuga el primer asentamiento pirata ............ 32-36 5.2 New Providence: Nassau y la República -

Game Components Set Up
In February 1678, after a long career of piracy, Henry Morgan cleverly manages to get himself named Governor of Jamaica, charged with driving out pirates and buccaneers! Rather than doing that, he invites all his former “associates” and brothers-in-arms to settle there, where they are able to finally enjoy the fruits of their activities with total impunity. 30 years later, the Great Challenge is organised to celebrate his nomination in true style : a race around the island, at the end of which the winning team is the one having amassed the greatest quantity of gold in its holds. All aboard ! e Action Cards Game components 80 gold doubloons used for paying port 66 action cards in 6 colours,1 colour per player fees and for winning the game ! 1 compass, showing who is Captain for the current round e board 1 gameboard showing Jamaica e race start 45 food tokens, essential for and the race course and end space movement at sea 2 action dice, which determine the level of possible actions e 5 symbols in the corners of the cards and their associated actions : 45 gunpowder tokens, used to increase e navigation box the value of the combat die for the action dice Load gold 1 combat die, used to resolve doubloons sea battles Move ship forwards 9 treasure tokens, used to show whether a Load pirate lair has already been pillaged or not food Move ship 6 ships, one per player backwards Load gunpowder Port space Sea space Pirate lair (golden needle) (white squares) (rock in the shape of a skull) 12 treasure cards, which provide extra powers, gold or cursed treasures.. -

Treasure Island Rules Summary & Reference V1.1
The Esoteric Order of Gamers orderofgamers.com Dedicated to immersive, thematic tabletop games. Rules summaries, foamcore plans, battle reports, interviews, reviews, videos, tutorials – and lots more. Sign up to the monthly newsletter on the website! Follow the VIDEOS TWEETS EsotericOrderGamers @EOGamers EOG and Don’t miss PHOTOS NEWS a Thing! orderofgamers EOGamers SUPPORT ME SO I CAN MAKE MORE GUIDES LIKE THIS ONE! Since 2004, I’ve been supplying tabletop gamers with free high-quality rules summaries — more than 340 of them so far! And the Esoteric Order of Gamers features hundreds of entertaining and informative videos about our excellent hobby. It takes time and money to do this work, and just a few $ a month really does help me do much more. Join the official EOG community – and get bonus rewards too! Please sign up and support me! patreon.com/esotericorder Thankyou! Peter (Universal Head) v1.1 Jul 2020 Game: TREASURE ISLAND Publisher: MATAGOT (2018) Page 1: Rules summary front Page 2: Rules summary back Print on card (ensure you are printing at 100% scale) laminate and trim to size. These sheets are intended only for the personal use of existing owners of the game for additional reference. Universal Head makes no claim whatsoever to the rights of the publisher and copyright holder, and does not benefit financially from these player aids. Artwork from the original game is copyrighted by the publisher and used without permission. This PDF may not be re-posted online, sold or used in any way except for personal use. If you need exceptional quality graphic design Peter ‘Universal Head’ Gifford for your next project, visit universalhead.com The Esoteric Order of Gamers Some hints display a chest icon and are more GAME SEQUENCE advantageous to LJS. -

Annales De Bretagne Et Des Pays De L'ouest, 120-1
Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest Anjou. Maine. Poitou-Charente. Touraine 120-1 | 2013 Varia Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/abpo/2558 DOI : 10.4000/abpo.2558 ISBN : 978-2-7535-2782-9 ISSN : 2108-6443 Éditeur Presses universitaires de Rennes Édition imprimée Date de publication : 30 mars 2013 ISBN : 978-2-7535-2780-5 ISSN : 0399-0826 Référence électronique Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 120-1 | 2013 [En ligne], mis en ligne le 30 mars 2015, consulté le 02 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/abpo/2558 ; DOI:10.4000/abpo.2558 Ce document a été généré automatiquement le 2 mai 2019. © Presses universitaires de Rennes 1 SOMMAIRE Pour une critique de la représentation tridimensionnelle des architectures mégalithiques en Europe occidentale. Méthodes et usages actuels Serge Cassen, Laurent Lescop et Valentin Grimaud Les chanoines de la cathédrale du Mans et le cumul des bénéfices au XIVe siècle (1294-1378) Julien Leloup Le ban et l’arrière-ban de Bretagne : un service féodal à l’épreuve des troubles de religion (vers 1550-vers 1590) Antoine Rivault Les négociants dans les assemblées de la Nation française à Cadix : représentation, assiduité et implication du négoce dans les affaires du Consulat de France (1716-1728) Olivier Le Gouic Le corps de ville à Brest : composition, fonctionnement et rôles (1750-1790) Bruno Baron Les officiers du présidial d’Angers dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : étude sociale Jacques Maillard Résonance d’une « perversion » : tanner la peau humaine en Vendée militaire (1793-1794) Anne Rolland-Boulestreau Comptes rendus Église, cimetière et paroissiens (Éditions Errance, Paris, 2012) Jean-Claude Meuret Histoire des Bretagnes 3 (CRBC-UBO, 2012) Bernard Merdrignac Auray 1364 (Presses Universitaires de Rennes, 2012) Yves Coativy Les origines des Sables-d’Olonne (Geste éditions, 2012) Frédérique Pitou L’Amirauté en Bretagne (PUR, Rennes, coll. -

“Every Man Shall Obey Civil Command”
“Every man shall obey civil Command” 1660 – 1720-luvuilla toimineet poikkeukselliset merirosvoyhteisöt Pro gradu -tutkielma Jyri Lehtonen 12.11.2018 Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Yleinen historia Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty Laitos – Institution – Department Humanistinen tiedekunta Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Tekijä – Författare – Author Jyri Lehtonen Työn nimi – Arbetets titel – Title “Every man shall obey civil Command” 1660 – 1720-luvuilla toimineet poikkeukselliset merirosvoyhteisöt Oppiaine – Läroämne – Subject Yleinen historia Työn laji – Arbetets art – Level Aika – Datum – Month and year Sivumäärä– Sidoantal – Number of pages Pro gradu -tutkielma 12.11.2018 90 + liitteet Tiivistelmä – Referat – Abstract Pro gradu -tutkielmani käsittelee 1660 – 1720-luvuilla toimineiden merirosvoyhteisöjen vallanjakoa ja päätöksentekoprosessia, jotka vaikuttivat heidän laatimien sopimusartikkelien sisältöön. Merirosvoyhteisöt olivat valtiosta riippumattomia itsenäisiä toimijoita, joiden tarkoituksena oli kerätä mahdollisimman paljon ryöstösaalista. Heidän täytyi luoda yhteisön jäsenien kesken yksityiskohtaiset säännöt, jotka kontrolloivat käytöstä ja ryöstösaaliin jakoa, koska purjelaivan operointi vaati sisäistä hierarkiaa ja organisointikykyä. Laajemmassa kontekstissa tutkimuksen käsittelemä aikakausi liittyy kansainvälisen kaupan ja siirtomaavaltojen kehitykseen, jotka loivat merirosvoyhteisölle hetkellisesti -
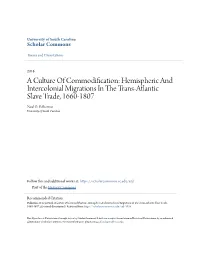
Hemispheric and Intercolonial Migrations in the Rt Ans-Atlantic Slave Trade, 1660-1807 Neal D
University of South Carolina Scholar Commons Theses and Dissertations 2016 A Culture Of Commodification: Hemispheric And Intercolonial Migrations In The rT ans-Atlantic Slave Trade, 1660-1807 Neal D. Polhemus University of South Carolina Follow this and additional works at: https://scholarcommons.sc.edu/etd Part of the History Commons Recommended Citation Polhemus, N. D.(2016). A Culture Of Commodification: Hemispheric And Intercolonial Migrations In The Trans-Atlantic Slave Trade, 1660-1807. (Doctoral dissertation). Retrieved from https://scholarcommons.sc.edu/etd/3934 This Open Access Dissertation is brought to you by Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. A CULTURE OF COMMODIFICATION: HEMISPHERIC AND INTERCOLONIAL MIGRATIONS IN THE TRANS-ATLANTIC SLAVE TRADE, 1660-1807 by Neal D. Polhemus Bachelor of Science College of Charleston, 2003 Master of Arts College of Charleston, 2010 Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Doctor of Philosophy in History College of Arts and Sciences University of South Carolina 2016 Accepted by: Matt D. Childs, Major Professor Daniel Littlefield, Committee Member Woody Holton, Committee Member Josh Grace, Committee Member Cheryl L. Addy, Vice Provost and Dean of the Graduate School © Copyright by Neal D. Polhemus, 2016 All Rights Reserved. ii ACKNOWLEDGEMENTS It has been a long journey to this point, and along the way I have received the assistance of many people. First and foremost, I thank my parents Peter and Jill Polhemus for instilling in me the important values of hard-work, sacrifice and determination. -
Joseph Smith, Captain Kidd Lore, and Treasure-Seeking in New York and New England During the Early Republic
Joseph Smith, Captain Kidd Lore, and Treasure-Seeking in New York and New England during the Early Republic Noel A. Carmack In his 2003 Dialogue article, Ronald V. Huggins discussed the pos- sibility that Joseph Smith’s ostensible encounter with the angel Moroni was the invocation of a long-held folk tradition of treasure guardians in a milieu of treasure seeking and folk magic in the northeast.1 Huggins concluded that “Smith must have learned of the [treasure-guardian] motif while helping his father dig for Kidd’s treasure and while studying Kidd’s life and lore as a boy.”2 Some Latter-day Saint scholars, however, maintain that the figure Moroni was a visiting angel, as has been represented in official LDS accounts.3 Whether or not Moroni was an angel or treasure guardian may be important in determining the derivation of Joseph Smith’s Book of Mormon character and otherworldly messenger, but perhaps more provocative is whether Smith’s two-decades- long encounter with the treasure-seeking worldview had any in- f luence on his role as translator. What did Joseph Smith know about Captain William “Robert” Kidd and other pirates operat- ing in the East Indian Ocean? How would he have obtained such information? This article examines the transmission of tales and published accounts of Captain Kidd (some of which may have been accessible to Joseph Smith) and the possibility that he appro- priated place names that appear in the Book of Mormon and pre-1830 maps, atlases, and geographical texts. Does the Book of 78 Carmack: Joseph Smith, Captain Kidd Lore, and Treasure-Seeking 79 Mormon contain language that might ref lect Smith’s youthful preoccupation with Captain Kidd and his hidden treasure? Scholars have well established that the prevalent use of folk magic and divining practices in New York and the New England states for the search of buried treasure was motivated by Captain Kidd’s legend and other pirate lore. -

Le Lémurien N° 9 Mai 2012 ------Amitié France Madagascar
Le Lémurien n° 9 Mai 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amitié France Madagascar Association de solidarité internationale Le Lémurien N° 9 Mai 2012 É d i t o r i a l Rien de nouveau ni rien en vue à l’horizon de la triste situation écono- AGENDA 2012 - 2013 mique et politique de nos amis de Madagascar. C’est vrai que nous n’avons pas 12 au 21 mai : Foire de Bordeaux le droit de parler politique dans un pays qui n’est pas le nôtre mais nous som- mes bien obligés de constater que leurs misères sont toujours là. 13 mai : Vide-greniers à Gradignan Je pense que l’heure arrive de tourner une grande page de notre déjà 26 mai : Marché africain à Pessac longue histoire avec nos amis frères. 22 mai au 3 juin : Mission de six per- Pour le moment nous ne pouvons plus rien pour le dispensaire. D’une sonnes à Madagascar part, parce que nous ne pouvons pas leur envoyer de médicaments puisque 17 juin : Vide-greniers à Madran (Pes- l’Europe nous l’interdit, d’autre part les infrastructures sont bien en place mais sac) il nous manque les moyens financiers pour pouvoir acheter les médicaments 27 octobre 2012 : Loto à Gazinet (20 h, nécessaires sur place. salle des fêtes). Il est bien évident qu’en cas d’urgence nous interviendrons dans la me- 30 novembre : Repas annuel, (20 h, sure de nos possibilités à condition qu’ils nous appellent. Il est grand temps de nous consacrer entièrement au village d’Ambato- salle des Sources) lampikely, à ses habitants et à leurs enfants. -

Dictionnaire Des Corsaires Et Des Pirates Ouvrage Publié Sous La Responsabilité Éditoriale De Guy Stavridès
Barbaresques, boucaniers, flibustiers, guerres de course, abor- dages, razzias, butins, partages de prises, chasses au trésor, canonnades… Corsaires et pirates jalonnent de leurs exploits la vie maritime et peuplent notre imaginaire. Voici le premier dictionnaire historique sur ces aventuriers des mers : près de 600 entrées, une œuvre monumentale, les meilleurs spécia- listes pour faire revivre ces personnages hauts en couleur, des plus emblématiques comme Drake, Jean Bart, Surcouf, Duguay-Trouin, Dragut, Barberousse, aux oubliés de l’his- toire ainsi qu’aux discrets mais indispensables armateurs. Un voyage dans le temps et à travers les océans où sont visités les principaux lieux associés à la course et à la piraterie, d’Alger aux Caraïbes, en passant par Boston, La Rochelle, Dunkerque, Salé, Saint-Malo jusqu’au golfe d’Aden, Sainte-Marie de Mada- gascar et les eaux de l’Asie du Sud-Est. Spécialiste des économies maritimes et sociétés littorales en Méditerranée à l’époque moderne, Gil- bert Buti est professeur d’histoire à Aix-Marseille Université et chercheur à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (TELEMME-Aix-en-Provence). Maître de conférences en histoire à l’université de Bretagne-Sud (Lorient) et chercheur au CERHIO- Lorient, Philippe Hrodej est spécialiste de l’histoire du commerce colonial et des flibustiers à l’époque moderne. Dictionnaire des corsaires et des pirates Ouvrage publié sous la responsabilité éditoriale de Guy Stavridès CONCEPTION : BLEU T © CNRS ÉDITIONS, PARIS, 2013 Dictionnaire des corsaires et des pirates Sous la direction de Gilbert Buti et Philippe Hrodej CNRS EDITIONS 15, rue Malebranche – 75005 Paris Sommaire Cartes ..............................................................................................