Le Calvinisme À Jametz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pays De Montmédy Portes Du Luxembourg Pays De Stenay / Val
/ SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 Quincy-Landzécourt : Visite libre de l'église Saint-Martin De 10h à 17h Église 03 29 80 15 90 SEPTEMBRE 2019 Stenay : Visite libre du musée de la bière CONTACTS La Ferté-sur-Chiers : Visite guidée de l'ouvrage de Villy-La-Ferté De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Musée 03 29 80 68 78 10h30, 14h et 16h Ouvrage de Villy-La-Ferté 03 24 29 79 91 Stenay : Activité libre "Musée zoomé" au musée de la bière Liny-devant-Dun : Visite libre de l'église Saint-Julien, accès au De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 Musée 03 29 80 68 78 Office de tourisme du Pays de Montmédy clocher et exposition de photos anciennes du village De 13h30 à 18h Église 06 11 18 70 48 Thonne-la-Long : Visite libre de l'église et de son horloge Lepaute Postez et partagez vos photos des 2 rue de l'Hôtel de ville 55600 Montmédy De 9h à 18h Église 03 29 80 15 90 Journées européennes du patrimoine Tél. +33 (0)3 29 80 15 90 Louppy-sur-Loison : Visites guidées des extérieurs du château sur nos réseaux sociaux [email protected] renaissance (6€/personne dès 18 ans) Thonne-le-Thil : Visite guidée du Bloc B7 - Prévoir une lampe - 1€/pers. www.tourisme-paysdemontmedy.fr De 8h à 18h Fléchage depuis Thonne-le-Thil 03 29 80 15 90 Facebook et Instagram avec la mention 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h Rue de la Porte Haute 03 29 80 15 90 Office de tourisme transfrontalier #journeesdupatrimoine suivi de ArdenneMeuse. -

ZRP Meuse Au 26 Oct 2020
INSEE NOM DEPT COMMUNE ZONE A RISQUE PARTICULIER / IA COM MEUSE 55008 AMEL-SUR-L’ETANG LA WOEVRE MEUSE 55010 ANCERVILLE CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55011 ANDERNAY ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55012 APREMONT-LA-FORET LA WOEVRE MEUSE 55017 AUTRECOURT-SUR-AIRE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55021 AVILLERS-SAINTE-CROIX LA WOEVRE MEUSE 55024 AZANNES-ET-SOUMAZANNES LA WOEVRE MEUSE 55031 BAUDONVILLIERS CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55038 BEAULIEU-EN-ARGONNE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55039 BEAUMONT-EN-VERDUNOIS LA WOEVRE MEUSE 55046 BENEY-EN-WOEVRE LA WOEVRE MEUSE 55049 BEUREY-SUR-SAULX CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55053 BILLY-SOUS-MANGIENNES LA WOEVRE MEUSE 55058 BONCOURT-SUR-MEUSE LA WOEVRE MEUSE 55062 BOUCONVILLE-SUR-MADT LA WOEVRE MEUSE 55069 BRABANT-LE-ROI ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55070 BRABANT-SUR-MEUSE LA WOEVRE MEUSE 55076 BREHEVILLE LA WOEVRE MEUSE 55081 BRIZEAUX ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55085 BROUSSEY-RAULECOURT LA WOEVRE MEUSE 55093 BUXIERES-SOUS-LES-COTES LA WOEVRE MEUSE 55096 CHAILLON LA WOEVRE MEUSE 55101 CHARDOGNE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55107 CHAUMONT-DEVANT-DAMVILLERS LA WOEVRE MEUSE 55117 CLERMONT-EN-ARGONNE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55123 LES HAUTS-DE-CHEE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55124 CONSENVOYE LA WOEVRE MEUSE 55125 CONTRISSON ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55132 COUSANCES-LES-FORGES CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55134 COUVONGES CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55145 DAMVILLERS -
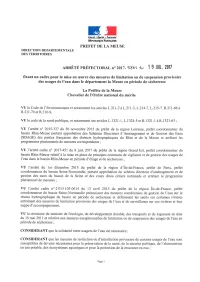
Arrêté Cadre Secheresse 2017
Page 1 Annexe 2 – Répartition des communes par zones d’alerte Zone d’alerte 1 : Aisne amont 55014 AUBREVILLE 55285 LAVOYE 55017 AUTRECOURT-SUR-AIRE 55116 LE CLAON 55023 AVOCOURT 55379 LE NEUFOUR 55032 BAUDREMONT 55253 LES ISLETTES 55033 BAULNY 55497 LES SOUHESMES-RAMPONT 55038 BEAULIEU-EN-ARGONNE 55254 LES TROIS-DOMAINES 55040 BEAUSITE 55289 LEVONCOURT 55044 BELRAIN 55290 LIGNIERES-SUR-AIRE 55065 BOUREUILLES 55295 LISLE-EN-BARROIS 55068 BRABANT-EN-ARGONNE 55301 LONGCHAMPS-SUR-AIRE 55081 BRIZEAUX 55343 MONTBLAINVILLE 55082 BROCOURT-EN-ARGONNE 55346 MONTFAUCON-D'ARGONNE 55103 CHARPENTRY 55380 NEUVILLE-EN-VERDUNOIS 55108 CHAUMONT-SUR-AIRE 55383 NEUVILLY-EN-ARGONNE 55113 CHEPPY 55384 NICEY-SUR-AIRE 55117 CLERMONT-EN-ARGONNE 55389 NUBECOURT 55128 COURCELLES-SUR-AIRE 55395 OSCHES 55129 COUROUVRE 55404 PIERREFITTE-SUR-AIRE 55518 COUSANCES-LES-TRICONVILLE 55409 PRETZ-EN-ARGONNE 55141 DAGONVILLE 55442 RAIVAL 55155 DOMBASLE-EN-ARGONNE 55416 RARECOURT 55174 EPINONVILLE 55419 RECICOURT 55175 ERIZE-LA-BRULEE 55446 RUMONT 55177 ERIZE-LA-PETITE 55453 SAINT-ANDRE-EN-BARROIS 55178 ERIZE-SAINT-DIZIER 55454 SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 55179 ERNEVILLE-AUX-BOIS 55000 SEIGNEULLES 55185 EVRES 55517 SEUIL-D'ARGONNE 55194 FOUCAUCOURT-SUR-THABAS 55498 SOUILLY 55199 FROIDOS 55525 VADELAINCOURT 55202 FUTEAU 55527 VARENNES-EN-ARGONNE 55208 GESNES-EN-ARGONNE 55532 VAUBECOURT 55210 GIMECOURT 55536 VAUQUOIS 55251 IPPECOURT 55549 VERY 55257 JOUY-EN-ARGONNE 55555 VILLE-DEVANT-BELRAIN 55260 JULVECOURT 55567 VILLE-SUR-COUSANCES 55266 LACHALADE 55570 VILLOTTE-SUR-AIRE 55282 LAVALLEE -

Règlement Intérieur AAPPMA « L’ETOILE DE MONTMEDY » Année 2021
Règlement intérieur AAPPMA « L’ETOILE DE MONTMEDY » Année 2021 Dépositaire des cartes internet avec règlementation : Bar l’Excelsior, Rue du Luxembourg MONTMEDY La MFR de DAMVILLERS, 4 AV de VERDUN 55150 DAMVILLERS Chez MAMY, 12 Rue du Fort Poulet DAMVILLERS Prendre sa carte, c’est de respecter le règlement intérieur de l’AAPPMA Responsables Gardes adhérents à l’ADGPP55 M. Olivier HENRY Président Tel : 06.32.70.09.40 M. Christophe DIDIER Tel : 06.33.91.99.51 M. Fabien CELESKI Vice-président Tel : 06.32.77.04.19 M. Tom RAFFI Tel :06.15.20.45.64 M. Jean-François PETITPAS Trésorier Tel : 06.74.06.94.66 M. Sébastien BOBECZKO Tel : 06.74.12.19.09 M. Théo HENRY Secrétaire Tel : 06.37.64.38.76 Obligation d’être titulaire d’une carte de l’AAPPMA de l’Etoile de Montmédy ou de l'URNE. Ouverture et fermeture : voir dates selon réglementation départementale. Pèche autorisée les Dimanches, Mercredis et jours fériés ainsi que le samedi de l’ouverture. Taille minimale des truites : 30 cm limitation à 3 truites/jour LOTS DE PECHE 1ère CATEGORIE : REGLEMENTATION LE CHABOT : du territoire d’Iré-le-sec jusqu’à son confluent avec la CHIERS (6,5 km de rivière) LA THONNE : sortie de Thonnelle au pont 800m en amont rive gauche. Parcours NO KILL TRUITES sur la THONNE voir réglementation affichée sur site. Le ruisseau SAULE GILLET qui se jette dans la THONNE est en RESERVE CLASSEE (pèche strictement interdite) BALLASTIERES : voir la réglementation sur la page face book ou sur le site des ballastières de Damvillers ème LOTS DE PECHE 2 CATEGORIE REGLEMENTATION Obligation d’être titulaire d’une carte de l’AAPPMA de l’Etoile de Montmédy ou de l'URNE. -

History of the 324Th Field Artille United States Army J 4" 0 Ttq. Ashburn
CO L O N E L T S O O O O 9 9 1 . Q . A H B U R N C TE DE T A L U CT BE R T H 1 8 , , , — a M e h 324 . E of the e N o f e th e lac e f t e th . st us , orth V rdun p rom which F A “ ” a a k M i a o s e d tt c ed ollv lle F a rm . Two obs e rvation b ll on w re shot own by Boche a irpl ane s while he w a s e ating this simple meal HI ST O R Y O F T HE 324 th FI E L D A R T I L L E U N I T E D S T A T E S A R M Y J 4" 0 TT SHB RN Q . A U O LONE L 394 m F . A . C , A , U s LI EU TENANT CO LO NEL. RE GU LAR ARMY" NE W YO RK GE O R E H D A MPA Y G . OR N CO N “ Q M k o fl DE DICATE D TO M Y C O M R A D E S I N A R M S OF THE 324th F. A.. U . s. A . ESPECIALLY TO THOSE O F THE R EGIMENT W HO SLEEP BENEATH THE BLOOD-STAINED FI ELDS OF FRANCE T . Q. A. PAGE U NITED STATES U NITED STATES I L L U ST RA T I O N S PAGE T . -

Page 1 G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN
G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1 . FEBRUAR 1964 AUSGABE IN DEUTSCHER SPRACHE 7. JAHRGANG Nr. 18 INHALT EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT VERORDNUNGEN Verordnung Nr . 7/64/EWG der Kommission vom 29 . Januar 1964 zur Fest legung der Liste der Gemeinden innerhalb der beiderseits der gemeinsamen Grenze zwischen Frankreich und den angrenzenden Mitgliedstaaten fest gelegten Grenzzonen 297/64 Anlage : I. Französisch-belgisches Grenzgebiet : A. Belgische Gemeinden 298/64 B. Französische Gemeinden 304/64 II . Französisch-luxemburgisches Grenzgebiet : A. Luxemburgische Gemeinden 314/64 B. Französische Gemeinden 314/64 III . Französisch-deutsches Grenzgebiet : A. Deutsche Gemeinden 317/64 B. Französische Gemeinden 322/64 IV. Französisch-italienisches Grenzgebiet : A. Italienische Gemeinden 330/64 B. Französische Gemeinden 331/64 3 8083 * — STUDIEN — REIHE ÜBERSEEISCHE ENTWICKLUNGSFRAGEN Nr. 1/1963 — Der Kaffee-, Kakao- und Bananenmarkt der EWG Die im Auftrag der Kommission entstandene Arbeit stammt vom ,, Inra Europe Marketing Research Institute", einem Zusammenschluß verschiedener Forschungs institute des EWG-Raums (Divo-Frankfurt , NSvS-Den Haag, Sema-Paris , Sirme Mailand, Sobemap-Brüssel), und gibt einen Überblick über die augenblickliche Marktlage sowie die voraussichtliche Entwicklung der nächsten Jahre . Die Erzeugnisse, die hier behandelt werden, Kaffee, Kakao, Bananen, stellen einen großen Teil der Exporterlöse der Entwicklungsländer . Die Kommission hat sich entschlossen, diese Arbeit zu veröffentlichen , da sie glaubt, daß sie für öffentliche wie private Stellen in der EWG und den assoziierten Staaten von einigem Interesse sein dürfte. Der Bericht behandelt Einfuhr und Durchfuhr, Verarbeitung, Absatz und Preis bildung und die Ergebnisse einer Verbraucher-Umfrage . Ein Ausblick auf die Ver brauchsentwicklung bis 1970 beschließt das Ganze . Das Werk (226 Seiten , 50 Diagramme) ist in den vier Sprachen der Gemeinschaft erschienen . -

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 Sur 111
21 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 111 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2014-166 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Meuse NOR : INTA1401593D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ; Vu le décret no 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble le I de l’article 71 du décret no 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu la délibération du conseil général de la Meuse en date du 18 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er.−Le département de la Meuse comprend dix-sept cantons : – canton no 1 (Ancerville) ; – canton no 2 (Bar-le-Duc-1) ; – canton no 3 (Bar-le-Duc-2) ; – canton no 4 (Belleville-sur-Meuse) ; – canton no 5 (Bouligny) ; – canton no 6 (Clermont-en-Argonne) ; – canton no 7 (Commercy) ; – canton no 8 (Dieue-sur-Meuse) ; – canton no 9 (Etain) ; – canton no 10 (Ligny-en-Barrois) ; – canton no 11 (Montmédy) ; – canton no 12 (Revigny-sur-Ornain) ; – canton no 13 (Saint-Mihiel) ; – canton no 14 (Stenay) ; – canton no 15 (Vaucouleurs) ; – canton no 16 (Verdun-1) ; – canton no 17 (Verdun-2). -

Mise En Page
LES DOCUMENTS D'URBANISME APPROUVES Breux Moulis 07 avril 2015 Saint Hubert Thonne le Thil Avioth Thonne la Long Autréville Olizy St Lambert Inor sur Chiers Thonnelle Verneuil Lamouilly Chauvency Petit Pouilly Direction Saint Hubert Ecouviez sur Martincourt Nepvant Thonne Verneuil Meuse sur les Près Grand Départementale des Luzy Meuse Brouennes St Martin Chauvency Territoires le Château Vigneul Villécloye sous Montmédy de la Meuse Cesse Montmédy Bazeilles Laneuville sur Meuse Stenay Velosne Quincy sur Othain Landzécourt Han 12 11 lès Juvigny 11 Flassigny Beaufort Baâlon Iré le Sec en Argonne Juvigny Beauclair Wiseppe sur Loison Remoiville Halles Mouzay Marville sous les Saulmory Louppy Côtes et sur Villefranche Loison Jametz Arrancy Montigny Rupt Lion sur devant sur Sassey devant Dun Delut Crusnes Sassey Murvaux Othain Sorbey Mont sur devant Sassey Meuse Brandeville Saint Laurent Villers Milly sur Othain Rouvrois devant Dun Dombras sur sur Bradon Murvaux Bréhéville Vittarville Othain Saint Doulcon Pierrevillers Dun Pillon Merles sur Meuse Lissey sur Peuvillers Villers Nouillonpont Aincreville Cléry Fontaines Loison les Duzey14 10le St Clair Cléry Ecurey en Verdunois Mangiennes Petit Liny Sivry le Grand devant sur Meuse Bantheville Reville aux Bois Mangiennes Dun Damvillers Muzeray Spincourt 13 Billy Romagne sous Vilosnes Etraye Cunel Brieulles Haraumont sous les côtes Mangiennes Romagne Sivry sur Meuse Wavrille sous sur Vaudoncourt Montfaucon Meuse Chaumont 25 Dvt Damvillers Azannes Loison Domremy Moirey Gouraincourtla Canne Gesnes Dannevoux -

2020DKGE52 La Mission Régionale D’Autorité Environnementale Grand Est
Grand Est Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet d’élaboration des zonages d’assainissement des communes d’Avioth, de Bazeille-sur-Othain, de Breux, de Chauvency-le-Château, de Chauvency-Saint-Hubert, d’Ecouviez, de Flassigny, de Han-lès-Juvigny, d’Iré-le-Sec, de Jametz, de Juvigny-sur-Loison, de Louppy-sur-Loison, de Montmédy, de Quincy-Landzécourt, de Remoiville, de Thonne-la-Long, de Thonne-le-Thil, de Thonne-les-Près, de Thonnelle, de Velosnes, de Verneuil-Grand, de Verneuil-Petit, de Bigneul-sous-Montmédy et Villécloye (55), porté par la Communauté de communes du Pays de Montmédy n°MRAe 2020DKGE52 La Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-4, R.122-17 et R.122-18 ; Vu le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ; Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, notamment son article 11 ; Vu les arrêtés ministériels des 19 décembre 2016, 15 décembre 2017 et 30 avril 2019, portant nomination des membres de la Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est ; Vu la décision du 26 mai 2016 de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est donnant délégation à son président pour certaines décisions -

Les Marches De Meuse Houblon Et Fortifications Assemblage Des Étapes Randonnée À VTT, À Cheval Et À Pied
Les Marches de Meuse Houblon et fortifications Assemblage des étapes Randonnée à VTT, à cheval et à pied Montmédy Stenay Beauclair Charmois Marville Halles-sous- les-Côtes Dun-sur- Meuse Écurey-en- Doulcon verdunois Damvillers Balisage à suivre : Moirey Ce circuit aux Marches de Meuse vous emmène au pays du houblon et des fortifications. Ce houblon, ingrédient indispensable de la bière, vous le découvrez au Musée Européen de la Bière de Stenay. Vous en apprécierez la qualité en dégustant une bière brassée localement : la Charmoy. Ces fortifications, signe que ce pays est une terre de frontière : - La citadelle de Montmédy. - Les châteaux de Charmois dont l’un héberge la brasserie de ... Charmoy. - Le château d’Imécourt à Louppy sur Loison qui accueillit Louis XIV en 1657. - Les vestiges de la citadelle de Jametz où les troupeaux paissent paisiblement. Et voir aussi le charme de la citée espagnole de Marville. Montmédy ©JM Lecomte Les itinéraires de randonnée pédestre connus sous le nom de « GRP », jalonnés de marques jaune rouge, sont une création de la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de la propriété intellectuelle. Les marques utilisées sont déposées à l’INPI. ©FFRandonnée. Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le Comité régional de la randonnée pédestre de Lorraine (Courriel : [email protected], Tél. : 03 83 18 87 36.) Les Marches de Meuse Houblon et fortifications 1ère étape - 20 kilomètres www.tourisme-meuse.com Stenay / Montmédy pied à 1 Stenay Départ de Stenay, Sathanagium en 714. Plus tard, une tête de Satan a pris place dans les armoiries de la Ville. -

0 CC Du Pays De Montmédy 0 Foncier Portrait
Communes membres : 0 Export_PDF de toutes les fiches A3 EPCI ortrait P Foncier CC du Pays de Avioth, Bazeilles-sur-Othain, Breux, Chauvency-le-Château, Chauvency-Saint- Hubert, Écouviez, Flassigny, Han-lès-Juvigny, Iré-le-Sec, Jametz, Juvigny-sur-Loison, Louppy-sur-Loison, Marville, Montmédy, Quincy-Landzécourt, Remoiville, Thonne- Montmédy la-Long, Thonne-le-Thil, Thonne-les-Près, Thonnelle, Velosnes, Verneuil-Grand, Verneuil-Petit, Vigneul-sous-Montmédy, Villécloye 0 Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement GRAND EST SAER / Mission Foncier Novembre 2019 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ 0 CC du Pays de Montmédy Périmètre Communes membres 01/2019 25 ( Meuse : 25) Surface de l'EPCI (km²) 244,48 Dépt Meuse Densité (hab/km²) en 2016 EPCI 29 Poids dans la ZE Longwy*(91%) Verdun(9%) ZE 117 Pop EPCI dans la ZE Longwy(5,8%) Verdun(1%) Grand Est 96 * ZE de comparaison dans le portrait Population 2011 7 462 2016 7 190 Évolution 2006 - 2011 65 hab/an Évolution 2011 - 2016 -54 hab/an 10 communes les plus peuplées (2016) Montmédy 2 178 30,3% Écouviez 506 7,0% 0 Marville 497 6,9% Thonne-la-Long 326 4,5% Thonne-le-Thil 268 3,7% Villécloye 266 3,7% Juvigny-sur-Loison 264 3,7% Breux 257 3,6% Jametz 255 3,5% Chauvency-le-Château 249 3,5% Données de cadrage Évolution de la population CC du Pays de Montmédy Pays CC du Evolution de la population depuis 1968 Composante de l'évolution de la population en base 100 en 1962 de 2011 à 2016 (%) 120 4% 110 2,3% 2,3% 2% 0,9% 1,1% 100 0,0% 0,1% 0,3% 0% 90 -2% -0,8% -

Avis Sur Le Projet De Centrale Solaire Photovoltaïque Implantée
Grand Est Avis sur le projet de centrale solaire photovoltaïque implantée dans l’ancienne base aérienne de Marville (55) n°MRAe 2018APGE29 Nom du pétitionnaire SAS Pays de Montmédy Solaire Communes Marville, Iré-le-Sec et Jametz Département Meuse (55) 14 permis de construire pour la réalisation du projet de centrale solaire Objet de la demande photovoltaïque Accusé de réception des 14/02/18 dossiers : Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est 1/8 Préambule relatif à l’élaboration de l’avis En application de la directive européenne sur l’évaluation environnementale des projets, tous les projets soumis à évaluation environnementale, comprenant notamment la production d’une étude d’impact, en application de l’article R.122-2 du code de l’environnement, font l’objet d’un avis d’une « autorité environnementale » désignée par la réglementation. Cet avis est mis à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. En ce qui concerne le projet de centrale photovoltaïque à Marville, Iré-le-Sec et Jametz (55), à la suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région comme autorité environnementale, la Mission régionale d’autorité environnementale1 (MRAe) Grand Est, du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a été saisie pour avis par le préfet de la Meuse (DDT 55). Le dossier ayant été reçu complet, il en a été accusé réception le 14 février 2018 au préfet de la Meuse (DDT 55).