Les Communes Contribuent À L'émergence De Filières Agricoles
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Benin• Floods Rapport De Situation #13 13 Au 30 Décembre 2010
Benin• Floods Rapport de Situation #13 13 au 30 décembre 2010 Ce rapport a été publié par UNOCHA Bénin. Il couvre la période du 13 au 30 Décembre. I. Evénements clés Le PDNA Team a organisé un atelier de consolidation et de finalisation des rapports sectoriels Le Gouvernement de la République d’Israël a fait don d’un lot de médicaments aux sinistrés des inondations La révision des fiches de projets du EHAP a démarré dans tous les clusters L’Organisation Ouest Africaine de la Santé à fait don d’un chèque de 25 millions de Francs CFA pour venir en aide aux sinistrés des inondations au Bénin L’ONG béninoise ALCRER a fait don de 500.000 F CFA pour venir en aide aux sinistrés des inondations 4 nouveaux cas de choléra ont été détectés à Cotonou II. Contexte Les eaux se retirent de plus en plus et les populations sinistrés manifestent de moins en moins le besoin d’installation sur les sites de déplacés. Ceux qui retournent dans leurs maisons expriment des besoins de tentes individuelles à installer près de leurs habitations ; une demande appuyée par les autorités locales. La veille sanitaire post inondation se poursuit, mais elle est handicapée par la grève du personnel de santé et les lots de médicaments pré positionnés par le cluster Santé n’arrivent pas à atteindre les bénéficiaires. Des brigades sanitaires sont provisoirement mises en place pour faire face à cette situation. La révision des projets de l’EHAP est en cours dans les 8 clusters et le Post Disaster Needs Assessment Team est en train de finaliser les rapports sectoriels des missions d’évaluation sur le terrain dans le cadre de l’élaboration du plan de relèvement. -

Monographie Des Communes Des Départements Du Mono Et Du Couffo
Spatialisation des cibles prioritaires des ODD au Bénin : Monographie des communes des départements du Mono et du Couffo Note synthèse sur l’actualisation du diagnostic et la priorisation des cibles des communes Une initiative de : Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Objectifs de Développement Durable (DGCS-ODD) Avec l’appui financier de : Programme d’appui à la Décentralisation et Projet d’Appui aux Stratégies de Développement au Développement Communal (PDDC / GIZ) (PASD / PNUD) Fonds des Nations unies pour l'enfance Fonds des Nations unies pour la population (UNICEF) (UNFPA) Et l’appui technique du Cabinet Cosinus Conseils Note synthèse réalisée dans le cadre de la mission mise en œuvre par le cabinet Cosinus Conseils Sarl Tables des matières Sigles et abréviations ............................................................................................................................................ 3 1.1. BREF APERÇU SUR LE DEPARTEMENT ....................................................................................................... 4 1.1.1. INFORMATIONS SUR LES DEPARTEMENTS MONO-COUFFO .................................................................................... 4 1.1.1.1. Aperçu du département du Mono ........................................................................................................... 4 1.1.1.1.2. Aperçu du département du Couffo ................................................................................................. 5 1.1.2. RESUME DES INFORMATIONS SUR LE DIAGNOSTIC -

République Du Bénin Ministère De L'eau Et Des Mines (MEM) Société Nationale Des Eaux Du Bénin (SONEB)
République du Bénin Ministère de l'Eau et des Mines (MEM) Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) Étude de collecte de données pour le développement des eaux souterraines et l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau dans les départements de Couffo et Plateau en République du Bénin Rapport Final Avril 2018 Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) Sanyu Consultants Inc. GE JR 18-047 Table des Matières Carte de localisation de la zone cible du Projet Table des Matières Liste des Tableaux et Figures/Abréviations/Taux de change CHAPTER 1 Présentation de l’Étude ............................................................................................... 1-1 1.1 Contexte et objectifs de l’Étude ........................................................................................... 1-1 1.2 Calendrier de l’étude .............................................................................................................. 1-1 CHAPTER 2 Présentation du secteur de l’eau Bénin .................................................................. 2-1 2.1 Plan de niveau supérieur dans le secteur de l’eau ............................................................ 2-1 2.2 Organisation du secteur de l’eau .......................................................................................... 2-1 2.3 Orientations de la coopération financière du Japon ......................................................... 2-4 2.4 Projets des autres bailleurs de fonds et organismes de coopération ............................. 2-5 CHAPTER -

Partner Country Coverage
IMaD’s Lessons Learned Luis Benavente MD, MS CORE’s webinar August 29, 2012 Insert title here Country Number of health Health workers trained in topics related to malaria diagnosis as of June 2012 total N facility visits trained Baseline Outreach How to TOT and On-the- job Database National External Malaria all assesmt. of training & perform supervi- training data entry, Malaria competency micros- Diagnostic support laboratory sors during mainte- Slide sets, assess- copy and capabilities supervision assessments OTSS OTSS nance NAMS ments RDTs Angola 5 6 2 18 12 0 0 12 26 70 Benin 11 409 2 30 1671 9 0 0 40 1,752 Burundi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DR Congo 0 0 0 23 0 0 0 0 74 97 Ethiopia 4 0 4 0 0 0 13 17 0 34 Ghana 37 1109 37 46 3704 10 10 6 40 3,853 Guinea Con. 11 0 11 0 0 0 0 0 20 31 Kenya 1192 52 1192 66 312 0 0 37 67 1,674 Liberia 8 200 8 35 975 11 0 7 141 1,177 Madagascar 50 31 50 18 18 0 0 0 23 109 Malawi 14 521 14 75 1132 3 0 0 64 1,288 Mali 5 172 5 24 1188 4 0 0 40 1,261 Nigeria 40 0 0 0 0 0 0 26 0 26 Zambia 6 278 6 12 1733 5 0 9 92 1,857 Total 1,401 2,778 1,331 347 10,745 42 23 114 627 13,229 Proportion of febrile episodes caused by Plasmodium falciparum Source: d’Acremont V, Malaria Journal, 2010 Better testing is needed to assess the impact of malaria control interventions Parasitemia prevalence after IRS, countries with at least biennial monitoring 80% Namibia-C Zimbabwe Moz-Maputo 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 CORE’s Surviving Malaria Pathway ITNs - Bednet use Caretaker recognizes -

The Benin Case Béatrice Lalinon Gbado Editio
Date : 28/07/2008 What challenges has your library faced? How did you respond? The Benin case Béatrice Lalinon Gbado Editions Ruisseaux d’Afrique, Parakou Library Benin Translated by : VIVIANA QUINONES La Joie par les Livres - Centre national de la literature pour la jeunesse Paris, France) Meeting: 155. Libraries for Children and Young Adults Section de bibliothèques pour enfants et jeunes de l’IFLA Simultaneous Interpretation: Not available WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 74TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL 10-14 August 2008, Québec, Canada http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm I - Introduction I am Beatrice Lalinon GBADO. writer for children and young people, I am the founder of the publishing house Ruisseaux d’Afrique, and initiator of SELIBEJ: Beninese week for children's books. This paper was prepared in link with Ms. MORA of the Departmental Library of Parakou, the northern capital of Benin ; it describes ten years of activities programmed for children and young people in our library network. II The problem : A dying library network II.1 The absence of African books for children When I was a child, I read in a rather modest environment, third-, fourth- and fifth-hand books, public library books, books borrowed from the school case, books, bits of books, written words... I have read a lot. Books coming from elsewhere, there to tell us the life and dreams of others. I am always fascinated by the beauty of literature; I love literature. In my own personal balance, there were also the evenings, around an elder : the school of moonlight, in the joy and drunkenness of fables, the school of African wisdom, of myths, tales and legends. -

Développement Économique Local
Bonnes pratiques des communes béninoises 2014 Développement Économique Local Les communes s’engagent pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 2ème Cycle de benchmarking CERCLES DE BENCHMARKING 2014 1 DOGBO DOGBO GUICHET UNIQUE INNOVATION SÉCURITÉ FINANCIÈRES KANDI L’affermaGE MODE DE GESTION MARCHÉ CENTRAL KARIMAMA POISSON MISE EN DÉFENS DES MARES SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DJAKOTOMEY JARDINS FAMILIAUX LA SUFFISANCE ALIMENTAIRE APLAHOUE SÉDENTARISATION JEUNES AGRICULTURE ENTREPRENARIATA GRICOLE EMPLOIST OVIKLIN LES FEMMES LA COMMERCIALISATION GARI SUPER DOGBO DOGBO GUICHET UNIQUE INNOVATION SÉCURITÉ FINANCIÈRES KANDI L’affermaGE MODE DE GESTION MARCHÉ CENTRAL KARIMAMA POISSON MISE EN DÉFENS DES MARES SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DJAKOTOMEY JARDINS FAMILIAUX LA SUFFISANCE ALIMENTAIRE APLAHOUE SÉDENTARISATION JEUNES AGRICULTURE ENTREPRENARIAT AGRICOLE EMPLOIS TOVIKLIN LES FEMMES LA COMMERCIALISATION GARI SUPER DOGBO DOGBO GUICHET UNIQUE INNOVATION SÉCURITÉ FINANCIÈRES KANDI L’affermaGE MODE DE GESTION MARCHÉ CENTRAL KARIMAMA POISSON MISE EN DÉFENS DES MARES SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DJAKOTOMEY JARDINS FAMILIAUX LA SUFFISANCE ALIMENTAIRE APLAHOUE SÉDENTARISATION JEUNES AGRICULTURE ENTREPRENARIAT AGRICOLE EMPLOIS TOVIKLIN LES FEMMES LA COMMERCIALISATION GARI SUPER DOGBO DOGBO GUICHET UNIQUE INNOVATION SÉCURITÉ FINANCIÈRES KANDI L’affermaGE MODE DE GESTION MARCHÉ CENTRAL KARIMAMA POISSON MISE EN DÉFENS DES MARES SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DJAKOTOMEY JARDINS FAMILIAUX LA SUFFISANCE ALIMENTAIRE APLAHOUE SÉDENTARISATION JEUNES AGRICULTURE ENTREPRENARIAT AGRICOLE -

Benin Private Health Sector Census
BENIN PRIVATE HEALTH SECTOR CENSUS December 2014 This document was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Andrew Carmona, Sean Callahan, and Kathryn Banke for the Strengthening Health Outcomes through the Private Sector (SHOPS) project. Recommended Citation: Carmona, Andrew, Sean Callahan, and Kathryn Banke. 2014. Benin Private Health Sector Census. Bethesda, MD: Strengthening Health Outcomes through the Private Sector Project, Abt Associates Inc. Download copies of SHOPS publications at: www.shopsproject.org Cooperative Agreement: GPO-A-00-09-00007-00 Submitted to: Ricardo Missihoun Commodities and Logistics Specialist United States Agency for International Development/Benin Marguerite Farrell, AOR Bureau of Global Health Global Health/Population and Reproductive Health/Service Delivery Improvement United States Agency for International Development Abt Associates Inc. 4550 Montgomery Avenue, Suite 800 North Bethesda, MD 20814 Tel: 301.347.5000 Fax: 301.913.9061 www.abtassociates.com In collaboration with: Banyan Global Jhpiego Marie Stopes International Monitor Group O’Hanlon Health Consulting BENIN PRIVATE HEALTH SECTOR CENSUS DISCLAIMER The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. TABLE OF CONTENTS Acronyms ........................................................................................................................... vi Acknowledgements -

Declaration and Birth Registration in Benin: a Promising Experience in Dogbo Municipality
MOJ Public Health Case Report Open Access Declaration and birth registration in Benin: a promising experience in Dogbo municipality Abstract Volume 8 Issue 5 - 2019 One of the insidious forms of social inequality suffered by a third of children born around David S Houéto,1 Graziella Ghesquière,2 the world is the lack of registration of their birth. A situation that is more worrying in André N’Ouémou2 developing countries, including Benin. To address this situation, Dogbo municipal 1School of Public Health, University of Parakou, Benin administration has initiated a collaborative approach involving all stakeholders in order to 2Belgian Agency of International Development, Benin take control of its development. The present study carried out a documentary review and the experience of Dogbo Municipality in birth registration. Actors were interviewed on Correspondence: David S Houéto, School of Public the basis of an expert choice taking into account the main factors involved in the process Health, University of Parakou, BP 123 Parakou, Benin, Tel of birth registration and other civil status facts ranging from the municipal administration +22997277515, Email to the village level with the concept of saturation. From the first year of intervention, all births of the municipality are declared and registered. Withdrawal of birth certificates was Received: August 28, 2019 | Published: September 13, 2019 carried out at a rate of 58.10% over the period considered. Death registration, on the other hand, increased gradually from 85 in the first year to 159 in the four–year interval. The process thus set in motion makes it possible to move to a phase of systematic registration of births and deaths with the prospect of extending it to other vital events. -

Cahier Des Villages Et Quartiers De Ville Du Departement Du Couffo (Rgph-4, 2013)
REPUBLIQUE DU BENIN &&&&&&&&&& MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT &&&&&&&&&& INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) &&&&&&&&&& CAHIER DES VILLAGES ET QUARTIERS DE VILLE DU DEPARTEMENT DU COUFFO (RGPH-4, 2013) Août 2016 REPUBLIQUE DU BENIN &&&&&&&&&& MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) &&&&&&&&&& CAHIER DES VILLAGES ET QUARTIERS DE VILLE DU DEPARTEMENT DU COUFFO Août 2016 Prescrit par relevé N°09/PR/SGG/REL du 17 mars 2011, la quatrième édition du Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Bénin s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire national en mai 2013. Plusieurs activités ont concouru à sa réalisation, parmi lesquelles la cartographie censitaire. En effet, la cartographie censitaire à l’appui du recensement a consisté à découper tout le territoire national en de petites portions appelées Zones de Dénombrement (ZD). Au cours de la cartographie, des informations ont été collectées sur la disponibilité ou non des infrastructures de santé, d’éducation, d’adduction d’eau etc…dans les villages/quartiers de ville. Le présent document donne des informations détaillées jusqu’au niveau des villages et quartiers de ville, par arrondissement et commune. Il renseigne sur les effectifs de population, le nombre de ménage, la taille moyenne des ménages, la population agricole, les effectifs de population de certains âges spécifiques et des informations sur la disponibilité des infrastructures communautaires. Il convient de souligner que le point fait sur les centres de santé et les écoles n’intègre pas les centres de santé privés, et les confessionnels, ainsi que les écoles privées ou de type confessionnel. -

World Bank Document
Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized Report No: ICR00005058 IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT 5392-BJ ON A CREDIT Public Disclosure Authorized IN THE AMOUNT OF SDR 22.9 MILLION (US$35 MILLION EQUIVALENT) TO THE REPUBLIC OF BENIN FOR A BENIN YOUTH EMPLOYMENT PROJECT Public Disclosure Authorized Dec 24, 2019 Social Protection and Labor Global Practice Africa Region Public Disclosure Authorized This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective Dec 24, 2019) Currency Unit = CFA Franc (XOF) XOF 1 = US$0.0017 US$ 1 = SDR 0.73 FISCAL YEAR July 1 - June 30 ABBREVIATIONS AND ACRONYMS ACE Agent Communal d’Emploi (Employment Agent) ACV Atelier de Compétence de Vie (Life skills Training) ANPE Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi (National Employment Agency) AQP Attestation de Qualification Professionnelle (Certificate of Professional Qualification) BAA Bureau d’Appui aux Artisans (Office of Support to Artisans) BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Central Bank of West African States) CESAM Centre de Suivi, d’Assistance, et de Management (A lead Training and Capacity Development Firm in Cotonou/Benin) CFP Centre de Formation Professionnelle (Vocational Training Center) CLR Completion and Learning Review by IEG of a PLR for a concluded CPF/CPS CPF Country Partnership Framework -
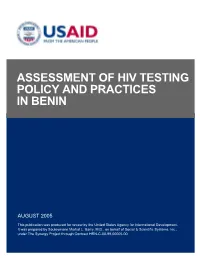
Assessment of Hiv Testing Policy and Practices in Benin
ASSESSMENT OF HIV TESTING POLICY AND PRACTICES IN BENIN AUGUST 2005 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Souleymane Martial L. Barry, M.D., on behalf of Social & Scientific Systems, Inc., under The Synergy Project through Contract HRN-C-00-99-00005-00. Bureau for Global Health Office of HIV/AIDS United States Agency for International Development 1300 Pennsylvania Ave., NW Washington, DC 20523 ASSESSMENT OF HIV TESTING POLICY AND PRACTICES IN BENIN The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. CONTENTS ABBREVIATIONS AND ACRONYMS ...................................................vii EXECUTIVE SUMMARY....................................................................... ix BACKGROUND......................................................................................1 HIV/AIDS SITUATION .........................................................................1 HIV/AIDS TESTING IN THE WEST AFRICA SUB-REGION...............3 METHODOLOGY ................................................................................4 KEY FINDINGS ......................................................................................4 DEVELOPMENT OF POLICIES, NORMS, STANDARDS, AND PROTOCOLS ...................................................................................4 AVAILABILITY OF PMTCT, VCT, AND ARV SERVICES ...................5 COMMUNITY -

Benin-Projet PRESREDI-Resume EIES-03 2017.Docx
PROJECT : RESTRUCTURING AND EXTENSION PROJECT FOR THE SBEE DISPATCHING AND DISTRIBUTION SYSTEM (PRESRDI) COUNTRY : BENIN SUMMARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Chef d’équipe D. IBRAHIME, Analyste Financier RDGN1 2549 A. MOUSSA, Ingénieur électricien RDGN1/COMA 7335 M. KINANE, Environnementaliste Principal SNSC 2933 P.H. SANON, Spécialiste Principal en Développement SNSC 5828 Social Membres d’équipe O. OUATTARA, Expert en gestion financière RDGN1/COSN 6561 Équipe du Projet M. ANASSIDE, Expert en acquisitions COML 7228 D. NDOYE, économiste pays Bénin RDGW0 / LIBJ Chef de Division Z. AMADOU PESD2 2211 pour le secteur Directeur pour le BALDEH H. P, PESD 4026 secteur Directeur régional LITSE J. RDGW 4047 1 Project Title: Restructuring and Extension Project for the SBEE SAP Code: P-BJ-FA0-004 Dispatching and Distribution System (PRESREDI) Country : Benin Department OITC Division: ONEC-1 1. INTRODUCTION At the request of Benin’s Authorities, the African Development Bank will support the implementation of the Restructuring and Extension Project for the SBEE Dispatching and Distribution System (PRESRDI) by providing co-financing with the Japan International Cooperation Agency (JICA). This project presents a summary Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) of the project. This assessment of the project were conducted in 2016, and is in compliance with the assessment conducted in 2015 as well as an update on it. According to national regulations, the project forms part of those activities for which a comprehensive environmental and social impact assessment is required. From an environmental and social standpoint, the project is classified in Category 1 in line with AfDB’s environmental and social assessment procedures given the nature of the works to be carried out, the size and scope of the project, as well as its potential direct and indirect impacts.